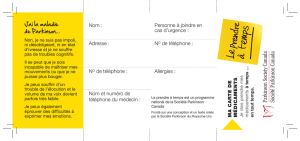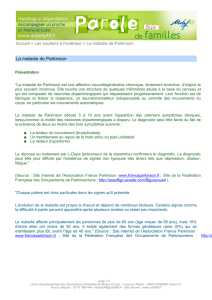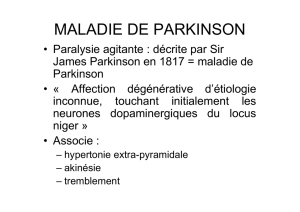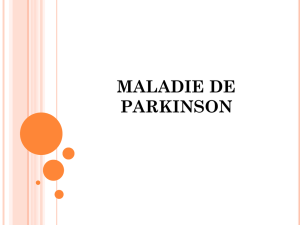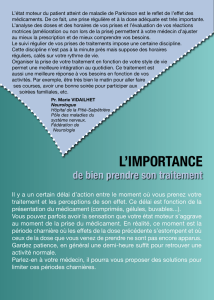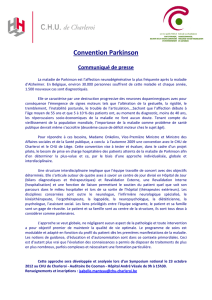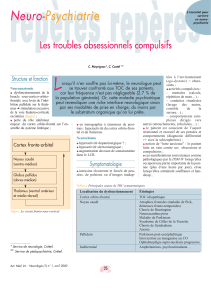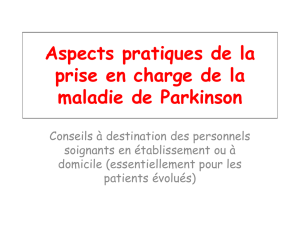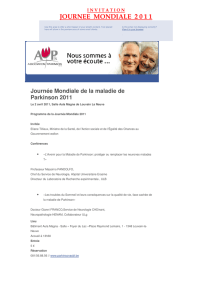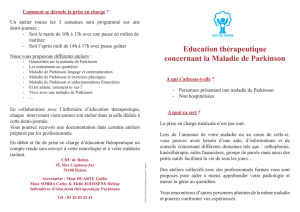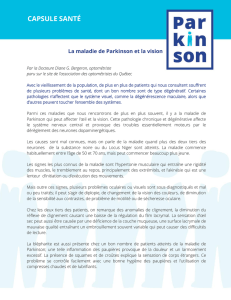G41-42, Pr. Anheim Marion Lienhard et Mariya Lilova Cours du 09

G41-42 1/19
G41-42, Pr. Anheim Marion Lienhard et Mariya Lilova
Cours du 09/11/2012 de 16 à 18h
M1 Physiopathologie
_________________________________________________________________________
Maladie de Huntington, syndromes et maladie de
Parkinson, démences héréditaires
I. MALADIE DE HUNTINGTON
A. Introduction
L’expression « Chorée de Huntington » est inexacte : la chorée (mouvement anormal
involontaire) n’est qu’un symptôme de la maladie de Huntington, ni le plus gênant ni le plus
précoce, parfois même absent dans certaines formes de la maladie.
C’est une maladie neurodégénérative qui conduit à la perte progressive des neurones du
noyau caudé (qui appartient au striatum, qui fait partie des noyaux gris centraux), et il y a
une atteinte du cortex frontal (voir plus loin).
Maladie rare, de prévalence 1-2 / 10 000.
De façon générale, elle débute entre 30 et 50 ans, mais :
- les formes juvéniles débutent dans l’enfance
- certaines formes moins sévères débutent à un âge plus avancé (70-80 ans)
Son spectre clinique est très variable, mais aboutit à un tableau de démence et de
grabatisation, et finalement au décès après 15-20 ans d’évolution.
La forme juvénile (JHD = juvenile Huntington disease) est particulièrement sévère et débute
avant 20 ans.
Par ailleurs, ils existent des HDL = Huntington disease like, des diagnostics différentiels de
la vraie maladie de Huntington.
(Le prof ne s’est pas attardé dessus, donc pour plus d’infos voir les diapos respectives)
B. Génétique (sera d’avantage développé dans le cours du Pr. Koenig)
C’est une maladie familiale à transmission autosomique dominante :
- un individu atteint a 50% de risque de la transmettre à ses descendants ;
- comme la pénétrance est complète, tous ceux qui ont la mutation développeront la
maladie tôt ou tard.
La maladie est due à une expansion de triplets CAG (au-delà de 36 triplets) au début du
gène HD (IT15) localisé en 4p16.3, qui code pour la Huntingtine.
Cette protéine est à expression ubiquitaire dans le SNC, son rôle est encore mal connu ;
dans la maladie de Huntington, on observe son accumulation toxique dans des inclusions
intra-neuronales.

G41-42 2/19
Le mécanisme physiopathologique exact est encore débattu : possible activité nucléotoxique
suite à l’accumulation de Huntingtine, ou bien c’est une sorte de protection que le noyau a
adopté face à une autre agression qu’on n’a pas encore identifiée.
C. Tests génétiques
On recherche le nombre de triplets CAG au niveau du gène HD.
1) Tests de confirmation
Plusieurs situations sont possibles:
- Le patient vient consulter et présente certains symptômes qui font suspecter la
maladie de Huntington, alors on fait le test pour confirmer l’hypothèse
- Il y a déjà une maladie héréditaire connue dans la famille
- Découverte d’une maladie héréditaire, quand l’histoire familiale n’est pas connue
(censure, adoption, fausse paternité…)
2) Tests prédictifs
Il peut s’agir de :
- Diagnostic pré-symptomatique (DPS): chez un individu majeur qui n’a pas encore
les symptômes
- Diagnostic pré-natal (DPN): chez une femme enceinte à risque de transmettre la
maladie ; on fait une amniocentèse ou une biopsie de villosités choriales ; en cas de
découverte de l’expansion de triplets, une IMG peut être envisagée.
- Diagnostic pré-implantatoire (DPI): avant l’implantation, au stage de 4-8 cellules,
on en prélève et on recherche l’expansion; si elle est absente, alors on peut
implanter l’embryon; si en revanche elle est présente, on n’implante pas, mais c’est
alors beaucoup moins traumatisant que dans le cas d’une IMG.
Statistiquement, plus la taille de
l’expansion est grande, plus l’âge de
début est précoce.
Mais pour un individu donné, on est
incapable de prédire l’âge de début.
(car des variations de la moyenne existent)

G41-42 3/19
D. Clinique
On distingue la phase initiale, précoce, souvent méconnue et négligée, et la phase
classique, celle qui est la mieux connue.
1) Pendant la phase initiale, on observe:
Peu ou pas de mouvements choréiques, mais plutôt un regard fixe, une diminution
du clignotement des yeux, des tics au niveau des sourcils
Des troubles du comportement courant : anxiété, irritabilité, désinhibition (troubles
du comportement sexuel, uriner dans la poubelle…), mauvaise hygiène, difficultés
professionnelles
Des troubles psychiatriques : anxiété majoritairement, dépression
Des troubles du sommeil : difficultés à s’endormir, réveil précoce, réveils
multiples…
Des troubles cognitifs : lenteur, difficultés de concentration...
Anosognosie : l’individu n’est pas conscient de ses troubles !
2) Une fois la phase classique est arrivée, alors on a :
Troubles du comportement (psychiatriques)
Il y a une exagération des troubles de la phase initiale : anxiété, excitation, désinhibition, ou
bien dépression, indifférence ; parfois hétéro/auto-agressivité.
Troubles cognitifs (intellectuels)
o Syndrome sous-cortico-frontal = syndrome dysexécutif
Associe atteinte du cortex frontal et/ou des noyaux gris centraux (qui sont sous-corticaux),
ce qui donne une difficulté dans la réalisation de toutes les tâches successives qui
permettent d’arriver à un but.
Par exemple, pour préparer des pâtes, on a besoin de plusieurs choses : avoir la motivation
de le faire, se lever, prendre une casserole, mettre de l’eau dedans, la mettre sur la plaque,
mettre la plaque en marche etc…
Pour réaliser toute tâche, il faut donc une certaine motivation ; il faut aussi savoir quand une
étape est finie pour pouvoir passer à la suivante (les pâtes ne seront jamais prêtes si on a
Exemple de situation classique de DPS:
Un homme de 25 ans, en bonne santé, vient consulter;
son père est atteint de la maladie de Huntington et sa
grand-mère paternelle est décédée probablement de la
même cause; il veut savoir s’il est porteur de la mutation.
Suite à un consentement éclairé, il peut accéder à un
DPS.

G41-42 4/19
oublié d’allumer le feu…) ; connaitre la succession des différentes étapes ; savoir revenir en
arrière si une étape n’est pas finie ; être capable de flexibilité (s’il n’y a plus de pâtes, alors
on prépare du riz) ; avoir le sens de la mesure (ne pas acheter 10 kg de pâtes quand il n’y
en a plus…) ; contrôler la fin d’une tâche (ne pas laisser les pâtes cuire trop longtemps)…
Toutes ces capacités sont inconscientes à l’état normal mais sont majeures et constituent
les capacités exécutives, la capacité de planifier des tâches pour arriver à un but.
Le syndrome dysexécutif est aussi présent dans la maladie de Parkinson, mais pas dans la
maladie d’Alzheimer (troubles de la mémoire, de la parole, de la réalisation de certains
gestes…)
o Apathie
Très invalidante, majeure dans les maladies de Huntington et de Parkinson : le patient est
capable sur le plan moteur de faire des choses, mais n’a pas de motivation spontanée.
Il s’agit d’une difficulté majeure pour l’entourage du malade : on a une transformation
radicale de la personnalité, de tout ce qui est propre à un individu et qui le rend unique.
Souvent confondue avec une dépression, c’est un signe qu’il faut savoir rechercher.
Anosognosie, qui devient majeure et qui est difficilement vécue par l’entourage :
non seulement le malade ne comprend pas ce qui lui arrive mais il ne comprend pas
pourquoi on l’embête, et trouve des excuses pour justifier ses actes.
Mouvements anormaux, qui peuvent être de plusieurs types :
- Chorée (du grec « danser » car les patients donnent l’impression de danser)
- C’est un mouvement anormal involontaire et sans finalité
- Il est brusque, bref et répétitif mais non rythmique, non stéréotypé
- Il est aléatoire : peut survenir au niveau de n’importe quelle(s) partie(s) du corps
- Il est présent aussi bien au repos que durant l’action, l’effort, mais disparait au le sommeil
- Il est exacerbé par l’émotion et le stress, et peut être brièvement et partiellement contrôlé
par la volonté
- Il survient sur un fond hypotonique, donc des petits mouvements peuvent prendre des
amplitudes importantes, les mouvements sont exagérés
- La marche est désordonnée (mais pas vraiment une ataxie) : difficultés dans la marche en
tandem.
- Parfois on peut observer une intégration des mouvements anormaux choréiques dans des
mouvements avec un but : par exemple le sujet fait semblant de se gratter, de se coiffer…
- Avec l’évolution de la maladie les mouvements choréiques diminuent, mais apparaissent
d’autres mouvements anormaux et de gros troubles d’adaptation de la posture, source de
chutes.
- Tics : mouvements anormaux semi-involontaires
Parfois présents au début de la maladie (clignotement des yeux, mouvements des sourcils,
flexion de la tête…)
Mais contrairement au cas de la maladie de Gilles de la Tourette, ici le patient n’arrive pas
bien à contrôler ses tics.
- Dystonie : contracture musculaire involontaire soutenue
Par exemple la dystonie cervicale = torticolis spasmodique : posture anormale + mouvement
suite à une contracture anormale du sterno-cléido-mastoïdien ;

G41-42 5/19
- Syndrome akinéto-hypertonique (=syndrome Parkinsonien) :
Soit au début de la maladie pour les formes sévères, soit avec l’évolution de la forme
standard.
- Myoclonies : secousses musculaires irrégulières
Présentes dans la forme juvénile.
Ainsi, dans la forme juvénile, on a plutôt un syndrome parkinsonien, une dystonie et des
myoclonies, et pas de mouvements choréiques.
3) Remarques sur les signes précoces
La maladie commence en moyenne 2 ans avant l’apparition de mouvements anormaux
(donc de la phase classique) par des troubles cognitifs subtils.
Ces signes précoces peuvent être détectés :
- en effet, avant d’acquérir des troubles cognitifs, on remarque déjà des petits troubles
dysexécutifs (24% des sujets porteurs) ;
- les troubles psychiatriques (dépression majeure, psychose, hallucinations…)
débutent par une simple irritabilité ;
- bien avant les troubles moteurs (chorée) on peut remarquer une bradykinésie
(lenteur) avant les mouvements involontaires ; on peut mettre en évidence cette
lenteur en faisant faire des mouvements rapides répétitifs.
4) Autres symptômes (peuvent être présents à la phase précoce/tardive)
- Atteinte de la mémoire de travail :
C’est une mémoire à court terme : on s’en sert pour mémoriser un numéro de téléphone le
temps de le noter, pour prendre des notes en cours, etc.
Elle est très sensible aux interférences (si on détourne notre attention pendant un bref
instant, on oublie le numéro de téléphone ou la phrase), donc nécessite une attention
soutenue, et c’est en partie le cortex frontal qui s’en occupe.
Elle est rapidement atteinte dans la maladie de Huntington.
- Ralentissement de la vitesse de traitement d’information :
Par exemple quelqu’un qui faisait aisément du calcul mental devient obligé de poser les
calculs, fait des fautes…
- Atteinte « exécutive » de la mémoire :
L’hippocampe est le site de localisation des informations, le disque dur sur lequel elles sont
enregistrées ;
Le cortex frontal est impliqué dans les particularités intellectuelles de l’individu, les
stratégies.
Alzheimer : on a une atteinte du cortex temporal interne et de l’hippocampe.
Huntington et Parkinson (atteintes dysexécutives) : l’hippocampe est relativement bien
préservé, donc l’étape de consolidation de l’information (son encodage dans l’hippocampe)
se fait ; mais comme le cortex frontal est atteint, il y a une atteinte de l’étape de récupération
de l’information (le cortex frontal n’arrive pas à « extraire » des informations présentes dans
l’hippocampe pour s’en servir, car pour cela il faut utiliser une stratégie).
Mais comme l’information est tout de même présente quelque part dans le cerveau, on peut
finir par réussir à la retrouver.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%