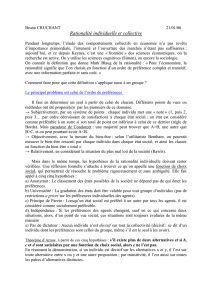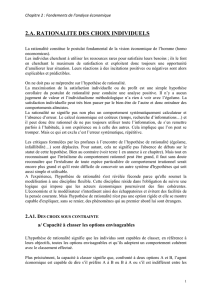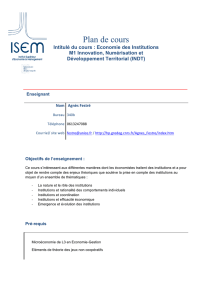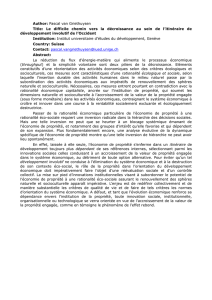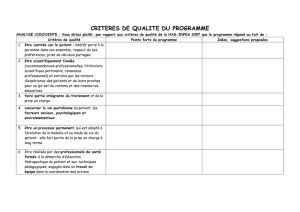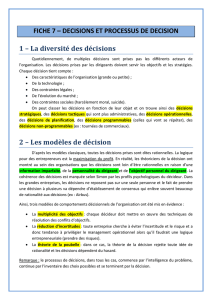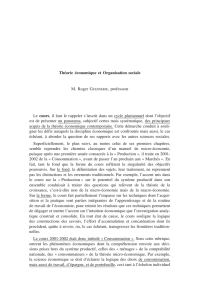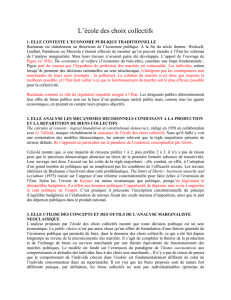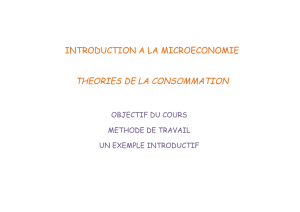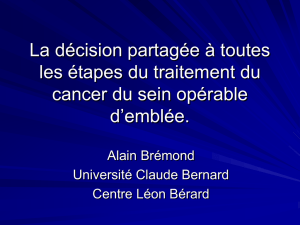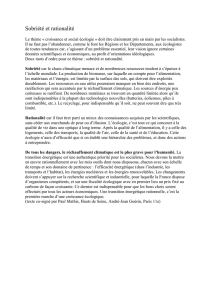L`État vu par les économistes - Direction Générale du Trésor

1
L’ETAT VU PAR LES ECONOMISTES
Lino GALIANA
lino.galiana@ens-lyon.fr
Rapport de stage au sein de la Direction Générale du Trésor écrit en
partenariat avec Martine Perbet, rédacteur en chef des Cahiers de
l’Evaluation. Tous nos remerciements à Nicolas Treich de TSE pour la
relecture de ce rapport.
(Version du 16 octobre en vue de publication sur le site des Cahiers de l’évaluation)
Juin-Août 2014
lino.galiana@ens-lyon.fr

2
SOMMAIRE
SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 2
1 L’entrée de l’Etat dans la science économique ..................................................................... 3
2 L’économie néoclassique ........................................................................................................ 3
3 La nouvelle économie ouvre la « boîte noire » de l’Etat ...................................................... 5
3.1 En amont, la représentation démocratique ................................................................... 7
3.2 En aval la production de biens publics ........................................................................ 15
4 L’Etat comme organisation .................................................................................................. 17
4.1 Ecueil premier pour la décision rationnelle : l’opportunisme…. .............................. 18
4.2 …. mais il y en a d’autres liés au design organisationnel ........................................... 20
5 Conclusion.............................................................................................................................. 22

3
1 L’entrée de l’Etat dans la science économique
« Les institutions sont les règles du jeu, dans une société, ou, plus formellement, sont les contraintes
d’origine humaine qui encadrent l’interaction humaine. En conséquence elles structurent les
incitations dans l’échange humain, qu’il soit politique, social ou économique.»
(Douglass North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance)
L’analyse économique de l’Etat est un fait récent dans l’histoire de la pensée économique.
Les économistes classiques, à l’exception d’Adam Smith, avaient tendance à négliger le traitement
des institutions. La fonction économique de l’Etat et les conséquences (bénéfiques comme néfastes)
de ses actions sur l’économie étaient absentes de leurs discours, à l’exception des débats sur le
protectionnisme. Le laissez-faire en politique économique intérieure comme extérieure leur
apparaissait comme étant un état normal et désirable. Dans un premier temps, les néoclassiques
(Walras, Marshall…) n’ont pas non plus étudié ces questions, préférant analyser seulement le
fonctionnement du marché.
Ce n’est que la seconde génération de néoclassiques qui a étudié le rôle de l’Etat en présence
de défaillances de marché (market failures), situations où le marché aboutit à une allocation sous-
optimale des ressources
1
. Arthur Pigou
2
, élève de Marshall, et rival de Keynes, est le premier à
avoir construit un raisonnement systématique justifiant l’intervention de l’Etat à partir d’arguments
microéconomiques (ceux-ci diffèrent largement des justifications macroéconomiques de Keynes ou
de Musgrave). Le modèle canonique de Pigou est repris par de nombreux auteurs, dont le plus
célèbre est Samuelson, et par des travaux tels que ceux de Garett Hardin sur la « tragédie des
communs »
3
.
2 L’économie néoclassique
1
Cette définition est postérieure à celle de Pigou puisqu’elle implique de connaître le premier théorème fondamentale de l’économie du bien-être
qui énonce que tout équilibre concurrentiel, en l’absence de défaillances de marché, est Pareto-optimal, cf. Kenneth J. Arrow et Gérard Debreu,
« The Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy », Econometrica (1954)
2
Arthur Pigou, The Economics of Welfare¸ Macmillan, 1920
3
Garett Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, 1968
PIGOU
L’Etat, informé et bienveillant, connaît les préférences collectives et
produit des biens publics qui leurs sont conformes

4
C’est Pigou qui énonce ce résultat classique selon lequel lorsqu’un marché est caractérisé
par des externalités (i.e. que les actions d’un agent provoquent une perte de bien-être pour d’autres
agents), alors l’Etat est fondé à intervenir, son action pouvant prendre différentes formes
(réglementation, taxe sur le pollueur, etc.). Comme les marchés imparfaits sont la règle plutôt que
l’exception, Pigou fournit un cadre d’analyse qui donne à l’Etat un rôle de premier plan dans le
système économique.
Le processus de production de biens publics
Les continuateurs de Pigou ont repris ses hypothèses : information parfaite, capacité
illimitée à traiter l’information, ces deux hypothèses étant le fondement de la rationalité
substantielle, celle de l’homo oeconomicus traditionnel (cf. encadré sur la rationalité). A ces deux
hypothèses s’ajoute le postulat d’un Etat bienveillant, c’est-à-dire qui cherche à maximiser le bien-
être collectif (qu’il connaît puisque l’information est parfaite). Dans cette école de pensée, appelée
« microéconomie classique », le partage entre le marché (coordination privée) et l’Etat
BIENS PUBLICS

5
(coordination publique) est évident : l’Etat prend en charge les activités où la concurrence n’aboutit
pas à un résultat optimal
4
.
Le processus de production de biens publics – que ce soit une infrastructure ou une
réglementation – se déroule en quatre étapes :
1. Les agents ont des préférences individuelles (les préférences de l’agent i sont notées ).
2. Le mécanisme du vote permet d’agréger les préférences individuelles en une préférence
collective tout comme le mécanisme du marché permet d’agréger les
préférences en une fonction de demande. Cette préférence collective – ou le résultat du
vote – représente la demande en biens publics.
3. Les lois votées détaillent l’offre de biens publics correspondant à cette demande.
4. Les biens publics se matérialisent dans la sphère sociétale grâce au travail de
l’administration. Celle-ci écrit la législation secondaire (décrets d’application des lois) et
concourt directement ou indirectement à la production de biens publics (contrôle,
sanction….).
Dans un processus stylisé tel que celui décrit par Pigou et ses disciples, ces étapes
s’enchainent sans frottement (carré bleu de la figure page précédente) et les biens publics produits
(y) sont parfaitement cohérents avec les préférences exprimées par le vote :
3 La nouvelle économie ouvre la « boîte noire » de l’Etat
Malgré son succès, ce modèle a subi de nombreuses critiques qui s’accordent pour en souligner
la naïveté. Il est en effet probable, puisque le processus de production d’un bien public convoque de
nombreux intermédiaires, que des distorsions soient introduites tout au long de ce processus qui
transforme n préférences individuelles (input) en un unique bien public (output).
Les nouveaux économistes ouvrent la « boîte noire » de l’Etat. Ils ne le considèrent plus comme
une entité abstraite, omnisciente, bienveillante et omnipotente, mais s’intéressent à ses
vulnérabilités qui peuvent introduire des biais dans la production de biens publics. Ses
vulnérabilités sont discernables tant du côté de la représentation démocratique que du côté de l’offre
4
Equilibre dit de Bowen-Lindhal-Samuelson du nom des trois auteurs ayant exhibé ce principe dans leurs travaux, cf. Bernard Salanié,
Microéconomie : les défaillances de marché. Economica (2000)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%