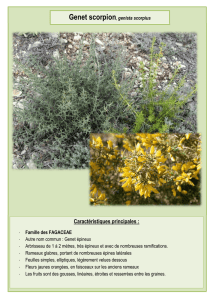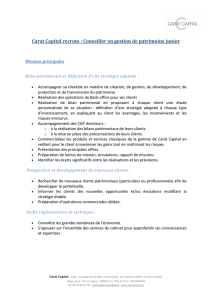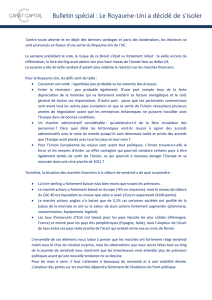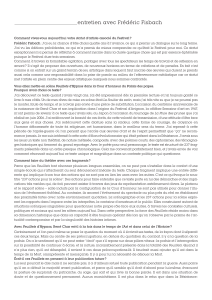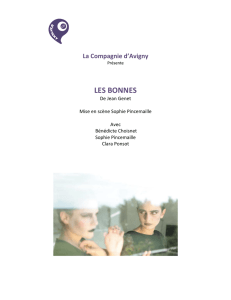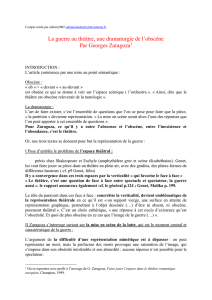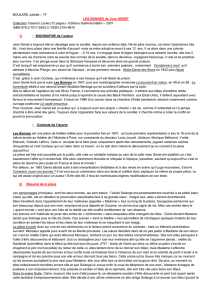Le théâtre de Jean Genet

LE THÉÂTRE DE JEAN GENET
Glorification destructrice de l’Image et du Reflet
Geir Uvsløkk
Hovedoppgave i fransk, høsten 2002
Klassisk og romansk institutt
Veileder : Solveig Schult Ulriksen

Sans le suivi attentif et les conseils précieux et précis de ma directrice d’étude,
Madame Solveig Schult Ulriksen,
ainsi que les encouragements et les conseils tout aussi précieux et précis de ma compagne,
Mademoiselle Julie Casoli,
cette étude n’aurait jamais vu la lumière du jour.
Qu’elles reçoivent ici l’expression de ma très profonde gratitude.
Un grand merci aussi à ma chère amie Mademoiselle Trude Kolderup, qui a eu la gentillesse
de lire le manuscrit à son état final. Son œil critique a été d’une aide considérable.
Merci, finalement, aussi à Monsieur Jean Gitenet, dont l’amabilité et les idées perspicaces ont
été de grandes sources d’inspiration. Il en va de même, bien évidemment, pour tous les autres
participants au colloque Jean Genet à Cerisy-la-Salle l’été 2000.
2

À ma Jue
3

TABLE DES MATIÈRES
Introduction ........................................................................................................... 5
PREMIÈRE PARTIE – BASES
Chapitre I – Initiation à l’œuvre et à la vie de Jean Genet.................................. 10
1. Une « détérioration psychologique » ............................................................................... 10
2. Œuvre de son temps et œuvre à part ................................................................................ 16
Chapitre II – Genet critique et critique genétienne............................................. 22
1. Univers réel et univers esthétique .................................................................................... 25
2. Une « identité universelle à tous les hommes » .............................................................. 31
3. Le vide de la beauté ou la beauté du vide ........................................................................ 38
DEUXIÈME PARTIE – LECTURES
Chapitre III – Le Balcon...................................................................................... 45
1. Le bal « con »................................................................................................................... 47
2. L’Évêque .......................................................................................................................... 62
Chapitre IV – « Elle » ......................................................................................... 71
Chapitre V – Les Paravents ................................................................................ 83
1. Se révolter contre la révolution ........................................................................................ 88
2. Warda ............................................................................................................................... 95
Bilan .................................................................................................................. 101
Bibliographie..................................................................................................... 106
4

Introduction
Déconcertant – mot qui semble bien caractériser Jean Genet. Il en va de même pour son
théâtre. La contradiction, le mensonge, l’inconstance et la trahison s’inscrivent à la fois dans
sa vie et dans son œuvre. Quiconque plonge dans son monde (que ce soit le monde réel ou
l’univers esthétique et imaginaire de ses textes) se retrouve dans une sorte de spirale du vide
(cf. Gitenet 1999a : 171-176) où les points fixes sont difficiles à repérer. Genet semble
délibérément dérouter ses lecteurs, tout comme il déséquilibra ses connaissances dans le
monde réel : l’histoire de sa vie, quoique apparemment exposée dans ses premiers ouvrages
et, ce dernier temps, illuminée par de nombreux biographes (v. notre bibliographie), reste
obscure ; son œuvre, quoique largement commentée et interprétée dès les premiers livres1,
demeure énigmatique.
Lors des dernières répétitions de la pièce Le Balcon pour la création à Londres (Arts
Theatre Club) en 1957, Genet – présent pour la première fois, et outragé par l’interprétation
du metteur en scène Peter Zadek – manifeste hautement son mécontentement. Deux jours plus
tard, le 22 avril, l’auteur fait scandale : il interrompt la première de la pièce, s’assied au milieu
de la scène et exige que le spectacle soit annulé. Les représentations ne seront cependant pas
supprimées : c’est Genet qui, après intervention de la police anglaise, n’aura plus le droit d’y
assister (cf. Plunka 1992 : 190-191).
Cette intervention furieuse de la part de l’auteur nous montre combien il tenait à ce que ce
soit sa version qui soit présentée aux spectateurs, et non celle du metteur en scène. Les
1 Moins, il est vrai, que celles de certains de ses contemporains, mais le nombre de commentaires critiques est
tout de même important.
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
1
/
110
100%