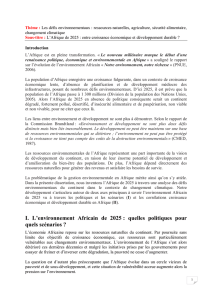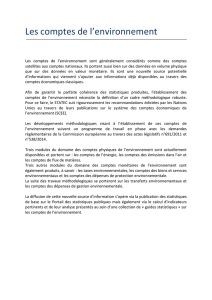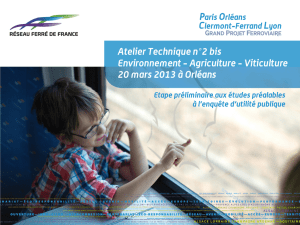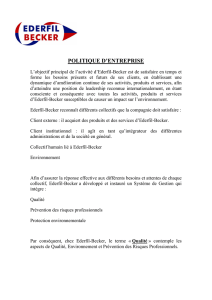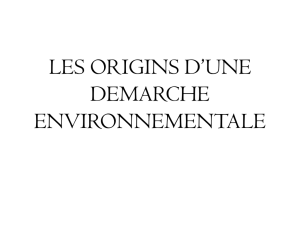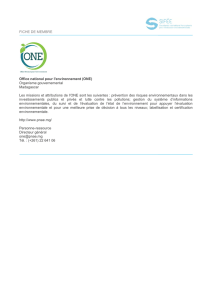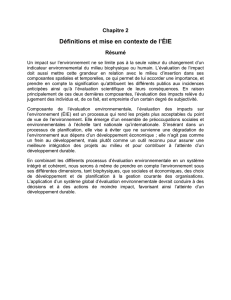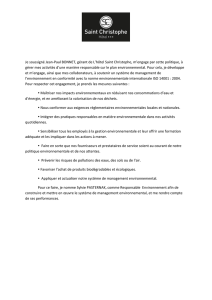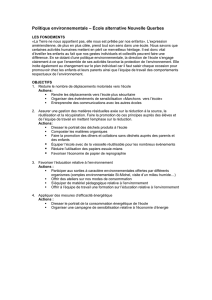Agriculture, environnement et territoires

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE
Prospective de l’environnement aquatique en Seine-Normandie
Quelle image tendancielle, quels facteurs de changement ?
Paris, 14 décembre 2006
Agriculture, environnement et territoires - 4 scénarios à 2025 :
Quels enseignements
pour les acteurs de l’eau de Seine-Normandie ?
Xavier Poux, AScA
8 rue Legouvé – 75010 – xavie[email protected]
Au début de l’année 2004, les ministères en charge de l’agriculture et de l’environnement
associés au CNASEA ont lancé un exercice de prospective sur le thème des relations
agriculture et environnement. Cette démarche était motivée par le constat d’une absence de
visions formalisées sur ce sujet précis alors même que chacun pressent que la régulation
des relations entre agriculture et environnement sera un enjeu majeur tant pour l’avenir des
politiques agricoles que pour celui des politiques d’environnement (politique de l’eau,
biodiversité,…). Au total, pour aller plus loin que des entrées « instrumentales » et/ou
techniques sur la question (les mesures agri-environnementales, l’agriculture raisonnée,…)
qui dominent actuellement le débat, il était jugé nécessaire de replacer la gestion de
l’environnement par l’agriculture dans un cadre d’analyse plus large.
À l’invite des commanditaires de la démarche, un groupe de travail ad hoc, intitulé « groupe
de la Bussière », impliquant des chercheurs, professionnels agricoles et représentants
d’associations environnementales et de consommateurs, présidé par Philippe Lacombe
(INRA), a été constitué pour traiter de la problématique de la régulation des relations
agriculture et environnement à long terme. AScA a été en charge de la conception et de
l’animation méthodologique et de la mise en forme des résultats. Un ouvrage paru à la
Documentation Française en 2006 rend compte de l’ensemble des travaux et, en particulier,
détaille les quatre scénarios élaborés par le groupe de la Bussière (cf. encadré).
Si l’analyse était conduite au niveau national, avec les spécificités que cela suppose dans la
manière de poser les enjeux et les problèmes, notamment en terme de « gouvernance »
d’un domaine qui reste très structuré à ce niveau, la problématique générale posée dans
l’exercice fait écho pour les acteurs de l’eau du bassin Seine Normandie. Plus précisément :
comment dépasser une prise en charge actuelle des enjeux environnementaux qui reste très
soumise à un modèle technique, professionnel et politique hérité du mode de gestion de
l’agriculture mis en place dans les années 1960 ? À l’heure où l’ensemble des observateurs
— ceux du groupe de la Bussière et au-delà — s’accordent pour anticiper des ruptures dans
ce domaine, il apparaît plus qu’opportun de replacer la problématique d’intervention dans le
domaine de l’eau en lien avec l’agriculture pour anticiper des évolutions plausibles qui en
affecteront les tenants et les aboutissants.
De manière très synthétique, on soulignera les particularités du bassin vis-à-vis des
déterminants d’évolution à l’œuvre dans les scénarios. Sur le plan agricole, le bassin est
engagé majoritairement dans un modèle très productif fondé sur les grandes cultures, avec
des avantages comparatifs européens voire mondiaux marqués. Les tendances lourdes
tendancielles vont plutôt dans le sens d’un renforcement de ce modèle. Sur le plan social et
territorial, les déterminants sont ambivalents avec d’un côté une métropole porteuse d’une
demande sociale associée à la préservation d’espaces agricoles multifonctionnels et la
production d’une nourriture de qualité, minimisant les risques sur la santé. De l’autre côté, le
bassin est plutôt caractérisé par une faible densité de population rurale et, partant, un
investissement social local « diffus », peu susceptible de rentrer en conflit avec le modèle
agricole.
1

Au total, la situation sur le bassin est de nature à exacerber les tensions et les conflits à
l’œuvre dans chacun des scénarios, avec des enjeux et des positionnements stratégiques
pour les acteurs de l’eau qui varient significativement d’un scénario à l’autre.
Encadré : présentation synthétique des scénarios
Les quatre scénarios élaborés dans le cadre des travaux du groupe de la Bussière ont été construits
en faisant des hypothèses contrastées sur les trois dimensions suivantes :
• comment s’exprime en 2025 la demande sociale d’environnement (sur quel thème, par quel réseau
d’acteurs, à quel niveau géographique), et comment se traduit-elle en une régulation
environnementale ?
• quel est le modèle agricole dominant en 2025 ?
• quelle est la logique d’usage de l’espace en 2025 ?
Le premier scénario, « La France des filières, l’environnement agro-efficace » décrit une
situation où la priorité assignée à l’agriculture française, dans un contexte de compétitivité
économique accru, est de conserver son rang comme leader agro-industriel en Europe. L’agriculture
est fortement intégrée dans un système agro-alimentaire dont les normes s’imposent aux
producteurs. La demande environnementale s’exprime via les organisations de consommateurs,
préoccupés par une garantie de sécurité sanitaire et alimentaire. Un cadre réglementaire fixe des
objectifs pragmatiques concentrés sur la qualité des produits et sur les ressources en eau. Il s’en suit
une adaptation essentiellement technologique aux problèmes environnementaux, axée sur une prise
en charge des flux de polluants alors que, dans le même temps, les pressions sur l’espace
s’accroissent. Le développement de agrocarburants à large échelle exprime le plus nettement l’offre
environnementale émanant de l’agriculture. Dans ce scénario, les contributions positives de
l’agriculture en termes de paysage et de biodiversité ne viennent que lorsque les produits agricoles
portés par les filières peuvent valoriser une image environnementale. On s’oriente plutôt vers la
constitution de petites « réserves » (zones Natura 2030) perdues dans un océan de médiocrité
environnementale. Il peut en découler des conflits latents, portés par les « perdants » de ce scénario :
les environnementalistes – voire les distributeurs d’eau - qui exigent mieux qu’un environnement
« aux normes ».
Pour gérer cette tension entre recherche de productivité et environnement, le deuxième scénario :
« L’agriculture duale : une partition environnementale » envisage qu’en 2025 la séparation
entre agriculture productive et agriculture générant des impacts environnementaux positifs est
assumée pour conserver les deux ‘modèles’. Cette séparation se traduit dans tout l’espace européen
et particulièrement en France. Mais la coexistence de ces deux types d’agriculture ne se fait pas
spontanément : elle repose sur des politiques publiques et des réseaux d’acteurs qui gèrent un
partage du territoire, fruit d’un compromis politique européen qui s’impose aux territoires. Les
politiques publiques traduisent cette dualité :
• dans les zones productives, des objectifs minimaux en matière d’environnement et de sécurité
sanitaire sont définis ;
• dans les zones « douces », les aides favorisent des systèmes souscrivant au respect de conditions
« structurelles » : présence de surfaces de compensation écologique, diversité de rotations,
promotion d’élevage herbager, bilan azoté contraignant…
On retrouve dans les zones productives des pratiques essentiellement fondées sur une gestion des
flux optimisée, mais sous contrainte de productivité. Les pressions sur l’environnement sont fortes,
comme dans le premier scénario. Au contraire, dans les zones douces, l’accent est mis sur le
maintien d’espaces multifonctionnels et sur une maîtrise d’ensemble du niveau de production :
l’amélioration d’ensemble est notable, du fait de critères structurels combinant exigences dans la
diversité des espaces agricoles et de gestion des flux. Des pratiques de gestion environnementale
fines, nécessitant un savoir faire que les exigences structurelles ne peuvent intégrer, peuvent
néanmoins être perdues localement.
Dans le scénario 3, « L’Europe des régions, un patchwork aux résultats environnementaux
2

contrastés », l’Europe des régions est devenue une réalité en 2025. L’agriculture est désormais un
secteur économique comme un autre, sans politique agricole commune. Les produits des régions se
confrontent sur le marché européen. Dans un contexte de concurrence accrue entre territoires,
chacun s’emploie à faire valoir ses avantages compétitifs, en s’organisant au niveau régional. Les
territoires sont les lieux où se négocient et s’élaborent autant de modèles agricoles. Les projets
locaux de gestion environnementale sont élaborés en concertation avec l’ensemble des parties
prenantes, ce qui conduit à des objectifs environnementaux adaptés aux demandes locales.
Contrairement aux scénarios précédents, il n’y a pas de mode d’action unique en termes de gestion
d’espaces multifonctionnels (de leur destruction à leur « co-production » par l’agriculture) ; les
modalités de gestion des flux sont extrêmement variables, depuis une simple annonce d’obligation
de moyens peu contraignants (mais rares dans une situation où l’évaluation locale est devenue la
règle) à une prise en charge volontaire des flux. Dans ce scénario, l’état de l’environnement s’inscrit
dans un gradient allant de réels succès agri-environnementaux (combinaison d’une demande
environnementale forte et de qualité, de systèmes agraires dans un environnement préservé) à une
absence de prise en charge effective (absence de demande environnementale, systèmes agraires
agressifs dans un environnement déjà dégradé).
Le scénario 4 : « Une agriculture Haute performance environnementale » repose sur une rupture
consistant à considérer l’environnement non plus comme une contrainte mais comme une
opportunité pour l’agriculture, notamment pour défendre la spécificité du secteur. En 2025, les
attentes environnementales sont au cœur des demandes de la société européenne. L’intégration des
normes environnementales dans le comportement des consommateurs restructure le fonctionnement
économique et politique de l’Europe. Un modèle d’agriculture « Haute Performance
Environnementale » est défini. Il s’appuie sur la base de l’agriculture biologique, dont il fait évoluer
les termes techniques — en conservant néanmoins le non recours à des produits de traitement
phytosanitaire — et économiques pour en faire un modèle de portée européenne. Ce modèle est
défendu et implique un protectionnisme sanitaire et environnemental assumé. Cette mutation
profonde passe nécessairement par un « contrat » social et politique particulièrement fort,
comparable à celui qui prévalut à la mise en place de la PAC dans les années 1960. Elle nécessite
une forte intensité en main d’œuvre, tant en termes quantitatif que qualitatif, au regard des savoir-
faire mobilisés. L’état environnemental qui résulte de cette intégration technique entre économie et
environnement correspond à une évolution très significative de l’état des paysages, de la
biodiversité sur l’ensemble des territoires. Les espaces agricoles gagnent en fonctionnalité
écologique, et permettant une restauration des espèces communes et remarquables qui en dépendent,
même si le maintien d’une activité agricole plus dense sur tout le territoire peut ne pas convenir à
toutes les espèces. La situation des ressources et des risques naturels s’améliore, notamment du fait
de l’abandon des phytosanitaires. La répartition plus homogène des productions conduit à une
moindre consommation d’énergie.
Aucun des quatre scénarios n’est apparu invraisemblable, plusieurs pouvant même être considérés
comme relativement tendanciels. Ils montrent que des évolutions importantes sont à anticiper et que
de nouveaux partenaires apparaîtront sur la scène agricole. Ils désignent aussi, pour tous les acteurs
en présence, des espaces de choix et un certain nombre de contraintes. Pour les politiques publiques,
en particulier, ils illustrent que la régulation entre agriculture et environnement pourra se faire selon
des modalités distinctes, et ils donnent de premières pistes pour imaginer les impacts différenciés
des divers systèmes de régulation possibles.
Référence : « Agriculture, environnement et territoires : quatre scénarios à l’horizon 2025 », Un
exercice de prospective du Groupe de la Bussière, Poux X. (coord.), Documentation Française,
2006.
3
1
/
3
100%