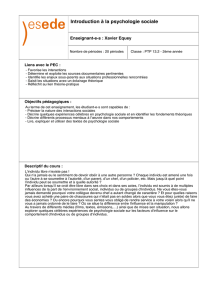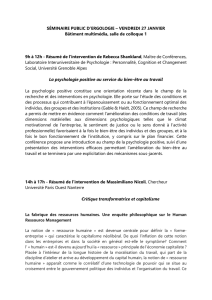est-il justifié de parler de psychologie positive

EST-IL JUSTIFIÉ DE PARLER DE PSYCHOLOGIE POSITIVE ?
Jacques Lecomte
Presses universitaires de Liège | Les cahiers internationaux de psychologie sociale
2012/1 - Numéro 93
pages 21 à 36
ISSN 0777-0707
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2012-1-page-21.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecomte Jacques, « Est-il justifié de parler de psychologie positive ? »,
Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 2012/1 Numéro 93, p. 21-36.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Presses universitaires de Liège.
© Presses universitaires de Liège. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en
France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège

Est-il justié de parler
de psychologie positive ?
Jacques LECOMTE
UFR de sciences psychologiques et
sciences de l’éducation, Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense
“”
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège

L’expression « psychologie positive »
semble, de prime abord, contrevenir à
la règle de neutralité axiologique selon
laquelle le scientifique doit éviter tout
jugement de valeur dans le cadre de son
activité professionnelle. Cet article vise à
montrer que la réalité est plus complexe
qu’on ne le pense habituellement et
conclut qu’il est légitime d’utiliser
l’expression « psychologie positive ». Des
réflexions supplémentaires sont apportées
sur le fondement humaniste de la
psychologie positive et sur sa place au sein
des différentes disciplines psychologiques.
La correspondance pour cet article doit être adressée à Jacques Lecomte, Université de Paris
Ouest Nanterre La Défense, UFR de sciences psychologiques et sciences de l’éducation, 200
avenue de la République, 92001 Nanterre CEDEx 1, France. Courriel : <jacques.lecomte442@
orange.fr>.
The expression “positive psychology”
may seem, at first glance, to contravene
to the rule of axiological neutrality, which
asserts that the scientist must avoid every
value judgment within the framework of
his professional activity. This article aims
to show that reality is more complex than
we think usually and it concludes that it
is rightful using “positive psychology”
expression. The article presents also some
additional thoughts about the humanistic
foundations of positive psychology and
on its position among different academic
psychological disciplines.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège

Est-il justié de parler de psychologie positive ? 23
U
1. Petite histoire de la neutralité axiologique
Utiliser l’expression « psychologie positive », c’est sous-entendre qu’il existerait
une psychologie négative. De façon plus générale, c’est, semble-t-il, introduire
un jugement de valeur dans l’univers scientique, univers dans lequel ce type
d’approche est, par principe, exclu. En effet, une règle généralement prônée
dans l’univers scientique est que le chercheur, dans le cadre de son activité
professionnelle, analyse des faits et se refuse à tout jugement de valeur. En d’autres
termes, son travail relève de l’objectivité scientique et non pas des croyances
subjectives personnelles.
Au l du temps, cette posture a été exprimée sous diverses formes et avec de
multiples appellations, reétant certaines nuances : distinction entre est et doit
être, distinction entre jugements de faits et jugements de valeur, distinction entre
le descriptif et le prescriptif, neutralité axiologique, critique du biais naturaliste.
Ce principe trouve son origine première dans un court passage du philosophe David
Hume. Dans son Traité de la nature humaine, il s’étonne de ce que de nombreux
penseurs constatent ce qui est (is) ou n’est pas, puis en tirent des conclusions sur
ce qui doit être (ought) ou non (Hume, 1739, p. 16). Ce glissement lui semble
totalement injustié.
Au vingtième siècle, le sociologue Max Weber applique cette idée de Hume à
l’univers scientique. Selon lui, « chaque fois qu’un homme de science fait
intervenir son propre jugement de valeur, il n’y a plus compréhension intégrale
des faits. » (Weber, 1959, p. 91). Notons au passage que Weber transgresse
fréquemment ce principe qu’il pose. A titre d’exemple, dans une seule page de la
traduction française de son texte majeur sur la neutralité axiologique, se trouvent
des expressions telles que « très fâcheux », « travail modeste, mais positif »,
« meilleurs représentants de notre éloquence parlementaire », « abus déplorable »
et « simulacre déloyal » (Weber, 1965, p. 414).
Mais l’essentiel n’est pas là. En effet, Weber introduit une nuance essentielle dans
son propos, en distinguant le jugement de valeur (Werturteil) et le rapport aux
valeurs (Wertbeziehung), ce dernier étant à ses yeux parfaitement légitime de la
part d’un chercheur. Il fournit un exemple hypothétique à ce sujet : un anarchiste
peut être un bon connaisseur du droit et, en raison même de ses convictions, peut
découvrir dans la théorie courante du droit des problématiques qui échappent à
d’autres. (Weber, 1965, p. 411).
Ceci apporte une première nuance à la distinction entre faits et valeurs en science :
le chercheur peut avoir une philosophie personnelle qui va orienter ses recherches
dans telle ou telle direction, l’essentiel étant qu’au cours de la recherche elle-
même, il soit très scrupuleux dans sa méthodologie et ses interprétations.
En 1903, le philosophe George Edwad Moore élabore et critique le concept de
sophisme naturaliste (naturalistic fallacy), qui consiste à assimiler les concepts
éthiques à des concepts naturels (Moore, 1998).
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège

CIPS n°93 – 2012 – pp. 21-3624
2. Les valeurs épistémiques sont-elles des valeurs morales ?
Notons tout d’abord une situation de la vie courante qui semble contrevenir au principe
de la distinction entre est et doit être. Searle (1964) fournit cependant une situation de
la vie quotidienne pour laquelle nous déduisons automatiquement un doit être à partir
d’un est. Si Jones promet à Smith de lui payer cinq dollars, c’est un fait, mais nous en
concluons immédiatement que Jones doit donc payer ces cinq dollars.
Mais qu’en est-il à propos de l’activité scientique ? Celle-ci ne peut faire l’économie
de valeurs, ce qui se constate par exemple dans l’expression « bonne (ou mauvaise)
hypothèse ». Mais c’est ici qu’intervient une nouvelle distinction, entre valeurs
éthiques et valeurs épistémiques (ou cognitives), ces dernières caractérisant
précisément l’activité scientique. Les principales valeurs épistémiques sont
l’objectivité, la rationalité, la cohérence, la simplicité, l’exactitude, la plausibilité.
Or, cette distinction est articielle aux yeux de certains auteurs, du moins sous sa
forme extrême. Ainsi, Putnam reconnaît qu’il y a une différence entre ces deux
groupes de valeurs, mais il afrme que « les jugements normatifs sont essentiels
à la pratique de la science elle-même. (…) Les jugements de “cohérence”, de
”plausibilité”, de ”simplicité” (…) sont tous des jugements normatifs au sens
de Peirce, ce sont des jugements de la forme de ”ce qui doit être” lorsqu’on a
affaire à un raisonnement. » (Putnam, 2004, p. 39). Il cite d’ailleurs un exemple
particulièrement troublant à cet égard : la théorie de la gravitation d’Einstein a
été préférée à celle de Whitehead par la communauté scientique cinquante ans
avant qu’une observation puisse véritablement les départager, du fait que la théorie
einsteinienne était plus simple et cohérente.
Certains auteurs vont plus loin encore. Selon Brinkmann (2005, p. 762), il n’y a pas
de différence fondamentale entre les valeurs épistémiques et les valeurs morales :
« Nous leur accordons de la valeur car elles sont intrinsèques à une bonne pratique
scientique. Ainsi, elles ne sont pas bonnes parce que nous leur accordons de la
valeur, mais nous leur accordons de la valeur pare qu’elles sont bonnes. C’est
ce que signie le mot ”objectivité”. Je crois qu’il est possible de démontrer que
toutes les valeurs épistémiques (ou cognitives) sont en fait d’abord et avant tout
des valeurs morales. » C’est tout particulièrement lorsque des valeurs épistémiques
ne sont pas respectées que leur caractère moral s’impose avec évidence. Ainsi,
la fraude scientique est une violation des valeurs épistémiques d’objectivité et
d’exactitude, et une violation de la valeur morale d’honnêteté.
L’inévitable enlacement des faits et des valeurs peut se constater dans certaines
interprétations de données scientiques. Un exemple est remarquable à cet égard
(Lecomte, 2002). La plupart des enfants maltraités deviennent des parents affectueux
(80-90 % dans la majorité des études). Beaucoup de personnes pensent le contraire,
l’illusion cognitive venant du fait que la plupart des parents maltraitants ont été
maltraités. Et l’on glisse, sans s’en rendre compte, d’une démarche rétrospective
à une démarche prospective. Mais ce n’est pas le sujet qui m’intéresse dans le
contexte présent. Il est impressionnant de constater que pratiquement toutes
les études sur ce thème utilisent l’expression « transmission (ou reproduction)
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Maison des sciences de l'homme - - 193.49.18.51 - 11/01/2013 18h44. © Presses universitaires de Liège
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%


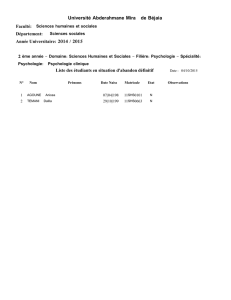

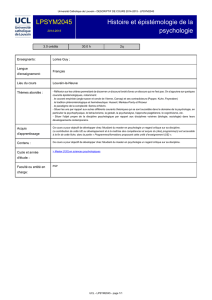
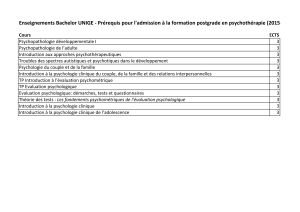
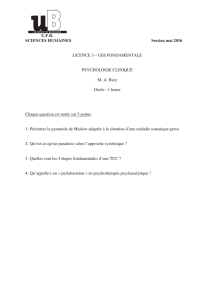
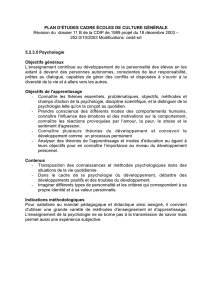
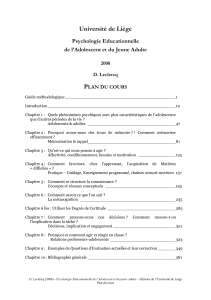
![Fiche projet n 2 [ PDF - 370 Ko ]](http://s1.studylibfr.com/store/data/008469253_1-179f3cc09c20e1657d654cc261bce6c5-300x300.png)