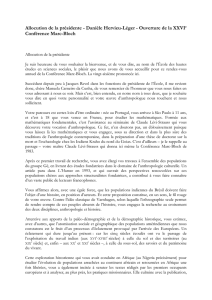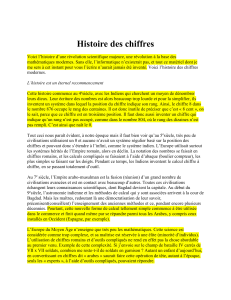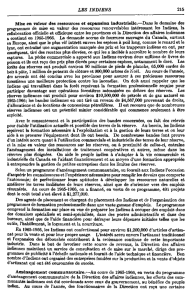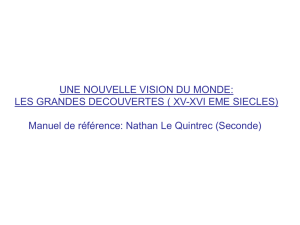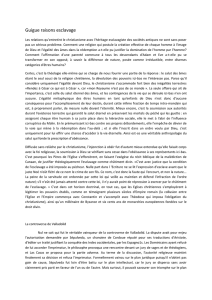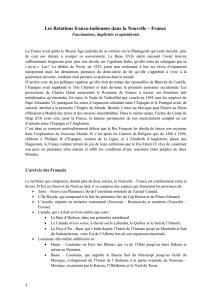« Savez-vous que les arbres parlent

Photo synthèse. 1 sur 3
PHOTO SYNTHESE
« Savez-vous que les arbres parlent ? Ils le font pourtant ! Ils se parlent entre eux et vous
parlent si vous écoutez. L’ennui avec les Blancs, c’est qu’ils n’écoutent pas ! Ils n’ont jamais
écouté les Indiens, aussi je suppose qu’ils n’écouteront pas non plus les autres voix de la
nature. »
« Je pense même que si un jour ils nous écoutent, nous les arbres, le vent, la pluie et tous les
animaux, il sera trop tard.
En tous cas, pour moi, c’est déjà trop tard.
Je ne comprends pas pourquoi mes souvenirs les plus anciens sont les plus nets. Je revois
encore Tilda escalader mon tronc et se lover à ma plus haute fourche. Elle mettait ses mains
en visière et me racontait ce qu’elle voyait. La forme des nuages, les troupeaux de chevaux
sauvages galopant vers l’ouest. Elle était si légère et sa voix était si chantante que parfois je la
prenais pour un oiseau.
Et puis un jour, comme à son habitude, elle grimpa dans mes branches mais elle ne dit rien.
J’ai senti les muscles de ses cuisses se contracter contre mon écorce. J’ai essayé de la rassurer
mais sa peur était trop forte pour qu’elle m’écoute. En deux bonds, elle était au sol, comme un
petit écureuil affolé. Elle a couru vers sa tribu en criant des mots rauques.
Le soleil était bas quand ils ont arrivés. Depuis midi, je sentais la terre vibrer. Ils étaient
nombreux, lents, décidés. Ils voulaient que la tribu parte plus à l’Ouest. Ils voulaient posséder
cette terre. Ils voulaient faire fortune. Vouloir était leur verbe. Le chef a accepté sans discuter
pour épargner les siens et la petite Tilda.
Je me souviens de l’odeur de la tribu quand elle a préparé son départ. Une odeur âcre, d’effroi
et de tristesse mêlés. Je devais avoir la même car tous sont venus me saluer et ont posé leur
front contre mon écorce. Puis ils sont partis, Tilda avec eux.
A partir de ce jour, mes souvenirs sont flous mais je suis toujours vivant. La preuve, ce récit
que je répète chaque jour aux hommes qui m’entourent. Mais je sens bien qu’ils ne
m’entendent pas.
Lorsque j’étais jeune, la lumière qui traversait mes feuilles et qui les colorait comme de la
chair d’avocat me donnait l’énergie de me hisser vers le haut. Mais depuis l’arrivée des
Blancs, le jour et la nuit me sont indifférents et la lumière ne joue plus dans mon feuillage.
En octobre de cette année, il a beaucoup plu. La pluie était torrentielle. Je percevais sa
violence au bruit qu’elle faisait en s’abattant sur moi. Les gouttes auraient dû ricocher de
feuilles en feuilles, me laver de la poussière de la plaine. Mais je n’ai rien senti de la sorte.
Juste son poids écrasant, comme une masse d’eau stagnante.
Alors j’ai compris. Je ne suis donc plus qu’un tronc scié à sa base. Les Blancs m’ont coupé le
jour de leur arrivée pour faire place nette. Depuis, je sers de siège au beau milieu d’un parc de
loisirs, sur lequel les petits Blancs nourris aux frites et au soda viennent assoir leurs fesses
adipeuses pour se reposer. Ils ont finit par rendre la surface de mon billot, concave comme
une cuvette. L’eau s’y accumule et pénètre insidieusement jusqu’à mes racines. Je pourris
lentement et c’est une bonne chose. Quand les insectes qui m’habitent déjà auront entièrement
dévoré ma chair, je ne serai plus qu’humus et je rejoindrai la terre qui m’a nourri.
En attendant de disparaître, je subis les humiliations avec résignation. Les petits Blancs ont
pris l’habitude de tailler mon aubier à coups de canifs. Ils y gravent des cœurs et des
obscénités. Jamais du temps de Tilda, les Indiens ne m’avaient fait endurer la moindre

Photo synthèse. 2 sur 3
violence. Le chef venait régulièrement me toucher et je lui transmettais toute l’énergie de ma
sève montante. »
Ce souffle végétal, le directeur du parc de loisirs ne peut l’entendre. Débordé toute l’année, il
l’est encore plus en ce moment. Il prépare activement la cérémonie commémorative de la fin
des guerres indiennes.
Non que la cause des Indiens lui soit chère. Mais il s’était dit que ça lui ferait une bonne
publicité de convier Blancs et Indiens à une fête commune dans ce parc, construit sur un
ancien territoire navajo. Il a pensé à tout : aux banderoles de bienvenue, aux boissons fraîches,
aux friandises déposées dans des corbeilles de vannerie et des récipients en terre cuite pour
rappeler l’artisanat indien. Des cars loués pour l’occasion transporteront les Indiens
volontaires de leur réserve au parc. Son discours aussi est prêt.
Les Indiens se moquent bien de la fête. Ils veulent juste voir ce qu’est devenue la terre dont
les Blancs les ont chassés il y a plus de cent ans.
En descendant des bus, ils vacillent un instant. Même le sol est méconnaissable. Bitumé par
endroits, recouvert de gazon synthétique à d’autres. L’ocre a disparu. Les arbres centenaires
taillés en siège sont pitoyables. Partout des objets métalliques, des attractions bruyantes, des
odeurs de plastique chaud et de fritures. Le faux artisanat des poteries et des vanneries usinées
leur soulèvent le cœur.
Le discours du directeur est tout aussi artificieux. Son ton ressemble à celui d’un politicien.
Bien timbré et démagogique. Il y est question de l’amitié entre les peuples, de la faculté de
pardon, car c’est vrai les Blancs ont failli autrefois, d’un futur rayonnant. Des paroles aussi
convaincantes et pourtant tout aussi fallacieuses que celles du président Jackson.
La fête bat son plein. Les Blancs hurlent dans les grandes roues, et dévorent entre deux
descentes vertigineuses des tonnes de pop-corn. Les toboggans sont pris d’assaut par les plus
jeunes qui se poussent avec brusquerie pour passer sans attendre leur tour.
Les Indiens se sont assis sur les arbres mutilés. Ils ferment les yeux, respirent à plein poumon
l’air de leurs ancêtres. Le vent se lève. Il les entoure de tourbillons de sil rouge envolé des
plaines environnantes. Ils sentent le bois dur sur lequel ils sont assis, le bois des arbres de
leurs aïeux. L’air est saturé de poussière et les gens doivent se protéger les yeux et le nez pour
ne pas étouffer.
Le directeur qui trouve la scène très folklorique sort son appareil photo. Les Indiens sont assis
les yeux clos et semblent parler avec les esprits. Ça fera une magnifique photo. Il l’enverra au
journal local qui en fera sa une et qui la légendera d’une phrase fraternelle.
La terre a également enveloppé le directeur. Elle s’infiltre sous ses paupières et le fait
larmoyer. L’espace d’un instant, la vue brouillée, il croit voir non plus des hommes mais des
arbres au fût rectiligne.
La photo est prise mais il la croit ratée. Furieux, il veut demander aux Indiens qui s’apprêtent
à partir de reprendre la pose. Mais quelque chose l’en empêche. Le sourire paisible et le
regard rasséréné des Navajos le troublent au plus au point.
Tandis que les bus redémarrent pour un long trajet en direction des réserves, le directeur fait
défiler frénétiquement les photos contenues dans son appareil. Sa fille trépigne à ses côtés.
— Tu me montres ?
Il ne l’écoute pas. Non, c’est impossible, se dit-il. Ce ne peut pas être celle que je viens de
prendre.

Photo synthèse. 3 sur 3
Il en vérifie le jour et l’heure. Tout est conforme. C’est sans doute une erreur du dateur
électronique, essaye-t-il de rationnaliser. Mais il sait que la photo qu’il a sous les yeux est
bien celle qu’il a prise à l’instant. Rien à voir avec les anciennes qu’il a conservées par
paresse sur la carte-mémoire. Cette photo résume tout ce qu’il pense des Indiens :
indomptables même parqués dans une réserve, insaisissable même cadrés par un objectif.
— On ne peut pas se fier à la technologie, bredouilla-t-il enfin. La mémoire est vide.
— Alors, pas de photo, s’impatient-elle.
— Pas de photo.
— Mais je t’ai vu appuyer sur le déclencheur. J’ai même vu le flash.
— Pas de photo, tu comprends ?
Comment expliquer que la photo, parfaitement nette, fait apparaître des hommes-arbres,
semblables aux mâts totémiques des Indiens canadiens qu’il a visités un an auparavant ?
Comment expliquer que les Indiens ne font qu’un avec le tronc sur lequel ils sont assis ? Que
la chair des hommes et le duramen des arbres se confondent, comme sculptés à la gouge ?
Comment expliquer qu’à cet instant tous les Amérindiens se fondent en un souffle rouge?
1411 mots
1
/
3
100%