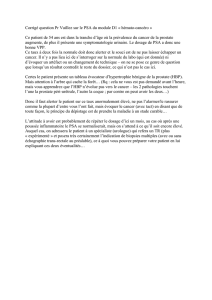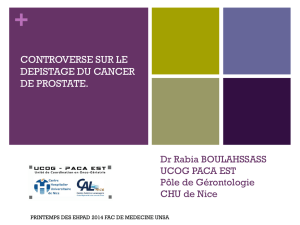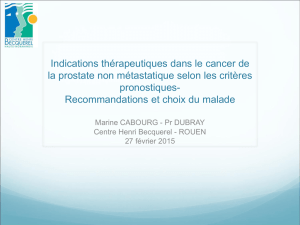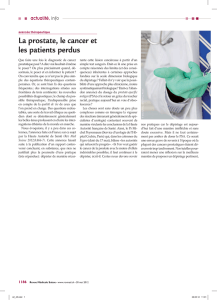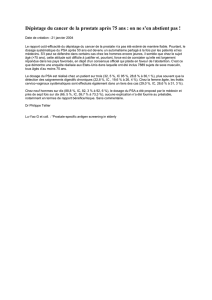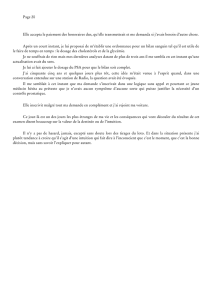Prise en charge des marges positives après

La constatation anatomopathologique de marges chirurgicales posi-
tives (Mg+) après prostatectomie totale (PT) est une situation com-
plexe dont la fréquence varie de moins de 10% à plus de 40% selon
le stade pathologique et les opérateurs [1-4]. La conduite à tenir thé-
rapeutique dans cette situation pourtant routinière demeure contro-
versée. Certains auteurs considèrent que les Mg+ sont un facteur de
risque de récidive surtout locale pour proposer une radiothérapie
adjuvante systématique [2-8]. En tenant compte de tous les autres
paramètres (PSA pré-opératoire, score de Gleason pathologique,
stade pathologique), le risque de récidive biologique est 2 à 4 fois
plus fréquent que chez les patients en Mg- [6]. Cependant, 40 à
50% des patients présentant des Mg+ ne récidiveront pas [9, 10].
D’autre part, si la récidive survient tardivement la radiothérapie de
rattrapage donne de bons résultats sur la survie [11-15].
Quelle valeur pronostique attribuer aux Mg+ comparativement aux
autres facteurs biologiques et anatomo-pathologiques ? Peut-on pré-
voir la récidive et limiter de ce fait un traitement adjuvant à un
groupe de patients à plus grand risque ? Est-il possible de diminuer
le taux de Mg+ et par quel moyen ? Autant de questions de pratique
quotidienne à résoudre pour l’urologue impliqué dans la prise en
charge du cancer de la prostate.
L’objectif de cette revue est de faire le point de la littérature sur ce
sujet.
DEFINITION D’UNE MARGE POSITIVE
Une Mg+ correspond à la présence de tissu cancéreux au contact
des limites encrées de la pièce de prostatectomie [2, 16].
Elle peut correspondre à 2 situations :
-tumeur intra-capsulaire (pT2) : la section chirurgicale est passée
dans la capsule et expose la tumeur.
-tumeur extra-capsulaire (pT3) : la section chirurgicale est passée
àdistance de la capsule mais expose la tumeur,
Le problème posé par la positivité d’une marge chirurgicale est de
savoir (ou de prévoir) s’il reste de la tumeur résiduelle, la section
chirurgicale ayant pu passer simplement au contact de la tumeur
comme au sein du tissu malin résiduel.
FREQUENCE DES MARGES POSITIVES
La fréquence des Mg+ varie de moins de 10% à 46% selon les
séries [1-4, 6, 17, 18]. Représentant plus de 50% des patients opé-
rés dans les années 80, la fréquence des Mg+ a chuté de façon
importante dans toutes les séries rapportées depuis 10 ans. Le dia-
gnostic plus précoce et la migration des stades cliniques observés
ces dernières années en sont l’explication principale. Les améliora-
tions apportées aux techniques chirurgicales ont également contri-
bué à cette situation, même si cette diminution de fréquence est sur-
tout observée pour les tumeurs intra-capsulaires [3, 19, 20]. Les
taux de Mg+ demeurent stables dans le temps en cas d’extension
extra-capsulaire (stade pT3), entre 25 à 40% [3, 16]. La préserva-
◆
MISE AU POINT Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291
Prise en charge des marges positives après prostatectomie totale
pour cancer localisé de la prostate
Frédéric STAERMAN (1),Michel SOULIÉ (2),Jacques TOSTAIN (3),Marc de FROMONT (4),Jean-Louis DAVIN (5),
Christian COULANGE (6) et les membres du sous-comité “Prostate” du CCAFU
(1) Service d’Urologie, CHU Robert Debré, Reims, (2) Service d’Urologie, CHU Rangueil, Toulouse,
(3) Service d’Urologie-Andrologie, Hôpital Nord, Saint-Etienne, (4) Prado Pathologie, Marseille, (5) Clinique Rhône-Durance, Avignon,
(6) Service d’Urologie, Hôpital Salvator, Marseille, France
RESUME
Les marges positives après prostatectomie totale sont une situation anatomo-pathologique fréquente (10 à 40%)
dans la pratique quotidienne des urologues en charge du cancer de la prostate. La présence de marges positives
est corrélé à la présence de tumeur résiduelle dans environ 50% des cas. La grande hétérogénéité des données
de la littérature sur la signification et le pronostic des marges positives rend la conduite à tenir difficile à préci-
ser clairement. L’objectif de cette mise au point était de faire une analyse des différents aspects de cette situation
et de proposer une prise en charge pratique. L’analyse s’est basée sur les données bibliographiques recueillies par
la source Medline.
En pratique, il s’avère indispensable de mieux qualifier le concept des marges positives sur le plan anatomo-
pathologique en précisant l’uni- ou la multifocalité, la longueur totale des marges et leur siège. La discussion
d’un traitement adjuvant ou différé s’appuie sur ces éléments histopathologiques couplés aux autres critères pro-
nostiques recueillis après la prostatectomie totale, le stade et le score de Gleason pathologiques, le volume tumo-
ral et le taux de PSA post-opératoire.
Mots clés : Cancer de la prostate localisé, prostatectomie totale, marges chirurgicales positives.
286
Travail du Sous-comité Prostate du CCAFFU
Manuscrit reçu : avril 2006, accepté : mai 2006
Adresse pour correspondance : Dr. M. Soulié, Service de Chirurgie Urologique et d’An-
drologie, CHU de Rangueil, 31034 Toulouse Cedex.
e-mail : [email protected]
Ref : STAERMAN F., SOULIÉ M., TOSTATIN J., de FROMONT M., DAVIN J.L.,
COULANGE C. Prog. Urol., 2006, 16, 286-291

tion des bandelettes neuro-vasculaires et l’exérèse de tumeurs plus
agressives (Gleason 7-10) peuvent également contribuer à mainte-
nir cette fréquence constante [21], même si certains auteurs ne par-
tagent pas cet avis [22].
Analytiquement, la fréquence des Mg+ dépend de plusieurs facteurs
:
La technique de lecture anatomo-pathologique
Sil’inclusion de la pièce opératoire n’est pas faite en totalité
(recommandations anatomo-pathologiques 2004), la mise en évi-
dence des Mg+ ne peut être réalisée de manière objective et exhaus-
tive [23]. Il s’agit là d’une des principales causes à la grande dispa-
rité des taux de Mg+ rapportés dans les séries de PT publiées [4]. Il
est estimé que 12% des Mg+ sont non vues si les sections sont pra-
tiquées tous les 5 mm par rapport aux sections de 2-3 mm, selon la
technique de Stanford [24]. A l’apex, les difficultés de lecture sont
liées à l’axe de section. EPSTEIN préconise une étude longitudinale
sur les 5 derniers mm pour éviter les fausses Mg+ en coupes per-
pendiculaires par rétraction de l’urètre [2].
La technique chirurgicale
Dans la série du Baylor Hospital, les modifications de la technique
de PT ont permis une diminution de la fréquence de Mg+ de 24 à
16% puis à 8% dans les stades localisés [16]. L’augmentation de la
fréquence des Mg+ au milieu des années 90 était expliquée par la
plus grande fréquence de la préservation des bandelettes neuro-vas-
culaires [1]. Cependant, pour l’équipe du John Hopkins Hospital ce
risque n’est que de 4% en cas de conservation bilatérale des bande-
lettes [3], information rapportée également par l’équipe de Ham-
bourg [22].
La présence de Mg+ est indirectement le reflet de l’expertise du
chirurgien comme de l’équipe anatomo-pathologique. Une grande
variabilité inter-opérateurs sur la fréquence des Mg+ a été observée
au MSK [17]. La fréquence de Mg+ variait de 10 à 48% selon l’ex-
pertise des chirurgiens pratiquant un nombre de PT/an allant de
moins de 5 à plus de 100.
Le stade tumoral
La fréquence des Mg+ est d’autant plus élevée que le volume tumo-
ral est important et que le stade pathologique est extra-capsulaire
(pT3) sur l’analyse de la pièce opératoire [25]. La présence de Mg+
pour des tumeurs intra-capsulaires (pT2) demeure une réalité avec
des taux variant de moins de 5% à 18% [3, 16, 25-28]. Cette situa-
tion est imputable à la technique chirurgicale donc au chirurgien. La
migration des stades au diagnostic depuis le milieu des années 90 a
fait apparaître une plus grande fréquence de stades T1c, ce qui par-
ticipe à l’explication de la diminution du taux de Mg+ dans les
séries récentes : stade pT2 : 6-29%, stade pT3 : 20-40% [3, 6, 21,
22].
POURQUOI Y-A-T-IL DES MARGES POSITIVES ?
L’influence des techniques chirurgicales et des voies d’abord
Voie d’abord et localisation du foyer cancéreux
La localisation et la fréquence des Mg+ varie selon la voie d’abord
chirurgicale utilisée. Sur une série de 371 patients classés pT2,
SALOMON amontré la présence de Mg+ à l’apex dans respective-
ment 10,3%, 4,6% et 9,4% pour la voie rétro-pubienne, périnéale et
coelioscopique [21]. En revanche, en situation postérolatérale, le
taux de Mg+ était plus fréquent par voie laparoscopique (8,8%
contre 4,3% et 3,4% pour les voies rétro-pubienne ou périnéale). Au
niveau du col, les marges sont positives dans environ 10% des cas.
Elles sont cependant exceptionnellement isolées (1%) et témoi-
gnent en général d’un volume tumoral important [29]. Chaque voie
d’abord a ses limites en terme d’exérèse carcinologique et le choix
d’une voie d’abord devrait théoriquement prendre en compte la
localisation de la tumeur sur les biopsies.
Enfait, les Mg+ sont le plus souvent corrélées à des facteurs de
mauvais pronostic comme un grade de Gleason élevé, l’atteinte des
vésicules séminales ou des lympho-nœuds qui vont influer sur l’é-
volution biologique post-opératoire [6, 16, 18]. Pour l’instant, il
n’est pas possible de dire si une voie d’abord présente un réel avan-
tage sur les autres en matière de taux de Mg+.
La préservation des bandelettes neuro-vasculaires
L’excision large des bandelettes neuro-vasculaires pour éviter la
survenue de Mg+ prévalait dans les années 90 [27]. CATALONA avait
montré que tous les patients avec une extension extra-capsulaire
dans la région des bandelettes neuro-vasculaires avaient des Mg+ en
cas de préservation de celles-ci (1). De même, SMITH arapporté une
diminution de 10% du taux de Mg+ après excision large des bande-
lettes neuro-vasculaires (30).
Du fait du développement de la chirurgie conservatrice des nerfs
érecteurs, la préservation des bandelettes interviendrait comme
cause de Mg+ dans seulement 0 à 7% des cas. En l’absence de pro-
blème technique, le caractère carcinologique de l’intervention ne
peut pas être compromis si la tumeur est intra-capsulaire, ce qui est
de plus en plus fréquent par la migration des stades au diagnostic.
Chez des patients sélectionnés, la préservation d’une ou des deux
bandelettes neuro-vasculaires a ainsi pu être proposée sans risque
carcinologique. BARRE et CHAUVEAUont rapporté une réduction du
risque de Mg+ postéro-latérales de 5 à 0,4% dans les pT2 et de 43
à6,6 % dans les pT3 en modifiant la technique de dissection de cel-
les-ci [26].
Cependant, il semble que les tumeurs prostatiques à risque de pT3,
notamment les tumeurs de stade clinique T2, exposent à un risque
majoré de Mg+ si la (ou les) bandelette(s) homolatérale(s) est
conservée.
Sous-stadification clinique
L’imagerie classique de la prostate (échographie, scanner) n’a pas
fait la preuve de son intérêt dans le bilan d’extension locale du can-
cer localisé de la prostate. L’IRM avec antenne endo-rectale et/ou
pelvienne de surface permet d’améliorer la stadification préopéra-
toire notamment sur l’extension extra-prostatique et les vésicules
séminales [23]. Pour les Mg+, la sensibilité de l’IRM rapportée
dans une série française a été de 37 % et la spécificité de 83% [20].
Il reste néanmoins un taux élevé de faux positifs et une grande
variabilité inter-opérateurs [31]. La place de l’IRM endo-rectale
dans le bilan pré-opératoire est encore limitée pour la gestion spé-
cifique du risque de Mg+.
INFLUENCE DES MARGES POSITIVES SUR LE
PRONOSTIC DU CANCER
Le PSA pré-opératoire, le stade pathologique et le score de Gleason
sont des facteurs pronostiques reconnus qui influencent l’évolution
post-opératoire des Mg+. De nombreuses études ont tenté de savoir
si la positivité des marges était un facteur pronostique indépendant
F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291
287

de récidive ou simplement une association à d’autres facteurs plus
péjoratifs (Tableau I). D’AMICO amontré qu’en l’absence d’attein-
tedes vésicules séminales ou d’un grade de Gleason prédominant
supérieur à 3, le statut des marges était un facteur prédictif indé-
pendant de récidive [9]. EPSTEIN aretrouvé la même information
dans le cas du score de Gleason 7 [2]. Pour la plupart des auteurs,
la présence de Mg+ est un facteur indépendant de récidive avec un
risque de récidive biologique multiplié par 4 [6, 4, 16, 24].
Influence du grade de Gleason
Certains auteurs estiment que le risque de récidive dépend surtout
dugrade de Gleason sur la pièce (notamment du pourcentage de
grade 4 ou 5) ainsi que du volume tumoral (2, 29). Ces constatations
sont valables pour les stades pT2 comme pour les pT3.
Influence du stade pathologique
Pour les cancers classés pT2, PALISAAR n’a pas retrouvé d’influen-
ce du statut des marges sur l’évolution biologique post-opératoire
(PSA > 0,1 ng/ml dans 4% contre 4,8%) avec un recul médian de
26 mois [25]. Aucune récidive n’était constatée en cas de Mg+ en
l’absence de grade histologique élevé (supérieur à 3). A 5 ans,
OHORI confirme l’absence de caractère péjoratif de Mg+ pour les
pT2 [16].
En revanche, CHENG note un taux de progression à 5 ans de 10 et
22% lorsque les marges sont respectivement négatives ou positives
pour les tumeurs pT2 [32]. Ces différences apparentes sont proba-
blement dues à un recul insuffisant du suivi de certaines séries. Pour
les cancers classés pT3, une évolution biologique est constatée dans
45% des cas si la marge est positive [32]. Cependant, d’autres fac-
teurs pronostiques plus péjoratifs (grade de Gleason > 3, vésicules
séminales envahies, pN+) que le statut des marges prédominent au
pronostic.
Influence du site et de l’étendue des marges
Sur 151 patients avec Mg+, OBEK rapporte une atteinte de l’apex
dans 59 % des cas alors qu’elle n’est que de 11 et 17% respective-
ment en postéro-latéral et au niveau du col vésical. De même, 57%
et 48% des patients avec Mg+ au col ou en situation postéro-latéra-
le ont eu une récidive biologique contre 29% pour l’atteinte de l’a-
pex [29].
Le risque de récidive biologique double lorsque les Mg+ sont mul-
tifocales comparées aux Mg+ unifocales témoignant d’un volume
tumoral plus important et pourrait expliquer ainsi une récidive plus
précoce. Cependant, le recul moyen de cette série n’était que de 25
mois et il n’est pas certain qu’avec un recul supérieur, cette diffé-
rence persiste [29].
PARTIN n’a pas retrouvé d’influence du site de la marge sur la sur-
vie sans récidive biologique. L’excision large des bandelettes neuro-
vasculaires qui permet de diminuer la fréquence des marges positi-
ves induit une différence sur la survie sans récidive dans les deux
années post-opératoires. Cependant, aucun bénéfice n’est retrouvé
à4ans [27]. De même, GROSSFELD retrouve peu d’influence du
nombre et du site des Mg+ sur la récidive biologique ou la fréquen-
ce d’un traitement complémentaire après prostatectomie totale, sur
la base de données de CaPSURE [6]. S’intéressant plus spécifique-
ment aux Mg+ de l’apex chez des patients sans atteinte ganglion-
naire ou des vésicules séminales, PETTUS n’a pas trouvé de diffé-
rence dans le taux de récidive biologique selon la localisation
unique ou non de la marge, à l’apex ou sur d’autres sites, avec un
recul médian de 53 mois [18].
Enrevanche, l’atteinte de l’apex est corrélée à un volume tumoral
plus important, une fréquence plus élevée d’atteinte capsulaire et un
grade plus élevé [24].
De plus en plus, la longueur des Mg+ s’associe au caractère uni ou
multifocal des Mg+ comme facteur pronostique. Les Mg+ unifoca-
les millimétriques ou < 3-4 mm auraient un très faible risque évo-
lutif sur la récidive si elles ne s’associent pas à d’autres facteurs
pronostiques péjoratifs [7].
Les Mg+ sont un facteur prédictif de récidive du cancer de la pro-
state après prostatectomie totale. Elles sont habituellement le reflet
de tumeurs plus agressives. Le nombre et le site des marges n’ont
d’influence qu’en l’absence d’autres facteurs péjoratifs anatomo-
pathologiques (pT3, présence de grade 4/5, envahissement séminal
ou ganglionnaire) (niveau de preuve III-3).
QUE FAIRE EN PRESENCE D’UNE MARGE POSITIVE ?
Il n’y a pas de consensus concernant la prise en charge optimale des
Mg+ après prostatectomie totale. Les options thérapeutiques com-
prennent la surveillance, la radiothérapie et/ou l’hormonothérapie
adjuvante ou la prise en charge de rattrapage lors de la récidive bio-
logique. Ainsi, parmi les patients de la base de données du CaPSU-
RE qui présentaient des Mg+, seuls 14,3% d’entre eux ont eu un
traitement adjuvant après PT et 20,9% ont eu un traitement com-
plémentaire avec un recul de 3 ans [6]. En l’absence d’études pro-
spectives et de recommandations, le choix dépend essentiellement
d’expériences individuelles dont la littérature est le reflet.
Surveillance
Elle repose sur la constatation que la progression biologique n’est
pas systématique. Sur la base des données CaPSURE, GROSSFELD
estime le risque d’avoir un traitement adjuvant après PT à 2,9 et
14,3% selon le caractère négatif ou positif des marges. Pour les
patients surveillés, 1 sur 5 aura un traitement de rattrapage [6]. Trois
ans après la prostatectomie totale, 1/3 des patients aura eu un trai-
tement complémentaire du fait des Mg+.
La surveillance paraît raisonnable pour les tumeurs pT2 à risque fai-
ble ou intermédiaire avec Mg+ unifocales et < 4 mm (niveau de
preuve IV).
Radiothérapie
Elle peut être proposée en adjuvant à la chirurgie dans les 3 mois
qui suivent ou en rattrapage lors de la réascension du PSA. Elle n’a
pas d’effet délétère sur la continence si celle-ci est récupérée après
la prostatectomie totale et peu d’effets secondaires digestifs (5% <
grade 3 à 2 ans) [7, 11, 13, 33, 34]. Son rôle sur le risque de surve-
nue d’une sténose uréthrale est cependant discuté.
Il existe une certaine variabilité dans les doses délivrées dans les
F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291
288
Tableau I. Evolution du PSA après prostatectomie totale avec marges
positives
Patients (n) PSA indosable (%) Suivi (mois)
Paulson 124 42 60
Epstein 167 57 60
Ohori 78 64 60
Lowe 80 70 45
Grossfeld 132 52 36
Total 581 55 52

séries rétrospectives publiées ce qui nécessitent des précautions
dans l’interprétation de l’efficacité. Une dose de 60 à 65 Gy est
appropriée.
Radiothérapie adjuvante
Uncertain nombre d’études suggèrent que la radiothérapie externe
adjuvante améliore le contrôle du cancer en maintenant un taux de
PSA indétectable (Tableau II). Elle diminue le risque de récidive
locale et métastatique [11]. VALICENTI amontré une amélioration du
contrôle local à 5 ans de 34% chez les patients irradiés [35]. LEIBO-
VICH acomparé 2 groupes de patients pT2 et une marge positive
avec ou sans RT adjuvante (50 à 68 Gy, médian 63 Gy). L’absence
de récidive biologique à 5 ans était de 88% avec radiothérapie con-
tre 59% sans. Cette différence n’était pas retrouvée pour la survie
spécifique ou l’évolution métastatique dans le délai de l’étude [33].
Radiothérapie de rattrapage
La réascension du PSA après prostatectomie totale fait évoquer une
récidive locale ou une évolution métastatique selon le délai post-
opératoire et le temps de doublement du PSA. Après 2 ans post-opé-
ratoires, si le temps de doublement du PSA est supérieur à 12 mois,
la récidive biologique (> 0,2 ng/ml) sera plutôt en faveur d’une réci-
dive locale et une radiothérapie de rattrapage peut être proposée [7,
13, 14].
Sur l’ensemble des séries rétrospectives publiées, la réponse en
terme de survie sans récidive biologique est d’environ 50% à 5 ans
(Tableau III). La dose délivrée doit être d’au moins 64 Gy [15, 34].
Les facteurs pronostiques habituellement corrélés avec un meilleur
contrôle carcinologique sont un taux de PSA < 1 ng/ml avant la
radiothérapie (voire 0,6 ng/ml pour certains) et le score de Gleason
pathologique < 8 [12, 15, 36].
En revanche, le statut des marges chirurgicales de la pièce opéra-
toire n’influence pas la réponse initiale à la radiothérapie, ni la sur-
vie sans récidive biologique pour la plupart des auteurs [12, 36].
MCDONALD aretrouvé un bénéfice des marges négatives sur l’évo-
lution du PSA post-radiothérapie pour stade pT3. L’hypothèse avan-
cée serait un possible biais par la non-sélection de patients en mar-
ges négatives pour la radiothérapie de rattrapage, une élévation
post-opératoire du PSA chez ces patients témoignant plus souvent
d’une évolution métastatique que d’une récidive locale [15].
La tolérance de la radiothérapie de rattrapage est bonne avec une
toxicité grade 1 et 2 de 17 à 38% et de grade 3 chez 0 à 5% des
patients uniquement [12, 13, 36, 23].
Hormonothérapie
Aucune étude n’a démontré l’intérêt de l’hormonothérapie en adju-
vant en cas de Mg+ [23]. Elle peut être proposée après prostatecto-
mie totale mais son bénéfice est controversé. Un traitement hormo-
nal adjuvant pour les tumeurs à haut risque évolutif (pT3, pN+,
score de Gleason élevé) réduit le risque de progression biologique à
5ans, mais il n'a pas été démontré d'impact sur la survie globale
[37].
COMMENT EVITER D’AVOIR DES MARGES POSITIVES
Améliorer la sélection des patients
La découverte du cancer de la prostate a un stade de plus en plus
précoce est le principal facteur de réduction du taux de Mg+. L’uti-
lisation combinée des 3 facteurs classiques prédictifs pré-opératoi-
res (TR, PSA initial, score de Gleason des biopsies) dans les tables
de Partin permet une approximation satisfaisante de la prédiction
pré-opératoire du risque de marges positives. D’autres outils tels les
nomogrammes actuellement disponibles permettent également
d’estimer ce risque [23].
Hormonothérapie néo-adjuvante
Huit études sur 9 ont montré une baisse du taux de Mg+ avec une
hormonothérapie néo-adjuvante. En revanche, aucun bénéfice en
terme de survie sans récidive biologique et globale n’a été démon-
tré pour 3 mois de traitement. Cela peut s’expliquer par les diffi-
cultés d’analyse des pièces opératoires après traitement hormonal.
Pour le moment, une hormonothérapie néo-adjuvante ne peut être
recommandée dans cette indication [23].
Opérateur et technique chirurgicale
Intuitivement, l’expérience du chirurgien est un facteur à prendre en
compte dans les résultats de la chirurgie carcinologique et cela a été
démontré pour l’œsophage, le pancréas, le côlon et le sein. Sur 10
737 prostatectomies totales réalisées entre 1982 et 1996, BEGG a
montré que les suites chirurgicales dans le cancer de prostate s’a-
mélioraient avec l’expérience. Cependant, il n’y a pas de corrélation
entre le taux de Mg+ et le nombre de PT réalisées et des variations
inter-individuelles persistent même pour une activité soutenue (> 20
prostatectomies totales/an) [17, 38]. A expérience égale, les varia-
tions peuvent aller du simple au double.
Si des différences d’indications existent, la technique chirurgicale
varie aussi. Certaines équipes ont pu réduire le taux de marges en
réalisant une prostatectomie totale plus “élargie” [19, 20, 27]. Ainsi,
ALSIKAFI et BRENDLER ont rapporté un taux global de Mg+ de 11%
avec 35% des Mg+ à l’apex en sectionnant profondément les liga-
ments pubo-prostatiques, le plexus de Santorini à 10 et 15 mm de
l’apex prostatique, l’urètre à 3 mm puis le muscle recto-urétral [19].
SOULIE,dans une série rétrospective déjà ancienne de 212 prosta-
tectomies totales (essentiellement des tumeurs palpables T2), a
“élargi” la dissection à l’apex en sacrifiant les deux bandelettes
neuro-vasculaires. Le taux de Mg+ a diminué de 53 à 20,5% avec
une nette réduction des Mg+ apicales de 33 à 8% [20].
Il n’est pas certain que l’excision large du col vésical ait un intérêt
thérapeutique. En effet, tous les patients rapportés par OBEK avec
une atteinte du col avaient d’autres facteurs de risque péjoratifs
(Gleason > 7, PSA > 20 ng/ml et/ou atteinte des vésicules sémina-
les) et étaient candidats à un traitement adjuvant [29]. Cependant,
certains auteurs recommandent de ne pas conserver le col vésical
avec une dissection poussée de l’urèthre en laparoscopie ce qui a
permis de diminuer le taux de Mg+ exclusivement dans cette loca-
lisation de 10 à moins de 2% [8].
F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291
289
Tableau II. Evolution du PSA après radiothérapie adjuvante pour
récidive biologique
Patients (n) PSA indosable (%) Suivi (mois)
McCarthy et al (1994) 27 67 33
Schild et al. (1996) 60 57 32
Choo et al. (2002) 73 88 50
Vicini et al. (1999) 38 66 48
Petrovich et al. (2002) 311 51 84
Taylor et al. (2003) 75 88 68
Total 584 69,5 52,5

CONCLUSION
La constatation de marges d’exérèse positives après prostatectomie
totale est un élément pronostique indépendant qui est souvent asso-
cié à d’autres facteurs anatomo-pathologiques plus péjoratifs. La
récidive biologique n’est cependant pas certaine dans tous les cas.
Il est nécessaire de demander aux anatomopathologistes de bien
qualifier les Mg+ (longueur en mm, sites, nombre) afin d’estimer le
risque évolutif potentiel.
La radiothérapie est recommandée en adjuvant dans les cas de moins
bon pronostic associé (Mg+ étendues et multifocales, pT3, score de
Gleason ≥4+3). En situation de rattrapage, la radiothérapie a une
bonne efficacité lorsqu’elle est réalisée pour une récidive biologique
tardive avec PSA < 1 ng/ml et PSADT supérieur à 12 mois.
Le meilleur traitement demeure préventif en optimisant les tech-
niques chirurgicales quelque soit la voie d’abord et en ne privilé-
giant pas la conservation des bandelettes neuro-vasculaires s’il exis-
te un risque prévisible de stade pT3.
REFERENCES
1. CATALONA W.J., BIGG S.W. : Nerve-sparing radical prostatectomy : eva-
luation of results after 250 patients. J. Urol., 1990 ; 143 : 538-543.
2. EPSTEIN J.I. : Incidence and significance of positive margins in radical pro-
statectomy specimens. Urol. Clin. North Am., 1996 ; 23 : 651-653.
3. HAN M., PARTIN A.W., CHAN D.Y., WALSH P.C. : An evaluation of the
decreasing incidence of positive surgical margins in a large retro pubic pro-
statectomy series. J. Urol., 2004 ; 171 : 23-26.
4. WIEDER J.A., SOLOWAY M.S. : Incidence, etiology, location, prevention
and treatment of positive surgical margins after radical prostatectomy for
prostate cancer. J. Urol., 1998 ; 160 : 299-315.
5. BOLLA M., VAN POPPEL H., COLLETTE L., VAN CANGH P., VEKER-
MANS K., DA POZZO L., DE REIJKE T.M., VERBAEYS A., BOSSET J.F.,
VAN VELTHOVEN R., MARECHAL J.M., SCALLIET P., HAUSTERMANS
K., PIERART M. : European Organization for Research and Treatment of Can-
cer : Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy : a randomized
controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet, 2005 ; 366: 572-578.
6. GROSSFELD G.D., CHANG J.J., BROERING J.M., MILLER D.P., YU J.,
FLANDERS S.C., HENNING J.M., STIER D.M., CARROLL P.R. : Impact
of positive surgical margins on prostate cancer recurrence and the use of
secondary cancer treatment : data from the capsure database. J. Urol., 2000;
163 : 1171-1177.
7. KAMAT A.M., BABAIAN K., CHEUING M.R., NAYA Y., HUANG S.H.,
KUBAN D., BABAIAN R.J. : Identification of factors predicting response
to adjuvant radiation therapy in patients with positive margins after radical
prostatectomy. J. Urol., 2003 ; 170 : 1860-1869.
8. KATZ R., SALOMON L., HOZNEK A., de la TAILLE A., ANTIPHON P.,
ABBOU C.C. : Positive surgical margins in laparoscopic radical prostatec-
tomy : the impact of apical dissection, bladder neck remodeling and nerve
preservation. J. Urol., 2003 ; 169 : 2049-2052.
9. D’AMICO A.V., WHITTIGTON R., MALKOWICZ S.B. : A multivariate
analysis of clinical and pathological factors that predict for prostate specific
antigen failure after radical prostatectomy for prostate cancer. J. Urol., 1995;
154 : 131-138.
10. HAN M., PARTIN A.W., ZAHURAK M., PIANTADOSI S., EPSTEIN J.I.,
WALSH P.C. : Biochemical (prostate specific antigen) recurrence probabili-
ty following radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer. J.
Urol., 2003 ; 169 : 517-523.
11. ANSCHER M.S. : Adjuvant radiotherapy following radical prostatectomy is
more effective and less toxic and salvage radiotherapy for a rising prostate
specific antigen. Int. J. Cancer, 2001 ; 96 : 91-93.
12. CHAWLA A.K., THAKRAL H.K., ZIETMAN A.L., SHIPLEY W.U. : Sal-
vage radiotherapy after radical prostatectomy for prostate adenocarcinoma :
analysis of efficacy and pronostic factors. Urology, 2002 ; 59 : 726-731.
13. FORMAN J.D., VELASCO J. : Therapeutic radiation in patients with a
rising post-prostatectomy PSA level. Oncology, 1998 ; 12 : 33-47.
14. LIAUW S.L., WEBSTER W.S., PISTENMAA D.A., ROEHRBORN C.G. :
Salvage radiotherapy for biochemical failure of radical prostatectomy : a sin-
gle-institution experience. Urology, 2003 ; 61 : 1204-1210.
15. McDONALD O.K., SCHILD S.E., VORA S.A., ANDREWS P.E., FERRI-
GNI R.G., NOVICKI D.E., SWANSON S.K., WONG W.W. : Radiotherapy
for men with isolated increase in serum prostate specific antigen after radi-
cal prostatectomy. J. Urol., 2003 ; 170 : 1833-1837.
16. OHORI M., WHEELER T.M., KATTAN M.W., GOTO Y., SCARDINO P.T.:
Pronostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy
specimens. J. Urol., 1995 ; 1818-1824.
17. EASTHAM J.A., KATTAN M.W., RIEDEL E., BEGG C.B., WHEELER
T.M., GERICK C., GONEN M., REUTER V., SCARDINO P. : Variations
among individual surgeons in the rate of positive surgical margins in radical
prostatectomy specimens. J. Urol., 2003 ; 170 : 2292-2295.
18. PETTUS J.A., WEIGHT C.J., THOMPSON C.J., MIDDLETON R.G., STE-
PHENSON R.A. : Biochemical failure in men following radical retropubic
prostatectomy : impact of surgical margin status and location. J. Urol., 2004
;172 : 129-132.
19. ALSIKAFI N.F., BRENDLER C.B. : Surgical modifications of radical retro-
pubic prostatectomy to decrease incidence of positive surgical margins. J.
Urol., 1998 ; 159 : 1281-1285
20. SOULIE M., SEGUIN P., BENOIT J.M., ESCOURROU G., TOLLON C.,
VAZZOLER N., PONTONNIER F., PLANTE P. : Impact of a modified api-
cal dissection during radical retropubic prostatectomyon the occurrence of
positive surgical margins : a comparative study in 212 patients. Urology,
2001 ; 58 : 217-221.
F. Staerman et coll., Progrès en Urologie (2006), 16, 286-291
290
Tableau III. Evolution du PSA après radiothérapie de rattrapage pour récidive biologique
Patients (n) Dose (Gy) PSA indosable (%) (actuarielle) Suivi (mois)
Catalona 21 - 29 12
Schild et al. (1996) 46 64 50 36
Wu et al. 53 61 23 24
McCarthy et al. (1994) 37 60-65 54 33
Morris et al. (1997) 48 60-64 68 36
Forman et al. (1997) 47 66 64 36
Cadeddu et al. (1998) 30 - 37 24
Nudell et al. (1999) 36 - 47 36
Pisanski et al. (2000) 166 64 46 60
Chawla et al. (2002) 54 65 35 (5 ans) 45 (médian)
Song et al. (2002) 61 66 39 (4 ans) 36 ( médian)
Choo et al. (2002) 98 62 39 60
Liauw et al. (2003) 51 65,7 56 (3 ans) 16 (5 ans) 46 (médian)
Tsien et al. (2003) 57 64,8 35 (5 ans) 30 (8 ans) 75 (médian)
Total 805 44,4 40
 6
6
1
/
6
100%