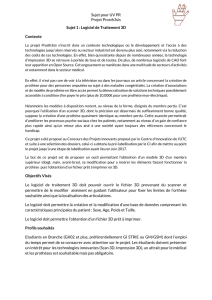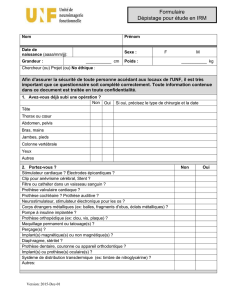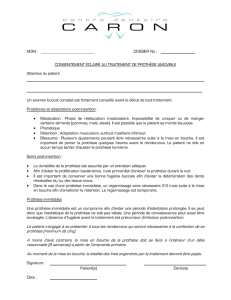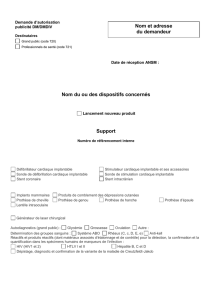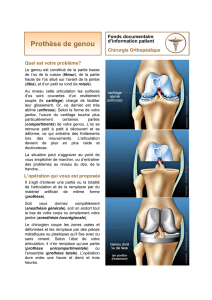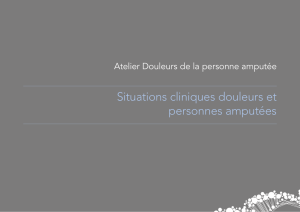Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

M. Eyer
P. Sendi
introduction
L’âge moyen de la population augmentant, l’incidence de l’ar-
throse et par conséquent le nombre d’arthroplasties sont en
progression. Des patients toujours plus âgés peuvent être opé-
rés avec un risque raisonnable. En l’absence de complications,
les implants primaires de hanche et de genou sont fonctionnels
durant quinze à vingt ans. Les infections de prothèse sont rares
(0,5-2% des implants primaires de hanche et de genou).1 Le
risque augmente pour les prothèses de révision et lors de circonstances favori-
santes (tableau 1).2,3 Le médecin de premier recours joue un rôle central dans la
reconnaissance du tableau clinique et la prise en charge.4,5 Il est le premier inter-
locuteur du patient se plaignant de douleurs, surveille les plaies opératoires, as-
sure le suivi antibiotique et les bilans biologiques. Cet article se veut un aperçu
pratique à l’attention du médecin de premier recours.
classifications
De nombreuses classifications ont été publiées. Les traditionnelles reposent
sur le mode de propagation, le tableau clinique ou la chronologie. Sur la base des
symptômes cliniques, on distingue l’infection aiguë et l’infection chronique. Selon
le moment de survenue des symptômes après l’implantation, on distingue l’in-
fection précoce (durant les deux premiers mois), différée (du 3e au 24e mois) et
tardive (au-delà de 24 mois). Selon le mode de propagation, on distingue l’infec-
tion exogène et l’infection hématogène. L’infection exogène est causée par inocu-
lation externe. Elle survient par contamination directe lors de l’implantation, d’in-
fection de plaie ou de ponction articulaire. L’infection hématogène est due à la
dissémination septique d’un foyer infectieux distant. Elle peut survenir
à tout mo-
ment
après l’implantation, cependant le risque est plus élevé durant la phase post-
opératoire précoce (figure 1). Les classifications traditionnelles permettent poten-
tiellement de déduire la pathogenèse et le germe. L’infection précoce aiguë est
typiquement causée par
Staphylococcus aureus
, l’infection différée chronique par les
staphylocoques à coagulase négative ou
Propionibacterium acnes
. L’infection tardive
Periprosthetic joint infections : a practical
overview for family physicians
Periprosthetic joint infection is a rare but se-
rious complication. Its management requires
the collaboration between general practitioner,
orthopaedic surgeon and infectious disease
specialist. A delay in the diagnosis can result
in complications, requiring complex surgical
procedures. Identification of the causative
pathogen and its susceptibility pattern is cru-
cial, because it guides both the choice of anti-
microbial treatment and the surgical strategy.
Antimicrobial treatment without proper micro-
biological sampling must be avoided. Swabs
from open wounds are not helpful, because
microorganisms belonging to the skin flora will
grow. The target audience of this review article
on periprosthetic joint infections is the gene-
ral practitioner.
Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 1871-5
L’infection de prothèse articulaire est une complication rare
mais redoutée. Sa prise en charge nécessite une collaboration
entre médecin de premier recours, orthopédiste et infectiolo-
gue. Une méconnaissance du diagnostic peut avoir pour con-
séquences des traitements chirurgicaux lourds. L’identification
du germe responsable de l’infection est essentielle. Elle guide
le choix de l’antibiothérapie et est aussi un critère décisif de
la stratégie chirurgicale. Une antibiothérapie ne devrait jamais
être instaurée sans prélèvement microbiologique adéquat
préalable. Ici, le frottis de plaie superficielle n’est d’aucune
utilité, car il reflète tout au plus la colonisation par des germes
de la flore cutanée. Cette revue se veut un aperçu pratique des
infections de prothèse articulaire à l’attention du médecin de
premier recours.
Infections de prothèse articulaire :
aspects pratiques à l’attention
du médecin de premier recours
pratique
Dr Myriam Eyer
Service des maladies infectieuses
Institut central, Hôpital du Valais
Avenue du Grand Champsec 86
1951 Sion
Dr Parham Sendi, PD
Universitätsklinik für Infektiologie,
Inselspital
und Institut für Infektionskrankheiten
Universität Bern, 3010 Bern
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
8 octobre 2014 1871
23_27_38128.indd 1 02.10.14 09:46

aiguë, chez le patient jusqu’alors asymptomatique, est typi-
quement hématogène et causée par un germe virulent tel
que
Staphylococcus aureus
ou
Escherichia coli
. Bien souvent, la
terminologie traditionnelle est source de confusion, notam-
ment lorsque le caractère aigu d’une infection est assimilé
à sa chronologie. Dans la pratique, une nouvelle classifica-
tion des infections de prothèse s’est établie comme suit :6
1. L’infection aiguë, qui peut se manifester durant deux pé-
riodes différentes :
A.
Infection hématogène aiguë,
dont la durée de symptoma-
tologie est m 3 semaines chez un patient ayant présenté
un suivi postopératoire sans particularité. Elle peut sur-
venir
à tout moment
après l’implantation.
B.
Infection postinterventionnelle précoce,
qui se manifeste au
cours des quatre semaines suivant une procédure invasive
(par exemple, implantation de prothèse ou arthrocentèse).
2. L’infection chronique, dont la symptomatologie dure plus
de trois semaines, ou qui survient plus d’un mois après
l’intervention.
Cette nouvelle classification permet une distinction simple
entre les infections pouvant être traitées par débridement
chirurgical et celles nécessitant une ablation de l’implant.
bactériologie
Les micro-organismes fréquemment isolés dans les infec-
tions de prothèse sont présentés dans le tableau 2.1,2 Leur
diversité explique le rôle crucial de l’identification micro-
biologique et de l’antibiogramme. Un frottis de plaie ou de
fistule n’a aucune utilité diagnostique, car il reflète la colo-
nisation par des germes de la flore cutanée sans mettre en
évidence les germes responsables de l’infection. Ceux-ci
doivent être identifiés par ponction articulaire ou biopsie.
Ces interventions doivent généralement être effectuées par
le chirurgien lui-même et dans les meilleures conditions
possibles d’asepsie, car un implant (non infecté) est excep-
tionnellement sensible à des contaminations microbien-
nes même infimes.
présentations cliniques
et recommandations
Infection aiguë
La plupart des infections postinterventionnelles précoces
sont d’origine exogène. Cliniquement, on observe un pro-
cessus de cicatrisation perturbé avec suintement, déhiscen-
ce secondaire, douleurs aiguës, épanchement, rougeur et
chaleur. Les signes inflammatoires systémiques (fièvre, élé-
vation de la CRP, déviation gauche) peuvent être absents.7
Une méconnaissance du tableau clinique engendre un re-
tard dans le diagnostic et donc la perte de l’option théra-
peutique la moins invasive, à savoir le débridement et le
maintien de la prothèse. Cette stratégie a de bonnes chances
de succès seulement durant un court laps de temps après
l’apparition des symptômes. Au-delà d’un mois, un change-
ment de prothèse est souvent nécessaire.
L’infection hématogène aiguë est due à une dissémina-
tion septique d’un foyer infectieux distant. Le foyer primaire
typique est une infection de la peau, des voies respiratoires
ou urinaires. Toutefois, il n’est pas rare qu’aucun foyer pri-
maire ne soit identifié (bactériémie primaire). Souvent, l’in-
fection hématogène n’est pas reconnue tout de suite car les
1872 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
8 octobre 2014
Tableau 1. Facteurs de risque* pour les infections
de prothèse
(Adapté de réf.2).
* Liste non exhaustive.
Risques liés aux comorbidités du patient
• Sexe masculin
• Obésité
• Diabète sucré
• Arthrite rhumatoïde
• Immunosuppression/corticostéroïdes
• Tumeur maligne
• Tabagisme
Risque exogène
Arthrite post-traumatique
Risques liés à la chirurgie
• Prothèse de révision
• Chirurgie de révision
• Arthroplastie bilatérale
• Opération de longue durée (L 2,5 heures)
• Complications postopératoires
• Complications de la cicatrisation (par exemple infection superficielle,
hématome, retard de cicatrisation, plaie nécrosée, déhiscence)
Risque endogène
Bactériémie à S. aureus3
Micro-organismes Fréquence (%)
Staphylocoques à coagulase négative 30-40
Staphylococcus aureus 15-25
Streptocoques 9-10
Bacilles à Gram négatif 3-6
Entérocoques 3-7
Anaérobies 2-4
Infections polymicrobiennes 10-11
Tableau 2. Micro-organismes fréquemment isolés
dans les infections de prothèse
(Adapté de réf.1,2).
Figure 1. Classification selon la pathogenèse
(Adaptée de réf.13).
1
0,5
1 2 Années
Incidence d’infection de prothèse (%)
Exogène
Hématogène
23_27_38128.indd 2 02.10.14 09:46

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
8 octobre 2014 1873
symptômes prédominants sont attribuables au foyer primai-
re et les douleurs articulaires n’apparaissent que plus tard.
Les signes inflammatoires systémiques sont importants.7
Lors d’infections bactériémiques chez un porteur de pro-
thèse, des symptômes tels que douleurs articulaires nouvel-
les doivent être activement évoqués dans l’anamnèse. A
noter qu’un ensemencement hématogène de la prothèse
survient dans 30-40% des bactériémies à
S. aureus
.3 Afin de
prévenir la colonisation hématogène de l’implant, il est donc
essentiel de traiter rapidement tout autre foyer infectieux
patent chez le porteur de prothèse. Lors d’infection de pro-
thèse déjà établie, le patient doit être adressé rapidement
à l’hôpital afin de confirmer le diagnostic, isoler le germe, et
ainsi possiblement éviter un changement de prothèse. Un
retard de diagnostic peut avoir pour conséquences l’appa-
rition d’une fistule et nécessiter une ablation de l’implant.
Infection chronique
Elle est d’origine exogène ou, rarement, hématogène si
elle n’est pas reconnue précocement et persiste durant des
semaines. L’infection exogène causée lors de l’implantation
par contamination directe se manifeste généralement au-
delà du premier mois qui suit l’intervention. Cependant, les
patients se plaignent souvent de douleurs depuis le mo-
ment de l’implantation (infection à bas bruit). Les douleurs
sont causées soit par l’inflammation locale, soit plus tard
par le décèlement de l’implant. Le signe clinique prépon-
dérant est un épanchement articulaire. Occasionnellement,
une fistule peut se former. La CRP et la vitesse de sédimen-
tation ne présentent pas de normalisation après la chirurgie
et restent légèrement élevées. Lors d’infection chronique,
un maintien de prothèse est irréaliste, car la durée des
symptômes est très longue et un biofilm bactérien épais
adhère sur celle-ci. Les germes responsables étant généra-
lement peu virulents et le patient peu incommodé, un diag-
nostic précis peut être effectué avant le traitement chirur-
gical.
concept thérapeutique
L’objectif thérapeutique est l’éradication de l’infection
en conservant une prothèse fonctionnelle et non doulou-
reuse. Il peut être atteint au mieux si l’infection est détectée
précocement et les principes thérapeutiques sont respec-
tés.8 La prise en charge globale du patient présuppose une
collaboration optimale entre médecin de premier recours
et hôpital. A la moindre suspicion d’infection, le praticien
doit rapidement adresser son patient à l’opérateur, car
l’impact fonctionnel dépend notamment du succès du
pre-
mier
traitement. Pour autant que le patient ne soit pas sep-
tique, une antibiothérapie ne doit en aucun cas être instau-
rée sans prélèvement microbiologique adéquat préalable.
La prescription d’antibiotiques sans intervention chirurgi-
cale, même en présence d’un diagnostic microbiologique,
est une démarche tout aussi erronée.
En principe, il y a cinq options chirurgicales possibles :
1) débridement avec maintien de prothèse, 2) changement
de prothèse en un temps, 3) changement de prothèse en
deux temps, 4) ablation définitive de prothèse (opération
de Girdlestone) et 5) traitement antibiotique suppressif au
long cours sans intervention chirurgicale.1 Les critères dé-
cisifs pour le choix de la stratégie chirurgicale sont évalués
en concertation interdisciplinaire. Ils ont été présentés dans
des articles antérieurs de ce journal et d’autres.1,2,8,9 Rare-
ment, lors de comorbidités graves, aucun traitement chirur-
gical n’est envisageable. La prothèse infectée est alors main-
tenue sous antibiothérapie suppressive sur 1-2 ans, voire à
vie. Il ne s’agit pas d’un traitement à visée curative, mais
d’une approche palliative. Ici particulièrement, le médecin
de premier recours doit participer activement au processus
décisionnel.
choix et durée du traitement
antibiotique
Le principe du traitement antibiotique des infections de
prothèse repose sur une durée prolongée et des concen-
trations plasmatiques hautes. En phase postopératoire, une
antibiothérapie intraveineuse est prescrite empiriquement,
puis selon l’antibiogramme du germe isolé. Après dix à qua-
torze jours, le traitement est généralement relayé par voie
orale. Plusieurs critères influencent le choix de l’antibiothé-
rapie :
• sensibilité du germe et stabilité vis-à-vis des mutations
de résistance ;
• biodisponibilité et distribution tissulaire ;
• toxicité, tolérance et interactions médicamenteuses.
Le traitement antibiotique des infections de prothèse à
staphylocoques est établi.10 Si le germe est sensible, la ri-
fampicine, associée à un autre antibiotique, est particuliè-
rement efficace en raison de son excellente activité sur les
staphylocoques adhérant en biofilm à la surface de l’implant
(phase stationnaire de croissance). La rifampicine doit être
utilisée
uniquement en association avec un autre antibiotique actif
contre le germe,
idéalement avec une quinolone. Le choix du
traitement antibiotique se fait sur recommandation de l’in-
fectiologue. Les substances mentionnées ci-dessus ne sont
jamais
prescrites empiriquement. Il s’agit de traitements de
durée prolongée, en général trois mois. Le praticien doit
faire preuve d’une attention particulière aux problèmes
d’adhésion thérapeutique ainsi qu’aux effets secondaires
et interactions (tableau 3). Par exemple, la rifampicine est
un puissant inducteur du cytochrome P450, dont l’effet at-
teint son maximum une semaine après son introduction, et
s’atténue progressivement deux semaines après son arrêt.
Elle peut donc augmenter le métabolisme des médicaments
administrés conjointement, entraînant des concentrations
plasmatiques sous-thérapeutiques et une inefficacité de
ceux-ci. La prudence est donc de mise.
antibioprophylaxie avant traitements
dentaires
Il n’y a pas d’indication à une antibioprophylaxie avant
traitements dentaires chez les porteurs de prothèse articu-
laire car le risque d’infection hématogène est négligeable.
Une étude, publiée en 2010, montre qu’environ 1250 pa-
tients porteurs de prothèse devraient recevoir une anti-
bioprophylaxie pour prévenir une seule infection.11,12 Une
hygiène dentaire soigneuse semble beaucoup plus impor-
23_27_38128.indd 3 02.10.14 09:46

1874 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
8 octobre 2014
Substances Effets indésirables Surveillance et mesures à prendre
Rifampicine Coloration rouge-orangée des sécrétions corporelles, de l’urine et des lentilles Informer le patient
de contact souples
Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements) Symptômes cliniques ; éventuelle réduction
de dose après avis infectiologique
Hypersensibilité (fièvre, réactions cutanées) Symptômes cliniques ; éventuelle réduction
de dose après avis infectiologique ou
changement de substance
Hépatite Symptômes cliniques, ASAT, ALAT
Augmentation du métabolisme par le P450 de médicaments administrés Co-administration à éviter si possible ;
conjointement (anticoagulants oraux, pilules contraceptives, corticostéroïdes, symptômes cliniques, taux sériques, temps de
anticonvulsifs, antidépresseurs, sédatifs, antipsychotiques, antihypertenseurs, thromboplastine
antiarythmiques, substances immunodépressives, inhibiteurs de protéase,
méthadone…)
Syndrome de type grippal, thrombocytopénie, insuffisance rénale Symptômes cliniques, formule sanguine,
créatinine
Fluoroquinolones Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) Symptômes cliniques
(ciprofloxacine, Troubles du système nerveux (céphalées, insomnie, confusion) Symptômes cliniques
lévofloxacine)
Troubles de la fonction rénale Créatinine
Effet additif sur l’allongement de l’intervalle QT lors de l’administration ECG
concomitante avec des médicaments susceptibles de prolonger l’intervalle QT
Formation d’un complexe chélate lors de prise simultanée de Prise 1-2 h avant ou 4 h après ces médicaments
médicaments contenant magnésium, aluminium, calcium, phosphate ou les produits laitiers
Tétracyclines Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) Symptômes cliniques
(doxycycline, Réactions cutanées (photosensibilité, éruption cutanée, hyperpigmentation) Symptômes cliniques
minocycline)
Troubles du système nerveux (vertiges) Symptômes cliniques
Résorption diminuée lors de prise simultanée de médicaments contenant Prise 1-2 h avant ou 4 h après ces médicaments
des cations (magnésium, aluminium, calcium, fer) ou les produits laitiers
Triméthoprime/ Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée) Symptômes cliniques
sulfaméthoxazole Troubles de la formule sanguine (leucopénie, anémie, thrombocytopénie) Formule sanguine
Hypersensibilité (fièvre, éruption cutanée, syndrome de Stevens-Johnson) Symptômes cliniques
Troubles rénaux (néphrite interstitielle, élévation de la créatinine) Créatinine, sédiment urinaire
Clindamycine Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée, colite à Symptômes cliniques
Clostridium difficile)
Réactions cutanées Symptômes cliniques
Acide fusidique Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements) Symptômes cliniques
Réactions cutanées Symptômes cliniques
Troubles hépato-biliaires Tests hépatiques
Troubles rénaux Créatinine
Inhibition réciproque du métabolisme lors de coadministration de médicaments Coadministration à éviter ; symptômes
également métabolisés par le CYP3A4 (statines, anticoagulants oraux, inhibiteurs cliniques, taux sériques
de protéase, ciclosporine) et risque de toxicités associées
Linézolide Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements) Symptômes cliniques
Troubles de la formule sanguine (leucopénie, anémie, thrombocytopénie) Formule sanguine
Troubles du système nerveux (céphalées, vertiges, neuropathies) Symptômes cliniques
Métronidazole Troubles gastro-intestinaux (nausées) Symptômes cliniques
Troubles du système nerveux (céphalées, vertiges, neuropathies périphériques) Symptômes cliniques
Augmentation de l’activité d’anticoagulants oraux Temps de thromboplastine
Tableau 3. Effets indésirables fréquents et surveillance de l’antibiothérapie ambulatoire
23_27_38128.indd 4 02.10.14 09:46

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
8 octobre 2014 1875
tante en termes de prévention. Il faut par ailleurs distinguer
les infec tions florides (abcès dentaire, ostéomyélite de la
mâchoire) qui nécessitent un traitement antibiotique et
éventuellement chirurgical.
conclusion
Une infection de prothèse articulaire peut survenir à
tout moment après son implantation. En cas de suspicion,
il importe d’éviter tout traitement antibiotique empirique
au cabinet médical et de référer rapidement le patient à
l’orthopédiste afin de confirmer le diagnostic microbiologi-
quement et de définir l’attitude chirurgicale. Un retard dans
le diagnostic ou un traitement inadéquat peuvent être pré-
judiciables.
Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec
cet article.
Implications pratiques
La prise en charge des infections de prothèses articulaires
nécessite une collaboration étroite entre médecin de premier
recours, orthopédiste et infectiologue
Une méconnaissance du diagnostic peut avoir pour consé-
quences des traitements chirurgicaux lourds
Une antibiothérapie empirique ne doit en aucun cas être
instaurée sans prélèvement microbiologique adéquat préa-
lable. De préférence, elle doit être instaurée en milieu hos-
pitalier après avis de l’infectiologue
Le frottis de plaie n’est d’aucune utilité, car il reflète la colo-
nisation par des germes de la flore cutanée et ne permet pas
de mettre en évidence les germes responsables de l’infection
Les infections exogènes sont pour la plupart acquises dans la
phase périopératoire. Les infections hématogènes peuvent
survenir à tout moment de la durée de vie d’une prothèse
Tout foyer infectieux manifeste (par exemple : infection de
la peau, des voies respiratoires ou urinaires) doit être rapi-
dement traité chez le patient porteur de prothèse, afin de
prévenir un ensemencement hématogène de l’implant
Des douleurs au niveau de l’implant doivent être rapidement
investiguées par le chirurgien lui-même. Les infiltrations arti-
culaires de corticoïdes ou d’analgésiques n’ont pas leur place
ici
Il n’y a pas d’indication à une antibioprophylaxie avant les
traitements dentaires chez les porteurs de prothèses arti-
culaires
>
>
>
>
>
>
>
>
1 ** Zimmerli W, Trampuz A, Ochsner PE. Prosthe-
tic-joint infections. N Engl J Med 2004;351:1645-54.
2 Del Pozo JL, Patel R. Infection associated with
prosthetic joints. N Engl J Med 2009;361:787-94.
3 Sendi P, Banderet F, Graber P, Zimmerli W. Peri-
prosthetic joint infection following Staphylococcus au-
reus bacteremia. J Infect 2011;63:17-22.
4 Sendi P, Zumstein MA, Zimmerli W. Prothesenin-
fektionen – Eine Übersichtsarbeit für die Praxis. Praxis
2011;100:787-92.
5 Zimmerli W, Kissling B. Gelenkprotheseninfekt :
Was sollte der Praktiker wissen ? Primary Care 2013;
13:156-7.
6 * Zimmerli W, Sendi P. Orthopedic implant-asso-
ciated infections. In : Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ (eds).
Mandell, Douglas and Bennett’s Principles and Practice
of Infectious Diseases, 8th ed. 2014. In press.
7 Sendi P, Banderet F, Graber P, Zimmerli W. Clinical
comparison between exogenous and haematogenous
periprosthetic joint infections caused by Staphylococcus
aureus. Clin Microbiol Infect 2011;17:1098-100.
8 ** Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, et al. Diag-
nosis and management of prosthetic joint infection :
Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases
Society of America. Clin Infect Dis 2013;56:e1-25.
9 * Borens O, Tissot C, Delaloye JR, Trampuz A. Dix
erreurs à ne pas commettre lors de la prise en charge
d’une prothèse articulaire infectée en orthopédie. Rev
Med Suisse 2012;8:2452-6.
10 Zimmerli W, Widmer AF, Blatter M, et al. Role of
rifampin for treatment of orthopedic implant-related
staphylococcal infections : A randomized controlled trial.
JAMA 1998;279:1537-41.
11 Berbari EF, Osmon DR, Carr A, et al. Dental proce-
dures as risk factors for prosthetic hip or knee infection :
A hospital-based prospective case-control study. Clin
Infect Dis 2010;50:8-16.
12 * Zimmerli W, Sendi P. Antibiotics for prevention
of periprosthetic joint infection following dentistry :
Time to focus on data. Clin Infect Dis 2010;50:17-9.
13 Trampuz A. Der Implantat-assoziierte Biofilm. In :
Schweizer Expertengruppe. Infektionen des Beweg ungs-
apparates, 1st ed. Grandvaux. Swiss orthopaedics 2013;
17-21.
* à lire
** à lire absolument
Bibliographie
23_27_38128.indd 5 02.10.14 09:46
1
/
5
100%