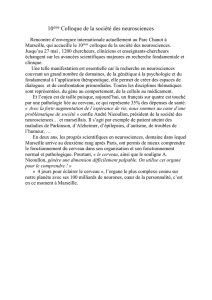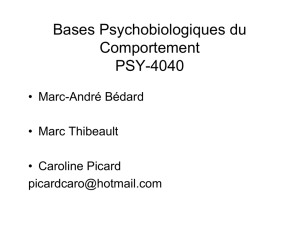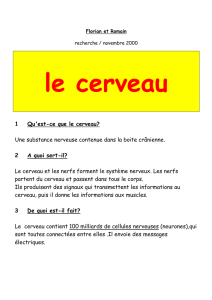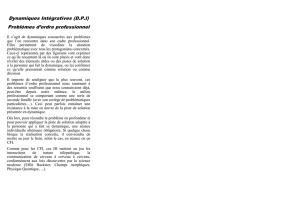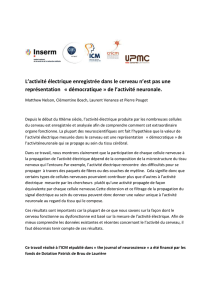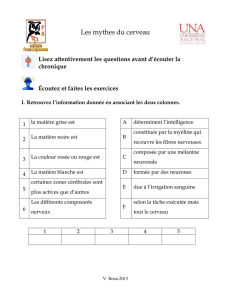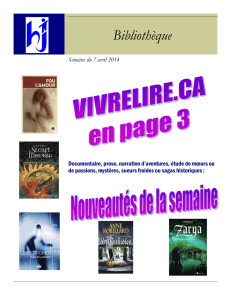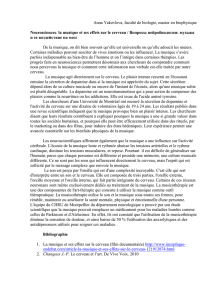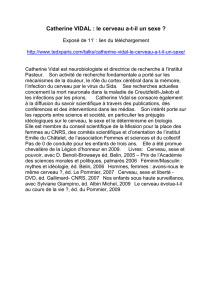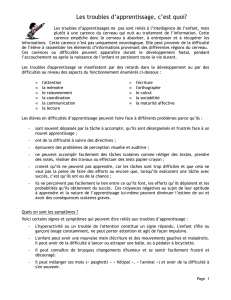Lester et Gorzalka

C
HAPITRE
U
N
La biopsychologie,
une discipline
neuroscientifique
Qu’est-ce que la biopsychologie ?
1.1
Qu’est-ce que la biopsychologie ?
1.2
Relation entre la biopsychologie et les autres
disciplines des neurosciences
1.3
Types de recherche caractérisant l’approche
biopsychologique
1.4
Subdivisions de la biopsychologie
1.5
Opérations convergentes : comment
les biopsychologues travaillent ensemble
1.6
Inférences scientifiques :
comment les biopsychologues étudient
le fonctionnement, non directement
observable, du cerveau ?
1.7
Critique des affirmations de la biopsychologie
Chap01.fm Page 1 Vendredi, 8. juin 2007 6:06 06
ÉPREUVES

2
Chapitre 1
La biopsychologie, une discipline neuroscientifique
FIGURE 1.1
Cerveau humain.
’apparence du cerveau humain n’a rien d’impres-
sionnant (voir figure 1.1). Il s’agit d’une masse de
tissu spongieux et plissé, pesant environ 1,3 kilo,
et dont la forme fait penser à une noix. Il ressemble plus
à ces déchets roulés par les vagues qu’on trouve sur les
plages qu’à une des merveilles du monde, ce qu’il est
pourtant. En dépit de cette apparence peu prestigieuse, le
cerveau humain est un réseau de
neurones
étonnamment
complexe (les neurones sont les cellules qui reçoivent et
transmettent les signaux électrochimiques). Voyez
la complexité des circuits neuronaux de votre
propre cerveau. On estime à 100 milliards le
nombre de neurones rassemblés de manière
complexe et à 1 000 milliards le nombre
de leurs connexions, le nombre de voies
possibles à travers ce magma étant
infini.
Accueil par John Pinel (
Greetings
from the Author
).
La complexité du cerveau humain
n’est pas si surprenante quand on
considère tout ce qu’il peut faire. Un
organe qui est capable de fabriquer
La
Joconde
, un membre artificiel ou un
avion supersonique, qui a permis
d’aller sur la Lune et dans les profon-
deurs de la mer, qui permet de vivre
les miracles que sont un coucher de
soleil sur les Alpes, un nouveau-né, ou
encore un smash bien assené, un tel
organe ne peut qu’être complexe. Paradoxa-
lement, les
neurosciences
(l’étude scientifi-
que du système nerveux) pourraient bien être le
dernier défi du cerveau : sera-t-il capable de
comprendre sa propre complexité ?
Les neurosciences comportent plusieurs dis-
ciplines reliées entre elles. Le premier objec-
tif de ce chapitre est de vous présenter l’une
d’elles : la biopsychologie. Chacune des sept
sections de ce chapitre caractérise la biopsychologie d’une
manière différente.
Avant d’entamer ce chapitre, je voudrais vous exposer deux
choses : (1) le cas de Jimmie G., qui va vous donner un avant-
goût de l’intéressant contenu de cet ouvrage, et (2) les principaux
thèmes qui y seront développés.
Le cas de Jimmie G.,
l’homme gelé dans le temps
[En 1975], Jimmie était un bel homme de quarante-
neuf ans, en pleine santé, avec une masse de cheveux
gris bouclés. Il était gai, amical et chaleureux.
« Hello, Doc ! dit-il. Belle matinée ! Je prends
cette chaise ? » […] Il parla des maisons où avait
vécu sa famille […], de l’époque de l’école, des
amis qu’il y avait et de son goût particulier pour les
mathématiques et les sciences. Il avait dix-sept ans,
il venait juste d’obtenir son diplôme de fin de lycée
lorsqu’il fut appelé en 1943. […] Il se souvenait des
noms des sous-marins sur lesquels il avait servi, de
leurs missions, des endroits où il avait stationné,
des noms de ses équipiers. […] Mais pour je ne sais
quelle raison, ses souvenirs s’arrêtaient là…
[…] Je fus frappé par le changement de temps
de conjugaison qu’il utilisait pour parler de ses
souvenirs d’école dans la Marine. Après avoir
employé le passé, maintenant il utilisait le pré-
sent.
[…] Soudain, je fus saisi d’un soupçon
invraisemblable.
« En quelle année sommes-nous,
M. G. ? lui demandai-je en dissi-
mulant ma perplexité sous un air
désinvolte.
— Quarante-cinq, mec. Pour-
quoi ? (Puis il poursuivit :)
Nous avons gagné la guerre,
Roosevelt est mort et Tru-
man est aux commandes.
Nous avons du temps
devant nous.
— Et vous, Jimmie, quel
âge avez-vous ?
— Pourquoi ? Je dois avoir
dix-neuf ans, Doc. J’en
aurai vingt à mon prochain
anniversaire. »
En regardant l’homme aux
cheveux gris qui se tenait
devant moi, j’eus une pulsion
que je ne me suis jamais par-
donnée…
« Là, lui dis-je en lui tendant
une glace. Regardez dans la
glace et dites-moi ce que vous
voyez… »
Il pâlit aussitôt et s’agrippa à sa chaise.
« Bon Dieu, chuchota-t-il. Bon Dieu,
qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui
m’arrive ? C’est un cauchemar ? Je suis
devenu fou ? C’est une plaisanterie ? » Il était
affolé, paniqué.
Je m’esquivai en emportant l’horrible miroir.
Deux minutes plus tard, je revins dans la pièce.
« Hello, Doc ! dit-il. Belle matinée ! Vous voulez
me parler ? Je prends cette chaise ? » Son visage
franc et ouvert n’exprimait aucun signe permet-
tant de penser qu’il me reconnût.
« Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés,
M. G. ? lui demandai-je avec désinvolture.
— Non, je ne pense pas. Quelle belle barbe vous
avez là ! Je n’aurais pas pu vous oublier, Doc ! […]
— Où pensez-vous que nous soyons, ici ?
— Je vois des lits et des malades partout. On
dirait une sorte d’hôpital. Mais, diable, qu’est-ce
que je pourrais bien faire dans un hôpital, au
milieu de tous ces vieux, tous plus âgés que
moi ?… Peut-être que je
travaille
ici… Si je ne tra-
vaille pas ici, c’est qu’on m’y a
mis
… Je suis un
patient, je suis malade sans le savoir, Doc ? C’est
fou, c’est épouvantable… »
L
Chap01.fm Page 2 Vendredi, 8. juin 2007 6:06 06
ÉPREUVES

1.1
Qu’est-ce que la biopsychologie ?
3
Souvenez-vous de Jimmie G. ; vous le retrouverez au cours
de ce chapitre.
Les quatre principaux thèmes de cet ouvrage
Vous allez apprendre beaucoup de choses nouvelles dans cet
ouvrage : idées, concepts, structures cérébrales, etc. Mais le
plus important, c’est que, plus tard, bien après avoir oublié la
plupart de ces choses nouvelles, vous aurez gardé en vous une
nouvelle façon de penser. J’ai sélectionné quatre idées nouvel-
les d’une importance particulière, qui sont les quatre grands
thèmes de cet ouvrage.
La pensée biopsychologique
Compte tenu de l’intérêt
scientifique (comme vous l’avez vu avec le cas de Jimmie G.)
et de l’importance dans la vie courante des divers sujets
qu’aborde la biopsychologie, nous recevons constamment
(par la télévision, les journaux, Internet, les amis, les relations,
les enseignants, etc.) des informations et des avis relatifs à la
biopsychologie. L’un des principaux buts de ce livre est de
vous aider à passer du stade de consommateur passif de bio-
psychologie au stade de penseur efficace et critique,
quelqu’un qui ne prend rien pour argent comptant, mais qui
évalue et juge les choses de son propre point de vue et en fonc-
tion de son style de vie.
Les implications cliniques
Les considérations
cliniques
(relatives à la maladie ou au traitement) font partie de la bio-
psychologie. Les études sur le cerveau malade ou lésé appren-
nent beaucoup de choses aux biopsychologues sur le
fonctionnement normal du cerveau. Réciproquement, beau-
coup de découvertes faites par les biopsychologues sont utiles
pour traiter les troubles du cerveau. Ce livre se focalise sur
l’interaction entre les dysfonctionnements cérébraux et la bio-
psychologie.
Les quatre thèmes (
Themes of Biopsychology
).
La perspective évolutionniste
Bien que l’on ne puisse
pas déterminer avec certitude les mécanismes de l’évolution
de l’espèce humaine, l’hypothèse selon laquelle notre cerveau
et notre comportement ont évolué sous l’influence de l’envi-
ronnement a souvent été à l’origine des grandes découvertes
de la biopsychologie. C’est ce qu’on appelle la
perspective
évolutionniste
. Un aspect important de cette perspective est
l’
approche comparative
(tenter de comprendre les phénomè-
nes biologiques par leur comparaison dans diverses espèces).
Vous apprendrez dans cet ouvrage que nous, les êtres
humains, avons appris beaucoup de choses sur nous-mêmes
en étudiant des espèces qui nous sont liées dans l’évolution.
L’approche évolutionniste est l’un des fondements de la bio-
psychologie moderne.
Les neurosciences cognitives
L’avancée dans un champ
disciplinaire quel qu’il soit est conditionnée pour une grande
part par les innovations technologiques. Le développement
d’un nouvel instrument de recherche est souvent suivi d’une
série de découvertes. Il n’en est pas de meilleur exemple que les
neurosciences cognitives
, qui sont l’un des domaines relative-
ment nouveaux de la biopsychologie, et qui ont été alimentées
par le développement des méthodes de création d’images de
l’activité du cerveau vivant. Grâce aux méthodes d’imagerie
cérébrale fonctionnelle, les neurosciences cognitives étudient
les régions cérébrales qui s’activent lorsque les sujets sont enga-
gés dans des
processus
cognitifs
(c’est-à-dire se rapportant à la
pensée), comme la mémoire, l’attention et la perception.
nm
1.1 Qu’est-ce que la biopsychologie ?
La
biopsychologie
est l’étude scientifique de la biologie du
comportement (voir Dewsbury, 1991). Les
psychobiologistes,
les biologistes du comportement ou les neuroscientifiques du
comportement
se réfèrent à ce courant de recherche. Je préfère
Les tests d’intelligence révélèrent chez lui
d’excellentes capacités. Il était très vif, observa-
teur, logique, et il n’avait aucun mal à résoudre
des problèmes et des énigmes difficiles – à condi-
tion que cela prît peu de temps. Sinon, il oubliait
ce qu’il était en train de faire…
Pour en revenir à sa mémoire, je me trouvais en
présence d’une immense et extraordinaire perte
de mémoire des faits récents – de sorte que tout ce
qu’on lui disait ou montrait avait toutes les chan-
ces d’être oublié en quelques secondes. Ainsi, je
posai ma montre, ma chaîne et mes lunettes sur le
bureau, je les recouvrai et je lui demandai de s’en
souvenir. Après avoir discuté avec lui pendant une
minute, je lui demandai de me dire ce que j’avais
recouvert. Il ne se souvint de rien – pas même que
je lui avais demandé de se souvenir de quelque
chose. Je répétai le test en lui demandant, cette
fois, d’écrire les noms des trois objets. De nouveau,
il oublia tout et il fut étonné quand je lui montrai
le papier sur lequel il avait écrit…
« Qu’est-ce que c’est ? lui demandai-je en lui
montrant une photo dans le magazine que je
tenais.
— C’est la Lune, répliqua-t-il.
— Non, ce n’est pas la Lune, lui répondis-je. C’est
une photo de la Terre prise de la Lune.
— Doc, vous plaisantez ! Il faudrait que
quelqu’un ait apporté un appareil photo là-
haut !… Comment est-ce que ce serait
possible ? »
Soumis à la pression constante de ces anomalies
et de ces contradictions, et de leurs implications
effrayantes, il fut gagné par la fatigue, l’angoisse
et même la colère… Moi-même, j’étais très ému –
il était terrible de penser à cette vie qui se dissol-
vait dans l’oubli.
Il était en quelque sorte bloqué à un moment de
son existence, un fossé d’oubli tout autour de
lui… C’était un homme sans passé (ni futur),
enlisé dans un moment constamment changeant,
sans signification.
(De
L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau
, par
Oliver Sacks. Reproduit avec l’autorisation du Groupe
Simon & Schuster Adult Publishing. Copyright © 1970, 1981,
1983, 1984, 1985 Oliver Sacks.)
Chap01.fm Page 3 Vendredi, 8. juin 2007 6:06 06
ÉPREUVES

4
Chapitre 1
La biopsychologie, une discipline neuroscientifique
néanmoins le terme de
biopsychologie,
parce qu’il traduit plus
l’étude de la psychologie par une approche biologique que
l’étude de la biologie par une approche psychologique : la
psychologie est au cœur de ce texte. La
psychologie
est l’étude
scientifique du comportement, c’est-à-dire l’étude scientifi-
que de toutes les activités de l’organisme sur l’environnement
ainsi que des processus internes censés leur être sous-jacents
(comme l’apprentissage, la mémoire, la motivation, la percep-
tion et l’émotion).
L’étude de la biologie du comportement a une longue his-
toire, mais la biopsychologie, quant à elle, n’a pas été une
discipline majeure des neurosciences avant le
XXe
siècle. Bien
qu’il ne soit pas possible de dater précisément la naissance
de la biopsychologie, la publication de
L’organisation du
comportement
en 1949, par D. O. Hebb, a joué un rôle clé
dans son émergence (voir Brown & Milner, 2003 ; Milner,
1993 ; Milner & White, 1987). Dans son ouvrage, Hebb a
développé la première théorie visant à expliquer grâce à l’acti-
vité cérébrale des phénomènes psychologiques complexes,
comme la perception, les émotions, la pensée, la mémoire. La
théorie de Hebb a beaucoup œuvré contre le point de vue selon
lequel le fonctionnement psychologique serait trop complexe
pour être fondé sur la physiologie et la chimie du cerveau.
Hebb a fondé sa théorie sur des expériences impliquant à la
fois des hommes et des animaux de laboratoire, sur des études
de cas cliniques et sur des arguments logiques développés à la
lumière de ses propres observations de la vie de tous les jours.
Cette approche éclectique est devenue la marque de fabrique
de l’investigation biopsychologique.
Comparée à la physique, la chimie ou la biologie, la biopsy-
chologie est un enfant, certes en pleine santé et à la croissance
rapide, mais un enfant quand même. Dans ce livre, vous récol-
terez les bénéfices de la jeunesse de la biopsychologie, et vous
vivrez en direct l’excitation des recherches actuelles.
nm
1.2 Relation entre la biopsychologie
et les autres disciplines
des neurosciences
Les neurosciences sont un travail d’équipe, et les biopsycho-
logues constituent une part importante de cette équipe (voir
Albright, Kandel & Posner, 2000 ; Kandel & Squire, 2000).
En discutant des relations entre la biopsychologie et les autres
disciplines des neurosciences, cette section va définir de
manière plus précise la biopsychologie.
Les biopsychologues sont des neuroscientifiques dont la
contribution concerne la connaissance du comportement et
des méthodes de recherche sur le comportement. C’est leur
orientation comportementale et leur expertise dans ce
domaine qui rend unique leur contribution aux neurosciences.
Vous apprécierez mieux l’importance de cette contribution si
vous comprenez que la finalité ultime du système nerveux est
de produire et de contrôler le comportement (voir Doupe &
Heisenberg, 2000 ; Grilner & Dickson, 2002).
La biopsychologie est une discipline intégrative. Les biopsy-
chologues tirent leurs connaissances des autres disciplines neu-
roscientifiques, qu’ils appliquent à l’étude du comportement.
Voici quelques-unes des disciplines particulièrement impor-
tantes pour la biopsychologie.
La
neuroanatomie.
L’étude des structures du système
nerveux (voir chapitre 3).
La neurochimie.
L’étude du support chimique de l’acti-
vité neuronale (voir chapitre 4).
La neuroendocrinologie.
L’étude des interactions entre
le système nerveux et le système endocrinien (voir
chapitres 13 et 17).
La neuropathologie.
L’étude des troubles du système
nerveux (voir chapitre 10).
La neuropharmacologie.
L’étude des effets des drogues
sur l’activité neuronale (voir chapitres 4, 15 et 18).
La neurophysiologie.
L’étude des fonctions et activités
du système nerveux (voir chapitre 4).
nm
1.3 Types de recherche caractérisant
l’approche biopsychologique
Si la biopsychologie n’est qu’une des nombreuses disciplines
des neurosciences, elle est elle-même vaste et variée. Les bio-
psychologues étudient beaucoup de phénomènes différents et
leurs démarches méthodologiques sont extrêmement diverses.
Afin de caractériser la recherche en biopsychologie, nous
allons traiter des trois aspects essentiels qui différencient les
approches : la recherche s’appuie sur des sujets humains ou non
humains ; elle peut prendre ou non la forme d’expériences ; elle
peut être fondamentale ou appliquée.
Sujets humains et non humains
Les sujets des recherches en biopsychologie peuvent être des
animaux humains (pour les sujets humains, on dit de plus en
plus des « participants ») ou des animaux non humains. Parmi
ces derniers, les plus courants sont les rats ; cependant, les
souris, les chats, les chiens et les primates non humains sont
également beaucoup étudiés.
Les humains présentent plusieurs avantages par rapport aux
autres animaux. Ils peuvent suivre des consignes, raconter leur
expérience subjective, et leurs cages sont plus faciles à net-
toyer. Je plaisante quand je parle de cages, mais, par cette bou-
tade, je veux attirer votre attention sur un des avantages des
humains sur les autres animaux : les humains sont tout simple-
ment plus économiques. Étant donné que seules les normes les
plus exigentes sont acceptables en matière de soins des ani-
maux utilisés en recherche, le coût de maintenance d’un
animal de laboratoire peut être prohibitif pour les chercheurs,
sauf pour ceux qui bénéficient de crédits importants.
Mais, bien évidemment, le principal avantage des humains
pour une recherche qui vise à comprendre la complexité du
fonctionnement du cerveau humain est que, justement, leur
cerveau est humain. En fait, vous devez vous demander pour-
quoi les biopsychologues s’ennuient à étudier des sujets non
humains. La réponse tient à la continuité de l’évolution du cer-
veau. Le cerveau des hommes et celui des autres mammifères
diffèrent essentiellement par la taille et l’étendue du cortex.
En d’autres termes, cette différence est plus quantitative que
qualitative. Par conséquent, de nombreux principes régissant
Chap01.fm Page 4 Vendredi, 8. juin 2007 6:06 06
ÉPREUVES

1.3
Types de recherche caractérisant l’approche biopsychologique
5
le fonctionnement du cerveau humain qui sont décrits dans la
littérature s’appuient sur des études sur les non-humains (voir
Nakahara
et al.
, 2002).
Inversement, les animaux non humains présentent trois avan-
tages sur les sujets humains. Le premier est que le cerveau et le
comportement des sujets non humains sont plus simples que
le cerveau et le comportement des sujets humains. À partir de
là, l’étude des sujets non humains est plus susceptible de révéler
des interactions fondamentales entre le cerveau et le comporte-
ment. Le deuxième avantage tient au fait que les idées naissent
souvent de l’
approche comparative
, c’est-à-dire de la compa-
raison des processus biopsychologiques dans différentes espè-
ces. Par exemple, en comparant le comportement d’espèces
dépourvues de cortex cérébral au comportement d’espèces en
possédant un, on va pouvoir tirer des conclusions valables sur le
rôle du cortex. Le troisième avantage est qu’il est possible de
conduire certaines recherches sur les animaux de laboratoire
qui, pour des raisons éthiques, sont impossibles avec des sujets
humains. Cela ne veut pas dire que la recherche animale ne soit
pas encadrée par un code éthique strict (voir Institut des ressour-
ces du laboratoire animal, 1996). Simplement, il y a moins de
contraintes éthiques pour la recherche de laboratoire sur les ani-
maux que sur les sujets humains.
Mon expérience est que la plupart des biopsychologues font
preuve d’une immense sollicitude envers leurs sujets, qu’ils
soient ou non de leur espèce. Cependant, les questions éthi-
ques ne sont pas laissées à l’appréciation du chercheur. Toutes
les recherches en biopsychologie, qu’elles utilisent des sujets
humains ou non, sont contrôlées par des comités éthiques
indépendants : « Les chercheurs ne peuvent pas échapper à la
logique suivante : si les animaux que nous observons sont de
bons modèles de nos propres activités, alors, ils méritent le
respect autant que nous-mêmes » (voir Ulrich, 1991, p. 197).
Études expérimentales et non expérimentales
La recherche en biopsychologie s’appuie à la fois sur des étu-
des expérimentales et sur des études non expérimentales. Les
deux types d’études non expérimentales sont les quasi-expé-
riences et les études de cas.
Expériences
L’expérience est la méthode utilisée par les
scientifiques pour découvrir les origines et les raisons de notre
mode de vie moderne. Qu’une méthode capable de telles
prouesses soit aussi simple a quelque chose de paradoxal. Pour
conduire une expérience avec des sujets vivants, l’expérimenta-
teur définit d’abord deux (ou plus) conditions expérimentales,
sous lesquelles les sujets sont testés. Habituellement, il teste un
groupe différent de sujets pour chaque condition (
protocole
intergroupes
), mais il est parfois possible de tester le même
groupe de sujets sur chaque condition expérimentale (
protocole
intra-groupe
). L’expérimentateur affecte les sujets aux condi-
tions expérimentales, applique les traitements et en mesure les
effets, tout cela de telle manière qu’il n’y ait qu’une seule diffé-
rence pertinente entre les conditions expérimentales comparées.
On appelle cette différence la
variable indépendante
. La
variable mesurée par l’expérimentateur pour tester l’effet de la
variable indépendante est, elle, appelée
variable dépendante
.
Pourquoi ne doit-il pas y avoir d’autre différence entre les
conditions expérimentales que la variable indépendante ?
Parce que, lorsqu’il y a plusieurs sources de variation de la
variable dépendante, il est difficile de savoir si c’est la varia-
tion de la variable indépendante ou une variation involontaire,
désignée sous le terme de
variable confondue
, qui explique
les effets observés sur la variable dépendante. Bien que la
méthode expérimentale soit simple d’un point de vue concep-
tuel, l’élimination des variables confondues peut être très dif-
ficile. Les lecteurs d’articles scientifiques doivent en
permanence être à l’affût de variables confondues qui seraient
passées inaperçues aux yeux des expérimentateurs.
Une expérience de Lester et Gorzalka (1988), visant à
démontrer l’effet Coolidge, illustre la méthode expérimentale.
L’
effet Coolidge
est le fait qu’un mâle devenu incapable de
poursuivre la copulation commencée avec sa partenaire peut
parfois recommencer à copuler avec une nouvelle partenaire
(voir figure 1.2). Avant que votre imagination ne s’emballe, je
tiens à vous signaler que l’expérience de Lester et Gorzalka
portait sur des hamsters et non sur des étudiants.
Pour Lester et Gorzalka, le fait que l’effet Coolidge n’ait pas
été observé chez les femelles tient probablement plus à la dif-
ficulté de conduire des expériences bien contrôlées sur cet
effet chez les femelles qu’à son absence. Selon eux, chez la
plupart des mammifères, les mâles sont plus facilement fati-
gués que les femelles sur le plan sexuel. Ainsi, les essais de
démonstration de l’effet Coolidge chez les femelles sont sou-
vent confrontés à la fatigue des mâles. Lorsque, pendant une
copulation, un nouveau partenaire sexuel est présenté à la
femelle, l’augmentation de sa réceptivité sexuelle peut tout
aussi bien témoigner d’un effet Coolidge que d’un effet de la
vigueur de ce nouveau mâle. Les femelles des mammifères
témoignant peu de fatigue sexuelle, cette variable confondue
ne constitue pas un problème sérieux pour montrer l’effet
Coolidge chez les mâles.
Lester et Gorzalka ont conçu une procédure astucieuse pour
contrôler cette variable confondue. Pendant que la femelle
copule avec un mâle (familier), un autre mâle (non familier)
copule avec une autre femelle. Puis les deux mâles se reposent
pendant que la femelle copule avec un troisième mâle. Enfin,
la femelle est testée avec l’un des deux premiers mâles, le
familier ou le non-familier. La variable dépendante est le
temps mis par la femelle pour prendre l’attitude de
lordose
(posture caractéristique de la réceptivité sexuelle des femelles
de rongeurs : arc-boutée, arrière-train redressé et queue rele-
vée) au cours de chacun des tests. Comme le montre la
figure 1.3, les femelles répondent plus vigoureusement aux
mâles non familiers qu’aux mâles familiers au cours du troi-
sième test, en dépit du fait que les deux premiers mâles, le
familier et le non-familier, soient aussi fatigués l’un que
l’autre et aient monté les femelles avec la même vigueur. Cette
expérience montre l’importance d’un bon protocole expéri-
mental pour établir, comme dans le chapitre 13, que les mâles
et les femelles sont beaucoup plus semblables que ne le pen-
sent la plupart des gens.
Études quasi expérimentales
Il est impossible d’appli-
quer la méthode expérimentale à tous les problèmes auxquels
s’intéressent les biopsychologues. Des obstacles physiques ou
éthiques empêchent de soumettre les sujets à certaines conditions
ou de gérer les conditions une fois que les sujets y ont été soumis.
Chap01.fm Page 5 Vendredi, 8. juin 2007 6:06 06
ÉPREUVES
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%