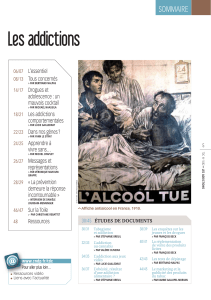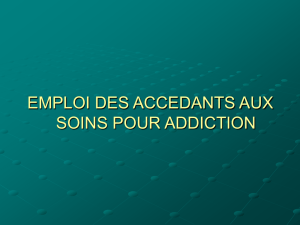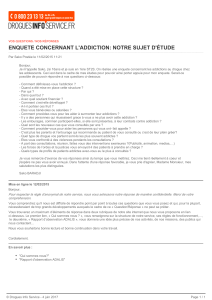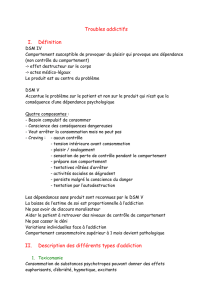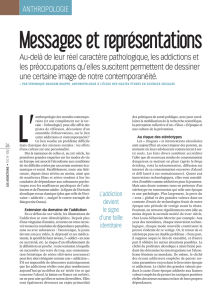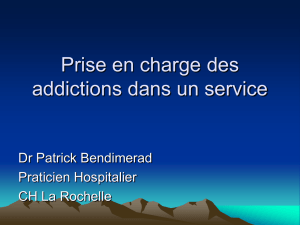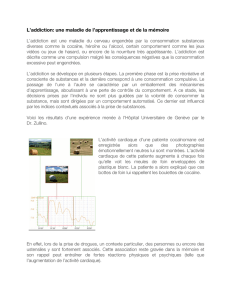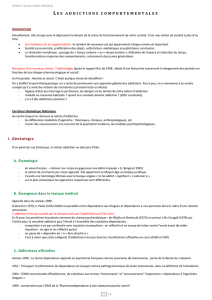Le point de vue de la philosophie

Le Courrier des addictions (15) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2013
17
Le point de vue de la philosophie
Françoise Kleltz-Drapeau*
Entre Le Discours de la servitude volontaire de La Boétie et “L’obéissance à la loi
qu’on s’est prescrite est liberté” de Rousseau, comment réfléchir à la modernité de
ces questions ? Françoise Kleltz-Drapeau va d’abord voir dans quel cadre, très vaste,
s’inscrit la problématique de la liberté, en faisant de brefs rappels sur ce qu’est la
liberté dans le monde physique, qui relient ce thème à la question du déterminisme.
Cela l’amènera ensuite à considérer cet être particulier dans la nature qu’est l’humain,
en interrogeant la façon dont nous nous posons la question de la liberté individuelle
face aux déterminismes naturels auxquels l’homme est confronté. Enfin, elle abor-
dera la question de savoir en quoi l’homme et sa liberté s’inscrivent à leur tour dans
la collectivité politique : en d’autres termes, après avoir, très sommairement, réfléchi
au libre arbitre dans le contexte des addictions, nous nous demanderons ce qu’il en
est des libertés dans la société et du rôle de celle-ci pour s’interroger sur l’addiction.
Le titre de cette journée était “libertés”,
au pluriel, et “addiction” au singulier.
Étonnée par ce pluriel, et puisque
l’étonnement est le propre des philosophes, j’ai
voulu savoir pourquoi ce mot de “liberté”, que
l’on trouve au singulier au fronton du Sénat,
se met au pluriel lorsqu’on le confronte à
l’“addiction”, au singulier.
Un mot qui a fait
beaucoup de métiers
Pour me mettre sur la piste, une phrase de Paul
Valéry (1) m’est revenue en mémoire : “Liberté :
c’est un de ces détestables mots qui ont plus de
valeur que de sens ; qui chantent plus qu’ils ne
parlent ; qui demandent plus qu’ils ne répondent ;
de ces mots qui ont fait tous les métiers, et des-
quels la mémoire est barbouillée de éologie, de
Métaphysique, de Morale et de Politique ; mots
très bons pour la controverse, la dialectique, l’élo-
quence ; aussi propres aux analyses illusoires et
aux subtilités infinies qu’aux fins de phrases qui
déclenchent le tonnerre.”
À ce mot qui a fait tous les métiers, on pour-
rait donc faire dire tout et n’importe quoi, car
il serait plus apte à faire vibrer notre cœur qu’à
faire fonctionner nos méninges. De fait, pour
un étudiant en philosophie, la liberté est un
concept redoutable, car c’est le type même de
notion dans laquelle il est très facile de tourner
en rond. Exemple : peut-on, sans contradic-
tion, enfermer la liberté dans les bornes trop
étroites d’une définition ? En effet, si je dis
ce qu’est la liberté, je l’asservis puisque je la
condamne à n’être que ce que j’ai défini qu’elle
serait. Je l’emprisonne ainsi dans un cadre,
ce qui, en effet, peut être une contradiction
logique, dans la mesure où on définit la liberté
comme une ouverture vers tous les possibles.
Si, pour un médecin, il est “relativement” facile
de dire ce que sont les opiacés, pour un philo-
sophe, il est donc plus difficile de définir ce que
peuvent être les libertés lorsqu’il y a addiction à
l’opium. Cette difficulté, vous la connaissez d’au-
tant mieux que chacun dans cette salle, soignant,
politique, usager de drogues, vous êtes, face à
l’addiction, un “philosophe” au sens étymologique
de ce mot. Non pas un “sage” ou un “savant”,
ce que le grec nomme un “sophos” en désignant
“celui qui sait”, mais un “philosophos”, c’est-à-dire
celui qui aime (“philos”), au sens très fort, qui
désire le savoir, précisément parce qu’il sent qu’il
n’a pas ce savoir. Être philosophe, c’est constater
que l’on n’a pas la science infuse. Dans le cas
qui nous intéresse, on peut dire que vous êtes
philosophes si vous n’êtes pas de dogmatiques
savants en ce qui concerne l’addiction, mais des
hommes et des femmes qui désireraient mieux
connaître le rapport entre libertés et addiction.
Et avec une telle aspiration au savoir, que peut
vous offrir la philosophie ? Pas une thérapie qui
guérirait de l’ignorance, mais, au mieux, une aide
à mieux vivre avec cette salutaire ignorance, et
à mieux poser les questions. Malheureusement,
lorsqu’on fait venir le “philosophe de service” dans
un débat, certains auditeurs, venus l’écouter avec
un doute inconfortable, certes, mais fécond, en
ressortent avec la certitude qu’ils ont enfin tout
compris, puis répètent à l’envi des discours aussi
jargonnants que simplistes !
Pour remplacer ces orgueilleuses panacées, voici
quelques bons vieux remèdes qui ont fait leur
preuve. Pour éviter le jargon : quelques petits
extraits de textes de très grands philosophes.
Aristote, le précurseur
Dans cet immense ensemble de questions qui
se posent, un fil conducteur devrait nous éviter
de nous perdre : il s’agit du point commun à
ces 3 domaines que sont la nature, l’individu
et la collectivité. Cet élément récurrent est la
notion d’autonomie, concept particulièrement
pertinent pour éclairer – au moins un peu –
la question des libertés et de l’addiction. La
réflexion va donc du plus général – la liberté
dans le monde physique – au plus intime – la
liberté pour l’individu –, et aboutit à une mise
en perspective dans l’espace du politique. J’ai
donc choisi de me recentrer sur la question des
libertés, le thème de l’addiction étant aujourd’hui
traité par des spécialistes.
Un philosophe a pensé la liberté dans ces
3domaines : c’est Aristote, dont l’intérêt
majeur a été de montrer qu’on ne peut pas
penser la liberté individuelle sans la situer
d’abord dans le cadre plus vaste du détermi-
nisme en physique. Il ne s’agit donc pas sim-
plement des réalités physiques de l’addiction
ou d’une interrogation sur un déterminisme
génétique des phénomènes de dépendance.
De fait, Aristote voit plus grand que la simple
physique humaine, et, curieusement, sa façon
de penser la Physique, avec une majuscule,
lui permet de mieux situer, au sens propre,
la question des libertés politiques ou indivi-
duelles.
Chez lui, le monde physique est divisé en
2parties : d’un côté ce qu’il appelle le “supra-
lunaire”, c’est-à-dire le monde de la parfaite
régularité des astres qui suivent un cours
rigoureusement déterminé; de l’autre, le
“sublunaire”, celui qui se trouve sous la lune,
c’est-à-dire notre “bas monde”. Cet espace dans
la physique aristotélicienne est le monde des
hommes, et il est opposé au monde supérieur
précisément parce qu’il est irrégulier, aléa-
toire, contingent. Ainsi apparaît la question
de la liberté : le monde supralunaire est parfait,
parce qu’il obéit aux lois de la physique. Il est
le monde de la Nécessité et ne connaît donc ni
hasard, ni liberté.
À l’inverse, dans le monde où habitent les
hommes, rien n’est nécessaire ou prédéter miné,
puisque tout est contingent, et c’est en raison
de ce qui pourrait être considéré comme une
imperfection du sublunaire que l’on voit s’ouvrir
à nous ce qu’il faut donc appeler “l’espace de
la liberté”. C’est parce que ce monde est indé-
terminé, –“mal fichu”, pourrait-on dire–, que
l’homme a la liberté de parfaire ce que la nature a
laissé inachevé (cf. les interprétations du monde
aristotélicien de Pierre Aubenque [2, 3]). La
* Françoise Kleltz-Drapeau, philosophe, docteur en philo-
sophie grecque, a travaillé sur Aristote sous la direction
de Pierre Aubenque. Elle enseigne les pratiques de lecture
des textes universitaires à l’université de la Sorbonne-Nou-
velle. Dans le cadre de l’Espace éthique et de l’université
Paris-Sud, elle étudie les relations entre la médecine et la
philosophie. Elle vient de publier
Une dette à l’égard de la
culture grecque, La juste mesure d’Aristote
(encadré, p. 21)
.

Le Courrier des addictions (15) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2013 18
liberté n’est pas du côté de la perfection. Elle
est un pis-aller pour parachever un monde
imparfait. Pour un Grec, elle pouvait être un
risque ou une chance : risque de sombrer dans
un désordre chaotique, chance de pouvoir agir
sur le monde en vue de l’améliorer.
Notons que, dans les systèmes physiques qui
nient la liberté, que ce soient les déterminismes
antiques ou actuels, il n’y a pas de scission dans
le monde physique, contrairement à ce qui
se passe chez Aristote : la réalité physique, y
compris les êtres humains, y est donc entiè-
rement déterminée rationnellement. Comme
dans le monde de Jacques le fataliste, tout
est écrit, par le destin ou par la science, peu
importe. Pour ceux qui croiraient ainsi à une
programmation génétique absolue de l’humain,
cela impliquerait, par exemple, que certains
hommes, par nature, de façon innée ou géné-
tique, seraient inéluctablement prédisposés
aux addictions, quelles que soient les circons-
tances, les acquis ou les expériences auxquels
ils peuvent être confrontés. Ils n’auraient donc
aucune liberté pour y résister. Sans entrer dans
ces questions scientifiques, rappelons seule-
ment que la réflexion sur l’addiction s’inscrit
dans un débat philosophique très ancien sur la
liberté et la nécessité dans le monde physique,
qu’il s’agisse de la Physique du Monde ou du
fonctionnement biophysique de chaque être
humain.
Après ce détour, on voit donc mieux les enjeux
de la liberté individuelle de l’être humain, ce
tout petit point dans l’immense ensemble des
êtres de la nature. Quittons la Physique pour
revenir à l’individu, mais, pour que ce soit cohé-
rent, restons chez Aristote. Nous avons vu que
l’homme était libre parce qu’il vivait dans un
monde où les choses peuvent, de façon contin-
gente, “être ou ne pas être”. Cette formulation,
shakespearienne avant la lettre, se trouve expli-
citement dans l’Éthique à Nicomaque (4). Cela
signifie que l’individu peut être ou ne pas être
victime d’addiction. Pour le dire en un vocabu-
laire sartrien, il faudrait affirmer que l’homme
est “condamné à être libre”.
Le déterminisme
des Stoïciens
Selon J.P. Sartre (5), l’homme est libre, ce qui
implique qu’il ne peut échapper à cette liberté.
Cette paradoxale nécessité de la liberté étant
posée, l’homme alors peut, et doit, être libre
puisqu’il est, comme chez Aristote dans un
monde où la liberté s’impose. On le sait, tous
les philosophes sont loin de partager cette
conception de la liberté. Les Stoïciens, par
exemple, qui furent de grands spécialistes des
sciences physiques, se distinguaient nettement
d’Aristote et affirmaient que le monde dans son
ensemble obéissait à des lois physiques très
strictes, parfaitement rationnelles de part en
part, et que l’homme, en tant qu’être de la
nature, ne pouvait échapper à sa rationalité
et au déterminisme de celle-ci. Ainsi, chaque
individu doit obéir aux lois qui ont été préa-
lablement fixées pour lui. Il y a un destin, et
dans le scénario de cette pièce de théâtre écrite
bien avant notre naissance, nous avons l’obli-
gation de jouer exactement le rôle qui nous est
imparti. Il reste à l’homme une infime marge
de liberté dans son interprétation des figures
imposées par la nature : s’il comprend ce scé-
nario, en d’autres termes s’il l’accepte alors
même qu’il n’a pas la possibilité de le refuser,
il peut faire “comme si” il l’avait choisi, et exé-
cuter son parcours imposé de bonne grâce.
Comme un ordinateur qui effectuerait un
programme “comme s’il avait pu le choisir” :
chez les Stoïciens, c’est dans cet interstice que
résident la grandeur et la liberté de l’homme.
Selon Spinoza :
connaître et comprendre
nos Déterminations
Chez Spinoza, le déterminisme de la nature est
parfaitement rigoureux et la volonté humaine
est elle-même déterminée. Or, comme cette
volonté est associée à la connaissance, la liberté
va résider dans le fait de connaître et de com-
prendre ce qui nous pousse à agir, ce que l’on
peut appeler nos “déterminations”. Ainsi, en
comprenant nos motivations, nous pouvons,
dans une certaine mesure, être la cause de nos
actes. Cela implique que, si nous comprenons
les mobiles, les moteurs de nos actions, nous
ne serons plus passivement mus par des moti-
vations qui nous échappent, au double sens de
ce terme. L’homme qui comprend pourquoi il
agit, même s’il est dans un monde très ration-
nellement déterminé, agit plus librement. Voici,
très schématiquement résumée, sa position telle
qu’on la trouve dans ce passage de l’Éthique (6) :
“Je dis que nous sommes actifs lorsque, en nous
et hors de nous, il se produit quelque chose dont
nous sommes la cause adéquate, c’est-à-dire [...]
lorsque de notre nature il suit en nous ou hors
de nous quelque chose que l’on peut comprendre
clairement et distinctement par elle seule. Mais
je dis, au contraire, que nous sommes passifs,
lorsqu’il se produit en nous quelque chose dont
nous ne sommes que la cause partielle.”
Nous commençons à comprendre que le vrai
problème de la liberté est de savoir si l’homme
est un être de la nature comme les autres, ou
bien s’il aurait un statut particulier.
Descartes : le libre arbitre,
marque de la divinité
Descartes va offrir ici une manière de poser le
problème. Globalement, il estime que, en tant
que je suis un corps, je suis une “machine”, une
mécanique qui obéit aux lois de la physique.
Néanmoins, comme l’homme n’est pas seule-
ment un corps mais “une chose pensante”, c’est
en tant que tel qu’il va avoir cette capacité de
ne pas être seulement un corps asservi aux
lois de la nature. Selon Descartes, cette liberté
joue un rôle fondamental. Il explique, dans
la quatrième des Méditations métaphysiques
que ce libre arbitre est en nous la marque de
la divinité (7) : “Il n’y a que la volonté seule ou
la seule liberté du franc arbitre que j’expéri-
mente en moi être si grande que je ne conçois
point l’idée d’aucune autre plus ample et plus
étendue, en sorte que c’est elle principalement
qui me fait connaître que je porte l’image et la
ressemblance de Dieu.”
Plus concrètement, et pour voir les enjeux par
rapport au problème de l’addiction, dans la
conception cartésienne, c’est parce que je suis
un être pensant que je peux faire ou le bien, ou
le mal. Si l’addiction ne peut pas s’expliquer de
façon purement mécanique, par la physique ou
la génétique, alors j’ai la possibilité de choisir
d’avoir ou de ne pas avoir une conduite addic-
tive, du moins tant que l’addiction n’a pas fait en
sorte que mon être entier obéisse aux besoins
physiologiques qui feraient que la dépendance
asservirait mes libres décisions.
De fait, on perçoit à quel point cette liberté de
pouvoir dire oui ou non, ce libre arbitre, pour
reprendre le mot des théologiens, imprime
dans l’homme la marque de ce qui le dépasse.
Même si l’on refuse les notions transcendan-
tales de Dieu ou de l’infini, on constate que
postuler la liberté humaine ouvre à l’homme
l’espace de la responsabilité, avec les avantages
et les inconvénients, la balance des bénéfices et
des risques qu’implique le fait d’être un homme
libre, donc responsable de ses actes. Le droit
nous le rappelle : celui qui agit dans des cir-
constances où il n’est pas libre du choix de ses
actions ne peut être tenu pour responsable des
actes qu’il a commis.
Ce problème est particulièrement complexe
quand il s’agit de juger ceux qui sont sous
l’emprise d’une substance ou d’une conduite
addictive dont ils sont entièrement dépendants.
Avant d’aborder plus en détail la question de
l’autonomie, on peut déjà citer, a contrario,
la description que Bergson propose de l’acte
libre (8) : “Nous sommes libres quand nos actes
émanent de notre personnalité entière, quand ils
l’expriment, quand ils ont avec elle cette indéfi-
nissable ressemblance qu’on trouve parfois entre
l’œuvre et l’artiste. En vain on alléguera que nous
cédons alors à l’influence toute puissante de notre
caractère. Notre caractère, c’est encore nous.”
Il y a donc du divin et de l’artiste dans celui qui
agit librement. Ses actes le reflètent et il peut
en être tenu pour responsable, c’est-à-dire qu’il
a la capacité d’en répondre, de dire pourquoi et
comment il les a faits. Les spécialistes de l’addic-
tion savent à quel point celui qui est dépendant
peut être, dans certains cas que les spécialistes

Le Courrier des addictions (15) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2013
19
ont à déterminer, privé d’une telle liberté, et
pourtant à quel point, parfois, il y aspire.
Pour conclure ce très bref survol de la liberté
individuelle, revenons à Aristote, puisqu’il
pose le problème des hommes qui sont privés
de liberté. Il s’agit d’un passage de La Politique
dans lequel il aborde la question de l’esclave.
Certains commentateurs y voient une apologie
de l’esclavage. En réalité, le texte est, à ce sujet,
beaucoup plus complexe (9) : “celui qui, par
nature, ne s’appartient pas à lui-même, tout en
étant un homme, mais est la chose d’un autre,
celui-là est esclave par nature ; et est la chose
d’un autre, tout homme qui, malgré sa qualité
d’homme, est la propriété (d’autre chose que de
lui-même)”, écrit-il. Selon Aristote, un esclave
qui tisse est, malheureusement, comme une
machine à tisser, l’instrument de celui qui le
possède.
Addictio, addictus,
addiction
Être réduit à l’état d’objet, être la chose d’un
autre ou de ce qui n’est pas vous, cela nous
renvoie à l’étymologie de l’anglicisme “addic-
tion”. Ce mot évoque l’“addictio” qui, en latin,
désigne la décision de justice qui permet à un
créancier de se saisir de la personne d’un débi-
teur. On peut alors juger ce débiteur comme
un “addictus”. On va l’adjuger à quelqu’un
d’autre, donc l’aliéner, c’est-à-dire, étymolo-
giquement, en faire la chose d’un autre. Ainsi,
l’addictus se donnait, s’adonnait, se vouait,
s’abandonnait à ce qui n’était pas lui. On dit
aussi que l’addictus n’a plus de nom propre :
on l’appelle du nom de son propriétaire. C’est
dire à quel point le mot “addiction” a, du point
de vue étymo logique, une connotation péjo-
rative que ne retiennent pas, bien sûr, les
addictologues.
Dans ces différentes formes, il s’agit de dépen-
dance par rapport à ce qui nous est extérieur.
Pourtant, dans les descriptions des conduites
addictives, on constate, dans certains cas, un
asservissement à quelque chose d’intérieur.
Ceux qui ont tendance à diaboliser le phé-
nomène évoquent des “possessions”, usent
du vocabulaire de la sorcellerie et parlent
d’“aliénés”, comme autrefois, les psychiatres.
On ne s’appartient plus : on s’adonne à une
habitude ou à un vice, et, par voie de consé-
quence, on s’abandonne soi-même. Ces
termes, sans doute excessifs, visent bien à
traduire un esclavage et la perte de la maî-
trise de soi.
Donc, pour éclairer par un dernier auteur ce
thème de l’esclavage, on peut penser à la dia-
lectique du maître et de l’esclave, chez G.W.F.
Hegel. Dans la Phénoménologie de l’esprit, il
présente 2 hommes en conflit : initialement,
ils sont égaux, mais l’un sait qu’il préférera
mourir plutôt que de servir. Pour résumer,
disons qu’on pourrait lui appliquer la devise
de notre Révolution : “Vivre libre ou mourir”.
À l’inverse, pour le second, la valeur majeure
est la vie, et non la liberté. Il choisit donc de
protéger sa vie, quitte à devenir esclave. On
retrouve là l’étymologie du mot “servus”, qui
a donné le “serf” du Moyen Âge : est devenu
esclave (“servus”) celui qui a décidé de protéger
– en latin “servare” – sa vie. En effet, l’une des
origines de l’esclavage était que, pendant les
guerres, certains se battaient jusqu’au bout,
en préférant la mort à la privation de liberté,
tandis que d’autres, pour sauver leur vie, se
rendaient. Ayant refusé de sacrifier leur vie,
ils sacrifiaient leur liberté. Ils étaient faits pri-
sonniers et devenaient esclaves des vainqueurs.
Que sacrifie donc celui qui accepte de se faire
l’esclave d’une dépendance ?
Avant de répondre à cette question, encore
un petit éclairage aristotélicien : ce passage
sur l’esclavage se trouve dans La Politique,
ce qui nous conduit à ce qui est précisément
l’antithèse de l’esclave dans la cité grecque : le
citoyen, comme modèle de la liberté humaine.
À Athènes le nombre des citoyens était très
réduit, puisqu’en étaient exclus les femmes,
les enfants, les étrangers et les esclaves, mais
les citoyens disposaient d’une liberté consi-
dérable. C’est pourquoi le citoyen est pour
Aristote le modèle de l’homme qui peut agir
sur le monde. C’est donc lui qui va parachever
ce monde contingent, “mal ficelé”, pour faire
en sorte que, face à l’ordre régulier du cosmos
dont nous parlions au début, l’ordre de la
collectivité humaine, la cité du politique,
puissent accorder l’ordre et la liberté. Nous
abordons donc le troisième point, à savoir la
liberté de l’individu dans la collectivité en ce
qui concerne la réflexion sur l’addiction. À
titre de transition, voici un petit passage d’un
penseur (pas assez lu), ce qui serait pourtant
fort utile lorsqu’on réfléchit à toutes les formes
de dépendances. Il s’agit de La Boétie, l’ami
de Montaigne. À 17ans, l’âge de Rimbaud,
l’âge aussi de toutes les tentations qui peuvent
conduire aux dépendances, La Boétie écrivit
un essai dont le titre a de quoi faire rêver
tous les addictologues : Discours de la servi-
tude volontaire. L’alliance des mots dans ce
titre désigne un texte fondamentalement et
génialement politique. En bon philosophe, La
Boétie cherche à comprendre quelque chose
qui l’étonne et qui, curieusement, semble
n’étonner personne. Ce paradoxe est que les
hommes sont créés libres et égaux et que,
pourtant, volontairement, ils vont s’asservir
à un pouvoir politique dominé par un seul
homme. Il écrit au début de son Discours
(10) : “Je désirerais seulement qu’on me fit com-
prendre comment il se peut que tant d’hommes,
tant de villes, tant de nations supportent tout
d’un tyran seul, qui n’a de puissance que celle
qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur
nuire, qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer,
et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils
n’aimaient mieux tout souffrir de lui, que
de le contredire.” Politiquement, La Boétie
explique cet asservissement d’hommes ini-
tialement libres par un système pyramidal : ce
qui est tyrannique est ce qui asservit quelques
éléments qui, à leur tour, vont avoir le droit
d’en asservir d’autres, et ainsi de suite, par un
phénomène qu’il compare à une contagion. Il
précise également, explicitement, que le tyran
obtient cette servitude volontaire en usant de
jeux, de spectacles de gladiateurs et d’autres
“drogues”, puisque ce sont des “appâts de la
servitude, la compensation de la liberté ravie,
les instruments de la tyrannie”. On voit en quel
sens l’argumentation de La Boétie peut rendre
compte de certains aspects de l’addiction, de
la servitude lorsqu’elle est “seulement” indi-
viduelle.
Le contraire de
la servitude volontaire :
la démocratie comme
autonomie
Reprenons d’abord l’étymologie du mot “auto-
nomie” : on y trouve le grec “nomos”, la loi, et
“autos” qui veut dire “par soi-même”. L’auto-
nomie désigne donc le fait d’être capable de
se donner à soi-même une loi. Cela s’oppose
à l’hétéronomie, c’est-à-dire à la loi qui vient
de ce qui est autre que nous-mêmes, “hétéros”.
Or, chez J.J. Rousseau, ce qui est défini comme
l’obéissance à la loi qu’on se donne à soi-même,
c’est la liberté.
Voici ce que Rousseau en dit dans le Contrat
social (11) : “Ce que l’homme perd par le
contrat social, c’est sa liberté naturelle et un
droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut
atteindre. Ce qu’il gagne, c’est la liberté civile
et la propriété de tout ce qu’il possède. Pour ne
pas se tromper dans ces compensations, il faut
bien distinguer la liberté naturelle qui n’a pour
bornes que les forces de l’individu, de la liberté
civile qui est limitée par la volonté générale,
et la possession qui n’est que l’effet de la force
ou le droit du premier occupant, de la pro-
priété qui ne peut être fondée que sur un titre
positif. On pourrait sur ce qui précède ajouter
à l’acquis de l’état civil la liberté morale, qui
seule rend l’homme vraiment maître de lui ;
car l’impulsion du seul appétit est esclavage,
et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est
liberté.”
La liberté est donc définie, par un paradoxe
qui doit toujours nous étonner, comme une
obéissance, mais, pour que cela ne soit pas
une “servitude volontaire”, il importe que l’on
soit dans une démocratie, comme en témoigne
cet extrait des Lettres écrites de la Montagne,
où Rousseau précise sa pensée (12) : “Il n’y a
donc point de liberté sans loi, ni où quelqu’un
est au-dessus des Lois : dans l’état même de

Le Courrier des addictions (15) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2013 20
nature l’homme n’est libre qu’à la faveur de la
Loi naturelle qui commande à tous. Un peuple
libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des chefs et
non pas des maîtres ; il obéit aux Lois, mais il
n’obéit qu’aux Lois et c’est par la force des Lois
qu’il n’obéit pas aux hommes […] Un peuple est
libre, quelque forme qu’ait son Gouvernement,
quand dans celui qui gouverne, il ne voit pas
l’homme mais l’organe de la loi.” Un texte à lire
et relire, ad libitum et “sans modération”, car
la lecture reste un “vice impuni”, une addic-
tion licite !
La démocratie est donc ce régime où chacun
est, alternativement, peuple, puisqu’il obéit
aux lois, et souverain, puisqu’il décide des lois
grâce à son droit de vote. Le Sénat est un bon
endroit pour évoquer ainsi le peuple souverain,
qui peut légaliser, pénaliser ou dépénaliser tout
ce qui peut provoquer chez les citoyens une
dépendance ou une servitude volontaire. D’un
point de vue rousseauïste, il est logique que le
peuple souverain ait voix au chapitre, surtout
quand il s’agit de la souveraineté que chaque
citoyen peut exercer ou non sur lui-même.
Mais, comment se rejoignent, ici, le collectif
et l’individuel, le politique et ce que j’hésite à
appeler l’éthique tant ce mot fait actuellement,
lui aussi, un peu tous les métiers ? Les contre-
sens qui pèsent sur le mot “éthique” pourraient
faire croire qu’il y aurait à porter un verdict
moral sur l’addiction. N’ayant ni la volonté,
ni surtout les compétences pour me risquer
seule à un tel jugement de valeur, je vais donc
faire appel à E. Kant, qui sera le dernier des
“experts” convoqués ici à la barre : lui non plus
ne donnera pas de réponse, mais il permettra
d’affiner encore la question. Kant étudie la “Loi
morale”, un concept qui propose, là encore,
une alliance de mots contradictoires, comme
“servitude volontaire” ou “liberté comme obéis-
sance aux lois”. Très schématiquement, on
pourrait dire que cette Loi morale est le point
de rencontre entre le vocabulaire de l’éthique
et celui du droit. Cette loi relève de l’auto-
nomie et fonde la responsabilité. Elle est, dans
notre monde, la manifestation d’une liberté
qui est d’un ordre transcendant. Chez Kant,
en effet, l’homme participe de 2mondes, celui
de la nature qui est déterminé, et celui de la
liberté. Toute action peut donc être comprise
comme prédéterminée par une causalité qui
peut être physique, sociologique ou psychique,
mais elle peut aussi être comprise comme le
fruit d’une volonté libre. Kant résume ainsi le
problème dans la troisième partie des Fonde-
ments de la métaphysique des mœurs (13) :“En
quoi donc peut bien consister une liberté de la
volonté, sinon dans une autonomie, c’est-à-dire
dans la propriété qu’elle a d’être à elle-même
sa propre loi ? Or, cette proposition : la volonté
dans toutes les actions est à elle-même sa loi,
n’est qu’une autre formule de ce principe : il ne
faut agir que d’après une maxime qui puisse
se prendre elle-même pour objet à titre de loi
universelle. Mais c’est précisément la formule
de l’impératif catégorique et le principe de la
moralité ; une volonté libre et une volonté
soumise à des lois morales sont par conséquent
une seule et même chose.”
Sans faire de rapprochements abusifs entre
Descartes et Kant, on ne peut que remarquer
l’éminent statut que ces philosophes donnent
à la liberté : chez le premier, elle est la marque
de Dieu sur la créature; chez le second elle
est, comme “la voûte étoilée au-dessus de nos
têtes”, ce qui rend le monde admirable. La
liberté, comme obéissance à la Loi morale
que je me donne à moi-même au-delà de toute
obéissance aux lois qui sont juridiquement
imposées, cette autonomie est pour Kant une
idée nécessaire de la raison, mais elle est un
idéal que nous ne pouvons rationnellement
démontrer. C’est cette éminente responsabi-
lité qui fait de nous des hommes. Certes, mais
si l’on considère qu’est un être responsable
seulement celui seul qui est libre d’exercer
ses choix autonomes, alors, qu’en est-il du
“dépendant” ? Pouvons-nous nous contenter
de dire qu’il est juridiquement et éthique-
ment un irresponsable ? Est-il privé de cette
noble liberté que décrit la philosophie, et, en
outre, la société souveraine et libre n’aurait-
elle pas, vis-à-vis de lui, une responsabilité,
car, à l’évidence, nous ne sommes pas libres de
ne pas nous sentir concernés par la question
de l’addiction ?
La charte :
la responsabilité
de tout le corps social
Dernier texte de référence : votre Charte pour
une autre politique des addictions. Dans la
mesure où il évite les réponses dogmatiques,
il est, semble-t-il, aussi fécond intellectuel-
lement que ceux précédemment cités : le
premier constat est que les frontières entre le
licite et l’illicite sont de plus en plus floues en
raison de la diversités des formes d’addictions
et du fait que notre société est “addictogène”.
Ce mot doit être compris dans son double
sens : notre société, telle qu’elle est, conduit
certains aux addictions, et cette même société
cautionne des addictions considérées comme
licites, par exemple en ouvrant le marché des
jeux d’argent, en ayant des intérêts financiers
pour le tabac ou l’alcool, ou en laissant se déve-
lopper des addictions aux médicaments. Dans
tous les cas, sans être la seule coupable, elle a
au moins sa part de responsabilité. Pour cela,
la charte insiste sur la nécessité de trouver
“le niveau requis de régularisation”, ce qui
implique, par exemple, que soit ouvert le débat
sur la dépénalisation. En ce qui concerne la
question de la légalisation, il est rappelé que ce
débat, très complexe, ne peut, en tout état de
cause, être seulement posé au niveau national,
car la marge de décision de la France est, en
ce domaine, très restreinte. Conséquence : en
tant que citoyen, je peux, et je dois, réfléchir
à mon degré de responsabilité politique face
à l’addiction. En amont, je dois me demander
en quoi ma société pourrait produire moins
de raisons de devenir dépendant et cautionner
moins d’addictions. En aval, lorsque l’addic-
tion est là, je dois me demander, en tant que
citoyen responsable, quel sort devrait être fait
à mes concitoyens “victimes d’addiction”, ainsi
bien sûr qu’à ceux qui sont “victimes de délits
commis par des citoyens sous l’emprise d’une
addiction”.
L’addiction est donc, de part en part, un pro-
blème inscrit au cœur du politique dans un pays
qui a pour devise “Liberté, Égalité, Fraternité”.
La crise économique que traverse notre société
est, certes, un facteur aggravant, mais elle ne
doit surtout pas être prise comme un prétexte
pour nous désintéresser financièrement d’une
addiction qui, justement, augmente avec les
difficultés économiques d’un pays.
Si la démocratie est fondée sur la notion
d’autonomie, puisque les citoyens obéissent
aux lois qu’ils se fixent à eux-mêmes, alors
l’autonomie des citoyens dans leurs pratiques
individuelles – les addictions, en l’occurrence
– doit pouvoir faire l’objet d’un débat ouvert.
Cela implique que l’on respecte la liberté de
chaque citoyen dans la sphère privée, à l’évi-
dente condition que cette liberté ne soit pas
une entrave pour d’autres citoyens qui pour-
raient être victimes d’une personne sujette à
la dépendance.
Soyons clairs : il ne s’agit pas d’entrer dans
l’intimité de cette absence de liberté que
constitue toute dépendance en ayant une
attitude autocratique vis-à-vis de ceux qui
“ne se gouvernent pas” eux-mêmes. Si la régu-
lation se limitait à cette forme de répression,
il y aurait alors “double peine” : de ceux qui,
par leur addiction, ont perdu une part de leur
liberté on restreindrait encore l’autonomie en
leur interdisant systématiquement de réflé-
chir au problème. Les “addicts”, dira-t-on,
sont trop dépendants pour avoir un avis sur
leur dépendance. En outre, si l’on y réflé-
chit, la société elle-même serait victime d’une
double peine : parce qu’elle suscite chez cer-
tains des dépendances qui à terme sont dan-
gereuses pour elle-même, il lui serait interdit
de réfléchir démocratiquement à la question
des libertés et de l’addiction. En résumé, la
dépendance serait un sujet trop important
pour être laissé à des citoyens addicts ou à
une société addictogène.
C’est précisément parce que certains citoyens
sont en perte d’autonomie que la responsabilité
de tout le corps social s’impose pour ne pas les
exclure en se désintéressant de leur perte de
liberté. Que dirait-on si l’on se désintéressait
ainsi de la perte d’autonomie des plus âgés
d’entre nous ? Or, pour le grand âge, comme

Le Courrier des addictions (15) – n ° 1 – Janvier-février-mars 2013
21
pour l’addiction, c’est la dépendance qu’il faut
prendre en charge et, en premier lieu, en consi-
dération, en évitant, dans les 2 cas, un vocabu-
laire moralisateur.
L’addiction est un problème de société, et
doit, à ce titre, être un véritable sujet de débat
politique, ouvert, et surtout informé, pour que
chacun ait les moyens de faire sur ces questions
un choix libre et éclairé. Les citoyens ont le
devoir, et pas seulement le droit, de débattre
ensemble de ces questions, puisque la liberté
consiste aussi à pouvoir réfléchir à ce qu’est
la liberté individuelle et la servitude volon-
taire, et cela sans se contenter de mettre sous
les verrous ceux dont on pense qu’ils se sont
eux-mêmes privés de liberté en “s’adonnant”
à des substances ou à des pratiques, licites ou
illicites, qui les asservissent.
Est-il idéaliste de croire que, s’ils étaient cor-
rectement informés par de vrais spécialistes
des sciences humaines et exactes, les citoyens
pourraient décider, de façon autonome et non
passionnelle, des décisions législatives qu’il faut
ou qu’il ne faut pas prendre sur ces questions ?
Le plus “mauvais exemple” que la société pour-
rait donner à ceux qui, face aux addictions,
ont perdu leur autonomie serait de renoncer à
l’autonomie des décisions politiques en se lais-
sant abuser par les discours démagogiques des
uns ou des autres. Quand on doit prendre des
décisions concernant la perte du libre arbitre, la
moindre des choses est d’exiger tous les moyens
de faire un choix libre et éclairé au-delà des
querelles partisanes.
La société, surtout quand elle est en crise, ne
peut se contenter de constater que les addic-
tions engendrent des zones de non-droit et
de délinquance organisée. Parce que certains
“ne se gouvernent pas” et n’obéissent plus à la
sublime “Loi morale”, faut-il pour autant laisser
ceux qui les fournissent dominer des territoires
qui deviennent ainsi hors-la-loi ? Dépénaliser
ou légaliser permettrait-il de redonner à la
loi la place qu’elle a, à l’évidence, perdue dans
certains lieux ? Je n’ai pas compétence pour
le dire, mais une chose est sûre : la société ne
peut pas non plus se contenter de dire qu’“il
n’y a pas de drogués heureux”. Sur ce point
encore, souvenons-nous de Rousseau, qui esti-
mait que la possession de certaines choses ne
rendait pas heureux alors que le fait d’en être
privés nous affectait douloureusement (14).
Certes, il n’évoquait pas là les substances illi-
cites, mais il parlait de tous ces désirs artificiels
que la société parvenait à faire passer pour des
besoins et dont le sevrage devenait forcément
tragique : “ce fut là le premier joug qu’ils s’impo-
sèrent sans y songer, et la première source de
maux qu’ils préparèrent à leurs descendants ;
car outre qu’ils continuèrent ainsi à s’amollir
le corps et l’esprit, ces commodités ayant par
habitude perdu presque tout leur agrément, et
étant en même temps dégénérées en de vrais
besoins, la privation en devint beaucoup plus
cruelle que la possession n’en était douce, et
l’on était malheureux de les perdre, sans être
heureux de les posséder”. Or, la liberté, l’auto-
nomie, pour un individu et pour une société,
ce n’est pas un artificiel désir, mais un besoin
fondamental dont la privation rend plus que
malheureux. Nous ne pouvons donc pas ne pas
être concernés par ce que certains – pas tous
– vivent comme une perte de liberté mettant
en cause, à terme, ce qu’ils considèrent comme
leur humanité.
La liberté : aux confins
de la rationalité,
mais le propre de l’homme
En conclusion de cet exposé qui a seulement
tenté d’expliquer pourquoi les organisateurs
de cette journée avaient mis un “s” au mot
“liberté”, disons que la liberté est un concept
qui explique un grand nombre de nos atti-
tudes, mais qui lui-même ne s’explique pas
aisément. Combien de fois disons-nous “j’agis
ainsi parce que je suis libre”, en pensant que
l’invocation de la liberté suffit à rendre compte
de nos actions ? Mais, les philosophes nous
montrent que rendre compte de la liberté
est complexe. Il ne faut pas en déduire que
la liberté est irrationnelle : elle est seulement
aux confins de la rationalité, toujours à la
limite de ce qui pourrait dépasser l’homme
et, pourtant, elle est ce qui, au sens propre,
peut “définir” l’humanité. Or, avec l’addiction,
nous voyons en quelque sorte la limite, l’ombre
portée de la liberté et, sans aucune démagogie,
nous devrions être reconnaissants à tous ceux
qui sont dans la dépendance car ils aident à
mieux comprendre ce que sont les libertés
dans leur multiplicité.
v
Références bibliographiques
1. Valéry P. “Fluctuations sur la liberté”. Regards sur
le monde actuel. Dans: Œuvres, tome II. Paris: Galli-
mard, La Pléiade, 1938:951.
2. Aubenque P. Le problème de l’être chez Aristote.
Paris : PUF, 1962.
3. Aubenque P. La prudence chez Aristote. Paris: PUF,
1963.
4. Aristote. Éthique à Nicomaque, VI, 4, 1140a12.
5. Sartre JP. Quatrième partie “Liberté et responsabi-
lité”. Dans : L’Être et le Néant. Paris: Gallimard, col-
lection TEL : 612.
6. Spinoza B. Éthique, III, définition II.
7. Descartes R. Méditations métaphysiques, IV.
8. Bergson H. De l’organisation des états de conscience :
la liberté. Dans : Essai sur les données immédiates de
la conscience.
9. Aristote. La Politique, I, 5, 1254a15.
10. de La Boétie E. Discours de la servitude volon-
taire. Paris : Payot, 174, 203.
11. Rousseau JJ. Du Contrat social, I, 8.
12. Rousseau JJ. Lettres écrites de la montagne. Paris :
Gallimard, La Pléiade, t. III, p. 841.
13. Kant E. Fondements de la métaphysique des
mœurs, III.
14. Rousseau JJ. Discours sur l’origine et les fonde-
ments de l’inégalité parmi les hommes. Paris : éditions
Garnier, 209.
Une dette à l’égard de la culture grecque.
La juste mesure d’Aristote, par Françoise Kleltz-Drapeau,
L’Harmattan, collection Ouverture philosophique, 122 pages, 13,50 €
Aristote est à la mode : en éthique médicale ou en économie par exemple, nombreux sont
ceux qui s’en réclament, à plus ou moins juste titre. Une telle vogue a de quoi étonner :
qu’apprend-elle, sur Aristote d’une part, sur notre époque d’autre part ? Pour cette double
interrogation, la notion de juste mesure est un fil conducteur, puisqu’elle illustre l’ambiguïté
d’une curieuse dette à l’égard de la culture grecque : Aristote hérite d’un “lieu commun” –
l’éloge du juste milieu – et, à partir de ce qui pourrait passer pour une banalité célébrant un
centrisme tiède, il élabore une notion philosophique. Or, notre temps a un point commun
avec les Grecs : si nous admirons tant la mesure, c’est que nous sommes fascinés par la
démesure. Ainsi, en recherchant dans la littérature et l’art grecs le passé préphilosophique
de la notion, en analysant quelques œuvres où s’illustre cette étonnante juste mesure, on
comprend mieux pourquoi notre siècle est obnubilé par le désir de tout mesurer, de tout éva-
luer. En se tenant à juste distance d’Aristote, ni trop près ni trop loin, en cherchant un juste
ton entre la vulgarisation et l’érudition, ce bref essai repart des œuvres et donne quelques
éléments pour “mesurer” l’intérêt d’Aristote aujourd’hui.
Pour commander l’ouvrage en ligne : http://www.editions-harmattan.fr
L’Harmattan, 7, rue de l’École-Polytechnique, 75005 Paris.
Prix unitaire : 13,50 € + 3 € de frais de port
1
/
5
100%