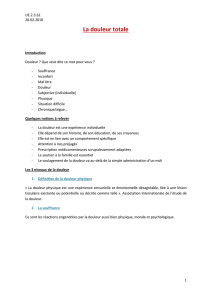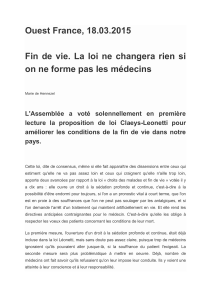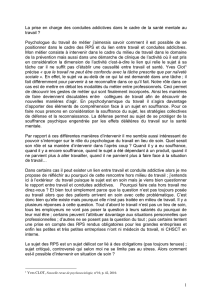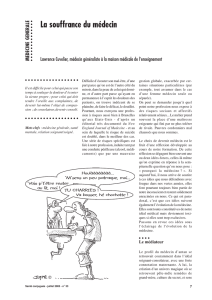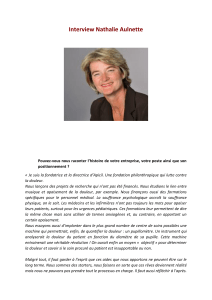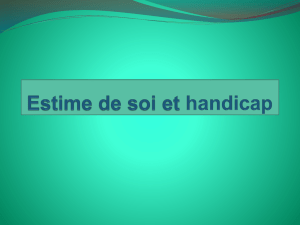Souffrance au travail - centre de gestion 61

! "!1!"! !
« (Dé)politisation de la santé au travail : risques psychosociaux versus souffrance au
travail »
Intervention au Centre de gestion de l’Orne, 13/10/2015
Frédérique Debout et Stéphane Le Lay (CNAM-Paris 5)
Introduction
« L’avènement des “risques psychosociaux” s’inscrit dans une histoire : celle des mots et
concepts pour désigner, pour dire les épreuves négatives du travail, sa pénibilité, son coût
vécu et perçu. » (Lhuilier, 2010, p.11). Au-delà des seuls « mots », cette histoire est
également celle des groupes d’acteurs qui, dans différents champs sociaux (scientifique,
politique, économique), ont lutté (et luttent encore) pour imposer le sens et la légitimité des
manières de définir ce que sont des « problèmes de santé au travail ».
Derrière le choix des mots, se dissimulent en effet de profondes divergences ontologiques
(qu’est-ce qu’un être humain ?), théoriques (qu’est-ce que le travail ? qu’est-ce que la santé ?
comment rendre compte de leurs interrelations – positives ou négatives ?) et axiologiques (à
qui attribuer la responsabilité de la prise en charge de la santé au travail ? qui doit être partie
prenante des discussions en la matière ?).
Sont donc posées des questions profondément politiques : quelle place voulons-nous que le
travail et la santé des travailleurs tiennent dans notre société ? quels mécanismes souhaitons-
nous mettre en œuvre pour y parvenir ?
Dans cette communication, nous défendrons la thèse que la notion de « risques
psychosociaux », loin d’éclairer les débats concernant les atteintes à la santé au travail,
brouille la compréhension des rapports sociaux à l’œuvre dans les organisations
contemporaines du travail. Catégorie visant à donner forme à un « problème de santé
publique », les RPS forment un dispositif politique de dépolitisation de la santé au travail
contribuant à alimenter les processus de fragmentation en œuvre depuis plusieurs décennies
dans les mondes du travail. En cela, ils s’opposent aux réflexions organisées autour du
concept de souffrance au travail.
I/ Le travail d’imposition d’une nouvelle catégorie
1/ L’apparition des risques psychosociaux dans l’espace public
Le sociologue Marc Loriol (2014) ou la psychologue Dominique Lhuilier considèrent que la
catégorie de risques psychosociaux a été popularisée par la presse au début des années 2000.
Une analyse en cours d’un corpus d’articles de presse en langue française parus entre 1998 et
2010 (comportant l’expression « souffrance au travail ») permet de préciser ce point. Le
nombre d’occurrences de l’expression « risques psychosociaux » augmente en effet durant la
période : de 6 pour les années 1998-2006 (dont 5 pour la seule année 2005), à 9 pour 2007 et
32 pour 2008, ce nombre plafonne à 80 en 2009 pour redescendre à 68 occurrences en 2010.
L’année 2008 est un moment charnière, car c’est à ce moment-là que Xavier Bertrand, alors
ministre du Travail, commande un rapport concernant le stress au travail à deux experts
Philippe Nasse, magistrat honoraire, et Patrick Légeron, médecin psychiatre (Encadré 1). Ce

! "!2!"! !
rapport, intitulé « La détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au
travail » contribuera à entériner l’adoption de la notion de RPS dans les débats publics et les
institutions, en s’appuyant sur un certain nombre d’études quantitatives internationales
(modèle de Karasek et Theorell – déséquilibre exigences professionnelles/autonomie
décisionnelle/soutien social – et modèle de Siegrist – déséquilibre efforts/récompenses) et
nationales (INRS).
Encadré 1
« Véritable enjeu de santé en entreprise, le stress au travail fait l’objet d’un rapport qui sera rendu
mercredi au ministre du travail Xavier Bertrand, pour tenter de définir, mesurer et prévenir un
phénomène qui pousse parfois des salariés au suicide. […] Sans avoir toujours des conséquences
si dramatiques, le stress au travail, et plus largement les risques psychosociaux (dépression, mal-
être, violence) se sont développés, ou ont été en tout cas médiatisés, au sein des entreprises,
devenant l’un des principaux problèmes de santé au travail, même s’ils ne sont pas encore
reconnus comme maladie professionnelle par la Sécurité sociale.
M. Bertrand s’est emparé du sujet à l’occasion de la conférence sur les conditions de travail en
octobre, regrettant que “si aujourd’hui tout le monde admet la réalité du problème, nous n’avons
pas d’indicateurs”. “Je souhaite que l’on puisse prendre en compte la question du stress au travail
aujourd’hui parce que c’est un impératif : (quand) on s’épanouit dans son travail, on travaille
bien”, a-t-il déclaré lundi sur France Inter/i-TELE/Le Monde. De plus, les conséquences
économiques du stress sont évaluées à “3 à 4% du PIB par le Bureau international du travail et
15% des arrêts de travail aujourd’hui seraient dus à des problèmes psychosociaux”, a-t-il ajouté.
Deux experts, Philippe Nasse, statisticien et économiste, et Patrick Légeron, médecin psychiatre,
ont donc été chargés d’un rapport visant à étudier et cerner l’ensemble des risques psychosociaux
liés au travail et les principaux facteurs de risques.
Mais la nomination de M. Légeron, aussi PDG d’un cabinet de conseil de gestion du stress en
entreprises, a suscité l’inquiétude de certains spécialistes du sujet.
Car deux visions, l’une collective, l’autre plus individuelle, s’opposent sur le stress. Les syndicats
et certains organismes spécialistes de santé au travail (Anact, Inrs, etc.), privilégient la première
approche, qui fait de l’organisation du travail la cause principale du mal-être des salariés. A
l’opposé, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à reconnaître la réalité du stress au
travail, mais elles privilégient souvent une action corrective, faisant appel à des cabinets de
conseil, comme celui de M. Légeron, proposant des programmes de “gestion individuelle du
stress”.
Pour l’Aderest, une association de spécialistes en santé du travail, “l’orientation ancienne,
affirmée et prédominante” du cabinet conseil de M. Légeron “vers des actions en entreprise de
type accompagnement individuel” fait craindre que les “facteurs de risque liés à l’organisation du
travail soient peu et/ou mal pris en compte”.
Xavier Bertrand a évoqué lundi quelques “pistes”, citant l’exemple d’Areva ou Renault “qui ont
décidé de mettre en place parfois des cellules d’écoute, une prise en compte des difficultés des
agents”. Jean-François Naton (CGT) espère de son côté “que le rapport ne restera pas sur une
approche culpabilisatrice et individuelle du stress”, et rappelle que “des éléments existent déjà
pour alerter sur la travail”, comme le turn-over, l’absentéisme et les arrêts de travail fréquents, ou
l’augmentation des conflits et des tensions au travail. »
« Un rapport pour définir, mesurer et prévenir le stress au travail », Agence France Presse, 11
mars 2008
2/ Une catégorie englobante
Les notions recouvertes par l’acronyme « RPS » ne décrivent pas toutes de la même manière
les liens entre subjectivité et travail, et si sous ce vocable sont rassemblées des notions aussi
différentes que celles de stress, violence, harcèlement moral, mal-être, TMS, dépression ou
encore suicides, c’est bien la catégorie de stress qui contribue principalement à organiser les
réflexions et les méthodologies.
Le stress est une notion galvaudée qui a surtout une dimension descriptive, très générale,
issue de travaux en physiologie fondés sur une méthodologie expérimentale, avant d’être

! "!3!"! !
appliquée, dans un second temps, aux situations de travail. Schématiquement, c’est la réponse
d’un organisme biologique en vue de se maintenir ou de se rétablir dans un état fonctionnel
face à des stimuli venus rompre le rapport avec l’environnement (H. Selye, 1936). C’est une
réponse adaptative à un « déséquilibre », une réaction normale (surtout surrénalienne par la
libération de cortisol) qui peut entraîner, si elle dure dans le temps, un épuisement des
ressources biologiques puis des lésions organiques. Le modèle de l’homme qui sous-tend les
théories du stress, c’est un modèle biologique, voire cognitivo-comportementaliste (Pavlov).
Or, ces modèles font l’impasse sur l’épaisseur de la vie mentale, de la vie d’âme, de la
subjectivité et de l’histoire singulière vécue… a fortiori, elles ne tiennent pas compte de
l’existence de l’inconscient, voire la récusent.
Les modèles du stress mettent l’accent sur les capacités/incapacités individuelles à « tenir », à
« résister » face aux pressions « extérieures », mais sans être en mesure de déterminer avec
précision la manière dont certaines dynamiques sociales jouent sur ces « résistances ». Loin
de mettre en question l’organisation sociale du travail, les outils censés mesurer le stress
insistent surtout sur l’adaptation et les processus d’adaptation individuels. Bref, « La
prévalence de la référence au stress […] tient […] à la congruence des modèles du stress avec
une double perspective qui domine aujourd’hui les modes de traitement de la problématique
santé et travail : perspective d’adaptation et de mesure. » (Lhuilier, 2010, p.18).
3/ Une absence de consensus
La notion de RPS s’est vite propagée, aboutissant à la création d’un cadre conceptuel peu
stabilisé. « Notion forgée dans l’urgence », selon Lhuilier (2010, p.18), cette catégorie ne fait
donc absolument pas consensus au sein du champ scientifique. Ainsi, pour cette chercheuse,
les RPS masquent mal l’individualisation et la « psychologisation » à outrance de la question
des atteintes à la santé.
De fait, pour le ministère du Travail, les RPS « recouvrent en réalité des risques
professionnels d’origine et de nature variées, qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé
mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact sur le bon fonctionnement des
entreprises. On les appelle “psychosociaux” car ils sont à l’interface de l’individu : le
“psycho”, et de sa situation de travail : le contact avec les autres (encadrement, collègues,
clients…), c’est-à-dire le “social” ».
Pourtant, considérer que l’« individu » renvoie au « psycho » et que la situation de travail
relève du « social » est un contresens problématique (Le Lay, 2007). De nombreuses
recherches sociologiques ont montré qu’un individu n’est pas une monade isolée, façonnée de
l’extérieur par des « contextes », des « environnements » fussent-ils sociaux. Toute
configuration (une entreprise, un quartier, un Etat) ne peut se comprendre sans la prise en
compte des individus qui en forment la trame, tout en étant eux-mêmes travaillés par elle. Les
idées de contexte ou d’environnement présupposent une extériorité radicale entre les
individus et ce qui les « entoure », quand il faut plutôt réfléchir en termes d’interpénétration :
subjectivité et social se travaillent dans un lent processus plus ou moins conflictuel en
fonction de l’équilibre des rapports sociaux qui traversent une configuration donnée.
Par ailleurs, étymologiquement, « risque » signifie « danger, inconvénient plus ou moins
prévisible ». Entre les 14e et 17e siècle, le terme était surtout utilisé pour parler des risques
encourus par les marchandises voyageant sur mer. La notion a ensuite été utilisée dans le
domaine assurantiel en général, puis dans le domaine de l’assurance sociale (à travers la

! "!4!"! !
question de la prise en compte des accidents du travail). Outre que l’on est passé d’une notion
concernant des biens à une notion concernant les individus (mais les travailleurs ne sont-ils
pas des marchandises, après tout ?), le risque a donc de fortes connotations probabilistes et
juridiques, qui n’ont qu’un lointain lien avec les questions de travail et de santé.
« La catégorie “RPS” [fait] du “psychosocial” un risque, dans la lignée de ceux identifiés par
la toxicologie industrielle […] Les controverses se radicalisent opposant les tenants de
“l’exposition aux risques” (qu’il s’agira donc d’identifier et de mesurer), à ceux qui
s’inscrivent plutôt dans la tradition de la “prédisposition”, celle qui permet de catégoriser des
“individus à risques”. Dans les deux cas, l’activité est évacuée et la seconde témoigne des
tendances eugénistes récurrentes mais aujourd’hui en pleine expansion. » (Lhuilier, 2010,
p.22). De plus, pour le psychologue Yves Clot, cette catégorie suppose un travailleur passif,
confronté à des risques extérieurs. Par ailleurs, l’évaluation quantitative des RPS pose des
problèmes que personne ne peut éluder. Ainsi, tout en prônant la mobilisation raisonnée de
données statistiques en la matière, le Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques
psychosociaux reconnaît que « se borner à un suivi statistique sans réaliser d’observations
qualitatives risquerait […] de conduire à des utilisations des statistiques manquant de
pertinence. » (Gollac et al., 2011, p.14). Plus radicaux, les psychodynamiciens du travail
critiquent toute quantification en raison de la complexité et de la spécificité des mécanismes
mis en œuvre dans le travail. Pour Christophe Dejours, les phénomènes mesurés ne reflètent
pas ce que les questionnaires prétendent atteindre et laissent dans l’ombre les aspects du
travail les plus essentiels : chacun entretient au travail un rapport singulier même s’il n’est pas
seulement solipsiste…
4/ Dépolitisation du travail et de la santé
Les sociologues Marlène Benquet, Pascal Marichalar et Emmanuel Martin ont montré, pour le
cas d’EDF/GDF, la manière « empirique » (c’est-à-dire sans chercher à être scientifiquement
fondée a priori) dont les directions des deux entités et leurs experts ont progressivement
imposé la notion de RPS dans les discussions du CNHSCT, à partir de 2003. Ceci avait pour
but premier de « parer au renforcement juridique de la responsabilité de l’employeur. Le
concept de risques psychosociaux, étroitement lié aux nouveaux groupes de travail
managériaux qui la portent, autonomise le traitement de la souffrance psychique par rapport
au débat classique sur la responsabilité des maux du travail » (2010, p. 135).
L’utilisation de la notion de RPS à EDF/GDF a produit trois effets importants. D’abord, une
dilution de la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne les atteintes à la santé
psychique des salariés : « le flou de la notion de risques psychosociaux est pensé comme un
facteur de consensus permettant d’échapper à la recherche des coupables » (Benquet,
Marichalar et Martin, 2010, p.138). Ensuite, une tendance à la réduction de la prévention des
risques à leur simple évaluation. Mais l’élément le plus important renvoie à la technicisation
des débats (langage, démarche), progressivement monopolisés par des managers et des
experts dans des groupes de travail où les représentants des salariés ne sont guère associés,
voire délibérément écartés. Or, on sait que la technicisation d’un domaine par une direction
est un moyen d’en dépolitiser les contenus pour mieux s’en réapproprier la
gouvernementalité. EDF/GDF a ainsi utilisé des instruments dont les effets délétères en
matière de santé sont dorénavant bien connus, comme le benchmarking (comparaison du
« niveau de risque » d’unités entre elles et avec d’autres entreprises), avant de marginaliser
complètement le CNHSCT sur les questions de santé au travail en créant un Observatoire de
la qualité de vie au travail qui préfigurera la dissolution du CNHSCT quelques mois plus tard.

! "!5!"! !
Parallèlement, des institutions comme l’ANACT (Encadré 2) et l’INRS ont contribué à
installer durablement la notion de risques psychosociaux dans le champ économique, à la fois
en la légitimant symboliquement via la sanction institutionnelle dont elles peuvent se
prévaloir, mais également en accompagnant pratiquement des entreprises pour l’évaluation
des risques et dans la réalisation d’expertises ciblées.
Encadré 2
« Benjamin Stahler [responsable du groupe de travail sur les risques psychosociaux du réseau
Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail)] refuse de stigmatiser les
entreprises : “Jusqu’à présent, elles n’ont géré que le volet ‘emploi’ des restructurations. Elles
n’ont pas encore pris la mesure du coût humain, social et financier des risques psychosociaux.
Mais j’ai le sentiment que les DRH et les CHSCT ont envie de s’emparer de cette question pour
développer une véritable logique de prévention.” Le groupe de travail de l’Anact a ainsi identifié
quatre types de tensions subies par les salariés : les tensions liées au travail lui-même (objectifs
trop élevés, horaires décalés, compétences inadaptées…) ; les exigences du salarié, qui a besoin de
reconnaissance et de donner du sens à son travail (un décalage trop flagrant entre ses valeurs
personnelles et sa pratique professionnelle génère de la souffrance) ; les tensions liées aux
relations au travail (mise en concurrence des salariés, harcèlement, exclusion…) ; et enfin,
l’accélération du changement (les compétences et les expertises acquises étant constamment
remises en question, avant même que le salarié ait eu le temps de se sentir à l’aise dans ses
nouvelles missions). “Cette typologie montre bien à quel point la mise en place d’une ligne
d’écoute psy est une réponse dérisoire à des questions de fond, sourit Benjamin Stahler. Le stress
et la souffrance au travail sont avant tout liés à des problèmes de management et
d’organisation.” »
Sabine Germain, « Le psy n’est pas une solution miracle », Les Echos, 22 janvier 2008
Tous ces éléments et les études de terrain nous poussent à considérer que les RPS constituent
un dispositif (avec ses discours, ses savoirs, ses institutions), visant à façonner en profondeur,
en matière de santé au travail, les modes de pensée et d’action de ceux vers qui elles se
déploient, dans le sens voulu par leurs promoteurs. Ce qui est écarté, c’est la mise en débat du
travail et son organisation. En ce sens, elles s’opposent en tous points au concept de
souffrance au travail, tel qu’il a été notamment développé par la psychodynamique du travail.
II/ Souffrance, travail et subjectivité
1/ Qu’est-ce que la souffrance au travail ?
La souffrance telle que la définit la psychodynamique du travail n’est pas initialement
pathogène (c’est-à-dire causes de troubles et/ou de maladies). La psychodynamique du travail
tient à la référence à la notion de souffrance. Parler de souffrance implique de parler de
défense, ce qui n’est pas le cas dans le couple mal-être/bien-être traduisant des états plus que
des constructions dynamiques. C’est d’abord une expérience subjective, un vécu pénible et
désagréable intrinsèque au fait de travailler. Contrairement à la notion de stress, elle ne place
pas le focus d’analyse sur les capacités/incapacités individuelles à résister, à tenir au travail.
Loin d’être un état ou un sentiment figé, la souffrance recouvre une valence dynamique. Elle
n’est pas synonyme de maladie, mais au contraire de ce qui nous mobilise dans le
travail, ce qui nous amène à développer des efforts, à nous engager, voire à faire preuve
de zèle. Elle ne se réduit pas à la souffrance pathogène.
Le travail représente avant tout ce qu’implique le fait de travailler : des gestes, des
savoir-faire, un engagement du corps et de la subjectivité, le pouvoir de sentir, réfléchir,
penser, inventer etc. Travailler, c’est toujours un mode d’engagement de l’individu pour
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%