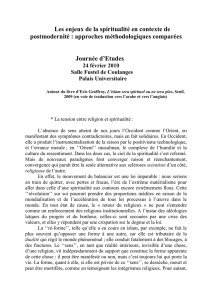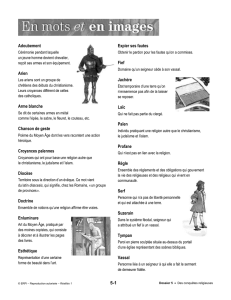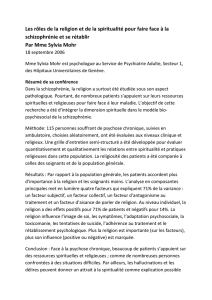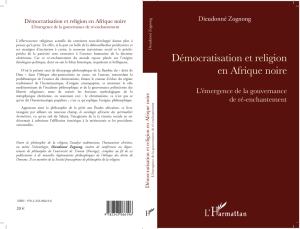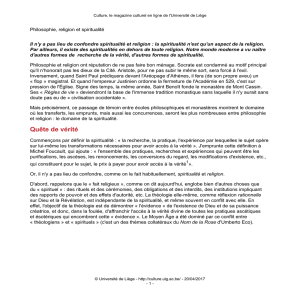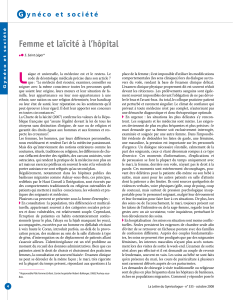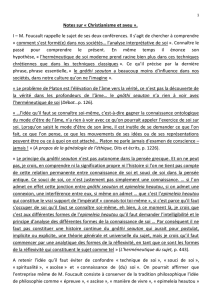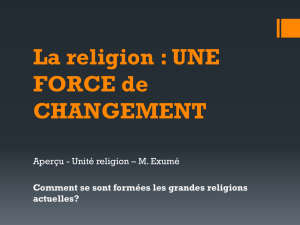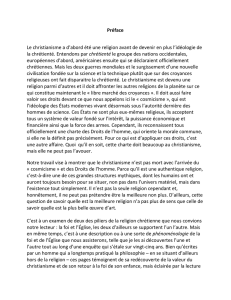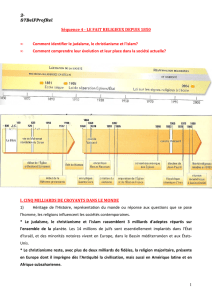...il y a eu Aristote... La théologie est précisément un type de

1
« ...il y a eu Aristote... La théologie est précisément un type de connaissance de structure rationnelle qui permet au sujet — en tant
que sujet rationnel et seulement en tant que sujet rationnel — d'avoir accès à la vérité de Dieu, sans condition de spiritualité.... La
scolastique ... était déjà un effort pour lever la condition de spiritualité qui avait été posée dans toute la philosophie antique et dans toute la
pensée chrétienne (saint Augustin et ainsi de suite) » (L'herméneutique...., p. 184).
« Pendant ces douze siècles (V->XVII), le conflit n'a pas été entre la spiritualité et la science : il a été entre la spiritualité
et la théologie » (Id. p. 28).
« Et au lieu de considérer le christianisme comme la religion d'un livre qui doit être interprété, je voudrais considérer le
christianisme comme la religion d'un soi qui doit être déchiffré » (note a, p. 69).
« ... cette notion de salut, quelle qu'en ait été l'origine, quel ait été sans doute le renforcement qu'elle a pu recevoir de la thématique
religieuse àç l'époque hellénistique et romaine, fonctionne, effectivement et sans hétérogénéité, comme notion philosophique, dans le
champ même de la philosophie. Le salut est devenu et apparaît comme un objectif même de la pratique et de la vie philosophique » (
L'herméneutique, p. 175).
« ...ce serait tout à fait inexact de ne voir et de ne mesurer l'importance de la notion de conversion que dans l'ordre de la religion, et de
la religion chrétienne. Après tout, la notion de conversion est aussi une notion philosophique importante, et qui a joué dans la
philosophie, dans la pratique philosophique, un rôle décisif. La notion de conversion a aussi dans l'ordre de la morale une importance
capitale. Et puis enfin il ne faut pas oublier que la notion de conversion s'est introduite de façon spectaculaire, et on peut dire
dramatique, dans la pensée, dans la pratique, dans l'expérience, dans la vie politique à partir du XIX°/s.. Il faudra bien un jour faire
l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la subjectivité révolutionnaire » (Id. p. 200).
Hadot : « pratique volontaire, personnelle, destinée à opérer une transformation de l'individu, une transformation de
soi » (Exercices..., p. 145).
- Foucault : « Par spiritualité j'entends... ce qui précisément se réfère à l'accès du sujet à un certain mode d'être et aux transformations
que le sujet doit faire de lui-même pour accéder à ce mode d'être. Je crois que, dans la spiritualité antique, il y avait identité ou presque
entre cette spiritualité et la philosophie » (Dits et écrits II, p. 1541). Ou encore :« ...tel qu'il est (le sujet) n'est pas capable de vérité... il ne
peut y avoir de vérité sans une conversion ou une transformation du sujet » (L'herméneutique..., p. 17).
« Sauf pour la vertu et ce qui se rattache à la vertu, n'oublie pas de pénétrer à fond dans le détail des choses afin d'arriver, par cette analyse,
à les mépriser. Applique le même procédé à toute la vie » (Marc Aurèle, Pensées..., Herméneutique... p. 290).
Le but c'est de donner au soi un forme, et à faire par les exercices spirituels un art de vivre (technè tau biou), un style
de vie.
- Pour le christianisme naissant, considéré comme une philosophie, l'examen de conscience a pour but de s'interroger
sur l'origine de la représentation. Qu'est-ce qui en moi m'inspire telle ou telle pensée, Dieu ou le diable ? D'où l'accent
mis sur l'intériorité et non plus sur le monde extérieur.
« Ce n'est pas la valeur des choses qu'il va falloir reconnaître, ce sont les secrets de la conscience qu'il faudra déchiffrer... Ce n'est plus la
valeur des choses par rapport au sujet qui est en question, c'est l'illusion interne de soi sur soi » (Du gouvernement... p. 291).
« Le christianisme est une religion du salut dans la non-perfection » (Du gouvernement des vivants, p. 253).

2
« Mais notre opiniâtre ennemi ne s'endort jamais dans sa malice. Que dis-je ? Il redouble surtout de fureur quand il voit l'homme
échappé (sic) à ses liens : plus nos passions s'éteignent plus sa haine s'enflamme » (Tertullien, De penitentia, note Du gouvernement...p.
134).
- « ... avec Tertullien (celui qui a inventé le péché originel » (p.118), vous avez cette idée, qui sera... capitale dans l'histoire du
christianisme, qu'au fond, plus on est chrétien, plus on est exposé. Plus on est chrétien plus le diable fait rage » Id. p. 122).
- « C'est dans le monachisme... et pas dans le christianisme en général, que ces techniques de la vie philosophique ont
été remises en activité » (Id. p. 253).
- « ... l'idée même de la rechute était une idée qui était étrangère aussi bien à la culture grecque hellénistique et romaine qu'à la religion
hébraïque. Penser la rechute, c'est, je crois, un des traits fondamentaux du christianisme »
(Id. p. 175).
« Le monde gréco-romain est un monde de la faute. C'est un monde de la responsabilité, c'est un monde de la culpabilité... Le
christianisme n'est donc pas une religion qui aurait introduit la faute, le péché, le peccatum, dans l'innocence d'un monde sans culpabilité. Il
a fait tout autre chose. Il a introduit le problème du peccatum, du péché, de la faute, non pas dans l'innocence, mais par rapport à elle. Il a
introduit le problème du peccatum par rapport à la lumière, par rapport à la délivrance et par rapport au salut. C'est-à-dire : qu'en est-il de
la faute et comment est-il possible de commettre une faute dès lors que l'on a eu accès à la vérité ? » (Id. p. 182).
- « La morale austère du modèle hellénistique a été reprise et a été travaillée par les techniques de soi définies par l'exégèse et la
renonciation à soi propres au modèle chrétien » (Herméneutique... p. 248).
« ce n'est plus l'acte lui-même, c'est, avant l'acte, le désir qui est l'élément important... Le bloc des aphrodisia se trouve ainsi disloqué.., et
il y a un recentrage... de tout le problème des aphrodisia autour du désir... » (Id. p. 291).
« Il faut montrer au contraire comment le désir, loin d'avoir été réprimé, est un quelque chose qui a été petit à petit extrait et a
émergé d'une économie des plaisirs et des corps, autour et à propos de lui, se sont cristallisées toutes les opérations et toutes les
valeurs positives ou négatives concernant le sexe. C'est le désir qui, à lui seul, a fini par confisquer tout ce qui était autrefois réuni dans
cette unité qui était celle des désirs, des plaisirs et des corps... Le désir, c'est bien effectivement ce que rappellerais le transcendantal
historique à partir duquel on peut et on doit penser l'histoire de la sexualité...il serait un peu inadéquat et tout à fait insuffisant, par
rapport à l'ampleur et la complexité des problèmes, de vouloir faire une histoire de la sexualité en termes de répression du désir » (Id.
p. 293).
« ce moment, cette chose est la constitution de ce que j'appelle l'herméneutique de soi, le commencement du soi occidental, qui est
autre chose que la disparition de l'Être et autre chose que le commencement de la rationalité moderne » (Débat sur « Vérité et subjectivité
»).
Lacan qui a fait resurgir « la question du prix que le sujet a à payer pour dire le vrai... en faisant resurgir à l'intérieur même de la
psychanalyse la plus vieille tradition, la plus vieille interrogation, la plus vieille inquiétude de cette epimeleia heautou, qui a été la forme
la plus générale de la spiritualité » (Id. p.31).
« Est-ce qu'on peut, dans les termes mêmes de la psychanalyse, c'est-à-dire tout de même des effets de connaissance,
poser la question de ces rapports du sujet à la vérité, qui — du point de vue en tout cas de la spiritualité et de
l'epimeleia heautou — ne peut pas, par définition, se poser dans les termes mêmes de la connaissance ? » (Id. p. 31).
1
/
2
100%