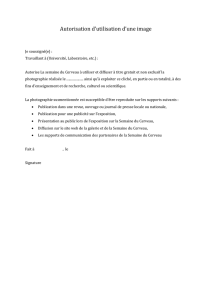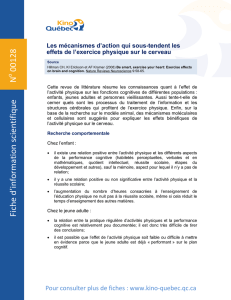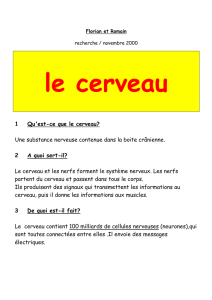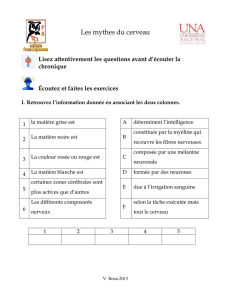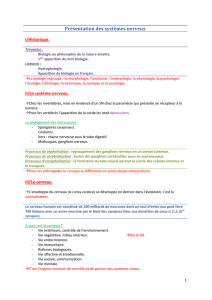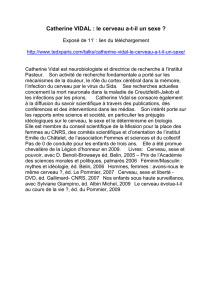Psychiatrie et psychothérapie sont (enfin) parvenues au cerveau

Quintessence
쎲Bien que Sigmund Freud ait pensé qu’il serait une fois possible de découvrir
les corrélations organo-biologiques des phénomènes psychiques, le cerveau en
tant que substrat de processus psychiques a été pratiquement perdu pour la psy-
chiatrie au 20esiècle. Il n’y avait tout simplement aucun moyen de visualiser in
vivo les particularités fonctionnelles et morphologiques de la plupart des troubles
psychiques. Aujourd’hui tout a changé. Depuis quelques dizaines d’années, les
neurosciences ont radicalement modifié les grandes hypothèses de base de la psy-
chiatrie et de la psychothérapie. Après un scepticisme initial, il est aujourd’hui
communément admis que tout ce qui est psychique est aussi biologique.
쎲La plasticité du cerveau, le fait que le fonctionnement du cerveau soit carac-
térisé par des remaniements morphologiques constants, est une donnée fonda-
mentale.
쎲L’imagerie diagnostique moderne a révolutionné la compréhension des pro-
cessus psychiques à de très nombreux égards. Nous comprenons maintenant
mieux les répercussions – à long terme – des premières influences sur le cer-
veau en développement, tout comme l’interaction entre expression génique et
facteurs environnementaux.
쎲Le cerveau est pour l’essentiel une machine à apprendre, et nous savons
étonnamment beaucoup de choses sur les corrélations biologiques des proces-
sus d’apprentissage.
쎲Ce qui est aussi une révolution, c’est que des diagnostics cliniques tels que
troubles anxieux, dépressions ou psychoses vont de pair avec des modifications
typiques non seulement de l’activité neuronale, mais aussi de structures mor-
phologiques et, ce qui est particulièrement important pour la pratique de la
psychiatrie, que les traitements psychiatriques provoquent des changements
quantifiables dans le cerveau. Ceci est vrai aussi bien pour la pharmacothéra-
pie que pour la psychothérapie.
쎲La psychiatrie et la psychothérapie sont ainsi devenues des domaines
spécialisés ayant un ancrage organo-biologique. L’époque où la psychiatrie fai-
sait sourire en tant que secteur marginal de la médecine et où la psychothérapie
était démolie comme papotage empathique est bien révolue.
Summary
Psychiatry and psychotherapy have (at last)
discovered the brain
쎲Although Sigmund Freud expected that in future it would be possible to find
the organic and biological correlates of mental processes, in the 20th century
the brain as a substrate for mental processes was largely lost to psychiatry.
There was simply no means available of identifying the special functional and
morphological features of most mental disorders in vivo. Today all this has
changed. In recent decades the neurosciences have radically altered the basic
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:569–575 569
Psychiatrie et psychothérapie sont
(enfin) parvenues au cerveau
Certaines interventions psychiatriques et psychothérapeutiques
modifient les structures du cerveau
Konrad Michel
Universitäre Psychiatrische Dienste (UPD), Universitätsklinik für Psychiatrie, Bern
Vous trouverez les questions à choix multiple concernant cet article à la page 565 ou sur internet sous www.smf-cme.ch.
Introduction
Les neurosciences ont révolutionné ces derniè-
res années notre compréhension de la biologie
du psychisme. La vieille image du système ner-
veux central en tant qu’organe non modifiable
(et éventuellement dégénérescent et atrophique)
est totalement et irrévocablement révolue. Le
«nouveau» cerveau est en remodelage constant
(plasticité) en fonction de processus adaptatifs.
Nous savons aujourd’hui que les réseaux neuro-
naux se modifient en permanence, c.-à-d. que de
nouvelles connexions s’établissent sous forme
de synapses et que d’anciennes disparaissent.
Nous savons de même que le cerveau renferme
des cellules souches neurales, qui produisent
constamment de nouvelles cellules nerveuses
(neurogenèse) migrant dans plusieurs structures
cérébrales pour s’y différencier.
Donald Hebb a suspecté en 1949 déjà que la base
des processus d’apprentissage se situait dans
l’aiguillage de la transmission synaptique de neu-
rone à neurone. La potentialisation à long terme
joue un rôle central. Il s’agit d’une réaction bio-
chimique dans laquelle une activation spécifique
de synapses voisines déclenche la synthèse de
protéines provoquant localement une potentia-
lisation de la liaison synaptique («neurons that
fire together wire together»). Il s’ensuit que pour
une liaison neuronale aiguillée de cette manière,
un stimulus présynaptique très discret peut déjà
donner lieu à un potentiel d’action. De nouvelles
expériences provoquent donc des modifications
structurelles durables au niveau des liaisons
synaptiques activées en réseau.
Certaines zones du cerveau plus fortement mises
à contribution – tout comme celles de la muscu-
lature dans l’entraînement physique – augmen-
tent de volume, ce qui frappe surtout au niveau
de l’hippocampe, qui est la région du cerveau
responsable du stockage et de l’évocation contex-
tuels (visuel-spatial, temporel, émotionnel, etc.)
d’éléments mnésiques. Une espèce de mésange
par exemple, qui cache partout ses stocks de
nourriture, a un hippocampe plus volumineux
que les mésanges qui ne le font pas. Les chauf-
feurs de taxi londoniens ont un hippocampe droit

joue déjà un rôle sur le développement du cer-
veau fœtal. Après la naissance, le cerveau est
soumis à un nombre incalculable de nouvelles
impressions, tente de les mettre en ordre et de
reconnaître des règles. Ces processus d’appren-
tissage se passent surtout dans le cortex préfron-
tal (CPF), nettement plus volumineux chez
l’Homo sapiens sapiens que chez les autres
mammifères (29% de la masse cérébrale, contre
17% chez le chimpanzé, 6,9% chez le chien et
3,4% chez le chat). C’est surtout le cortex orbito-
frontal (COF), partie du CPF, qui est responsable
de l’apprentissage des innombrables éléments
du comportement social. Il se développe surtout
après la naissance. L’une des tâches essentielles
du COF est la régulation des émotions. C’est sur-
tout entre six et douze mois que se développent
d’innombrables synapses. Les expériences régu-
lières s’organisent en voies neuronales, ce qui
crée des structures de base neuronales à long
terme, marquées par les premières expériences
d’interactions sociales. Il y a donc une corré-
lation neurobiologique à l’interaction précoce
mère – enfant. A partir de trois ans, le nombre
de synapses atteint son maximum, nettement
plus élevé qu’à l’âge adulte, ensuite de quoi s’ins-
talle une phase d’élagage massif («pruning») et
de nettoyage des liaisons synaptiques non fonc-
tionnelles.
Le Moi neurobiologique
Les éléments d’apprentissage sont stockés sous
forme de représentations neuronales. Ces der-
nières sont caractérisées par des réseaux neuro-
naux spécifiquement mnésiques, qui seront
réactivés ou reconstruits par des processus asso-
ciatifs lors du processus du souvenir. Un seul
neurone ne «sait» rien. Ce n’est que l’activation
ou la désactivation de plusieurs neurones qui
donne une signification.
Le principe de représentation neuronale des
expériences d’interactions dans l’enfance a un
parallèle manifeste avec le modèle psychanaly-
tique de la représentation d’un objet internalisé
(par ex. la mère). Au cours du développement se
forme une représentation du Moi et du non-Moi,
fortement marquée par les premières expérien-
ces d’interactions sociales. John Bowlby a utilisé
il y a plus de 30 ans de cela le terme de «working
models» internes, qui se forment au cours du
développement de l’enfant comme une représen-
tation de l’histoire du développement inter-
actionnel – et individuel. Le comportement de
liaison postulé dans la théorie du même nom joue
ici un rôle capital: les enfants ayant une liaison
sûre ont de meilleures chances – même à l’âge
adulte – de pouvoir contrôler leurs impulsions
émotionnelles, ce qui signifie neurobiologique-
ment que les voies contrôlant le cerveau émo-
tionnel sont mieux développées.
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:569–575 570
plus grand que les autres londoniens, et cette
augmentation de volume est fonction des années
de service comme chauffeur. Les musiciens ont
des zones de projection sensori-motrices plus
grandes pour certaines fonctions motrices bien
précises, par ex. jouer du violon, de même que
des zones de projection plus spécialisées au
niveau du cortex acoustique primitif. Nous sa-
vons de l’expérimentation animale que l’activité
physique favorise la neurogenèse dans l’hippo-
campe, surtout si l’animal se trouve dans un
environnement intéressant, avec beaucoup d’es-
pace, d’interactions sociales, etc. («enriched en-
vironment»).
Tout ceci ne se passe pas sans régulation par
l’ADN, à savoir par l’expression génique. C’est
l’ADN qui déclenche la synthèse de protéines, qui
quant à elles dirigent les réactions biochimiques
à l’origine des modifications morphologiques.
Les gènes sont notre logiciel contrôlant toutes les
réactions biochimiques réagissant aussi bien aux
conditions internes qu’externes, c.-à-d. tous les
processus adaptatifs. Pour l’Homo sapiens en
particulier: le cerveau est un organe social –
l’être humain se développe dans une structure
complexe de relations sociales. Les processus
d’apprentissage les plus importants que nous
traversons pour nous y retrouver dans notre
existence sont de nature psychosociale.
Les premières influences
sont des aiguillages
Chaque cerveau a sa propre histoire de dévelop-
pement. Nous supposons que l’influence (psycho-
physiologique) de la mère (dépression, stress)
assumptions of psychiatry and psychotherapy. After initial scepticism it is gen-
erally accepted nowadays that whatever is psychological is also biological.
쎲Central is the discovery of the brain’s plasticity – the fact that brain func-
tion is characterized by constant morphological reorganisation processes.
쎲Modern imaging techniques have revolutionized our understanding of men-
tal processes in many ways. Thus, we now understand the – long term – effects
of earlier influences on the developing brain, and also the interplay of gene
expression and environmental influences.
쎲Essentially the brain is a learning machine, and we know a surprisingly
much about the biological correlates of learning processes.
쎲Another revolutionary finding is that clinical diagnoses such as anxiety
disorders, depression or psychotic disorders are associated with typical alter-
ations not only of neuronal activity patterns but also of morphological struc-
tures, and – a factor of particular importance for the practice of psychiatry –
that psychiatric therapies bring about measurable changes in the brain. This
is true of pharmacotherapy and psychotherapy alike.
쎲Psychiatry and psychotherapy have thus become biologically-anchored spe-
cialties. The days are past when psychiatry was smiled upon as a marginal
medical field and psychotherapy as empathic small talk.

physo-cortico-surrénalien («axe HPA») sous
l’effet de la production accrue de l’hormone li-
bérant la corticotropine (CRH). La CRH est pro-
duite en excès si le feedback négatif des récep-
teurs des glucocorticoïdes ne fonctionne pas, ce
qui est le cas lorsque dans une situation de stress
il n’y a ni maîtrise du danger ni adaptation suf-
fisante. L’absence de suppression de la cortico-
tropine et du cortisol après injection du glucocor-
ticoïde synthétique dexaméthasone est typique
du cerveau constamment stressé. Dans le cer-
veau «stressé», l’activité neurale au niveau du
système limbique, de l’amygdale surtout, est
augmentée, alors qu’elle est diminuée dans le
CPF et l’hippocampe. S’il est question de survie,
nous faisons manifestement appel à des struc-
tures évolutives précoces, et nous ignorons les
«activités de luxe», plus récentes. Dans les situa-
tions de stress prolongé, tout comme dans les
dépressions d’ailleurs, le nombre de nouvelles
synapses est drastiquement diminué, surtout
dans le CPF et l’hippocampe sous l’effet de la
concentration plus élevée d’hormones de stress,
tout comme la néoformation neuronale à partir
de cellules souches neurales. L’apoptose (mort
cellulaire programmée) est également diminuée,
ce qui témoigne d’une plasticité neuronale
généralement perturbée et donc d’une capacité
d’adaptation réduite. Des concentrations élevées
de glucocorticoïdes à long terme ont de très nom-
breuses autres répercussions, dont la suppres-
sion de la synthèse de médiateurs de la commu-
nication intracellulaire tels que prostaglandines
et cytokines, ou la baisse des concentrations
d’hormones sexuelles.
Ce sont surtout les vécus traumatiques à la
période de développement qui sollicitent le sys-
tème d’adaptation et donnent à l’âge adulte aussi
une susceptibilité accrue au stress, des réactions
excessives du système limbique et du même fait
de l’axe HPA. L’amygdale, centrale d’alarme, en-
registre très rapidement – et malheureusement
sans grande différenciation – les situations me-
naçantes, ce qui se manifeste par une réaction
psychophysiologique immédiate (palpitations,
vertige, oppression, etc.). L’activation de l’amyg-
dale après émission brève (quelques millisecon-
des, si brève qu’elle ne peut devenir consciente)
d’images de visages menaçants a été démontrée
par imagerie. L’antagoniste de l’amygdale est le
CPF, sorte de stock de travail online, dans lequel
impulsions émotionnelles, sensations corpo-
relles, perception, cognition et très nombreux
éléments mnésiques accumulés au cours de
l’existence sont dynamiquement reliés. Ce sont
les structures corticales qui nous permettent ici
d’analyser de manière plus différenciée les situa-
tions menaçantes et éventuellement de reconnaî-
tre la réaction de l’amygdale comme une fausse
alerte. Cette analyse corticale d’une situation
se produit cependant bien après l’activation de
l’amygdale. Joseph LeDoux [2] parle de la «high
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:569–575 571
Nous vivons notre histoire en permanence, que
nous le voulions ou non. Le Moi adulte est une
instance qui interprète simultanément passé,
présent et avenir, et qui les relie, la plupart du
temps sans que cela ne soit conscient – tout ceci
résulte de processus neurobiologiques. Les sou-
venirs importants pour la représentation du Moi
sont surtout stockés et évoqués dans le cortex
préfrontal. Ce n’est pas par hasard que le CPF
soit la région arrivant le plus tard à maturité dans
le développement du cerveau. Même si à l’âge
adulte les structures de base du Moi sont relati-
vement résistantes au changement, le Moi est
une structure dynamique capable de changer
sous l’effet de nouvelles expériences. Ce qui peut
le mieux s’illustrer par le terme du Moi narratif:
l’histoire très personnelle – stockée dans les neu-
rones – de notre Moi (la représentation biogra-
phique de notre Moi) est constamment modifiée
sous la lumière de nouvelles expériences – ce qui
naturellement a une importance fondamentale
pour l’activité thérapeutique.
Processus adaptatifs
L’apprentissage n’est absolument pas un simple
processus cognitif. De très nombreuses régions
corticales et sous-corticales sont impliquées.
L’harmonie émotionnelle et motivationnelle joue
un rôle déterminant dans les processus d’ap-
prentissage. L’activation du noyau amygdalien
basolatéral par exemple aide à la disposition
des contenus mnésiques dans le CPF et l’hippo-
campe. Les voies mésolimibiques-mésocortica-
les dopaminergiques jouent un rôle capital pour
la fonction du CPF, et tout spécialement pour la
motivation à viser des buts importants. Le réseau
cérébral est constamment occupé à faire des pré-
visions à partir des expériences accumulées au
cours de l’existence et à diriger l’action du mo-
ment. L’harmonie émotionnelle est à la base des
processus adaptatifs – nous «sentons» si quelque
chose est bon ou pas bon pour nous – processus
inconscients pour la plupart. «All functions of
mind reflect functions of brain» [1] est également
le cas pour les états affectifs, c.-à-d. que les états
affectifs ne sont imaginables que si les réseaux
neuronaux correspondants sont activés.
Le stress, spécialement s’il se prolonge, joue un
rôle central dans de nombreux troubles psychi-
ques. Le cerveau dispose de récepteurs aux mi-
néralo- et glucocorticoïdes. Les premiers ont leur
importance dans l’analyse de situations de dan-
ger immédiat (réactions de type «fight-flight»), et
les derniers dans l’adaptation, le développement
et la mémorisation de comportements de maî-
trise de nouvelles situations. Le problème com-
mence dès que nos possibilités de maîtrise sont
dépassées et que le système hormonal de stress
n’est pas à la hauteur de la situation. Il en résulte
une hyperactivité de l’axe hypothalamo-hypo-

Des différences individuelles dans le contrôle des
réactions biochimiques, et donc également dans
la résistance biologique au stress, peuvent être
influencées par des polymorphismes génétiques.
Nous connaissons deux allèles du gène 5-HTT
Promotor, un long (l) et un court (s), gène précé-
dant fonctionnellement le gène 5-HTT. Les per-
sonnes ayant la variante ll ont moins tendance
aux dépressions et tentatives de suicide que
celles ayant la variante ss, et celles qui ont la
variante ls se situent entre les deux [4]. Environ
32% de la population occidentale sont porteurs
de ss, 49% de sl et 19% de ll – ce qui indique
clairement que nous avons génétiquement des
capacités d’adaptation différentes. Mais il est
rassurant de savoir que des études d’expérimen-
tation animale montrent qu’un comportement
maternel optimal au début du développement a
un effet protecteur considérable. L’interaction
«nurture» et «nature» est donc toujours valable
– ce que nous oublions facilement.
La thérapie a des effets mesurables
sur la fonction (et la morphologie)
du cerveau
Il n’est pas possible ici de décrire en détail les
éléments neurobiologiques spécifiques actuelle-
ment connus dans les diagnostics psychiatri-
ques. Nous ne parlerons que des résultats les
plus importants dans quelques troubles, à titre
d’exemple.
Dans la dépression, il y a une activité diminuée
dans certaines régions corticales, ce qui est
particulièrement le cas dans le CPF gauche. Cette
région est associée aux buts et émotions positi-
ves, le CPF droit l’étant aux émotions négatives.
Il n’y a pas que l’activité qui soit réduite au ni-
veau du CPF, mais aussi son volume. Des études
post mortem ont découvert une diminution de
la densité neuronale de 17 à 30% dans le CPF.
L’hippocampe est rétréci de 8 à 19% dans les
dépressions prolongées. Ces résultats sont en
en corrélation avec la durée cumulée des phases
dépressives non traitées et expliquent de nom-
breux déficits fonctionnels typiques de la symp-
tomatologie dépressive (par ex. problèmes
mnésiques, difficultés de concentration, perte
d’élan vital et des actions ciblées, etc.). L’amyg-
dale par contre est hyperactivée dans la dépres-
sion. Une hyperactivation habituelle de l’amyg-
dale et de l’hémisphère droit est signe de
mauvais pronostic. Ces changements sont ac-
tuellement compris comme résultant en premier
lieu de l’hypercorticisme (hypothèse du ré-
cepteur des glucocorticoïdes).
Dans le traitement de la dépression, il s’est avéré
que des modifications de l’activité neuronale
peuvent être obtenues aussi bien avec la phar-
macothérapie qu’avec la psychothérapie (par ex.
thérapie interpersonnelle) [5]. Pour ce qui est de
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:569–575 572
road» corticale – lente – à l’opposé de la «low
road» sous-corticale – rapide – qui va directe-
ment du thalamus à l’amygdale.
Tout cela devient passionnant si nous considé-
rons le cerveau et son étonnante plasticité
comme le substrat biologique des traitements
psychiatriques-psychothérapeutiques. Les thé-
rapies sont des processus d’apprentissage dé-
clenchés par l’interaction thérapeutique, que ce
soit l’apprentissage de nouveaux modes de pen-
sée et de comportement, le contrôle des émotions
ou les développements de la personnalité.
LeDoux est d’avis que dans une thérapie, les
structures les plus récentes dans l’évolution (cor-
ticales) doivent apprendre à contrôler les struc-
tures plus anciennes (sous-corticales). Le but
n’est pas de supprimer les émotions, mais d’in-
tégrer les deux choses en parfaite harmonie. La
sérotonine joue un rôle capital dans le contrôle
des impulsions émotionnelles. La concentration
la plus forte des récepteurs de la sérotonine
se trouve dans le gyrus cingulaire antérieur,
une structure qui selon les études actuelles
est le véritable centre de commutation entre le
CPF et le système limbique. Le fMRI (fonctional
magnetic resonance imaging) montre que nous
pouvons effectivement modifier l’activité neuro-
nale dans ces deux régions, en fonction de
notre analyse d’une situation émotionnelle.
Ochsner et al. [3] par ex. ont présenté à des
sujets sous IRM des images émotionnellement
stressantes (opérations, enfants mourants,
chiens montrant les dents, etc.). Pour la première
mesure de l’activité neuronale, ces sujets ont
eu comme message de laisser agir ces images, et
pour la seconde de diminuer consciemment leur
impact émotionnel par une analyse différente
(par ex. «ces enfants sont maintenant guéris»).
Dans la première situation, c’est l’activité de
l’amygdale qui a prédominé sur celle du CPF ven-
trolatéral, et dans la seconde ce fut l’inverse. Il y
a donc de toute évidence des instances dans la
substance grise qui sont capables de contrôler
nos émotions.
Facteurs génétiques
Sur les quelque 23000 gènes de l’Homo sapiens,
la moitié environ est exprimée dans le système
nerveux central. Pour la croissance des dendri-
tes, des épines et des synapses, à savoir pour la
survie des cellules nerveuses, l’expression de
gènes spéciaux est indispensable à la production
des facteurs dits neurotropes (par ex. BDNF,
brain derived neurotrophic factor). La produc-
tion de BDNF est diminuée sous l’effet de concen-
trations trop élevées de glucocorticoïdes. Pour le
contrôle des impulsions émotionnelles, le gène
5-HT Transporter (5-HTT) notamment joue un
rôle déterminant, un gène dont l’expression est
responsable du transport de la sérotonine.

pété de l’expérience traumatisante dans un en-
vironnement sûr, il s’agit de créer une mémoire
explicite du traumatisme la plus complète possi-
ble, mais à condition que les structures cortica-
les puissent inhiber les impulsions anxiogènes de
l’amygdale. La confrontation aux stimuli anxio-
gènes peut s’avérer nécessaire pour cela. Des
études montrent, parallèlement à l’amélioration
de la symptomatologie, des modifications au
fMRI, encore trop peu consistantes à l’heure ac-
tuelle. Une étude avec la paroxétine a montré une
amélioration de la mémoire explicite, et même
une augmentation de volume de l’hippocampe
[6] – ce qui indique que les antidépresseurs non
seulement atténuent les répercussions négatives
du stress, mais peuvent même éventuellement
les faire régresser. C’est exactement ce que nous
souhaiterions dans le traitement du SSPT: une
amélioration des fonctions neuronales, créant
les conditions pour le stockage contextuel d’élé-
ments mnésiques.
Les troubles obsessionnels présentent une dys-
fonction au niveau du CPF orbito-frontal, du
noyau caudé, des ganglions de la base (corps
strié) et du thalamus, et plus précisément une hy-
peractivité du circuit cortico-striato-thalamique.
Le modèle actuel veut que des activités motrices
et cognitives soient entretenues par un feedback
pathologiquement accentué entre le COF et le
thalamus. Etonnamment (ou peut-être justement
pas) les clichés PET montrent une similitude
frappante avec la corrélation neurobiologique de
la passion amoureuse. Dans ces deux situations,
l’hyperactivité du système dopaminergique et
l’hypoactivité du système sérotoninergique té-
moignent d’une attitude attentiste. Il y a plus de
dix ans déjà que des études PET ont montré que
la pharmacothérapie par un ISRS et la thérapie
comportementale cognitive peuvent donner une
normalisation à long terme de l’activité typique
dans les troubles obsessionnels, et tout spéciale-
ment une correction de l’hyperactivité dans le
noyau caudé [7], ce qui est une preuve puissante
qu’un type de comportement négatif peut être
«désappris» par des expériences correctrices
(exposition).
De manière générale, le fait que les répercus-
sions neurophysiologiques et neurobiologiques
de la psychothérapie soient actuellement saisis-
sables ouvre des dimensions entièrement nou-
velles à la psychothérapie. Elle n’est plus «sim-
plement» quelque chose de psychologique,
d’insaisissable, voire de louche, mais nous
pouvons dire aujourd’hui que la psychothérapie
modifie certaines structures cérébrales. Les
concepts psychologiques qui se sont avérés uti-
les par le passé ont soudain tout leur sens, vus
sous l’angle neurobiologique. La plasticité du
cerveau signifie que les anciennes et nouvelles
expériences ont en tout temps des corrélations
biologiques. La recherche va toujours plus devoir
s’intéresser dorénavant à la question de savoir
CURRICULUM Forum Med Suisse 2006;6:569–575 573
l’effet des antidépresseurs, nous savons mainte-
nant qu’ils stimulent non seulement l’inhibition
présynaptique de la recapture de la sérotonine et
de l’adrénaline, qui s’accumulent dans la fente
synaptique, mais aussi la neurogenèse dans
l’hippocampe et la croissance des dendrites et
synapses – en normalisant la dysfonction de
l’axe HPA et la synthèse accrue de CRH. Des fac-
teurs neurotropes tels que le BDNF, qui jouent un
rôle central dans la sélection et la stabilisation
des liaisons synaptiques, sont produits en plus
grandes quantités sous l’effet des antidépres-
seurs, et soutiennent les processus adaptatifs ou
les rendent enfin de nouveau possibles. Ces pro-
cessus dépendent dans une très large mesure de
l’activité, ce qui signifie en d’autres termes que
l’input de l’extérieur est essentiel pour la plasti-
cité synaptique. Ceci comprend les activités cor-
porelles (dans le cas des souris, le choix de cou-
rir dans la roue renforce les neurogenèses) et les
interactions sociales, comme dans la psychothé-
rapie par exemple. Les antidépresseurs peuvent
être la condition nécessaire à une amélioration –
mais nul ne sait encore s’ils réalisent de nou-
velles voies neuronales. En plus des antidépres-
seurs, il y a par ailleurs de très nombreuses
autres substances neuroprotectrices telles que
lithium, Ginkgo biloba, œstrogènes, ocytocine,
éventuellement aussi les neuroleptiques atypi-
ques. L’halopéridol et la morphine par contre ne
semblent pas avoir de tels effets, et la morphine
abaisse même la neurogenèse.
Dans le syndrome de stress post-traumatique
(SSPT), l’hippocampe présente une diminution
de volume pouvant atteindre 25%, qui n’a long-
temps été comprise que comme la conséquence
des effets du stress. Le fait que des jumeaux uni-
vitellins, ayant un SSPT ou non, ont générale-
ment tous deux des hippocampes de plus faible
volume, indique qu’une vulnérabilité préexis-
tante joue également un rôle. Donc le SSPT est
actuellement principalement considéré comme
un problème de l’élaboration d’expériences trau-
matisantes (souvent multiples). Le traumatisme
provoque un trouble de la réception des stimuli,
de la mise en mémoire et de l’évocation mnési-
que. Font partie de ce tableau clinique une hy-
peractivité au niveau de l’amygdale et une hypo-
activité au niveau du cingulum antérieur et de
l’hippocampe. Ce type d’activité se voit lorsqu’un
patient sous fMRI ou PET active son souvenir de
la situation traumatisante par la lecture d’un
script autobiographique.
L’hypothèse est que le stress extrême provoque
une dissociation fonctionnelle entre l’amygdale
et l’hippocampe. Les souvenirs ne peuvent ainsi
plus être codés et le transfert de l’expérience
traumatisante dans le système de mémoire ex-
plicite n’est plus possible. Le traumatisé n’est
donc plus capable de classer son expérience
traumatisante dans sa mémoire autobiographi-
que. Dans le traitement du SSPT, par travail ré-
 6
6
 7
7
1
/
7
100%