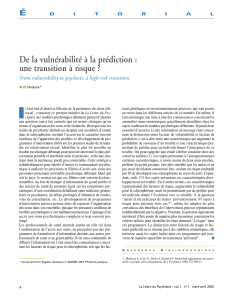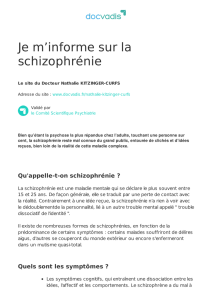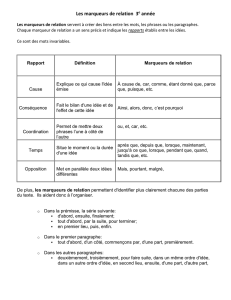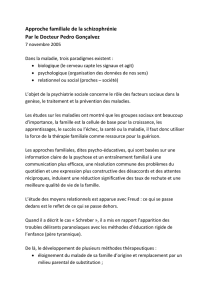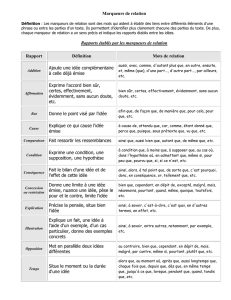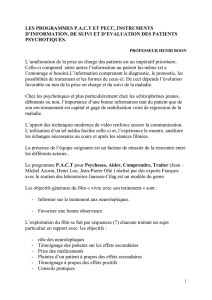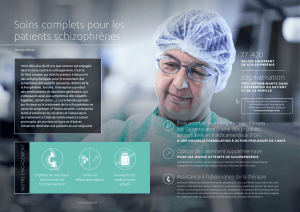Mise en page 1

Post Scriptum
d'un Congrès à l'autre...
108e seion
LE PRIX "PREMIÈRE
COMMUNICATION
DU CPNLF"
N° 3
Conférence Warot :
La maladie d'Alzheimer
Session franco-belge :
Prise en charge des
psychoses
Les Échos du CPNLF

Post Scriptum
2
Post Scriptum, ce mois-ci comme chaque mois, rapporte dans la rubrique "Les Échos du CPNLF"
une partie des interventions communiquées dans le cadre du 108e congrès du CPNLF. Vous
pourrez notamment prendre connaissance des interventions dans le cadre de la Session
scientifique associative franco-belge et de la conférence Warot.
L’association du CPNLF a instauré l’attribution d’un prix dit de la "Première communication du CPNLF"
dont le but est d’offrir à des internes et jeunes médecins et/ou acteurs de santé mentale la possibilité
de communiquer et d’avoir leurs travaux publiés. Cette année, six communications ont été
sélectionnées et trois prix attribués.
Les communications sélectionnées pour le "Prix de la Première Communication"
N°3 - Novembre 2010
Directeur de la publication : Pierre Thomas - Rédacteur en Chef : Patrick Martin
Infographiste : Vivianne Lambert - Photos de ce numéro : Martine Bertheuil
Les communications retenues et présentées dans le cadre du 108e congrès du CPNLF, sous la présidence du Pr Laurent
Schmitt (Toulouse), du Pr Marc Bourgeois (Bordeaux), du Dr Jean-Paul Chabannes (St-Egrève) et du Pr Patrick Martin (Paris)
ont été les suivantes :
• La démarche participative et la mémoire transactive améliorent-t-elles la qualité de vie au travail des infirmiers en
psychiatrie ? par Paul Brunault (Tours)
Contexte : Chez les soignants en psychiatrie, peu d’études se sont intéressées aux déterminants
de la qualité de vie au travail alors que cette population est particulièrement exposée à
l’épuisement professionnel.
Objectifs : Étudier le lien entre le type d’organisation d’un service (démarche participative et
mémoire transactive) et la qualité de vie au travail de ses infirmiers.
Méthode : Quatre-vingt quatre infirmiers en psychiatrie ont rempli des questionnaires auto-
administrés évaluant la démarche participative, la mémoire transactive, la justice
organisationnelle perçue, le soutien organisationnel perçu et la qualité de vie au travail.
Résultats : Il existe un lien significatif entre démarche participative, mémoire transactive et
qualité de vie au travail.
Conclusion : Cette étude suggère que l’amélioration de la démarche participative et de la
mémoire transactive en service de psychiatrie pourrait améliorer la qualité de vie au travail des infirmiers, en améliorant
la justice organisationnelle et le soutien organisationnel perçus.
Mots clés : qualité de vie au travail ; démarche participative ; mémoire transactive ; infirmier en psychiatrie.
• Le syndrome du QT long chez les patients psychiatriques chimiorésistants : prévalence, facteurs de risque, et implications
thérapeutiques, par Nadia Chaumartin (Villejuif)
Les patients psychiatriques présentent une surmortalité liée en partie aux morts subites,
favorisée par certains neuroleptiques et d’autres psychotropes par un allongement de
l’intervalle QT. Une étude a été menée à l’Unité pour Malades Difficiles de Villejuif afin de
mesurer la prévalence du syndrome du QT long, de ses facteurs de risque, ainsi que le lien
avec les traitements. Ces résultats montrent :
- une prévalence de QT longs de 40 %, dont 6% > 500ms.
- le facteur de risque médicamenteux est très présent. Les autres facteurs de risque sont peu
retrouvés.
- une variabilité de la mesure de l’intervalle QT selon l’opérateur et la méthode de calcul.
- une augmentation du nombre et de la valeur moyenne des QTc parallèlement au nombre
de coprescriptions et de posologies élevées.
Ces résultats ont permis la sensibilisation des soignants et la mise en place d’un protocole de surveillance renforcée du
risque lié au QT long.
Mots Clés : QT long, psychotropes, coprescription, Unité pour Malades Difficiles
• Le sentiment de familiarité chez les sujets psychotiques, par Laetitia Delbos (Lille)
Les délires d’identification des personnes sont mal caractérisés et peu explorés. Leur étude
pourrait apporter un éclairage sur les mécanismes impliqués dans les troubles psychotiques.
Dans cette présentation, nous proposons de parler d’une étude portant sur le sentiment de
familiarité dans la schizophrénie. Il s’agit de mesurer une réponse électrophysiologique, la
réponse électrodermale, chez des sujets psychotiques avec des troubles de la reconnaissance
cliniques à la présentation de photos de visages organisés selon différentes conditions :
célèbres, familiers et inconnus et de la comparer à celle des sujets psychotiques sans troubles

de la reconnaissance et des sujets témoins sains. Les résultats permettent de conclure à l’existence de troubles de la
reconnaissance infracliniques chez tous les sujets psychotiques et à la présence d’un continuum allant des sujets sains aux
sujets psychotiques avec des troubles de la reconnaissance, en passant par les sujets psychotiques sans troubles de la
reconnaissance.
Mots-Clés : Délires d’identification des personnes, psychose, réponse électrodermale
• Impact de l’amniocentèse sur la psychopathologie maternelle et sur les représentations maternelles d’attachement,
par Aude Delcuze (Tours)
L’amniocentèse est largement utilisée pour un diagnostic prénatal. Le but de l’étude était
d’évaluer ses effets sur la psychopathologie maternelle, pendant la grossesse et en postpartum,
en termes d’anxiété, de stress, de dépression et des représentations maternelles
d’attachement.
Cette étude prospective observationnelle a comparé un groupe exposé de 232 femmes et un
groupe non exposé de 160 parturientes. Les participantes ont répondu à quatre évaluations
différentes : juste après l’amniocentèse, au second semestre, au 7ème mois et en post-partum.
Lorsqu’elle est indiquée pour des marqueurs sériques élevés ou une anomalie échographique,
l’amniocentèse est associée à une augmentation significative et transitoire des scores
d’anxiété et de dépression. Globalement, les représentations maternelles d’attachement étaient intégrées et équilibrées
dans les deux groupes. Cependant les parturientes du groupe amniocentèse étaient plus orientées sur elles-mêmes que
sur l’enfant.
L’amniocentèse est associée à des réactions affectives d’adaptation qui se normalisent avec l’évolution rassurante de la
grossesse.
Mots clé : amniocentèse, attachement prénatal, dépression prénatale, anxiété prénatale
• Théorie de l’esprit, empathie et trouble de la personnalité borderline,par Anne-Hélène Moncany (Toulouse)
Le trouble de la personnalité borderline (TP BDL) est caractérisé par des relations
interpersonnelles perturbées, attribuées à un défaut de mentalisation. Le but de notre étude
était de mettre expérimentalement en évidence une altération de la théorie de l'esprit (ToM)
et de l’empathie chez ces patients. Nous avons comparé les performances de 15 patients
borderline et de 16 sujets contrôles sur trois tests évaluant la ToM et un test mesurant
l’empathie. Nous retrouvons une altération des performances du groupe de patients borderline
aux deux tests de ToM reposant sur le raisonnement sur l’état mental de l’autre (mental state
reasoning) ; en revanche nous n’avons pas mis en évidence de différence sur le test vidéo
reposant sur la perception de l’état mental de l’autre (mental state decoding) et sur l’échelle
d’empathie. Ces résultats suggèrent une altération de la ToM dans le TP BDL, avec une
dissociation entre ses deux composantes et sans déficit de l’empathie.
Mots-clés : Trouble de la Personnalité Borderline - Théorie de l'esprit - Empathie - Mentalisation
• Evaluation de l’efficacité d’une intervention cognitivo-comportementale ultra-brève, pour
des patients déprimés hospitalisés, menée par des thérapeutes en formation, par Julie Rieu
(Toulouse)
Peu de travaux ont porté sur la prise en charge psychothérapeutique de patients déprimés
hospitalisés. Cette étude a évalué l’efficacité d’une intervention cognitivo-comportementale
ultra-brève dispensée par des thérapeutes en formation, pour des patients déprimés hospitalisés.
Vingt-deux patients souffrant d’un épisode dépressif majeur ont été randomisés pour recevoir,
en plus des soins médicamenteux et institutionnels, les entretiens de soutien habituels (11
patients) ou la thérapie ultra-brève (11 patients).
Le critère principal d’évaluation a été l’évolution de l’intensité dépressive mesurée à l’aide des
échelles de Beck (BDI-II) et Hamilton (HDRS).
Les deux prises en charge ont été efficaces. La réduction des scores à l’HDRS a été significativement plus importante dans
le groupe "thérapie ultra-brève". Cette différence s’est confirmée, à 2 mois, sur les scores obtenus à l’échelle de Beck.
Cette étude suggère l’efficacité d’une intervention ultra-brève pour des patients déprimés hospitalisés et sa faisabilité par
des thérapeutes non aguerris.
Mots-clés : hospitalisation, dépression, psychothérapie cognitivo-comportementale ultra-brève, thérapeutes en formation.
Le premier prix a été attribué à Anne-Hélène Moncany (Toulouse), le deuxième à Julie Rieu (Toulouse) et le troisième à Paul
Brunault (Tours).
3
Post Scriptum

L E S E C H O S D U C P N L F. . . L E S E C H O S D U C P N L F. . .
Dans le cadre de la Conférence Pierre Warot, avec le
Pr Philippe Robert (Nice) comme discutant le Pr
Florence Pasquier (Lille), est intervenue sur la
thématique : "Alzheimer : perspectives d'avenir"
La maladie d’Alzheimer représente 35 millions de
personnes dans le monde et 5 millions de nouveaux
cas par an. Elle est la première cause d’inva-lidité et est
une cause de dépendance et d’entrée en institution. Le
coût mondial estimé de cette maladie est de 315
millions de dollars dont 1/3 est à la charge de la
famille. Ces constats ne peuvent pas laisser indifférents
face à la nécessité de promouvoir et de financer de
nouvelles études sur cette maladie. Actuellement, cette
maladie est toujours
stigmatisée. Parfois,
elle n’est pas perçue
comme une maladie et
n’est pas toujours prise
en charge par manque
d’information des
proches et des
médecins.
Par conséquent, les
proches sont les
principaux soignants et
sont peu soutenus.
Les soignants familiaux
présentent une morbi -
dité psychologique et
physique majeure et une prévalence de dépression
multipliée par 3 à 40. En plus de poser le diagnostic et de
prendre en charge le(a) patient(e), les médecins ont d’une
part, un rôle de dépistage des troubles chez les aidants et
d’autre part, un rôle d’informations sur ce que peut
exprimer et communiquer le(a) patient(e). Une lueur
d’espoir est que les proches aidants sont en mesure
d’identifier les aspects positifs de l’aide donnée, de
trouver un plaisir et un sens à l’accompagnement du
patient et ont conscience d’améliorer sa qualité de vie. Le
soutien psychologique de l’aidant dépend de son histoire
et de ses interactions avec le(a) patient (e)
antérieurement à la maladie. Ainsi, la prise en charge du
patient et de son entourage ne peut pas être standardisée
mais doit être personnalisée.
La maladie d'Alzheimer est également le sujet
qu'avaient choisi d'évoquer A. Soltani (Boulogne
s/Mer) et al. dans la communication : "Diagnostic
précoce de la maladie d’Alzheimer. Marqueurs
biologiques"
Introduction : L’objectif de ce travail est d’identifier et
de décrire les principaux marqueurs biologiques de la
maladie d’Alzheimer.
Méthodologie : Méta analyse des publications (1993 –
2009). La recherche documentaire a été réalisée par
interrogation des banques de données MEDLINE, NLM
(National Library of Medecine), PubMed et centrée sur
les Revues de la littérature,
Marqueurs biologiques
- Marqueurs des tissus périphériques : peau
- Marqueurs génétiques :gène APP, gènes PS1 et PS2,
gène de l’apolipoprotéine E,
- Marqueurs du liquide céphalo-rachidien : protéine
Tau, ubiquitine, marqueurs liés à la dégénérescence
neurofibrillaire, peptide Aβ1-42 plus mutation sur le
géne PS1.
- Marqueurs sériques : peptide
Aβ.(1-40)amyloïde, protéine
Tau, marqueurs de
l’inflammation, autoanticorps,
apolipoprotéines E, AI, AII,
protéine p97.
Conclusion : Cette méta
analyse met en évidence une
augmentation du dosage des
marqueurs biologiques de la
maladie d’Alzheimer dans le
liquide céphalo-rachidien, les
tissus périphériques et dans le
sérum.
L’intérêt de ces dosages serait
d’augmenter la précision du diagnostic clinique
précoce de la maladie d’Alzheimer pour une meilleure
prise en charge.
Bibliographie
1) Hannequin D,Frebourg T,Martinez M,Agid Y, Clerget-
Darpoux F Les facteurs génétiques dans l’étiologie de la
maladie d’Alzheimer. M.S.médecine scientifique 1996,
12 : 6-7.
2) Thomas P, Hazif-Thomas C, Billon R et al : Un nouvel
instrument de dépistage de la démence chez la
personne âgée, le Gpcog. Rev Ger et Gerontol 2004 ;
102 : 83-8
Mots clés : Maladie d’Alzheimer, démence, diagnostic
précoce, marqueurs biologiques.
Dans le cadre des Petits-déjeuners scientifiques du
congrès du CPNLF, les Prs Nicolas Franck (Lyon) et
Pierre Vidailhet (Strasbourg) ont exposé de leur point
de vue d'experts l’intérêt de la Remédiation cognitive.
Les troubles cognitifs constituent incontestablement
une des caractéristiques les plus invalidantes de la
schizophrénie. Ils sont fortement corrélés aux
perturbations de la vie quotidienne et à l’insertion
socioprofessionnelle des patients. Ces troubles sont
assez stables, peu mobilisables, associés à des
4Post Scriptum
Le Pr Philippe Robert et
le Pr Florence Pasquier
lors de leur intervention

altérations cérébrales structurales et fonctionnelles et
concernent la plupart des patients. Appliquée depuis
longtemps chez les patients cérébro-lésés, la
remédiation cognitive commence à trouver sa place en
psychiatrie. Ces objectifs sont de réduire le handicap
vécu au quotidien, de permettre au patient d’être plus
autonome, d’améliorer le suivi du traitement et la
qualité de vie et enfin de mieux comprendre les
relations entre difficultés cognitives et handicap
psychique. La première étape de la remédiation est
d’identifier le plus précocement possible, les difficultés
et les plaintes du patient pour lui proposer un
programme ciblé et une approche "sur-mesure" en
tenant compte de son profil cognitif propre. Plusieurs
études ont mis en évidence des résultats spécifiques,
appropriés et persistants dans le temps. Il existe donc
une légitimité à utiliser ces techniques efficaces en
complément des médicaments et de la psychothérapie
chez les patients schizophrènes. Les recommandations
suscitent un espoir majeur dans la prise en charge du
patient c’est pourquoi, elles doivent être plus répandus.
La thématique concernant la Prise en charge des
Psychoses en Belgique et en France a été exposée dans
le cadre de la Session scientifique associative franco-
belge, sous la présidence des Drs Michel Floris
(Tournai), Jean-Paul Chabannes (St-Egrève) et Yann
Hodé (Rouffach).
Le Dr Marc-André Domken (Liège) a abordé la Prise en
charge précoce du patient schizophrène : bilan des
programmes de détection précoce.
Afin de détecter précocement les troubles
psychotiques, des populations à ultra haut risque de
psychose (UHR) ont été identifiées et intégrées dans
des programmes de prévention (EPPIC, CAARMS,
Post Scriptum 5
EPOS). Chez ces patients à UHR, présentant des
facteurs de risque génétiques, des troubles
intermittents ou des syndromes psychotiques
atténués, 30% ont développé un trouble psychotique.
Des programmes d’intervention précoce ont été mis
en place dans plusieurs pays, permettant de diminuer
la transition vers la psychose (EPPIC-PACE en Australie,
EDDIE en Angleterre, PRIME aux Etats-Unis), montrant
un intérêt pour le traitement précoce par thérapie
cognitivo-comportementale ou encore par les Oméga 3.
Mc Gorry, Arch Gen Psy,2002 ; Morrison, Bri J Psy,
2004 ; Mc Glashan Am J Psy, 2006 ; Amminger et al,
Arch Gen Psy, 2010
Le Dr Benoit Giliain (Louvain-la-Neuve) a abordé la
place de la famille et de l’environnement social du
patient.
L’environnement social dans lequel vivent les patients
atteints de schizophrénie a une influence considérable
et profonde sur le pronostic.
Leff et son équipe (1972) ont introduit le concept d’
"Expressed Emotion" (émotion exprimée). Ils montrent
que dans une famille présentant un niveau élevé
d’émotions exprimées, la fréquence des rechutes chez
un patient schizophrène augmente ; alors qu’une
famille avec un faible niveau d’émotions exprimées
constitue un support bénéfique pour le patient.
L’objectif pour l’entourage du patient, famille et
équipes de soins, est donc de diminuer le climat
émotionnel afin de favoriser le rétablissement du
patient; en adoptant des attitudes personnelles, un
soutien mutuel ou en assistant à des formations
(psychoéducation, gestion de l’éprouvé émotionnel).
Boblington et Kuipers, 1994 ; Mary P.0.Brien, 2009 ;
Chambon et Marie-Cardine, 1993 ; Leff et al., 1972
L E S E C H O S D U C P N L F. . . L E S E C H O S D U C P N L F. . .
Session scientifique
associative franco-belge :
de g. à d. : les Drs Benoit
Delatte, Benoit Giliain,
Marc-André Domken,
Yann Yodé et Michel Floris
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%