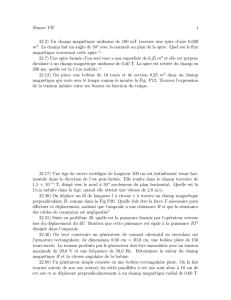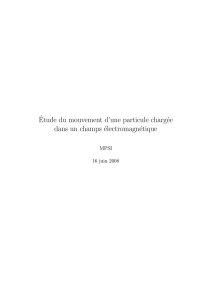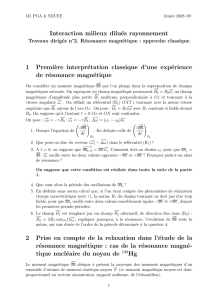Induction électromagnétique. Aspects énergétiques. Applications.

S´ebastien Bourdreux
Agr´egation de Physique
Universit´e Blaise Pascal - Clermont-Ferrand
Induction ´electromagn´etique.
Aspects ´energ´etiques.
Applications.
Novembre 2002

TABLE DES MATI`
ERES 2
Table des mati`eres
1 Mise en lumi`ere du ph´enom`ene physique 5
1.1 Deux approches exp´erimentales possibles . . . . . . . . . . . . 5
1.1.1 Circuit mobile dans un champ permanent . . . . . . . 5
1.1.2 Circuit fixe dans un champ variable . . . . . . . . . . 5
1.1.3 Synth`ese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 LoideLenz ............................ 6
2 Mise en ´equations de l’induction 8
2.1 Cadre d’´etude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Force ´electromotrice de Lorentz . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.1 Force et champ ´electromoteurs . . . . . . . . . . . . . 8
2.2.2 Roue de Barlow : g´en´erateur unipolaire . . . . . . . . 10
2.3 Loi de Faraday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.1 Expression g´en´erale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.2 Rail de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.3 Tension aux bornes d’un dipˆole ´electrocin´etique . . . . 14
2.4 Champ ´electromoteur de Neumann . . . . . . . . . . . . . . . 15
3 Les notions d’auto-induction et d’inductances 16
3.1 Auto-induction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Aspects ´energ´etiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3 Couplage magn´etique de circuits . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3.1 Couplage de deux circuits . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.3.2 Principe du transformateur . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Applications 23
4.1 Moteur asynchrone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Acc´el´eration de particules : le b´etatron . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 Courants de Foucault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.4 Machines tournantes g´en´eratrices . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4.1 Alternateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4.2 Dynamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5 Convertisseurs ´electrom´ecaniques 32
5.1 Le haut-parleur ´electrodynamique . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2 Moteur `a courant continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.2 Equation m´ecanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

TABLE DES MATI `
ERES 3
5.2.3 Equation ´electrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2.4 R´egime transitoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.2.5 R´egime permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2.6 Fonctionnement en g´en´erateur . . . . . . . . . . . . . 38

Agr´egation : Le¸con de Physique 24
Niveau : 1er cycle universitaire (ou PC)
Pr´erequis : les points suivants doivent ˆetre acquis
– (les ´equations de Maxwell)
– les forces de Lorentz et de Laplace
– les lois de l’´electrostatique et de la magn´etostatique
– la loi d’Ohm g´en´eralis´ee
Introduction
La d´ecouverte par Oersted de l’action d’un courant ´electrique sur une
aiguille aimant´ee incita plusieurs physiciens `a se demander si, inversement,
le magn´etisme ne pourrait pas cr´eer des effets ´electriques. Bref, si le cou-
rant ´electrique produit des effets magn´etiques, le magn´etisme ne doit -il pas
produire dans certaines conditions du courant ´electrique ?
Toutes les tentatives aboutirent `a des r´esultats n´egatifs jusqu’aux travaux du
chimiste et physicien britannique Michael Faraday. Contrairement `a Amp`ere,
Faraday ´etait avant tout un exp´erimentateur. Apr`es des centaines d’exp´eriences,
il parvient en 1831 `a produire du courant ´electrique `a l’aide d’un aimant.
L’exp´erience fondamentale qui d´emontre cette production de courant en l’ab-
sence de pile se r´ealise tr`es simplement. Tous les autres physiciens avaient
cherch´e un ph´enom`ene permanent ; nous allons voir que la d´ecouverte inat-
tendue de Faraday bouscula fortement les id´ees re¸cues de l’´epoque...
Aujourd’hui, le ph´enom`ene de l’induction, est `a la base de la production
d’´electricit´e dans les dynamos, les moteurs, les transformateurs et les alter-
nateurs, et trouve ainsi d’innombrables applications dont nous regarderons
quelques exemples simples.
4

1 MISE EN LUMI `
ERE DU PH ´
ENOM `
ENE PHYSIQUE 5
1 Mise en lumi`ere du ph´enom`ene physique
Les ph´enom`enes d’induction concernent l’action `a distance d’un circuit
´electrique ou de toute source de champ magn´etique sur un autre circuit
´electrique. L’existence de ces ph´enom`enes est li´ee `a une ´evolution dans le
temps de conditions de ”couplage magn´etique” existant entre ces ´el´ements ;
cette ´evolution peut avoir pour origine un mouvement dans l’espace (ie appa-
rition d’une vitesse relative), et plus g´en´eralement toute variation en fonction
du temps de ce couplage.
1.1 Deux approches exp´erimentales possibles
1.1.1 Circuit mobile dans un champ permanent
On suppose que les sources du champ permanent sont ext´erieures au cir-
cuit, constitu´e d’une bobine par exemple, reli´ee `a un oscilloscope. Le champ
magn´etique permanent peut ˆetre celui d’un aimant en U.
Il existe une tension u(t) aux bornes de la bobine alors qu’aucun g´en´erateur
n’est pr´esent. On note
– que si la bobine est immobile, u= 0
– que u(t) est positive lorsque la bobine s’approche de l’aimant et n´egative
quand elle s’en ´eloigne
– que l’amplitude de u(t) croˆıt avec la vitesse de d´eplacement de la
bobine,ve
La bobine est le si`ege d’un ph´enom`ene d’induction, qu’on appelle induction
de Lorentz.
1.1.2 Circuit fixe dans un champ variable
Si l’on d´eplace cette fois l’aimant en laissant la bobine fixe, on observe
les mˆemes ph´enom`enes que dans le premier cas.
Le syst`eme se comporte comme un g´en´erateur. Comme l’aimant se d´eplace
dans le r´ef´erentiel du laboratoire, la bobine voit un champ magn´etique va-
riable au cours du temps. Ce sont ces variations temporelles qui sont `a
l’origine du ph´enom`ene d’induction observ´e : on parle ici d’induction de
Neumann.
On aurait pu cr´eer un champ variable en utilisant une deuxi`eme bobine
reli´ee `a un g´en´erateur de tension variable, observ´ee par la deuxi`eme voie de
l’oscilloscope. La bobine (fixe) d´etecte alors le champ g´en´er´e par la bobine
reli´ee au g´en´erateur (comme une antenne !).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
1
/
40
100%