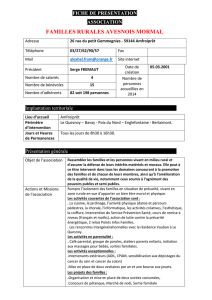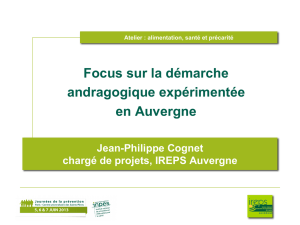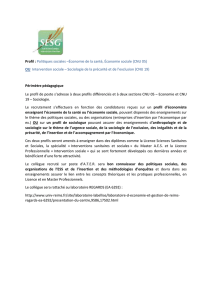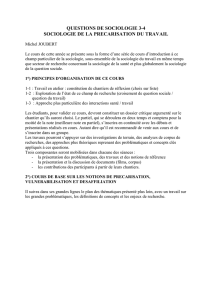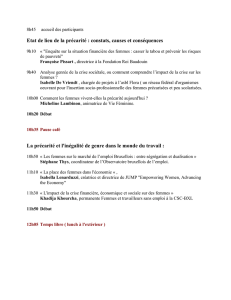Maryse Bresson, Sociologie de la précarité

Cet ouvrage de synthèse – propre de la collection
128 d’Armand Colin – offre, dans un langage clair
et accessible, les principaux apports théoriques et
méthodologiques de la sociologie de la précarité.
L’auteure, Maryse Bresson, dont les travaux antérieurs
portent sur les SDF, les centres sociaux et, plus
globalement, l’intervention sociale, nous permet de
mieux cerner un concept relativement flou, utilisé
et banalisé par les médias et les politiques publiques.
La précarité est ainsi devenue, dans les dernières
décennies, une « nouvelle question sociale » qui
revient à désigner tantôt des populations parti-
culières, tantôt un « risque » de pauvreté lié à une
instabilité socio-économique. Mais qu’est-ce qu’un
précaire ? Et par rapport à quoi caractérise-t-on une
situation de précarité ? C’est bien dans un refus des
simplifications et avec l’objectif de montrer la variété
et la complexité des situations que cet essai présente
«la manière dont la sociologie définit la précarité,
étudie les populations concernées et analyse les
processus qui expliquent les situations » (p. 6). Cet
essai présente ainsi un double intérêt : d’une part,
il donne l’étendue des connaissances et des débats
sur le thème de la précarité en sociologie et, d’autre
part, il promeut une approche par les processus de
précarisation.
Le livre est articulé autour de trois chapitres. Le
premier s’intéresse à la manière dont on « catégorise »
les précaires à travers les différentes écoles et
courants de la sociologie qui s’affrontent mais
peuvent, à l’occasion, se compléter. Le deuxième
vise à apporter des éléments de connaissance sur
ces populations : la vie quotidienne (conditions
d’emploi, travail) ; les trajectoires associées à l’idée
de risque (notamment d’exclusion) ; l’importance et
la diversité des liens sociaux. Le troisième chapitre,
enfin, se présente davantage comme la thèse de
l’auteure, à savoir valoriser une approche de la
précarité en terme de processus.
Au préalable, M. Bresson identifie cinq paradigmes,
autant de manière théoriques et méthodologiques
d’envisager la précarité :
•la sociologie de la pauvreté : le raisonnement
est basé sur le manque, et les pauvres sont le plus
souvent caractérisés par une insuffisance ou une
absence de revenus (mais pas seulement) ;
•la sociologie du sous-développement : elle
repose, selon les débats, sur l’hypothèse d’un retard
(culturel, politique, économique), induisant ainsi
Recherches et Prévisions n° 91 - mars 2008
147 Comptes rendus de lectures
l’idée d’un rattrapage possible. Ce paradigme est
plus particulièrement relatif à l’opposition Nord-
Sud mais il peut également renvoyer à des divisions
à l’intérieur des pays riches (ce que l’on désigne
comme « Quart-Monde ») ;
•la sociologie de la marginalité et de la déviance,
qui utilise un paradigme interactionniste (influencé
par l’ouvrage SSttiiggmmaatteessd’Erving Goffman) où les
individus sont perçus comme des marginaux :
l’apport de ce paradigme est de souligner l’impor-
tance de la désignation et du regard d’autrui ;
•la sociologie de l’assistance et des assistés : les
populations sont définies par les secours qu’elles
reçoivent, ce qui peut avoir pour conséquence de
les stigmatiser ;
•enfin, la sociologie de la précarité – à laquelle se
rattache manifestement l’auteure – et qui vise à
analyser des processus de précarisation en s’appuyant
sur les mutations de la société. Deux courants la
composent. Le premier repose sur le postulat que
«l’instabilité est inhérente à la dynamique sociale
et politique de la modernité » (p. 41) et le deuxième
insiste sur la vulnérabilité de masse.
Si ces paradigmes servent principalement à iden-
tifier les différents courants de pensée, le souci de
M. Bresson est véritablement de critiquer les catégo-
risations, forcément « enfermantes » et, dans tous
les cas, limitatives. Catégoriser est d’autant plus
délicat qu’il existe, par exemple, des conventions
différentes entre Eurostat, l’INSEE et le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD)
pour définir le seuil de pauvreté selon que l’on parle
de médiane ou de moyenne. Or, « faire changer la
définition du seuil de revenu ou l’échelle pour
calculer le nombre d’unités de consommation du
ménage c’est faire varier le nombre de pauvres »
(p. 24). Deux acceptions principales du terme de
« précarité » sont cependant soulignées : soit on
désigne des populations plutôt pauvres (peu de
revenus, peu d’éducation, sans emploi), pouvant
même être des exclus si des problèmes de loge-
ment viennent, en outre, se greffer ; soit on parle
de populations qui risquent de voir leur situation
se dégrader. Globalement, l’incertitude quant à
l’avenir (pas seulement professionnel) est un élément
déterminant induit par la notion même de précarité.
En raison des difficultés et des pièges des catégori-
sations soulignées par l’auteure autour de la notion
de « population précaire », on peut d’autant plus
Maryse Bresson
SSoocciioollooggiieeddeellaapprrééccaarriittéé
2007, Paris, Armand Colin, collection Sociologie 128, 126 pages.

s’interroger sur la manière dont la précarité est
pensée en dehors du contexte français : qui et
comment (en fonction de quelles normes sociales,
économiques et culturelles ?) sont désignés les
pauvres et les « précaires » ? Ce questionnement
aurait sans doute mérité davantage que quelques
pages. Certes, la grande difficulté est de comparer
ce qui peut l’être. Statistiquement, compte tenu de
la multiplicité des approches nationales de la
pauvreté, l’entreprise paraît quasi impossible. Tout
au plus fait-on remarquer ici que l’utilisation en
France du terme de « précarité » – dans le contexte
du marché du travail – est connotée négativement,
tandis que dans les pays anglo-saxons on parle de
flexibilité, perçue, en revanche, positivement. Il
semblerait qu’il existe, de fait, une spécificité
française dans la manière de penser la précarité
car, au-delà du lien avec l’emploi, la question des
liens sociaux est également interrogée.
Les travaux sociologiques français ont ainsi montré
que la précarité ne peut être limitée à l’emploi et
tout un ensemble de critères sont à prendre en
compte. Être en emploi, ou le seul statut de celui-
ci, ne conditionne pas une situation dite précaire :
l’intérêt du travail ou sa faible reconnaissance sont
également des éléments déterminants. En outre, un
précaire peut avoir un revenu stable (issu du travail)
mais l’individu fait alors face à des problèmes de
surendettement, des coupures d’eau et d’électricité
et de logement. En outre, nombreux sont les
travaux ayant montré que les précaires ne sont pas
coupés de tout lien familial et/ou affectif mais que
leur réseau relationnel ne leur permet pas de sortir
de leurs difficultés. Plusieurs recherches s’accor-
dent sur un lien social en crise (au sens de « ce qui
fait tenir les hommes ensemble » dans la société)
par le délitement des cadres intégrateurs, notam-
ment le travail. Toutefois, l’emploi et le travail sont
désormais un intégrateur parmi d’autres.
Les approches sociologiques par les trajectoires ont
permis d’identifier quelques populations dites « à
risques » de se retrouver en situation de précarité
économique : les femmes au regard des discrimi-
nations qui perdurent sur le marché du travail ; les
jeunes « massivement victimes des tensions sur le
marché du travail » (p. 60). Quelques pages sur les
populations issues de l’immigration auraient sans
doute été également bienvenues. On note d’ailleurs
une forme d’ambiguïté dans les pages consacrées
aux quartiers dits « sensibles » où l’on trouverait
assurément des populations « à risque » comme les
jeunes mères de famille monoparentale. Même si
M. Bresson prend bien soin de souligner la diversité
des situations et des populations qui y résident, on
peut toutefois lui reprocher quelques pages sur les
rapports entre les jeunes et la police dans les
quartiers dits « sensibles » qui ne paraissent pas en
lien direct (sauf à creuser les amalgames) avec le
sujet.
Plus globalement, le mérite du propos est de
souligner que la précarité est désormais à penser en
terme d’espace et de rompre avec le schéma expli-
catif ancien qui cherchait à comprendre la part de
la responsabilité individuelle et des déterminismes
sociaux. Le questionnement sur la précarité à partir
de la division du travail tend à être remplacé par la
question urbaine, les inégalités territoriales et les
ségrégations spatiales. L’entrée par les processus
permet ainsi de penser de manière dynamique
l’articulation entre marché du travail, protection
sociale, urbanisation, problème du logement, etc.
C’est moins une situation en tant que telle (le
chômage par exemple) qu’une succession de situa-
tions qui conduit à désigner une situation (ou un
individu) comme précaire.
L’approche est en outre incomplète si elle ne prend
pas en compte la dimension subjective de la
précarisation, notamment la souffrance mentale.
Le schéma explicatif des processus pluriels permet
de ne pas favoriser une cause unique et de mieux
rendre compte de la complexité des situations :
«l’approche par les processus est féconde parce
qu’elle repose, implicitement, sur l’abandon de
l’idée que la société est organisée par un mécanisme
central, qui serait le pivot de l’ordre social. Elle
laisse toutefois en suspens la question de la
manière dont sont articulés les différents niveaux
des processus et de leur hiérarchie et réintroduit
un doute sur l’identification des "causes" et des
"conséquences"» (p. 105). Cette approche revient
à poser la nécessité de combiner une approche
quantitative, d’une part, afin de repérer des situa-
tions de précarité, de mieux connaître les profils
des « populations à risques » et d’identifier des
facteurs, et une approche qualitative, d’autre part,
pour les vécus subjectifs et l’analyse des parcours.
Sandrine Dauphin
CNAF – Rédactrice en chef de
RReecchheerrcchheesseettPPrréévviissiioonnss.
Recherches et Prévisions n° 91 - mars 2008
148 Comptes rendus de lectures
1
/
2
100%