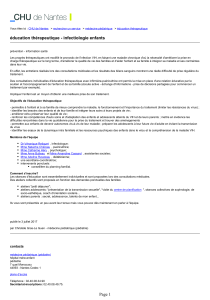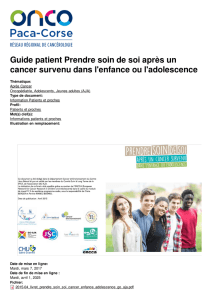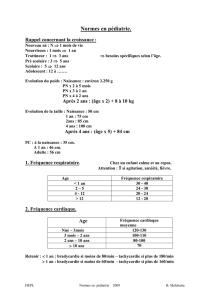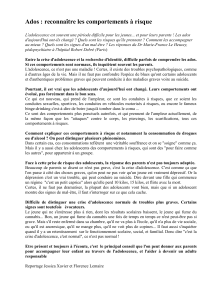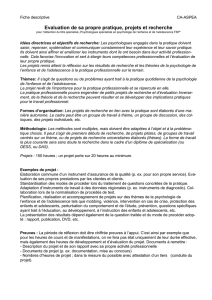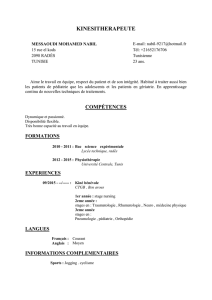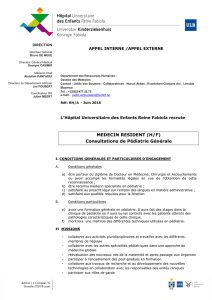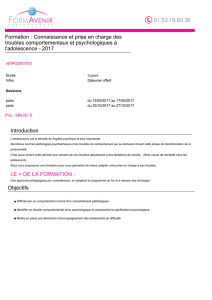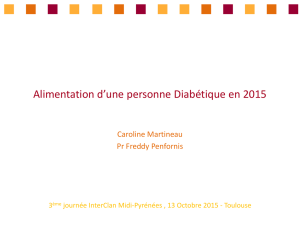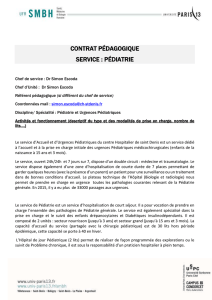Adolescents diAbétiques : de lA pédiAtrie à lA Médecine d

DIABÉTOLOGIE
ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 21
ADOLESCENTS DIABÉTIQUES:
DE LA PÉDIATRIE À LA MÉDECINE
D’ADULTE
Rupture ou continuité?
La prise en charge des enfants atteints de maladie chronique comporte cer-
taines étapes clés pour la qualité de vie et l’équilibre de la maladie: l’annonce
du diagnostic, l’adolescence qui permet l’autonomisation du jeune, mais qui
comporte aussi d’inévitables risques et expériences (1, 2) et enfin le passage
en adulte. Ce dernier temps de la pédiatrie intervient lorsque l’adolescence n’est pas terminée, dans une période de
mutation féconde pour le jeune, mais instable: choix professionnel, études supérieures, engagement amoureux, auto-
nomisation par rapport aux parents, départ du foyer familial et changement de ville, voire de pays. Ces changements
dans la vie des adolescents/jeunes adultes peuvent être facteurs de perte de continuité dans le suivi médical.
ENJEUX ET RISQUES
DE LA TRANSITION
Plus qu’un simple passage d’une
équipe médicale à une autre, il
s’agit d’une transition, c’est-à-dire
d’un processus qui s’étale sur des
années, avant, pendant et après,
jusqu’à un accrochage stabilisé en
médecine d’adultes. Les risques de
rupture dans les soins sont impor-
tants : abandon du suivi en pédia-
trie avant l’organisation du passage,
échec du passage “primaire” (n’ar-
rive pas en adulte) ou “secondaire”
(n’y retourne pas après une ou deux
consultations). Les taux de perte de
vue sont de 20 à 30 % lorsque la tran-
sition n’est pas organisée de façon
très spécifique (3, 4). Ces ruptures
peuvent durer des années, le patient
se débrouillant avec des prescrip-
tions de médecins généralistes sans
surveillance spécialisée. Elles ont
des conséquences graves : déséqui-
libre glycémique durable, apparition
de complications dégénératives non
dépistées et non traitées, augmen-
tation du risque de complications
aiguës, essentiellement hospitalisa-
tions pour acidocétose (3).
Quitter la pédiatrie ? C’est quitter
l’endroit où l’on a été soigné depuis
des années, le plus souvent dès l’an-
nonce du diagnostic, et perdre des
relations fortes avec des personnes
souvent comparées à une deuxième
famille. La fonction protectrice de la
pédiatrie est importante, les jeunes
patients savent qu’on y tolère leurs
écarts et qu’on n’hésite pas à les rap-
peler lorsqu’ils oublient de venir.
Dans le cas du diabète, la pédiatrie
peut aussi représenter, pour beau-
coup de patients, de familles et aussi
de soignants, un univers protégé des
complications – aussi redoutées que
mal connues – qui n’arriveront que
l’adolescence permet des détours
plus ou moins transitoires avec
l’acceptation de la permanence du
diabète (déni, transgressions, etc.),
le passage en adulte confronte à la
nécessité de “faire avec” la maladie.
De plus, la confrontation avec les pa-
tients adultes, des “vieux”, avec des
Dr Paul Jacquin
Praticien hospitalier et pédiatre,
Médecine de l’adolescent,
Hôpital Robert-Debré, Paris.
« Les taux de perte de vue sont de 20 à
30% lorsque la transition n’est pas organi-
sée de façon très spécifique. »
chez l’adulte... La perte de ces liens
et de cette protection génère de l’in-
quiétude et souvent des doutes sur
les qualités et la compétence de la
nouvelle équipe, la peur de ne pas y
être compris, ou pas accepté « si on
ne fait pas tout bien ».
Passer en adulte, c’est aussi une
injonction à devenir adulte, ce qui
ne se fait jamais d’un coup, qui plus
est avec une maladie. En effet, si

DIABÉTOLOGIE
22 ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7
complications visibles dans la salle
d’attente ou en hospitalisation, est
une difficile épreuve pour les jeunes,
surtout s’ils n’y ont pas été préparés.
De même, c’est parfois seulement
en services d’adultes que les jeunes
patients apprennent ou prennent
conscience de certaines limites
qu’impose le diabète, concernant en
particulier la grossesse, le permis de
conduire et les professions interdites.
PRÉPARER ET ORGANISER
LA TRANSITION
Pour limiter les risques de rupture
et les difficultés évoquées ci-dessus,
de nombreuses équipes ont mis en
place des procédures diverses : dos-
sier de transition, checklist, consul-
tation spécifique de transition, per-
sonnel dédié spécifique “transiteur”,
etc. (5-7). L’efficacité de ces mesures
tient à deux critères essentiels (8, 9) :
la préparation et l’organisation de
la transition, ce qui est repris dans
les recommandations publiées (10,
11). Nous insisterons sur un certain
nombre de points-clés :
• La transition ne se résume pas au
bref temps du passage d’un service
à un autre : elle débute des années
avant le passage et s’achève après
deux ou trois années d’un bon ac-
crochage en adulte.
• Le passage en adulte est un des as-
pects de l’avenir : il doit donc être
évoqué dès les premières années
du suivi, comme une perspective
de vie.
• Anticiper l’avenir avec la maladie :
quelles conséquences peut avoir
le diabète sur la vie d’adulte, quels
risques, quels appuis et solutions ?
Il faut parler des complications
dès l’annonce du diagnostic et au
cours du suivi en pédiatrie, sans se
cacher derrière des non-dits, qui
recouvrent souvent des angoisses
basées sur une sous-information
(des adolescents, de leurs parents,
et parfois aussi des soignants en
pédiatrie) : souligner les bénéfices
du traitement régulier, mais aussi
de toute amélioration de l’équilibre
glycémique même dans des mau-
vaises passes, de l’intérêt de la sur-
veillance régulière, des possibilités
thérapeutiques à tous les stades
de la maladie. La sexualité, la gros-
sesse et la contraception doivent
être abordées suffisamment tôt,
tout comme les limites qu’impose
le diabète sur certaines professions
et sur le permis de conduire. Il s’agit
d’une continuité de vie, évolutive et
dynamique, et non d’une bascule
brutale d’une enfance protégée à
un univers adulte rempli de souf-
frances et de menaces.
• La transition doit être préparée : il
n’y a pas d’âge “légal” du passage,
celui-ci doit intervenir à un mo-
ment où le jeune et ses parents s’y
sentent prêts, dans une période de
relative stabilité médicale, en s’arti-
culant avec les étapes de la vie sco-
laire ou professionnelle. En France,
c’est majoritairement autour des 18
ans : fin du lycée, changement de
ville envisagé, etc. Être prêt signifie
être suffisamment autonome sur
les différents aspects de sa maladie
et du traitement, ce qui concrète-
ment ne s’évalue ni ne se décrète la
veille du passage.
• De plus, la préparation doit être
basée sur un diagnostic global du
patient et de sa famille, c’est-à-dire
aussi sur les plans psychologiques
et sociaux. Les troubles psychiques
tels que la dépression ou les
troubles du comportement alimen-
taire (souvent masqués) doivent
être recherchés et, si besoin, pris en
charge durant cette phase de pré-
paration. La question de la rupture
des droits sociaux concerne de plus
en plus de jeunes adultes et doit
être évitée.
• Un document médical de trans-
mission doit être rédigé avant le
passage. Il doit être clair et syn-
thétique, car il est autant destiné
au diabétologue d’adultes qu’au
patient lui-même. C’est un résumé
des éléments essentiels de l’histoire
du diabète, des traitements et
d’éventuelles complications, qui
est plus utile que l’intégralité du
dossier.
• Enfin, le patient doit être
suffisamment informé sur la nou-
velle équipe, voire la rencontrer,
afin de pouvoir se représenter les
changements que représente ce
passage et de pouvoir les envisager
positivement. La présentation de la
nouvelle équipe soignante dépend
des conditions géographiques
(pédiatrie et service d’adultes sur
le même site ou non). Elle peut se
faire physiquement (visite de ser-
vice ou rencontres organisées en
amont du passage, consultation
conjointe) ou par une plaquette de
présentation du service.
• La transition doit s’appuyer sur
une indispensable collaboration
entre les équipes pédiatriques et
d’adultes. L’accrochage en diabé-
tologie adulte sera très nettement
facilité si le patient sent qu’il existe
une connaissance et une confiance
réciproque entre les partenaires.
Certains patients, pour lesquels le
passage paraît le plus risqué, béné-
ficieront d’un accompagnement
physique transitoire dans la nou-
velle équipe jusqu’à un accrochage
réussi.
• L’organisation du passage, la prise
des rendez-vous, la surveillance
de la présence aux consultations
doivent être suivies conjointe-
ment par les équipes pédiatriques
et d’adultes selon des modalités
déterminées en commun. Ainsi on
peut “rattraper” les patients qui ne
seraient pas arrivés en adulte ou
qui décrochent rapidement après
un ou deux rendez-vous.
• L’accueil des jeunes patients en
adulte doit être optimisé. Il est im-
portant que les équipes d’adultes
puissent proposer un accueil
adapté aux besoins de ces patients
qui nous disent clairement qu’ils
ne veulent pas être pris pour des
adultes, mais pas non plus pour
des enfants : infirmière dédiée,

Adolescents diabétiques: de la pédiatrie à la médecine d’adulte
ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 23
choix privilégié de médecins se-
niors, regroupement des jeunes sur
des temps d’éducation thérapeu-
tique... La sexualité et la contracep-
tion, mais aussi les consommations
(alcool, tabac et cannabis) doivent
être des sujets facilement abor-
dables en consultation. Une forma-
tion en médecine de l’adolescent
pourrait être organisée en commun
pour les équipes pédiatriques et
d’adultes. Le monitorage des dif-
férents rendez-vous médicaux et
paramédicaux doit être organisé et
suivi, étant donné la fréquence des
oublis et les changements à cet âge.
• Le changement de traitement
dès le début du suivi en adulte est
déconseillé, perçu comme une
disqualification de la prise en charge
antérieure et compromettant
l’établissement d'une relation de
confiance patient-médecin.
• Le médecin traitant (mais bien des
jeunes n’en ont pas) doit être infor-
mé de l’ensemble de ce processus.
Après le premier rendez-vous en
adulte, le patient qui le souhaite doit
pouvoir revenir informer l’équipe
pédiatrique de ses impressions sur
la nouvelle équipe, et chercher une
autre solution en cas d’inadéquation.
• Le rôle des parents : il est essentiel
tout au long du processus d’anti-
cipation et de préparation du pas-
sage. Les parents doivent être asso-
ciés à l’évaluation qui précède la
mise en route du projet de transi-
tion. Leur présence aux côtés de
leur grand enfant, au moins une
fois en adulte, permet de valider le
choix qui est fait et aide au transfert
de confiance d’une équipe à l’autre,
gage de réussite du suivi en adulte.
CONCLUSION
Le passage en adulte est une étape
importante dans la vie du patient
diabétique, dont les conséquences
sont importantes pour sa qualité
de vie d’adulte. Si pour certains, ce
cap est franchi facilement, il n’en
va pas de même pour tous, avec des
risques graves en cas d’échec. Pour
faire en sorte que tous les patients
le réussissent, il faut s’en donner les
moyens :
• du côté de la diabétologie pédia-
trique par une anticipation et une
préparation suffisantes, une évalua-
tion large (médico-psychosociale)
de la situation du jeune avant le pas-
sage, une organisation du passage
structurée et un accompagnement
adapté à chaque situation ;
•ducôtéadulte,l’accueiletlaprise
en charge des adolescents jeunes
adultes doivent s’adapter au degré
d’autonomie et de maturité des nou-
veaux arrivants, avec un monitorage
des consultations qui permet de s’as-
surer que l’accrochage est réussi.
Ces aménagements de nos pratiques
sont indispensables pour la qualité
de vie de nos patients. Leur mise en
place exige une collaboration et des
échanges entre équipes de diabéto-
logie d’adultes et pédiatriques tout à
fait profitables.
MOTS-CLÉS
Diabète de type1, Transition, Passage à
l’âge adulte, Pédiatrie, Adolescence
1. Alvin P. Maladie chronique à l’adolescence: dix questions pertinentes.
Arch Pediatr2003; 10: 360-366.
2. Jacquin P, Levine M.Dicultés d’observance dans les maladies
chroniques à l’adolescence: comprendre pour agir. Arch Pediatr 2008 ;
15(1): 89-94.
3. Tuabiana-Rufi N, Du Pasquier L, Jacquin P et al. Transition de la
pédiatrie en service d’adultes des adolescents diabétiques de type1.
Congrès de l’Alfediam/SFD Lille2010 (Communication orale) in Diabetes &
Metabolism2010.
4. Anderson Bj, Wolpert Ha. A developmental perspective on the
challenges of diabetes education and care during the young adult period.
Patient Education and Counseling 2004 ; 53: 347-352.
5. McDonagh JE. Growing up and moving on : Transition from pediatric to
adult care. Pediatr Transplantation2005 ; 9: 364-372.
6. Van Walleghem N, Mcdonald CA, Dean HJ. The maestro project: a
patient navigator for the transition of care for youth with type 1 diabetes.
Diabetes Spectrum 2011 ; 24: 9-13.
7. Cadario F, Prodam F, Bellone S et al. Transition process of patients with
type 1 diabetes (T1DM) from paediatric to the adult health care service: a
hospital-based approach. Clin Endocrinol (Oxf) 2009 ; 71(3): 346-50.
8. De Beaufort C, Jarosz-Chobot P, Frank M. Transition from pediatric to
adult diabetes care: smooth or slippery? Pediatr Diabetes 2010 ; 11(1):
24-27.
9. Suris JC, Domine F, Akre C. La transition des soins pédiatriques aux
soins adultes des adolescents sourant d’aections chroniques. Rev Med
Suisse 2008 ; 4 (161): 1441-4.
10. Rosen DS, Blum RW, Britto M et al. Transition to adult health care for
adolescents and young adults with chronic conditions: position paper
of the Society for Adolescent Medicine. J Adolesc Health 2003 ; 33(4):
309-11.
11. Peters A, Lael L, The Ada Transitions Working Group. Diabetes care
for emerging adults : recommendations for transition from pediatric
to adult diabetes care systems. A position statement of the American
diabetes Association. Diabetes Care 2011 ; 34: 2477-2485.
RÉFÉRENCES
1
/
3
100%