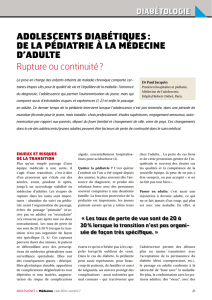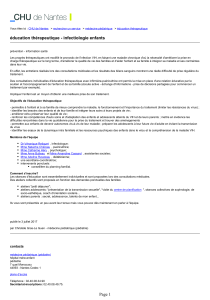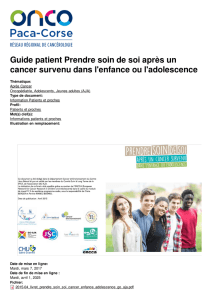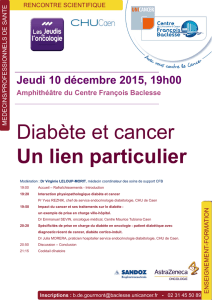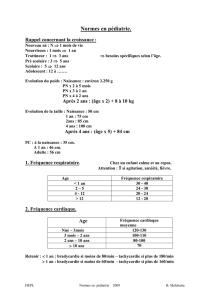Le passage des adolescents du suivi pédiatrique à la diabétologie

Médecine
& enfance
Soraya, vingt et un ans, étudiante en
deuxième année en sciences écono-
miques est diabétique depuis l’âge de
quatre ans. Fait clinique exceptionnel,
elle ne s’est jamais fait une injection
d’insuline elle-même, toutes ont été
faites jusqu’à ce jour par sa mère ou
quelquefois par son père. Les diffé-
rentes interventions de l’équipe pluri-
disciplinaire ont échoué à lui faire fran-
chir ce cap (médecin, infirmière de
soins, éducation thérapeutique, psycho-
logue, autohypnose).
Elle refuse avec la même obstination le
passage en service d’adultes, prête à ac-
cepter tous les changements si elle ne
quitte pas la pédiatrie où elle se sent
bien. Elle propose qu’un médecin
d’adultes vienne la suivre en pédiatrie.
Yoan, dix-neuf ans, inactif à la maison,
fumeur de cannabis régulier, a un dia-
bète qu’il traite très insuffisamment. Il
est en hyperglycémie chronique et a été
hospitalisé pour acidocétose il y a un
an. Il manque plus de la moitié des ren-
dez-vous et réapparaît à la deuxième ou
troisième relance, « puisque vous
m’avez écrit ». Mais lorsqu’on réussit à
le voir, il insiste beaucoup pour ne pas
passer en diabétologie adulte et deman-
de un délai supplémentaire.
Maria, diabétique depuis l’âge de cinq
ans, a toujours été suivie dans le même
service. Toute l’équipe la connaît, « com-
me si on l’avait faite », ainsi que les
graves difficultés qu’elle rencontre du
côté de ses parents au plan psycholo-
gique et social. Elle accepte difficilement
de quitter la pédiatrie pour un service de
diabétologie adulte, qu’elle choisit elle-
même car il a une bonne réputation et
est situé près de son domicile. Un cour-
rier est adressé dans ce nouveau service
et le passage se fait sans contact direct
entre les diabétologues. Elle va à son
premier rendez-vous et le pédiatre en
est informé par courrier. Puis plus de
nouvelles. On découvre deux ans plus
tard, à l’occasion d’un travail de re-
cherche sur la transition, qu’elle n’a plus
aucun suivi car le premier contact en
service d’adultes ne lui a pas convenu.
Elle a été très soulagée d’être appelée
par la pédiatre, qui a pu refaire le point
avec elle et lui proposer un autre diabé-
tologue avec qui elle est en lien régulier.
La jeune fille a bien accroché avec ce
médecin et a tenu à revenir nous le dire.
Julien, dix-huit ans, vient d’avoir son bac.
Il rentre en école d’art, il est diabétique
depuis cinq ans et se débrouille plutôt
bien même s’il ne fait pas beaucoup de
glycémies. Ses HbA1c sont autour de
7,5 %. Pour lui, le passage ne pose pas
de problème. Il demande simplement
que ça se fasse après qu’il se sera installé
dans son année universitaire, principal
changement qu’il a à gérer actuellement.
LE PASSAGE : QUITTER
L’UNIVERS FAMILIER ET
PROTECTEUR
DE LA PÉDIATRIE
Ces exemples permettent un premier
constat, à savoir que les adolescents ou
Le passage des adolescents du suivi pédiatrique à la diabétologie
d’adultes constitue toujours une épreuve. Quitter un milieu de soins fa-
milier pour l’inconnu n’est jamais aisé, et ce d’autant moins que cela in-
tervient à une période de la vie plutôt instable, gestion du diabète inclu-
se [1]. A côté des facteurs individuels de réussite ou d’échec de ce pas-
sage, il existe des facteurs liés à l’organisation des différents acteurs de
soins et aux disponibilités locales.
On différencie le passage, qui ne représente que l’étape centrale du
changement d’équipe, de la transition, processus long qui débute bien
en amont du passage et se termine lorsque l’accrochage est jugé satis-
faisant en service pour adultes. L’enjeu majeur de ce passage est médi-
cal, et au-delà, il engage la qualité de vie des patients. En effet, les
conséquences en cas d’échec sont graves : complications aiguës plus
fréquentes, en particulier acidocétoses, accélération de la survenue de
complications dégénératives (néphropathie et rétinopathie), dépistées
plus tardivement et moins bien traitées [2-4].
L’adolescent entre pédiatrie et médecine d’adulte:
une transition à soigner, le diabétique en exemple
P. Jacquin, pédiatre, médecine de l’adolescent, hôpital Robert-Debré, Paris
mai-juin 2016
page 151
10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page151

jeunes adultes (AJA) les plus fragiles
semblent les moins bien armés pour
changer d’équipe et préfèrent s’accro-
cher au suivi pédiatrique. Mais l’analyse
des difficultés dont témoignent ces pa-
tients nous éclaire sur la problématique
de la transition chez tous les patients.
Plusieurs aspects objectifs et subjectifs
de la prise en charge pédiatrique expli-
quent les difficultés de ce départ.
DES BARRIÈRES SYMBOLIQUES
Les années passées en pédiatrie ont vu
des liens forts se constituer avec l’équi-
pe, souvent sur un mode quasi familial :
l’infirmière « grande sœur », le diabéto-
logue en position parentale, et les
autres patients, notamment les plus pe-
tits, en frères et sœurs. Ces liens comp-
tent sans doute d’autant plus que ceux
de la vraie famille sont fragiles, voire
défaillants. Comment quitter et renon-
cer à cet environnement affectif chaleu-
reux ?
Mais surtout, la pédiatrie est associée à
l’idée de protection des enfants et des
adolescents, et ce quelle que soit la qua-
lité de l’équilibre du diabète. Il s’agit
d’une représentation générale de l’en-
fance et des soins, loin des turpitudes
de l’âge adulte et de sa fin promise.
Quand la maladie chronique touche un
enfant, les parents, et bien souvent les
soignants aussi, ont absolument besoin
de croire que peut-être un jour il ou elle
s’en sortira et échappera à la chronicité
« à vie ». Certains sont tentés de donner
de faux espoirs pour alléger la charge
de l’annonce du diagnostic : « peut-être
que dans dix ans, les progrès de la mé-
decine… ». Le sentiment de protection
magique fait dire à un patient « avoir
[une HbA1c à] 12 % en pédiatrie, ça va,
mais en adulte c’est mortel ! ».
La pédiatrie, c’est aussi une temporalité
lente, le temps de mûrir et de s’autono-
miser progressivement tout en étant re-
connu comme pas complètement indé-
pendant. Le passage en diabétologie
adulte est vécu comme une rupture dans
ce processus maturatif, comme une in-
jonction à devenir adulte «d’un coup » et
à couper les différents cordons de l’en-
fance. Cet aspect « rite de passage » est
stimulant quand on se sent prêt, mais au
contraire angoissant si ce n’est pas le cas.
LES COMPLICATIONS :
UN ENJEU BIEN RÉEL
De plus, particulièrement dans le cas du
diabète, ces barrières symboliques et re-
lationnelles sont doublées d’une barriè-
re bien réelle, celle des complications
dégénératives, vraie gravité de la mala-
die. La néphropathie et la rétinopathie
diabétiques ne surviennent générale-
ment qu’après dix ou quinze ans de dia-
bète, c’est-à-dire essentiellement chez
l’adulte [5]. C’est pourquoi elles sont
souvent méconnues en pédiatrie, res-
tant plus ou moins sous le boisseau de-
puis l’annonce du diagnostic, mais tou-
jours présentes comme une menace
lointaine. Les informations en la matiè-
re sont parcellaires, les enfants ou ado-
lescents et leurs parents n’en ont qu’une
vision obscure mais souvent extrême de
cécité, dialyse et amputation. Tout le
monde s’accorde pour ne pas en par-
ler… Mieux vaut rester en pédiatrie que
de plonger dans cet univers sinistre !
Une des anticipations les plus anxio-
gènes des adolescents sur ce qu’ils au-
ront à vivre en diabétologie d’adulte est
d’ailleurs de s’imaginer dans la salle
d’attente avec des « vieux » et des pa-
tients atteints de complications visibles.
LA PLACE DES PARENTS
Les parents, et souvent aussi les soi-
gnants de pédiatrie, ont des attentes
contradictoires vis-à-vis des adoles-
cents. Tantôt ils ne voient pas que leur
enfant a grandi et le considèrent encore
comme un enfant alors qu’il est déjà
presque un adulte, tantôt ils veulent le
pousser à une autonomisation trop rapi-
de ou trop précoce, au risque de le lais-
ser dans une solitude dangereuse. Le
plus souvent, ils sont ambivalents ; leur
discours va généralement dans le sens
de l’autonomisation de l’adolescent,
mais ils la redoutent, craignant que cela
ne soit synonyme de dégradation de
l’équilibre glycémique. L’attachement
des parents aux soignants de pédiatrie
est également important et réclame
pour eux aussi un travail de séparation.
Sur le plan pratique, l’implication des
parents dans les soins et dans la gestion
du matériel reste souvent importante au
moment du passage, mais non dite. Il
est souhaitable de nommer concrète-
ment cette répartition des tâches de fa-
çon à la faire évoluer.
LE MONDE INCONNU
DE LA DIABÉTOLOGIE
D’ADULTE
Comme en pédiatrie, des obstacles réels
se surajoutent aux inquiétudes person-
nelles. La première difficulté peut être
d’avoir un rendez-vous : a-t-on le nom
du médecin ou est-ce simplement à un
service qu’on est adressé ? avec quels
documents ? le courrier ou résumé
d’observation est-il adressé directement
au médecin ou remis au patient ? Si ces
repères fondamentaux ne sont pas
clairs, certains patients AJA n’arriveront
jamais au bon endroit. D’autres ques-
tions se posent sur le contenu de cette
première consultation : le médecin au-
ra-t-il assez de temps ? va-t-il vouvoyer
ou tutoyer ? verra-t-il les parents ? va-t-
il juger sévèrement le patient mal équi-
libré, voire remettre en cause la prise en
charge pédiatrique ? « saura-t-il com-
prendre mon cas particulier ? ».
Ces premiers contacts avec l’équipe
adulte sont déterminants pour la suite :
insuffisamment rassurants et enga-
geants, ils vont conduire nombre de pa-
tients à l’abandon du suivi spécialisé.
C’est souvent ainsi qu’une errance mé-
dicale s’installe durant plusieurs an-
nées, entraînant une qualité de soins et
de prévention des complications bien
moindre. Notons que les files actives
des services de diabétologie d’adulte
sont beaucoup plus importantes que
celles des patients arrivant de pédiatrie,
ce qui explique la difficulté d’accorder à
ces derniers un accueil particulier.
POUR UNE TRANSITION
RÉUSSIE
L’analyse des difficultés évoquées permet
Médecine
& enfance
mai-juin 2016
page 152
10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page152

d’avancer un certain nombre d’éléments
de solution, le premier étant la nécessi-
té que l’adolescent soit réellement l’ac-
teur principal de la transition. Plutôt
que de subir un changement plus ou
moins brutalement imposé, le patient
doit arriver à l’âge du passage en ayant
acquis les capacités et le sentiment qu’il
est prêt à franchir cette étape [6-8]. Cela
suppose de penser la transition dans un
cadre large et un temps long, bien au-
delà du seul changement d’équipe de
soins, comme un cheminement de la dé-
pendance infantile à l’autonomie du
jeune adulte, capable de se débrouiller
avec sa maladie.
Le diabète est une maladie exemplaire
parce que son traitement permet en
théorie un contrôle quasi parfait, mais
au prix de nombreuses contraintes quo-
tidiennes, sources d’autant de difficultés
d’observance. Lorsqu’arrive l’adolescen-
ce, on constate des décrochages plus ou
moins importants dans la régularité des
mesures de glycémie, voire des injec-
tions, et un comportement alimentaire
et des horaires qui s’éloignent de plus en
plus des prescriptions pour se rappro-
cher de la « norme» de cet âge [1]. Le sui-
vi médical des adolescents se limite
alors souvent à des questions d’obser-
vance et à la négociation d’objectifs à at-
teindre. Cette période devrait être au
contraire l’occasion de construire une
nouvelle alliance avec ce patient, qui ex-
périmente et s’approprie sa maladie [9].
Notre rôle est d’accompagner cette ma-
turation nécessaire à la conquête de
l’autonomie et à la construction d’un
projet de vie, dans lequel la maladie
chronique doit avoir une place, mais pas
toute la place.
UNE PRÉPARATION GLOBALE
ET PRÉCOCE
Les recommandations en matière de
transition insistent sur la nécessité de sa
préparation, de sa progressivité et de sa
structuration (dossier, check-list,
etc.) [10-12]. Ce sont des repères très
utiles pour tous, adolescents, parents et
soignants (tableau I). Il existe des pro-
grammes étape par étape, spécifiques
du diabète ou d’autres pathologies, qui
préparent dès le début de l’adolescence
cette transition vers l’âge adulte [13-15].
La préparation au passage répond à un
double objectif :
첸
permettre l’acquisition des connais-
sances et des compétences nécessaires à
l’autogestion du diabète ;
첸
accompagner les processus dévelop-
pementaux de l’adolescence, la sexuali-
sation, l’autonomisation vis-à-vis des
parents, la socialisation.
Cette évolution progressive suppose des
changements dans les relations triangu-
laires entre soignants, patient et pa-
rents. Il est important que l’adolescent
soit reçu au moins une partie du temps
sans ses parents et qu’il ait la possibilité
d’exprimer ses attentes et ses questions,
sans peur d’être jugé. De même, les pa-
rents doivent pouvoir être écoutés sépa-
rément pour être soutenus dans leur
part du travail d’autonomisation.
Concernant le traitement du diabète,
l’autonomie se construit par étapes et
tâche par tâche. Elle ne doit pas être
évaluée comme un tout, mais plutôt
comme un ensemble de compétences
différentes (tableau II). L’autonomie n’est
pas synonyme de tout faire seul, mais
plutôt d’être capable d’évaluer ce qu’on
sait et ce qu’on fait, et de savoir quelles
ressources mobiliser pour être aidé
pour ce qu’on ne sait pas faire seul.
Aider les patients à se projeter dans
l’avenir suppose aussi de pouvoir parler
précocement (dès dix-douze ans) des
contraintes et limites de la maladie
qu’ils auront à intégrer [10] : les profes-
sions interdites, les restrictions au per-
mis de conduire, les conditions néces-
saires pour une grossesse sans risque, et
bien sûr les complications.
Ces dernières font partie des risques, et
en parler est nécessaire pour mieux
comprendre les enjeux du traite-
ment [16]. Il faut souligner qu’il ne s’agit
pas de menaces de tout ou rien, mais
d’altérations possibles (au niveau oph-
talmologique, rénal, sensitif, etc.) que
l’on surveille régulièrement et que l’on
peut traiter à tous les stades évolutifs.
L’apport de l’expérience des équipes
d’adultes, habituées à traiter les patients
avec des complications, est essentiel et
Médecine
& enfance
mai-juin 2016
page 153
Tableau I
Objectifs de la préparation au passage
첸Comprendre sa maladie et son traitement
첸Savoir l’expliquer aux autres
첸Connaître les éléments à surveiller, les obs-
tacles, les ressources (personnes à joindre,
coordonnées)
첸Gérer son traitement seul (cf. tableau II)
첸Contacter les soignants et prendre ses
rendez-vous seul
첸Voir les soignants seul
첸Plaider en son nom propre (« self advocacy »)
첸Exprimer ses attentes et ses questions seul
첸Participer à la décision médicale partagée
첸Aborder les questions de santé sexuelle
첸Connaître les effets de l’alcool, du tabac et
des drogues en général, et leurs interactions
avec la maladie
첸Droit à la confidentialité
첸Ressources et appuis dans le domaine psy-
chologique
첸Ressources et appuis dans le domaine social
첸Orientation scolaire et formation profession-
nelle, restriction dans les métiers
첸Activités extrascolaires ou extraprofession-
nelles comme les autres de son âge
Tableau II
Savoirs et compétences en diabète :
« Qui fait quoi ? (patient, parents,
infirmière ou autre aide extérieure) »
(d’après [1])
첸Informer l’entourage
첸Glycémies : horaires, les faire, les noter
éventuellement, les interpréter
첸Insulines : horaires, choix de la dose (ou du
bolus) d’insuline rapide, réglage de la basale
ou du débit de base, préparation du matériel,
réalisation de l’injection ou pose du cathéter
첸Conduite à tenir en cas d’hypoglycémie :
sucre (où ?), glucagon
첸Conduite à tenir en cas d’hyperglycémie,
recherche d’acétone
첸Gestions des stocks d’insuline et du
matériel, dates de péremption, aller à la
pharmacie, demande de renouvellement
d’ordonnance
첸Alimentation et menus à la maison et en
dehors
첸Adaptation du traitement pour le sport
첸Prise et suivi des rendez-vous médicaux
첸Suivis des résultats (HbA1c) et autres bilans
[1] Anderson B.J., Auslander W.F., Jung K.C. et al. :
« Assessing family sharing of diabetes
responsibilities», J. Pediatr. Psychol., 1990; 15 : 477-92.
10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page153

doit être intégré et adapté dans les pro-
grammes d’éducation thérapeutique en
pédiatrie.
D’autres sujets qui préoccupent les ado-
lescents doivent être systématiquement
abordés au cours de cette phase de pré-
paration, parce qu’ils concernent la san-
té en général et peuvent interagir avec
le diabète : sexualité et contraception,
hygiène de vie, conduites à risques, ta-
bac, alcool, cannabis, etc. [17]. Tous les
problèmes ne sont pas réglés parce
qu’on les a abordés une fois, mais cette
ouverture permet, d’une part, de ré-
pondre à certaines questions et, d’autre
part, d’indiquer à l’adolescent qu’il peut
en reparler avec ses soignants ultérieu-
rement.
ÂGE DU PASSAGE
ET CHOIX DU DIABÉTOLOGUE
Lorsque l’adolescent se sent prêt, le pas-
sage est organisé, généralement aux
alentours de dix-huit ans, âge limite de
la pédiatrie. Age officiel de la majorité
et de la fin des études secondaires, c’est
aussi le début d’une période d’instabili-
té qui va durer plusieurs années, dans
lesquelles l’AJA va rentrer dans la vie
professionnelle ou estudiantine, éven-
tuellement changer de ville et donc de
lieu de suivi, quitter ses parents, se
mettre en couple, etc. Cela ne nous pa-
raît pas une contre-indication au passa-
ge ; au contraire, il est logique que le
passage en adulte s’inscrive dans cette
période de choix déterminants pour soi
et son avenir. Retarder le passage en at-
tendant un hypothétique point d’équi-
libre stable comporte toujours une di-
mension régressive et déprimante d’im-
possibilité de franchir une étape. Ce
n’est une bonne solution que dans cer-
taines situations particulièrement
lourdes (poly-pathologie ou comorbidi-
té psychiatrique).
Le choix du diabétologue d’adulte, libé-
ral ou le plus souvent hospitalier, est
fait sur des critères d’offre locale et de
liens avec l’équipe pédiatrique. Il est de
beaucoup préférable que cela soit un
médecin précis, sénior de l’équipe adul-
te, et non une adresse à un service en
général. Le jeune et ses parents doivent
être associés à ce choix suffisamment
tôt pour qu’ils aient le temps d’y adhé-
rer ou de faire d’autres propositions.
La transition est facilitée lorsque les pa-
tients « ont vu la tête » du nouveau réfé-
rent, c’est-à-dire après qu’il leur a été
présenté, soit lors d’une rencontre (par
exemple en groupe en hôpital de jour),
soit lors d’une consultation conjointe
(plus difficile à organiser), soit encore
virtuellement (photo, vidéo). Il est évi-
dent que lorsque la pédiatrie et le servi-
ce pour adultes sont dans le même hô-
pital, ces questions sont beaucoup plus
simples à régler que lorsqu’il s’agit de
deux sites plus ou moins éloignés.
Une autre façon de faciliter la transition
peut être la proposition d’une rencontre
avec un patient diabétique adulte pris
en charge dans le service destinataire.
Cette incarnation de la possibilité de
vivre adulte avec la maladie aide les
adolescents à se projeter vers l’avenir.
Ce lien intergénérationnel peut être
plus structuré et durable, et constituer
un véritable parrainage.
La transmission des informations entre
services est une autre occasion de mon-
trer au patient qu’il est désormais véri-
tablement l’interlocuteur central. Le
compte rendu médical de synthèse du
suivi pédiatrique doit être remis au pa-
tient, avec les points essentiels du trai-
tement et les éventuelles complications,
mais aussi les problèmes associés. S’il
existe des difficultés psychologiques im-
portantes, par exemple troubles du
comportement alimentaire ou dépres-
sion, il est souhaitable de les mention-
ner, avec l’accord du patient, ainsi que
les prises en charge complémentaires
en cours.
EN SERVICE D’ADULTE
L’accrochage avec l’équipe du service
d’adulte va se jouer sur les premiers
contacts. Il est nécessaire de présenter
les différents membres de l’équipe soi-
gnante, son mode de fonctionnement et
ses ressources : infirmières, médecins,
diététicienne, psychologue, autres mé-
decins, service social, numéro de télé-
phone en cas d’urgence, prise des ren-
dez-vous… Le mieux est de pouvoir
proposer un référent qui facilitera et
surveillera la mise en place du suivi en
adulte. Cela nécessite des aménage-
ments spécifiques dans les prises de
rendez-vous, le fléchage des patients
vers le médecin choisi, un temps de
consultation supplémentaire [7, 8, 10, 11].
Sur le plan médical, la continuité initia-
le est la règle : on ne change pas le trai-
tement instauré en pédiatrie dès les pre-
mières consultations. La présence des
parents accompagnant leur fils ou leur
fille à la première consultation n’est ni
interdite ni obligatoire, mais la présen-
tation du nouveau diabétologue aux pa-
rents a souvent un effet favorable de
« passage de témoin ».
Les patients AJA ne sont plus des en-
fants, ils sont libres et autonomes, mais
pas pour tout ni seuls. Dans l’étude
« Pass’âge » en cours [2], 80 % des ado-
lescents qui « passent » aux alentours
des dix-huit ans vivent encore chez
leurs parents et comptent encore beau-
coup sur ces derniers pour la gestion du
matériel et des stocks d’insuline, pour
les rendez-vous et de façon non excep-
tionnelle pour les injections. Cette
« mixité de statut » doit être prise en
compte par les services d’adulte : l’inter-
valle recommandé entre deux rendez-
vous pour les patients AJA est de trois
mois, et ils ont besoin d’être rappelés
s’ils ne viennent pas. De même que pour
les adolescents en pédiatrie, le suivi des
AJA pour le diabète doit être l’occasion
d’aborder d’autres problématiques de
santé fréquentes à cet âge : sexualité et
contraception, difficultés psycholo-
giques, addictions, etc. La référence aux
pairs, pour se comparer, se comprendre
et se soutenir, est particulière à cet âge.
C’est pourquoi le recours à des séances
de groupe de patients, que ce soit sur le
diabète ou sur d’autres sujets, est facili-
tateur. Le partage d’expérience entre
équipes pédiatriques et médecins
d’adulte peut être ici très fructueux.
SÉCURISER LA TRANSITION
Il s’agit de ne pas perdre le patient en
route. Sans organisation particulière, le
nombre de perdus de vue après le pas-
sage en adulte était de 20 à 60 % [18] !
Médecine
& enfance
mai-juin 2016
page 154
10 mai16 m&e ado diabète 13/06/16 17:31 Page154

Le travail de préparation et l’organisa-
tion du passage permettent d’améliorer
très nettement les chances de succès,
mais il faut également porter une atten-
tion toute particulière aux premières
années en diabétologie pour adulte. Le
risque de décrochage secondaire est éle-
vé, après une ou quelques consulta-
tions. Il est donc souhaitable de suivre
de façon exhaustive le devenir des pa-
tients passés en adulte, par un fichier ad
hoc pendant deux ans au minimum.
L’ensemble des spécificités du suivi des
AJA en diabétologie d’adulte réclame
une organisation particulière et un in-
vestissement professionnel important.
L’intérêt de regrouper les patients AJA
entre eux, avec des moyens et un fonc-
tionnement approprié, a conduit à l’éta-
blissement de « cliniques de la transi-
tion » pour les dix-huit à vingt-cinq ans,
pour une ou plusieurs pathologies
(dans les pays anglo-saxons essentielle-
ment) [19]. D’autres expériences utili-
sent un service tiers pour faciliter la
transition : unité de médecine de l’ado-
lescent et du jeune adulte, dans laquelle
les patients transitent avec une possibi-
lité de prise en charge mixte, alternant
les spécialistes pédiatres et ceux d’adul-
te, jusqu’à ce que le patient soit prêt à
passer dans le circuit adulte classique.
CONCLUSION
La problématique de la transition dans
les maladies chroniques amène à repen-
ser certains aspects de la pédiatrie et de
l’éducation thérapeutique : anticipation
insuffisante de l’avenir, tendance à la
passivité des patients. Comme souvent,
les adolescents, leurs exigences et leurs
fragilités nous obligent à remettre en
question nos pratiques.
Nous devons mieux préparer l’avenir
des patients suivis en pédiatrie, ce qui
suppose d’être également mieux infor-
més aussi sur les différents aspects de la
vie adulte avec le diabète et de tra-
vailler plus en collaboration avec nos
partenaires en diabétologie d’adulte.
L’autonomie à construire par les AJA
n’est pas le résultat d’une succession
d’examens de compétences à franchir,
c’est une autonomie dans la réflexion
personnelle et la prise de décision, la
valorisation de ses expériences lui per-
mettant d’échanger avec ses soignants.
Cela suppose des changements impor-
tants dans les places de chacun, pa-
tients, soignants et parents. Une transi-
tion réussie, c’est un patient AJA qui a
intégré sa maladie dans son projet de
vie et qui a trouvé dans le service adulte
la confiance et les ressources néces-
saires à la gestion de son diabète.
첸
Nous remercions toute l’équipe du service d’endocrino-
logie et de diabétologie de l’hôpital Robert-Debré, ainsi
que tous les membres du groupe collaboratif de l’étude
« Pass’âge » sur la transition des diabétiques en Ile-de
France. Diabétologie de l’enfant et de l’adolescent : hô-
pital Robert-Debré (Drs Tubiana-Rufi et Jacquin), hôpital
Necker-Enfants Malades (Pr Robert, Dr Beltrand), Paris ;
CHI Poissy-Saint-Germain (Dr Personnier) ; CH Pontoise
(Dr Pantalone) ; CHIC Créteil (Dr Fourmaux) ; CH Argen-
teuil (Dr Colin-Gorsky) ; CH Gonesse (Drs Elias et Bara-
kat). Diabétologie pour adultes : hôpital Cochin-Hôtel-
Dieu (Pr Timsit et Dr Sola), hôpital La Pitié (Dr Halbron),
hôpital Lariboisière (Pr Gautier et Dr Bouché, Mme Ge-
net), Paris ; hôpital Jean-Verdier, Bondy (Pr Cosson,
Dr Banu) ; hôpital Henri-Mondor Créteil (Dr Drouma-
guet) ; CH Pontoise (Drs Campinos et Gonfroy); CH Go-
nesse (Drs Seret-Begue et Assayag) ; CH Argenteuil
(Dr Chedin) ; CHI Poissy-Saint-Germain (Dr Carreira).
Spécialiste en diabétologie libérale : Dr Letanoux.
L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts en rapport
avec la rédaction de cet article.
Médecine
& enfance
mai-juin 2016
page 155
Références
[1] TUBIANA-RUFI N., GUITARD-MUNNICH C. : « Diabète de
l’adolescent », in GRIMALDI A. : Traité de diabétologie, Flamma-
rion Médecine Sciences, 2009 ; p. 274-9.
[2] TUBIANA-RUFI N., DU PASQUIER L., JACQUIN P. et al. :
« Etude longitudinale de la transition de la pédiatrie à la médeci-
ne pour adultes chez les jeunes patients diabétiques en Ile-de-
France », Diabetes Metab., 2010 ; 36 suppl. 1 : A20.
[3] BRYDEN K.S., PEVELER R.C., STEIN A. et al. : « Clinical and
psychological course of diabetes from adolescence to young
adulthood : a longitudinal cohort study », Diabetes Care, 2001 ;
24:1536-40.
[4] HOLMES-WALKER D.J., LLEWELLYN A.C., FARRELL K. : « A
transition care programme which improves diabetes control and
reduces hospital admission rates in young adults with Type 1
diabetes aged 15-25 years », Diabet. Med. J. Br. Diabet. Assoc.,
2007 ; 24 : 764-9.
[5] JAMES S., GALLAGHER R., DUNBABIN J., PERRY L. : « Preva-
lence of vascular complications and factors predictive of their
development in young adults with type 1 diabetes : systematic li-
terature review », BMC Res. Notes, 2014 ; 7:593.
[6] ANDERSON B.J., WOLPERT H.A. : « A developmental pers-
pective on the challenges of diabetes education and care during
the young adult period », Patient Educ. Couns., 2004 ; 53:347-
52.
[7] MCDONAGH J.E. : « Growing up and moving on : transition
from pediatric to adult care », Pediatr. Transplant., 2005 ; 9:364-
72.
[8] ROSEN D.S., BLUM R.W., BRITTO M. et al. : « Transition to
adult health care for adolescents and young adults with chronic
conditions : position paper of the Society for Adolescent Medici-
ne », J. Adolesc. Health, 2003 ; 33 : 309-11.
[9] JACQUIN P., LEVINE M. : « Difficultés d’observance dans les
maladies chroniques à l’adolescence : comprendre pour agir »,
Arch. Pédiatr., 2008 ; 15 : 89-94.
[10] CAMERON F.J., AMIN R., DE BEAUFORT C. ET AL., INTER-
NATIONAL SOCIETY FOR PEDIATRIC AND ADOLESCENT DIA-
BETES : « ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014.
Diabetes in adolescence », Pediatr. Diabetes, 2014 ; 15 suppl.
20 : 245-56.
[11] PETERS A., LAFFEL L., THE ADA TRANSITIONS WORKING
GROUP : « Diabetes care for emerging adults : recommenda-
tions for transition from pediatric to adult diabetes care systems.
A position statement of the American Diabetes Association »,
Diabetes Care, 2011 ; 34 : 2477-85.
[12] SURIS J.C., DOMINE F., AKRE C. : « La transition des soins
pédiatriques aux soins adultes des adolescents souffrant d’affec-
tions chroniques », Rev. Méd. Suisse, 2008 ; 4:1441-4.
[13] http://www.gottransition.org/resources.
[14] http://www.sickkids.ca/Good2Go/For-Youth-and-Families/
Transition-tools/Index.html.
[15] NAGRA A., MC GINNITY P.M., DAVIS N., SALMON A.P. :
« Implementing transition : Ready Steady Go », Arch. Dis. Child.
Educ. Pract. Ed., 2015 ; 100 : 313-20.
[16] WYSOCKI T., LOCHRIE A., ANTAL H., BUCKLOH L.M. :
« Youth and parent knowledge and communication about major
complications of type 1 diabetes : associations with diabetes
outcomes », Diabetes Care, 2011 ; 34 : 1701-5.
[17] ALVIN P., DE TOURNEMIRE R., ANJOT M.N., VUILLEMIN
L. : « Maladie chronique à l’adolescence : dix questions perti-
nentes », Arch. Pédiatr., 2003 ; 10 : 360-6.
[18] PACAUD D., YALE J.F. : « Exploring a black hole : transition
from paediatric to adult care services for youth with diabetes »,
Paediatr. Child Health, 2005 ; 10 : 31-4.
[19] VAN WALLEGHEM N., MACDONALD C.A., DEAN H.J. :
« Evaluation of a systems navigator model for transition from pe-
diatric to adult care for young adults with type 1 diabetes », Dia-
betes Care, 2008 ; 31 : 1529-30.
10 mai16 m&e ado diabète 15/06/16 11:26 Page155
1
/
5
100%