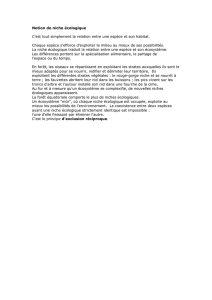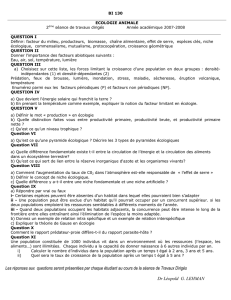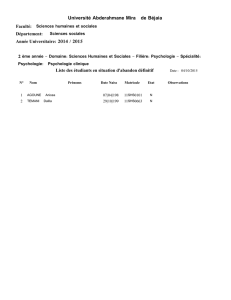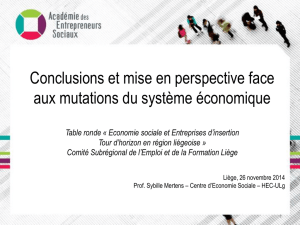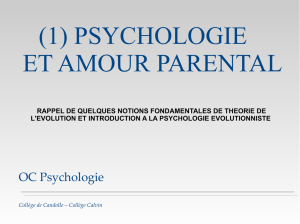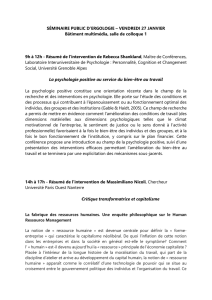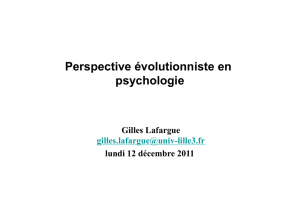Automne Séminaire 09 Psychologie comparative des comportements

!
!"#$%&'(
)*%+&,+-'(
09#
Psychologie#comparative#des#comportements#
Catherine#Brandner#
#
!
Perspective évolutionniste de l’anorexie mentale
D’après le texte de Crawford, C.B. (1989). The theory of evolution: of what value to psychology?
Journal of Comparative Psychology, 103, 4-22
Mélanie Allain, Licence ès Sciences du sport et de l'éducation physique, mention Enseignement
L’anorexie mentale est un trouble du comportement alimentaire qui se développe dans nos sociétés
industrialisées et qui touche principalement les femmes.1 Le DSM-IV-TR définit l’anorexie mentale
comme une pathologie qui se caractérise par le refus de garder un poids corporel minimum normal,
une peur intense de prendre du poids, une altération significative de la perception de la forme de son
propre corps, et une aménorrhée c’est-à-dire l’absence de 3 cycles menstruels minimum entraînant
une perte de ses fonctions sexuelles reproductrices.2
Les raisons d’une telle pathologie sont multifactorielles3 et peuvent être abordées de différentes
manières selon les domaines spécifiques que recouvre la psychologie. Crawford (1989) développe
plusieurs approches distinctes et complémentaires pour étudier la signification de l’anorexie mentale.
L’approche socioculturelle nous est la plus familière. Elle pose l’hypothèse que l’anorexie mentale se
développe alors que les jeunes femmes recherchent la maigreur pour se conformer aux idéaux de
beauté de leur société. Par ailleurs, l’approche évolutionniste part du postulat que les comportements
actuels ont évolué en réponse à des conditions ancestrales. La perspective évolutionniste recherche
les causes ultimes du comportement c’est-à-dire à comprendre pourquoi un comportement a évolué.
Dans le cas de l’anorexie mentale, elle cherche à comprendre à quel comportement normal des
populations ancestrales correspond le comportement pathologique actuel de l’anorexie mentale.
Alors que la perspective socioculturelle nous est la plus familière, quel est l’intérêt d’adopter une
perspective évolutionniste dans l’étude d’un comportement alimentaire comme l’anorexie mentale ?
Nous expliquerons deux hypothèses évolutionnistes développées par Crawford (1989) et montrerons
leur intérêt dans le domaine de la psychologie.
L’hypothèse de la compétition entre femme nécessite de transposer une jeune femme anorexique
dans un contexte environnemental pauvre en ressources caractéristique des populations ancestrales.
Il y a des millions d’années, le manque de ressources entraînait une forte compétition entre les
femmes pour pouvoir survivre et faire survivre sa progéniture. Par conséquent, seules les femmes les
plus fortes physiquement et socialement pouvaient survivre dans cet environnement hostile. Cette
compétition entre femmes était représentative de la sélection naturelle de Darwin (1859).
Dans ce schéma, l’anorexie mentale se propose comme un trait adaptatif de la sélection naturelle. En
effet, la perte de poids aurait la fonction de retarder la maturation de la jeune femme. Ce retard
pubertaire provoquerait le désintérêt de l’homme puisqu’elle n’est plus fécondable et implicitement
réduirait la compétition entre les femmes. Ainsi, la jeune anorexique aurait plus de temps pour se
développer socialement et physiquement.
En termes de fitness (succès reproducteur), nous pouvons penser que le comportement anorexique à
un coût élevé. Cependant, le retard pubertaire maximise la fitness. En effet, le désintérêt des hommes
et la baisse de la compétition entre femmes laissent du temps à l’anorexique pour se développer
dans le but d’être plus compétitive et de proposer de meilleures ressources à ses futures
progénitures.
Dans cette perspective évolutionniste, c’est l’hypothèse du retard pubertaire qui est mise en avant.
Ceci peut amener à de nouvelles pistes de réflexion quant aux soins à prodiguer aux patientes
atteintes d’anorexie mentale aujourd’hui. En effet, l’hypothèse du retard de maturation nous fait
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 T. Léonard, C. Foulon, J-D. Guelfi, Trouble du comportement alimentaire chez l’adulte, EMC-
Psychatrie 2, 2005, p. 96-127.
2 American psychiatric Association, DSM-IV-TR manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, texte révisé par J.-D. Guelfi et al. 4ème édition, Paris : Masson, 2000, p. 676.
3 T. Léonard, C. Foulon, J-D. Guelfi, Trouble du comportement alimentaire chez l’adulte, EMC-
Psychatrie 2, 2005, p. 96-127.

!
2!
réfléchir sur la possibilité de concevoir des thérapeutiques non médicamenteuses basées sur le
développement physique et social de l’anorexique.
La deuxième hypothèse développée par Crawford (1989) est celle de l’altruisme alimentaire. L’acte
altruiste est défini par un comportement qui peut nuire à la survie et la reproduction de sa propre
personne au profit d’autres individus.4
Pour comprendre cette hypothèse, il faut transposer les traits caractéristiques de l’anorexique dans
l’environnement hostile des populations ancestrales de chasseurs-cueilleurs. Aujourd’hui, l’anorexique
est définie comme une personne hyperactive qui manque de confiance en elle. Elle aime faire plaisirs
aux autres en leur faisant à manger. Aussi, elle a une tendance à voler et cacher de la nourriture pour
la redonner aux autres. Ces caractéristiques, qui aujourd’hui sont pointées du doigt, répondent à un
comportement de survie dans l’environnement rude et pauvre en ressources des populations
ancestrales. Lors d’intenses famines, le comportement des jeunes anorexiques était un trait adaptatif
au milieu. En effet, leur maigre alimentation et leur comportement d’offrande alimentaire leur
permettaient de nourrir les plus nécessiteux (enfants et mères) et ainsi participer au maintien de leur
survie.5
Cet acte altruiste est bénéfique en termes de fitness inclusive : l’anorexique augmente la fitness de sa
parentèle, c’est-à-dire ceux dont elle a une proximité génétique, mais aussi sa fitness individuelle du
fait de la proximité génétique avec ceux qu’elle aide.
L’intérêt de cette deuxième hypothèse est de mettre en avant le comportement altruiste d’offrande
alimentaire qui est un comportement laissé pour compte dans les approches non-évolutionnistes. Ceci
permet d’ouvrir des pistes de réflexion quant à la thérapeutique utilisée pour soigner les cas
d’anorexie mentale. En effet, nous pourrions réfléchir à des thérapies favorisant ce comportement
d’offrande alimentaire pour agir sur la notion de confiance en soi dont les anorexiques souffrent.
Avec l’explication de deux hypothèses évolutionnistes, nous avons montré qu’il était intéressant de
s’ouvrir à différentes perspectives lors de l’étude d’un comportement pathologique tant sur le point de
la compréhension du trouble, que sur la thérapeutique à mettre en place. En effet, la perspective
évolutionniste, dans sa recherche des causes ultimes, met en avant d’autres aspects de l’anorexie
mentale, permettant de porter la réflexion sur différentes ou nouvelles thérapeutiques. Aussi,
l’explication par les causes ultimes est un complément aux approches qui recherchent des causes
plus mécanistes de la pathologie mentale.
Références
Charles B. Crawford, The Theory of Evolution : Of What Value to psychology, Journal of Comparativ
psychology 1989, vol. 103, p.4 – 22.
T. Léonard, C. Foulon, J-D. Guelfi, Trouble du comportement alimentaire chez l’adulte, EMC-
Psychatrie 2, 2005, p. 96-127.
American psychiatric Association, DSM-IV-TR manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux, texte révisé par J.-D. Guelfi et al. 4ème édition, Paris : Masson, 2000, p. 676.
Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Biologie, Adaptation et révision scientifique de R. Mathieu, 2ème
Edition, De Boeck, 2004, p.1252.
M. Crahay, C. Goffinet, Regard croisé sur l’anorexie, Edition Universitaire de Liège, Liège, 2001, p.99
– 100.
La pilosité faciale des hommes expliquée par la sélection sexuelle
D’après le texte de Ritchie, M.G. (2007). Sexual selection and speciation. Annu. Rev. Ecol. Evol.
Syst., 38, 79-102.
Evelyne Antonietti, Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, option anthropologie clinique et
psychopathologie
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Neil!A.!Campbell,!Jane!B.!Reece,!Biologie,!Adaptation!et!révision!scientifique!de!R.!Mathieu,!2ème!Edition,!De!Boeck,!2004,!p.1252.!
5!M.!Crahay,!C.!Goffinet,!Regard+croisé+sur+l’anorexie,!Edition!Universitaire!de!Liège,!Liège,!2001,!p.99!–!100.!

!
3!
A ce jour, parmi les hommes et les femmes, nous remarquons une grande diversité des morphes.
Phénotypiquement, nous constatons des différences : l’homme est plus grand, plus musclé et plus
poilu alors que la femme est moins grande, moins musclée et moins poilue que l’homme. Les
différences de morphes que l’on peut observer entre les hommes et les femmes sont des
dimorphismes sexuels (Darwin, 1871). Ils peuvent porter sur les caractères sexuels primaires, par
exemple les organes génitaux, ou sur les caractères sexuels secondaires tels que la pilosité.
Concernant la pilosité, excepté celle de la zone pubienne, celle des aisselles et des cheveux, nous
notons une différence entre les deux sexes. L’homme est en général plus poilu au niveau du corps
que la femme et possède en principe une barbe (il y a cependant des différences interspécifiques) et
des sourcils plus fournis. En observant la nature, le cas d’hommes parfaitement glabres et de femmes
à barbe est très rare. Il y a des différences de morphes observées entre hommes et femmes qui ne
peuvent s’expliquer par la sélection naturelle (Darwin, 1859). Cette sélection naturelle concerne les
caractéristiques telles que les morphes, sélectionnées pour conférer au porteur un avantage pour
survivre dans son environnement. Pourtant certains morphes, tels que la barbe ou la mâchoire plus
carrée de l’homme n’avantagent pas ou plus sa survie dans l’environnement actuel. Alors pourquoi
peut-on observer encore aujourd’hui certains de ces morphes parmi les hommes et les femmes s’ils
ne résultent pas d’une adaptation à l’environnement ?
Le sujet de ce texte porte plus particulièrement sur la pilosité faciale, c’est-à-dire la barbe (la
moustache est englobée sous le terme de barbe, il ne sera pas question ici de différenciation) pour
tenter de répondre à cette question. D’abord nous allons essayer de comprendre la fonction première
des poils puis sa quasi-disparition jusqu’à nos jours. Ensuite nous tenterons de comprendre la pilosité
faciale de l’homme qui n’a pas ou peu disparu et elle sera placée dans une perspective de la sélection
sexuelle de Darwin pour comprendre sa présence actuelle. Pour finir, nous ferons un lien avec l’effet
de notre culture sur la pilosité.
Si nos ancêtres étaient velus, comme la plupart des singes, nous pouvons nous imaginer que cela
devait être un avantage pour la survie. Les poils protègent la peau et ont une fonction de roulement à
billes aux endroits de frottement de la peau. Ceci explique la raison de la présence de poils sur la
zone pubienne et sous les aisselles encore aujourd’hui. De plus, les poils sont une protection contre le
froid et ont une fonction de transmission d’odeur. Nous pouvons comprendre alors leur avantage en
terme de survie en ces temps reculés quand il n’y avait ni vêtements ni crèmes solaires ni parfums.
Pourquoi ont-ils alors pratiquement disparu avant que ces accessoires soient inventés ? M. Belt
(1874, cité par Darwin, 1871) proposa une explication par le fait que la nudité facilite le repérage de
tiques et autres parasites. Cependant cette explication n’explique pas pourquoi l’homme a gardé une
certaine pilosité comme la barbe. La théorie de la sélection sexuelle (Darwin, 1871) semble pouvoir
apporter une réponse à cette question. La sélection sexuelle concerne la compétition intra-sexe et le
choix d’un partenaire pour la reproduction intra-spécifique. Le choix du partenaire se fait sur des
critères de « beauté » dépendants du temps et du contexte d’une espèce. Ces critères de beauté sont
des morphes qui ont un effet d’attractivité plus ou moins grand sur l’autre sexe. Ils seraient aussi des
indicateurs de supériorité reproductive (M. J. West-Eberhard, 1983) ce qui signifie qu’ils seraient liés à
de « bons gènes » relatifs à la santé. Par exemple, la queue de paon, jugée sur une échelle
d’attractivité par les femelles, est un indicateur de bonne santé et donc de supériorité reproductive.
Les femelles recherchent aussi des mâles qui pourront leur apporter sécurité et ressources
(nourriture, protection, etc.) lors des soins fournis aux petits. Ainsi les morphes des mâles seraient
sélectionnés sexuellement en conférant un avantage dans la reproduction. Les individus porteurs de
ces morphes avantageux auront une meilleure reproduction car ils seront plus choisis par les femelles
que leurs pairs non-porteurs.
En ce qui concerne l’évolution de la pilosité, il semblerait qu’il est apparu à un moment donné une
préférence du côté des hommes pour leur choix d’une partenaire femelle moins poilue (Darwin, 1871).
Lorsqu’une préférence pour un critère de beauté apparaît, le trait sélectionné sexuellement « moins
poilu » tend à s’exagérer (Darwin, 1871 cité par M. J. West-Eberhard, 1983). Ces femmes qui étaient
moins poilues et préférées des hommes eurent un plus grand succès reproductif et leur descendance
hérita du trait « moins poilu ». A leur tour, la descendance femelle et mâle (le trait peut être hérité par
les deux sexes (Darwin, 1871)) fut moins poilue et permis la diffusion du trait dans la population.

!
4!
L’évolution de ce trait tendant à s’exagérer expliquerait pourquoi nous ne sommes plus autant poilus
que ne l’étaient nos ancêtres.
Cependant, les hommes ont gardé une certaine pilosité faciale : la barbe. Dans certaines cultures, la
barbe était sacrée et considérée comme un critère de beauté (H. Ellis, 1925). Comme expliqué ci-
dessus, les critères de beauté sur lesquels se fait le choix du partenaire seraient des indicateurs de
supériorité reproductive. Quelle serait donc le message caché de la barbe ? La barbe apparaît chez
les garçons à la puberté, lors de la maturation sexuelle (Darwin, 1871). Elle est corrélée avec le taux
de testostérone de l’homme (N. Neave, K. Shields, 2008). N. Neave et K. Shields (2008) ont mené
une étude sur les effets de la manipulation de la pilosité faciale des hommes sur la perception des
femmes de l’attractivité, la masculinité et la dominance des visages masculins. Ils ont présenté 15
visages masculins, modulés par un logiciel de morphing, avec cinq niveaux de pilosité (glabre, mal
rasé léger, mal rasé franc, barbe légère, barbe franche) à 60 femmes de 18 à 44 ans (âge moyen
21,7). Elles ont ensuite jugé ces visages sur des échelles d’attractivité, de masculinité et de
dominance. Les résultats sont les suivants : une barbe franche produit l’impression d’un individu plus
âgé, masculin, agressif et socialement mature. Le visage jugé le plus dominant est celui de la barbe
légère. Mais concernant l’attractivité sexuelle, et le désir de liaison à court comme à moyen terme, le
morphe choisi est celui « légèrement mal rasé ». En résumé, la barbe ou sa présence légères serait
un bon indicateur pour le choix des femmes. Recherchant un partenaire ayant de « bons gènes » et
susceptible d’apporter des ressources pour subvenir aux besoins de la famille à venir, les femmes
choisiraient donc de préférence les hommes à barbe, ces derniers leur semblant plus aptes que les
hommes glabres à leur apporter ce qu’elles recherchent. L’évolution aurait donc sélectionné ce
morphe masculin afin d’apporter une aide dans le choix des femmes pour un partenaire.
Dans la mythologie, par exemple, de nombreux dieux sont pourvus de longues barbes. Les barbes
des dieux, incarnant la sagesse, pourraient être un indicateur de leur maturité et pouvoir. De même,
les prêtres égyptiens portaient la barbe comme objet de vénération (H. Ellis, 1925). Mais la culture
occidentale d’aujourd’hui semble passer la barbe de mode. Le poil est devenu un ennemi à éradiquer.
Les publicités pour le rasage sont nombreuses et les mannequins affichent un visage glabre. De plus,
les femmes sont considérées plus attractives par les hommes si elles n’ont pas de poils sur le corps.
Nous pourrions faire l’hypothèse que les hommes rasés paraissent plus jeunes, et qu’ils auraient donc
une meilleure fertilité ou seraient plus vigoureux. Ceux-ci auraient plus de succès auprès des femmes
lors de leur choix de partenaire. Il est difficile de comprendre cet effet de la culture qui influence
l’apparence des hommes et des femmes. Peut-on le considérer comme une évolution normale des
morphes ? Ou comme une influence qui va en contresens de l’évolution naturelle de la sélection
sexuelle ? (ce sujet ne fera pas l’objet de ce texte).
Il pourrait y avoir une autre façon d’expliquer la présence de la barbe chez l’homme. Ce caractère
sexuel dimorphique pourrait avoir une autre utilité que celle de la reproduction. Il permettrait
l’identification intra-spécifique du sexe d’un individu (Wallace, 1878 ; Huxley, 1938 ; Mayr, 1963 ;
Selander, 1972 ; Backer and Parker, 1979 cités par M. J. West-Eberhard, 1983). Celui qui porte une
barbe serait reconnu en tant que mâle et celui qui n’en porte pas, comme une femelle. Bien entendu,
les individus ne se limitent pas à un seul caractère pour identifier le sexe d’un autre individu. Cette
perspective est assez limitée car elle ne prend pas en compte l’effet de la culture qui préconise le
rasage de la barbe.
En conclusion, nous constatons que la théorie de la sélection sexuelle selon Darwin (1871) permettrait
d’expliquer la présence de la pilosité faciale chez les hommes à ce jour. La barbe serait donc un
indicateur de maturité et de dominance pour les femmes. En effet, celles-ci recherchent un partenaire
qui leur procure des ressources et de « bons gènes » contribuant à une descendance en bonne santé.
Cependant la culture semble aller dans un tout autre sens en affichant un idéal masculin sans barbe.
De son côté, la femme n’a pas gardé de pilosité faciale car sa nudité est plus appréciée par les
hommes et valorisée par la culture occidentale actuelle qui bannit les poils mêmes dans les endroits
(pubis et aisselles) les plus nécessaires. Ainsi il se pourrait que dans un futur lointain la pilosité faciale
des hommes disparaisse, elle aussi.
Références
Darwin, C. 1859 (1992). L’origine des espèces. Paris : Flammarion

!
5!
Darwin, C. 1871 (1999). La Filiation de l’Homme et la sélection liée au sexe (3ème ed). Paris : Syllepse.
Ellis, H., (1925). Etudes de psychologie sexuelle - IV : la sélection sexuelle chez l’homme : Toucher –
Odorat – Ouïe – Vision. Paris : Mercure de France.
Neave, N., K., Shields, (2008). The effects of facial hair manipulation on female perceptions of
attractiveness, masculinity, and dominance in male faces. Personality and Individual Differences, 45,
5, 373-377
West-Eberhard, MJ. (1983). Sexual selection, social competition, and speciation. The Quarterly
Review of Biology. 58(2):155-183.
La perception visuelle: Contexte naturel et dispositif expérimental
D’après le texte de Rosenthal, G.G. (2007). Spatiotemporal dimensions of visual signals in animal
communication. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst., 38, 155-178.
Gabrielle Baechler, Maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie, option Psychologie
expérimentale
La perception visuelle comprend plusieurs processus tels l’attention, la détection du mouvement, de la
forme et de la texture ou encore la segmentation de l’image. Rosenthal et al, 2007, font part de la
prépondérance du processus de sélection de l’image dans la perception visuelle de nombreux
animaux. D’après Schaaf et al, 1998, qui ont étudié ce mécanisme chez les macaques, la sélection
visuelle interviendrait de manière précoce dans la chaîne de traitement du stimulus visuel.
A partir de ces énoncés, se formule la problématique suivante: le processus de sélection visuelle se
manifeste-t-il de manière précoce chez le rat qui effectue une tâche expérimentale de reconnaissance
d’objets?
Pour y répondre, il s’agit d’abord de définir les concepts de perception et de reconnaissance. D’après
Donnadieu et al, 2006, la perception visuelle désigne l’ensemble des processus qui permettent à
l’homme et à de nombreux animaux de prendre connaissance du monde qui les entoure; elle s’opère
sur la base des informations que le système visuel transmet à partir des signaux de l’environnement.
Quant à la reconnaissance visuelle, elle définit une identification de l’objet à partir d’une
représentation mentale mise en parallèle avec la perception réelle; elle constitue donc une
particularité de la perception. A ce titre, on peut supposer que la reconnaissance visuelle dispose
d’une partie des processus compris dans la perception et notamment le processus de sélection visuel
dont il est question dans cet exposé.
Afin d’expliquer l’action et l’intervention précoce du processus de sélection dans la perception visuelle,
il convient de faire un bref survol sur le codage de l’information visuelle.
Selon Rosenthal et al, 2007, l’information des signaux visuels est encodée dans des patterns
spatiotemporels qui comprennent des variations de couleurs, de formes et d’intensité à travers le
temps et l’espace. La composante spatiale peut se présenter dans des variations morphologiques
(pelage, plumage...) alors que la composante temporelle comporte des changements d’orientation ou
de posture. Ces dimensions s’expriment en même temps et exercent deux grands rôles dans la
communication animale: se protéger des prédateurs, tel lors du camouflage ou se faire voir, à
l’exemple de la parade nuptiale. Ces deux fonctions prépondérantes semblent donc requérir la
présence d’un mécanisme perceptif de sélection précoce.
Selon ce point de vue et suivant Rosenthal et al, 2007, ce processus de sélection précoce est
prépondérant dans le milieu naturel. Un exemple nous est fourni par les grands ongulés: pour ce
genre de mammifères, les stimuli qu’ils perçoivent précocement sont situés sur le plan horizontal en
raison de l’attaque présumée de leurs prédateurs qui se déroule sur une ligne horizontale. Un autre
exemple nous est donné par les petits rongeurs qui sélectionneraient les stimuli verticaux car leurs
prédateurs sont souvent aériens et fondent sur eux en suivant une ligne verticale. Ainsi, dans ces
deux cas, une sélection visuelle précoce assure la survie.
La recherche expérimentale, qui s’est intéressée à cet aspect du traitement de l’information visuelle, a
pu déterminer que ce processus de sélection précoce est opérée dans le cortex visuel primaire. Selon
Rosenthal et al, 2007, de simples cellules dans le cortex visuel primaire de macaques présentent
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%