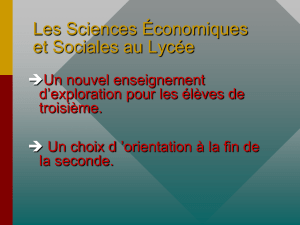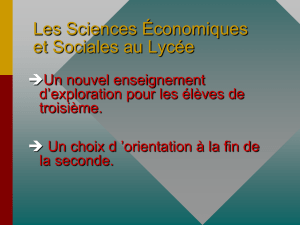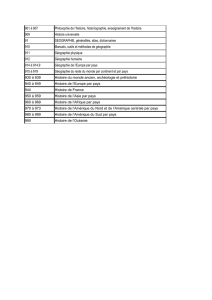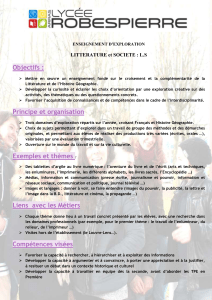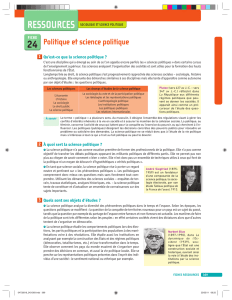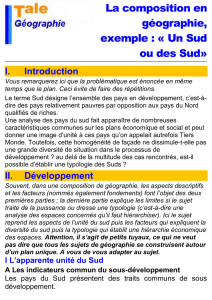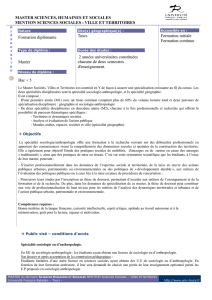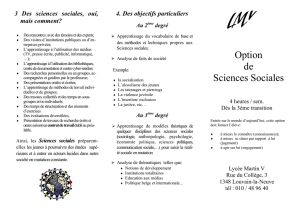III – Problématique, hypothèses et proposition

… l’Acteur en 4 Dimensions
95
III – Problématique, hypothèses et proposition méthodologique
Fait irruption dans notre culture,
qui n’en avait jamais formé d’idée que locale et vague, la nature
Michel Serres
Quelles sont les disciplines qui s’intéressent aux rapports homme-nature ? Aucune en
particulier, plusieurs à petites doses. Anthropologie, économie, géographie, économie et
sociologie en sont quelques exemples, et fondent certains préceptes qui nous guideront
tout au long de notre réflexion, transdisciplinaire donc. Nous posons quatre hypothèses
qui nous aideront à répondre aux questions de départ suivantes : sur le plan théorique,
comment s’articulent rapports social et patrimonial sur un hydrosystème, à l’échelle d’un
territoire ? D’un point de vue pratique cette fois, comment fournir une aide à la
négociation environnementale dans un contexte territorial et multi-acteurs? Une
proposition : l’Acteur en 4 Dimensions, un modèle conceptuel d’analyse qui propose une
nouvelle vision d’un jeu d’acteurs, basée sur les relations humaines (rapport social) et les
relations homme-nature (rapport patrimonial).
1. Ces sciences humaines qui touchent à la nature
1.1. Anthropologie, ethnologie : les prémices des rapports homme-nature
Anthropologie : « ensemble des sciences qui étudient l’homme en société » (Robert). En
anthropologie, l’intérêt pour les relations que les sociétés entretiennent avec les éléments naturels
de leur environnement s’est manifesté de plusieurs façons à travers 1) l’étude de la « culture
matérielle », 2) l’analyse des modes de connaissance des objets et phénomènes naturels en liaison
avec leur utilisation aussi bien technique que symbolique. Dans les années’50, deux figures
dominent l’étude de la culture matérielle, Leroi-Gourhan et Haudricourt. Avant de s’occuper de
leurs dieux, il était d’abord nécessaire de savoir ce que les gens mangent, où ils habitent, comment
ils se vêtent ; et pour cela, il fallait s’intéresser à la façon dont ils prélèvent leurs moyens de
subsistance sur le milieu environnant. En optant très tôt pour la préhistoire, Leroi-Gourhan
s’excluait automatiquement d’une démarche interdisciplinaire portant sur les sociétés actuelles,
mais il fut à l’origine du développement en France des études sur les rapports que les sociétés
préhistoriques entretenaient avec leur environnement. L’influence d’Haudricourt, quoique limitée,
joua néanmoins un rôle décisif dans la promotion de l’interdisciplinarité en ethnologie en suscitant
des doubles formations, sciences de l’homme et sciences de la vie. Lévi-Strauss représente la
troisième personnalité qui joua un rôle dans le développement de l’interdisciplinarité. C’est pour
comprendre les positions des plantes et des animaux figurant dans les mythes que Lévi-Strauss
porta tant d’attention à leurs caractéristiques biologiques, écologiques et comportementales.
L’enseignement de Lévi-Strauss appelle à la nécessité de connaître le milieu dans lequel vit une
société pour comprendre le langage mythique par lequel elle exprime sa conception du
fonctionnement du monde.
Claude Levi-Strauss est le premier à appliquer à l’anthropologie la méthode structuraliste, issue
des linguistes et notamment de Saussure. Une structure consiste en éléments tels que la
modification de l’un entraîne celle de tous les autres. Ce seraient les rapports entre les éléments et
non les éléments eux-mêmes qui définissent la structure (Lévi-Strauss, 1963). Ainsi les pratiques
des hommes relèvent de schèmes qui les rendent intelligibles. C’est en étudiant la praxis mais
aussi les mythes, l’imaginaire que l’on trouve la structure. La structure est alors un système de

Partie 2 : Quatre hypothèses pour un modèle…
96
schèmes conceptuels présents à la fois dans le monde matériel et dans l’idéologie des groupes
sociaux territorialisés (Diméo, 1990).
Pierre Bourdieu adhère aussi à ce courant du structuralisme en proposant de dépasser l’opposition
entre sujet et objet. Il présente l’homme comme ayant à la fois un sens pour lui-même en tant
qu’individu et une signification sociale. Il introduit le concept d’
habitus
qui est le système de
dispositions de chaque individu à percevoir, à sentir, à penser, à agir (Bourdieu, 1980). Pour lui,
les productions humaines se font par un double processus qui met en scène l’individu et l’agent
social et qui serait l’intériorisation de l’extériorité et l’extériorisation de l’intériorité.
Il est possible de relier le structuralisme au
matérialisme dialectique
, un courant philosophique de
la praxis et de l’action humaine. Sa méthode implique la prise en compte et l’analyse des
conditions de vie, des rapports à l’environnement et des évènements quotidiens. C’est à travers la
praxis que le chercheur appréhende les idées et les représentations de l’homme. Entre praxis et
pratique sociale s’intercale toujours un médiateur qui est le schème conceptuel que décrivait Lévi-
Strauss en 1963. Pour celui-ci, le fonctionnement des structures passe par une connaissance des
rapports dialectiques entre le monde matériel et le monde idéel. On cherche à comprendre de
quelle façon s’établissent les relations entre sujet et objet : l’objet influençant le sujet par
accommodation et le sujet façonnant l’objet par assimilation (Diméo, 1990). Ces courants de
pensée représentent un appui théorique dans l’analyse des rapports socio-spatiaux ou socio-
territoriaux.
Ethnologie : « étude théorique des groupes humains » (Robert). Parallèlement, apparaît
l’ethnoscience, un terme utilisé pour la première fois par Murdock en 1950 pour traiter des idées au
sujet de la nature et de l’homme. Aux Etats-Unis, Conklin en 1954 définit l’ethnoscience comme le
fait de « partir des catégories sémantiques indigènes pour étudier la connaissance qu’une société a
de son environnement ». Mais après que l’on eut renoncé à reconstituer les cultures à partir de la
somme des classifications populaires, le terme ethnoscience ne fut plus utilisé que pour désigner
l’étude des modes de connaissances populaires de la nature. L’objectif général de l’ouverture de
l’anthropologie et de l’ethnologie est de mettre en évidence la façon dont les membres des sociétés
étudiées se représentent le fonctionnement de la nature, leur façon de classer les plantes et les
animaux et de comprendre les logiques qui sous-tendent leur mode d’exploitation du milieu.
Mais ni l’anthropologie ni l’ethnologie ne s’ouvrent totalement aux programmes de recherche
pluridisciplinaire. D’abord parce que l’anthropologie semble aspirer à pouvoir traiter les rapports
homme-nature à l’intérieur de son propre domaine. Il est vrai que les enseignements de Leroi-
Gourhan, d’Haudricourt et de Lévi-Strauss n’invitaient pas les chercheurs à amorcer de réels
partenariats avec des collègues de domaines différents, mais les poussaient plutôt à assumer eux-
mêmes une démarche interdisciplinaire. Mauss avait lui aussi débroussaillé les différentes
directions dans lesquelles devait s’engager la recherche, mais en affirmant que son objet demeurait
la société dans sa globalité. L’ensemble de ces personnalités ont affûté les outils et esquissé, en
guise d’hypothèses de travail, des lois permettant de mener à bien cette recherche, mais ils n’ont
pas abordé les sociétés de façon holistique, laissant ce soin à leurs héritiers (Friedberg, 1992).
1.2. L’économie et la nature
Economie : « bonne administration des richesse matérielles » (Robert). Robbins, en 1947, définit
l’économie comme « la science qui étudie le comportement humain en tant que relations entre des
fins et des moyens rares à usages alternatifs ». Malinvaud, en 1975, ajoute que l’économie est « la
science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins

… l’Acteur en 4 Dimensions
97
des hommes vivant en société »
50
. Ciblant deux objets d’étude, que sont la logique de décision
sociale et le système de production et d’allocation de richesses, l’économie a pour objectif de
rendre compte de l’univers de la production et de l’échange de biens et de services individualisés à
partir d’une théorie du choix rationnel (Godard, 1992).
Trois concepts-phares servent de base à l’économie : les agents, les biens et l’utilité ; la
préoccupation centrale étant la recherche de l’efficacité de l’allocation des biens pour atteindre le
niveau le plus élevé possible de bien-être collectif ou de richesse
51
. Encore aujourd’hui, on
distingue plusieurs paradigmes au sein de la discipline : néo-classicisme, keynésianisme,
institutionnalisme ou marxisme. Mais chacun reconnaît que la théorie neo-classique s’est renforcée
comme le modèle dominant. Cependant, depuis les années’70, l’étude d’objets particuliers a donné
naissance à la formation de spécialités, telles l’économie rurale ou l’économie de l’environnement.
L’économie de l’environnement s’appuie sur des concepts tels que :
• ressource naturelle
ou
actif naturel
, désignant des bien non reproductibles (Gordon, 1954)
• bien collectif
ou
bien public
, des biens pour lesquels des actions de consommation successives
sont tantôt possibles, tantôt impossibles (Samuelson, 1954)
• effet externe
lorsque l’action d’un agent affecte la fonction d’utilité d’un autre en dehors d’un
échange volontaire entre eux (Pigou, 1920)
A partir de ces concepts, sont nés divers résultats : des modèles visant à mieux prendre en compte
les conditions imparfaites d’accès à l’information, la notion de valeur d’option liée à la méthode
d’évaluation contingente, des méthodes pour évaluer les actifs naturels, des discussions sur
l’attitude face au risque, à l’économie de l’information, etc... Critiquées tantôt par certains
économistes traditionnels (Poupardin
et al.,
1971), tantôt par des scientifiques s’intéressant à
l’économie (Georgescu-Roegen, 1971 ou Passet, 1979), les bases théoriques de cette nouvelle
économie ne sont pas acceptées par tous et peinent à s’affirmer dans le milieu de la recherche
(Godard, 1992).
En marge de l’économie académique, certaines études abordent les milieux et les ressources en
tant qu’éléments constitutifs de la reproduction économique des groupes sociaux considérés
(Jollivet, 1978). C’est le cas de l’économie forestière (Larrère
et al
., 1986) qui s’est transformée en
une spécialité pluridisciplinaire combinant des approches technique, sociologique, ethnologique,
historique et économique. Sur un autre registre, l’analyse des échecs des stratégies de
développement ont lancé et alimenté la réflexion sur les rapports entre l’environnement et le
développement (Milton & Farvar, 1972 ; Sachs, 1980). Petit à petit, l’économie s’intéresse alors à
des actifs multi-fonctionnels impliquant des aspects non-marchands dans des temporalités de très
long terme. L’un des aboutissements serait dans une économie pluridisciplinaire à dominante
sociologique et anthropologique, pour une tentative de réorganiser l’analyse autour du concept
d’ « écosociosystème » proposé par Ribeill en 1978. Peut-on aller dans ce sens sans toucher au
noyau théorique profond de l’économie ? Cette question se pose toujours de manière controversée.
1.3. Une touche de psychologie
La psychologie de l’environnement met en avant les interactions entre l’homme et son
environnement, entre l’individu et l’aménagement d’espaces. Peu développée en France, elle
connaît un essor important au niveau international
52
. La psychologie de l’environnement s’appuie
50
La nature intervient ici par les contraintes qu’elle impose à la liberté de comportement des agents.
51
L’optimum de Pareto désigne une allocation des biens telle qu’il ne soit pas possible de la modifier sans
porter atteinte au bien-être d’un agent.
52
Notamment au travers de deux réseaux : International association for people-environment study (IAPS) et
Red de psicologia ambiental latinoamerica (Repala).

Partie 2 : Quatre hypothèses pour un modèle…
98
sur des modèles appelés
transactionnistes
, lesquels relient systématiquement acteurs et contexte.
L’individu est alors proposé comme un système intégré à l’environnement. Les psychologues
analysent par exemple les processus permettant d’élaborer des représentations cognitives de
l’espace, se penchent sur les représentations de la ville, de l’habitat, des atouts et des défauts des
territoires, et en dressent ensuite des cartes mentales de l’espace qui renseignent sur la lisibilité
des lieux et la pertinence de leur configuration (Vaillancourt, 2005). La psychologie sociale est
également mobilisée dans la réalisation de sondages sur l’acceptabilité environnementale.
Des psychologues américains, comme Harold Prohansky, ont notamment étudié le phénomène du
crowding
, soit le sentiment d’entassement dans des espaces limités. En France, Abraham Moles a
eu une grande influence avec sa
Psychologie de l’espace
53
. Selon Moles (1995), la compréhension
des relations que l’homme entretient avec l’espace qui l’entoure est régie par la loi
proxémique issue de la psychologie de l’espace : « tout ce qui est proche (ici et maintenant) est
pour moi plus important que ce qui est lointain (ailleurs, autrefois et plus tard) ». Il existe ainsi
trois types de relations fondamentales en occident :
- l’absence de relation
: les archétypes pour les terriens occidentaux pourraient être le désert,
l’océan, la forêt tropicale ;
- l’identité d’un lieu
: lieu clos difficilement accessible aux autres, lieu où se concentre la majorité
des activités et biens de l’individu, lieu bénéficiant d’une dénomination précise et reconnue par
tous ;
- l’appropriation du lieu
: lieu qui dispose non seulement d’une identité mais qui en plus est le mien
pour de nombreuses raisons qui dépassent la notion de propriété juridique […] cette
appropriation peut se faire selon deux comportements : l’
enracinement
quand un individu
s’installe en un lieu qui devient le barycentre de sa vie, autour duquel il développe des lieux
secondaires (travail, loisir), avec entre les deux les espaces traversés ayant moins de valeurs ; et
l’
errance
qui se caractérise par des fréquences de passage à travers un territoire donné et qui
peut développer chez celui qui la pratique un degré de connaissance de ce territoire aussi précise
que chez les enracinés, sans pour autant qu’il y attache de la valeur.
Dès lors, certains lieux du territoire, certaines entités peuvent faire l’objet de sentiments
d’attachement ou d’appartenance. A l’inverse, d’autres lieux pourraient être l’objet de sentiments
d’éloignement, de détachement.
Pour étudier les représentations des individus, les psychologues se basent sur ce que Simon
appelle la
rationalité procédurale,
qu’il différencie de la
rationalité substantive
. Un comportement
est rationnel de manière procédurale quand il est le résultat d’une réflexion appropriée ; un
comportement est substantivement rationnel quand il est en mesure d’atteindre des buts donnés
(Simon, 1982). A l’origine et par définition, la rationalité ne dépend de l’acteur que d’un seul point
de vue : ses buts (Gould & Kolb, 1964). Si l’économie est surtout axée sur la rationalité
substantive (les résultats), la psychologie s’intéresse particulièrement à la rationalité procédurale
(le processus) et cherche à décrypter les
processus cognitifs
, les
processus intellectifs
selon
l’expression de James
54
. Historiquement, trois directions principales ont guidé la recherche
psychologique sur les processus cognitifs : l’apprentissage, la résolution de problèmes et
l’élaboration de concepts.
Pour la plupart des problèmes que l’homme rencontre dans le monde réel, aucune procédure ne lui
permet de découvrir la solution optimale même si la notion d’
optimum
est bien définie, les
capacités de l’homme pour traiter l’information étant relativement modestes face à l’énorme
53
Avec Elizabeth Rohmer (1972).
54
James W. (1890) Principles of psychology.

… l’Acteur en 4 Dimensions
99
complexité du monde. Et l’homme se retrouve très vite en dehors de l’espace de rationalité
substantive
computable
. S’intéresser à la rationalité procédurale des individus face à un contexte
de risque et d’incertitude, c’est trouver des procédures efficaces pour proposer de véritables
solutions aux problèmes concrets de prise de décision. Ainsi en est-il de l’heuristique du joueur
d’échecs pour une recherche sélective et pour ses connaissances encyclopédiques des schémas
significatifs, qui sont à la base de sa rationalité procédurale quand il choisit de déplacer une pièce.
L’esprit humain peut acquérir une grande variété de compétences, de modèles de comportements,
de répertoires pour résoudre les problèmes et les habitudes de perception (Edwards, 1968). Mais
tous ces éléments dépendent de ce que l’individu a appris, des expériences qu’il a faites. Une
rationalité substantive ne peut s’appréhender que dans des situations très simples ; dans toutes les
autres situations, l’esprit humain utilise les informations imparfaites qu’il possède, simplifie et se
représente la situation comme il peut. C’est alors la rationalité procédurale qui guide
intuitivement
les comportements des individus dans des situations complexes, risquées, incertaines (Simon,
1982). Les nouvelles interrogations, notamment environnementales, concentrent l’attention sur de
nouveaux phénomènes empiriques, et leur explication réclame en retour une compréhension des
processus à la base de la rationalité humaine.
La psychologie de l’environnement s’intéresse aux relations entre les individus et leur
environnement en se basant le plus souvent sur l’étude des rationalités procédurales. Ce champ
disciplinaire, et notamment la
psychologie de l’espace
, offre une base riche et pertinente pour
l’étude des rapports homme-nature.
1.4. La géographie s’environnementalise
a. s’ouvrir aux liens entre espaces et peuples
A l’origine, la géographie est descriptive, empirique et encyclopédique pour faire connaître la terre
et ses régions. Puis elle devient science humaine au XIXè, notamment grâce à deux auteurs. Rittel
d’abord en 1836 présente une réflexion
déterministe
de la discipline qui insiste sur l’influence du
milieu physique dans l’histoire des peuples. Ratzel ensuite en 1897, à l’origine du courant
environnementaliste
de la géographie, tente de préciser les lois physiques qui déterminent les
distributions de l’espèce humaine. Puis, au début des années 1900, des chercheurs comme Vidal de
la Blache développent la thèse du
possibilisme
, laquelle statue qu’il n’y a pas de nécessité
déterminante dans le milieu géographique, mais partout des possibilités que l’homme, maître de
son choix, va ou non utiliser.
La géographie s’est ainsi consacrée assez tôt à l’étude de l’homme et de son environnement. A la
fin du XIXè siècle, Elisée Reclus définissait l’environnement comme un milieu biophysique
aménagé. La géographie accepte le lien entre discours sur la nature et discours social et rejette la
fausse opposition géographie humaine- géographie physique, sciences dures – sciences molles. La
géographie veut aborder les questions d’environnement dans un contexte humain à travers une
analyse claire de grands concepts explicatifs qui lient approches physiques et humaines (George,
1970). Aujourd’hui, la géographie de l’environnement se préoccupe particulièrement
d’aménagement des territoires, qu’il s’agisse d’un quartier, d’une ville, d’un continent.
Déforestation ou changements climatiques, épuisement des ressources halieutiques ou ferroutage,
la géographie de l’environnement s’intéresse à une diversité de thèmes, toutes échelles
confondues.
Pour appréhender les relations homme-nature, on s’appuie sur la géographie comportementale qui
privilégie l’étude des représentations et de l’imagination pour expliquer l’influence des processus
cognitifs sur la connaissance et les pratiques spatiales (Bailly, 1992). La géographie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%