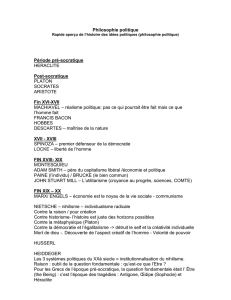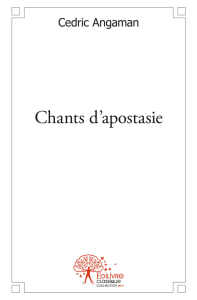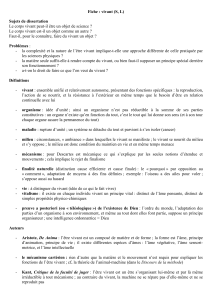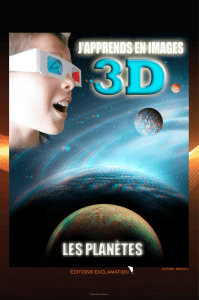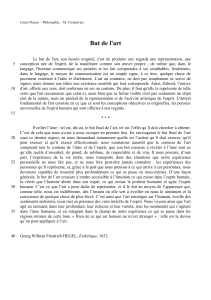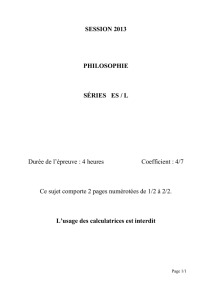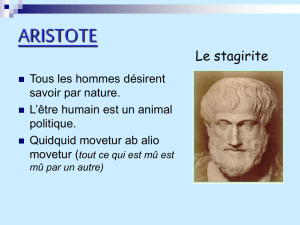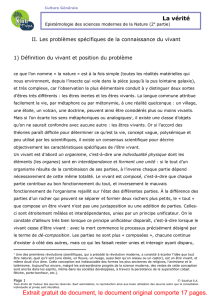Contrôler le pouvoir de la musique: la censure

Contrôler le pouvoir de la musique: la censure dans l'anquité
Gravure (Gaffurius, 1492) montrant Pythagore et ses découvertes musicales
Lorsque l'on parle de « censure musicale », on pense avant toute autre chose aux
interdits ayant touché le jazz, à « l'art dégénéré » du régime Nazi ou encore à l'art sous
Staline, soit autant de situations du 20e siècle. Pourtant, la musique a été soumise à l'interdit
depuis bien plus longtemps ; déjà dans l’Antiquité, des cas de censure peuvent être relevés.
Car l’idée que la musique a une influence physique et psychique sur notre monde est très
ancienne. Dans l’Ancien Testament, on trouve des exemples éloquents : les trompes détruisant
les murs de Jéricho, David guérissant Saül de sa mélancolie en jouant de la harpe, ou bien
encore Elisée qui prophétisait plus facilement lorsque l’on faisait venir un harpiste.

Dans la tradition philosophique grecque, la légende veut que Pythagore (VIe siècle
avant J.-C.), étant passé à côté d’une forge, constata que les marteaux qui frappaient
simultanément le fer produisaient des sons harmoniques les uns par rapport aux autres. Il
inspecta ensuite ces marteaux et remarqua qu’ils avaient des poids mathématiquement
proportionnels les uns aux autres. Il appliqua ensuite cette découverte à des cordes tendues par
des poids dans les mêmes rapports et engendra ainsi des accords harmoniques. Il s’aperçut
alors qu’en touchant une de ces cordes, les autres vibraient aussi sans avoir été touchées. Ce
phénomène de vibration sympathique des cordes lui a offert un modèle réduit pour expliquer
tous les mécanismes gouvernant le monde. Tout ce qui pouvait être interprété en termes de
relations s’est vu ramené à un problème d’harmonie ou de discordance : les sons d’un
intervalle, les écarts des ramifications d’une plante, les mouvements des astres, en passant par
la magie, l’amour et la poésie. Tout était en relation, tout était nombre.
De même, pour Pythagore, le corps et l’âme étaient des harmonies, réagissant par
sympathie avec le monde qui les entoure. Le tempérament de l’esprit était une harmonie
d’éléments contraires tels la colère, le flegme ou la mélancolie ; si un déséquilibre se
produisait dans l’âme et qu’elle tendait trop vers un de ces éléments, la médecine
pythagoricienne enseignait qu’on pouvait rétablir l’équilibre psychique en lui faisant entendre
la mélodie adéquate. Or, si la musique pouvait servir à guérir un déséquilibre, elle pouvait
aussi le provoquer. La musique, entrant en résonance directe avec l’âme, pouvait l’influencer
de façon considérable en la conduisant à la joie comme à la tristesse, en passant par tout le
panel émotionnel. L’auditeur ne pouvait donc pas s’en protéger et était à la merci de la
musique, tel Ulysse enchanté par les sirènes. Comme nous n’avons malheureusement pas de
traces écrites des dires de Pythagore, ces idées nous ont été retransmises essentiellement par
des documents rédigés par ses élèves, les pythagoriciens.
Pour Platon et Aristote (Ve - IVe siècle avant J.-C.), il s’agissait de limiter ce pouvoir
énorme qu’avait la musique par la raison. Ils argumentaient qu’il existait une hiérarchie entre
l’âme et le corps ; l’âme, le siège de la raison, se situait au-dessus et régulait le corps, le siège
des émotions. Si on se laissait aller à ses émotions, sans les contrôler par la raison, on se
retrouvait au même rang qu’un animal. D’après eux, le texte, parlant à l’âme, se retrouvait
hiérarchiquement supérieur à la musique, qui, elle, parlait seulement au corps. A ce titre,
Aristote rejetait l’aulos, une sorte de flûte double typique de cette époque, qui « […] n'est pas
un instrument moral ; elle n'est bonne qu'à exciter les passions, et l'on doit en limiter l'usage
aux circonstances où l'on a pour but de corriger plutôt que d'instruire. Ajoutons que la flûte
possède, en fait, un inconvénient en complète opposition avec sa valeur éducative : c'est
l'impossibilité de se servir de la parole quand on en joue. » (Aristote, La Politique, livre VIII,
chap. 6, § 5). Selon lui, la plus grande faute de cet instrument était d’empêcher la parole
pendant que l’on en jouait, à l’inverse de la cithare qui, elle, accompagnait le chant poétique.
L’aulos, associé au rite dionysiaque, n'était donc toléré que dans la tragédie, un spectacle issu
du culte à Dionysos qui avait une valeur cathartique aux yeux des théoriciens.
Pour Aristote et Platon, la musique est nombre, et à ce titre elle s'adresse à la ratio
plutôt qu'aux sens uniquement. Ainsi, le véritable musicien devait écouter les nombres plutôt
que les sons. Les intervalles purs étaient favorisés (octave, quinte, quarte), car

mathématiquement simples. En dehors des instruments, tout était normé ; les rythmes et les
mélodies devaient suivre des schémas préétablis précis. Les virtuoses étaient bannis, « [...]
car, dans cette éducation, l’élève ne cultive pas l’art musical en vue de son propre
perfectionnement, mais pour le plaisir des auditeurs, et plaisir de bas étage. C’est pourquoi
l’exécution d’une pareille musique est indigne de l’homme libre et convient plutôt à des
mercenaires […] » (Aristote, La Politique, livre VIII, chap. 6, § 6).
Mais est-ce que le public pensait de la sorte, ne voyant dans l'art musical qu'un outil
pour l'élévation et le soin de l'âme et du corps ? Timothée de Milet (Ve - IVe siècle avant J.-C.)
osa briser les cadres établis ; il rajouta une quatrième corde à sa lyre, ce qui lui permit de
jouer des mélodies plus complexes, et il composa des pièces avec des rythmes différents et
dans lesquelles il modulait. Ces nouveautés firent scandale : il se fit retrancher sa corde
supplémentaire, éjecter de Spartes et huer à Athènes par plusieurs poètes. Cependant, le public
le porta rapidement aux nues et il gagna par la suite de nombreux prix de concours, montrant
que l’opinion des philosophes n’était pas forcément partagée par tous.
Vers le IVe siècle avant J.-C., un philosophe grec disciple de Socrate, Artistoxène de
Tarente, chercha à s’éloigner du modèle pythagoricien qui jaugeait tout en termes de pureté
numérique. Il écrivit de nombreux livres sur l’harmonie et la musique dans lesquels il
soutenait qu’il fallait juger les notes non pas avec des rapports mathématiques, mais par la
sensation auditive qu’elles produisaient. Pour la première fois dans l’Histoire, il fonda une
science musicale indépendante des mathématiques qui se basait seulement sur la perception
auditive.
Nicolas Matthes, étudiant en 3e année de Bachelor d'histoire
Remerciements à Brenno Boccadoro pour son aide précieuse en la matière.
Pour en savoir plus :
BOCCADORO, Brenno, «Le corps et l'esprit de la musique grecque», in: A l'écoute de
l'Antiquité, Musée d'Art et d'Histoire - Faculté des Lettres, Genève, 1996.
BOCCADORO, Brenno, «Forme et matière dans la théorie musicale de l’Antiquité Grecque»,
in: E. Darbellay, ed., Le temps et la forme. Pour une épistémologie de la connaissance
musicale. Genève, 1998, pp. 221-252.
DARRIULAT, Jacques, Platon : Philosophie et musique :
http://www.jdarriulat.net/Auteurs/Platon/PlatonMusique.html
1
/
3
100%