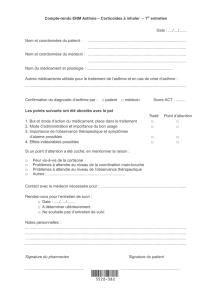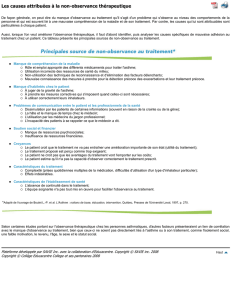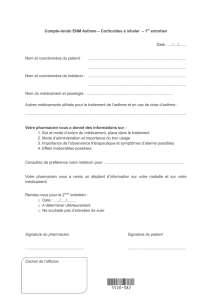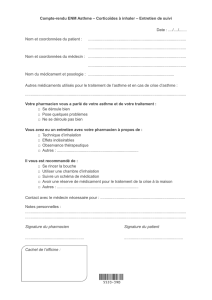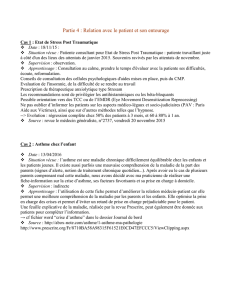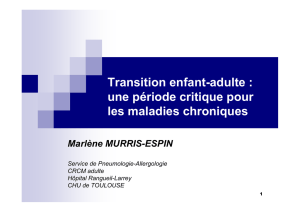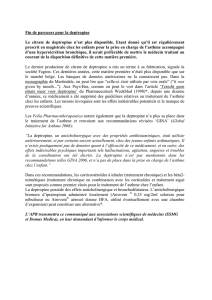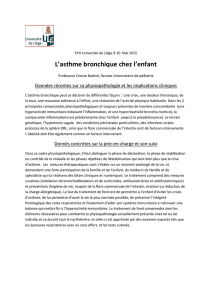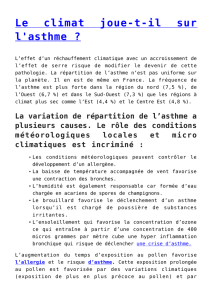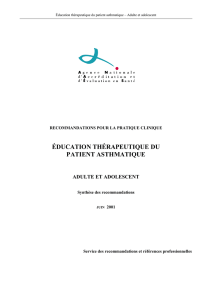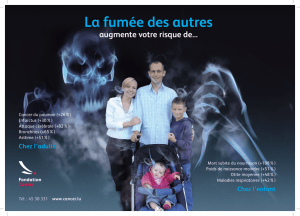La crise (d`asthMe !) de L`adoLescence Sa prise en charge

PNEUMOLOGIE
ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 25
LA CRISE (D’ASTHME!)
DE L’ADOLESCENCE
Sa prise en charge
L’asthme est la maladie chronique pédiatrique la plus
fréquente en Europe avec une prévalence qui a augmenté
considérablement au cours des 20 dernières années et plus
particulièrement chez l’enfant. Les dernières enquêtes nationales montrent une prévalence cumulée de l’asthme de
plus de 10 % chez l’enfant âgé d’au moins dix ans et une prévalence de l’asthme actuel de 6 à 7 % chez l’adulte (1). De
nombreuses études le montrent : l’asthme est moins bien contrôlé à l’adolescence que chez l’enfant plus jeune et à
l’âge adulte. Comment l’expliquer ? Causes physiologiques ? Psychologiques ? Environnementales ? Phase nécessaire
au passage dans le monde des adultes ? L’objectif de cette revue est d’examiner les caractéristiques ainsi que dié-
rents aspects de la prise en charge de l’asthme de l’adolescent.
L’ASTHME DE
L’ADOLESCENT EST-IL
TOUJOURS DE L’ASTHME ?
L’asthme est à la fois sous-diagnos-
tiqué et diagnostiqué par excès chez
l’adolescent. L’erreur de diagnostic
est particulièrement fréquente chez
les adolescents qui se présentent
avec une toux ou des symptômes à
l’exercice (2). Les gênes à l’effort de
l’adolescent sont en effet bien plus
souvent des limitations physiolo-
giques à l’effort, plus particulière-
ment lorsqu’ils sont en surpoids ou
lorsqu’ils ne pratiquent pas d’acti-
vités physiques régulières. Dans
l’étude de la cohorte de l’Île de
Wight, les siffleurs non asthmatiques
représentent 22 % des siffleurs à
l’âge de 18 ans. Ils ont des fonctions
pulmonaires normales, peu d’hyper-
réactivité bronchique et sont moins
allergiques. Les auteurs concluent
que ces sifflements non asthmatiques
sont fréquents chez les adolescents
et sont associés au tabagisme et à la
prise de paracétamol (3). La prépon-
dérance des symptômes respiratoires
dans les crises d’anxiété qui par-
tagent beaucoup de symptômes avec
la crise d’asthme quand elle n’y est
pas associée rend parfois difficile la
distinction entre les deux. Ces simi-
litudes pourraient être expliquées
d’une part par une hypersensibilité
des chémorécepteurs au monoxyde
de carbone, mais également par
un conditionnement peur-dyspnée
identique (2).
LE DÉSÉQUILIBRE
DE L’ASTHME
À L’ADOLESCENCE
L’enquête décennale Santé 2003 de
l’Institut national des statistiques
et des études économiques (Insee)
(France métropolitaine) montrait
que la prévalence de l’asthme ac-
tuelle (dans l’année écoulée : siffle-
ments chez un enfant ayant déjà eu
des crises d’asthme ou traitements
pour sifflements ou asthme) était de
près de 9 % en troisième. Parmi les
598 adolescents asthmatiques de troi-
sième, 38,5 % avaient un asthme non
contrôlé (au moins 4 crises, 1 réveil
par semaine, 1 crise grave, 4 consul-
tations en urgence ou 1 hospitalisa-
tion dans l’année écoulée) et 29,2 %
ne prenaient pas de traitement anti-
inflammatoire malgré l’absence de
contrôle de leur asthme (4). Les ado-
lescents asthmatiques ont une mor-
bidité et une mortalité augmentées.
Alors que l’autonomisation pourrait
permettre d’améliorer le contrôle de
l’asthme et donc sa morbidité, elle
va, au contraire, de pair avec une
baisse habituelle de la compliance
thérapeutique.
L’ÉVOLUTION DE L’ASTHME
EST-ELLE DIFFÉRENTE
CHEZ LA FILLE ET LE
GARÇON ?
Les garçons préadolescents ont une
prévalence augmentée des siffle-
ments et de l’asthme par rapport aux
filles. Cependant, à l’adolescence,
ce rapport s’inverse avec une pré-
valence des symptômes évocateurs
d’asthme plus élevée et des crises
Pr Ralph Epaud, Dr Christine Fourmaux,
Service de Pédiatrie,
Centre hospitalier intercommunal de Créteil

PNEUMOLOGIE
26 ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7
plus sévères chez la fille (4). Dans
l’étude de Delmas, la prévalence cu-
mulée de l’asthme était plus élevée
chez les garçons que chez les filles
(4). Avant la puberté, la prévalence
des sifflements dans les 12 derniers
mois était plus élevée chez les gar-
çons. Après la puberté, la prévalence
des symptômes évocateurs d’asthme
était plus élevée chez les filles.
L’implication du statut hormonal a
été proposée comme explication,
comme en témoigne l’observation
que les femmes avec des ménarches
précoces ont une fonction respira-
toire plus altérée et une incidence de
l’asthme plus élevée à l’âge adulte. Il a
également été montré que l’intensité
des symptômes respiratoires variait
au cours du cycle, plus importante
aux phases lutéale et folliculaire et
moins importante juste avant l’ovu-
lation (2).
IMPACT DU SURPOIDS
L’obésité, comme le surpoids, est
en augmentation dans le monde et
est particulièrement problématique
pour les adolescents. Si l’obésité est
associée à l’asthme, son impact plus
précis est moins évident chez l’ado-
lescent. Par exemple, bien que le
pourcentage d’enfants en surpoids
semble plus élevé dans l’asthme
sévère, son impact sur la sévérité de
l’asthme est discordant dans la litté-
rature. Chez les filles, l’obésité joue
un rôle sur le contrôle de l’asthme en
augmentant la fréquence des symp-
tômes et des exacerbations. Chez
l’adolescent, le surpoids impacte sur-
tout la qualité de vie et la réponse au
traitement. van Gent a montré que la
qualité de vie était diminuée de 25 %
chez des enfants asthmatiques en
surpoids contre 14 % pour un asthme
seul et 1% pour un surpoids isolé (5).
Il a également montré qu’une aug-
mentation de 1% de l’IMC entraînait
une diminution de la réponse au trai-
tement mesurée par l’évolution du
rapport de Tiffeneau et la réponse aux
β2-mimétiques.
L’OBSERVANCE
À L’ADOLESCENCE
L’observance est « l’action d’observer
une prescription, une coutume, de se
conformer à une règle de conduite »
(Larousse). C’est le respect des ins-
tructions et des prescriptions du
médecin. Appliquée à l’asthme, l’ob-
servance thérapeutique correspond
à l’ensemble des comportements de
santé qui sont observés par le patient.
L’adhésion thérapeutique est une
autre dimension puisqu’elle indique
que le patient est partie prenante de
son traitement. Comme dans toutes
les maladies chroniques, l’obser-
vance est souvent inadéquate dans
l’asthme. De plus, l’observance réelle
doit tenir compte de l’utilisation op-
timale du dispositif. Elle est de l’ordre
de 50 % chez l’enfant. L’observance
vraie, qui tient compte de l’utilisa-
tion adéquate du dispositif d’inha-
lation (nébulisation ou chambre
d’inhalation) est encore plus faible
(6). L’observance diminue avec l’âge.
Elle est plus élevée chez le nourrisson
et le jeune enfant : 77 % dans l’étude
de Gibson (7) et 75 % dans l’étude de
Butz (8). Elle est de l’ordre de 30 %
chez l’adolescent, encore moins
bonne que chez l’adulte (30 vs 57 %)
(9). L’inobservance concerne tous les
degrés de sévérité de l’asthme et les
patients les moins observants sont
ceux dont l’asthme est le moins bien
contrôlé. L’inobservance est associée
à une augmentation de la consom-
mation de corticoïdes par voie orale,
à la fréquence du recours aux soins et
à l’absentéisme scolaire. Dans un sui-
vi prospectif de 3 ans, le contrôle des
symptômes et des débits de pointe
était associé à la compréhension du
mode d’action des médicaments et à
la prise des doses prescrites (10).
Dans une étude récente (11), des
adolescents ont rapporté que la ma-
ladie asthmatique avait un impact
sur leur bien-être et sur leurs inter-
actions avec les autres. Dans cette
étude, les principaux points attachés
à une mauvaise observance étaient
communs à beaucoup de maladies
chroniques :
• la sensation de l’enfant d’être perçu
comme différent, marginalisé par
rapport à ses camarades ;
• l’ambivalence concernant l’inter-
vention parentale, à la fois attendue
et rejetée ;
• la limitation dans leurs activités ;
• les contraintes liées aux traite-
ments (horaires et nombre de prises
essentiellement).
La non-observance peut être aussi
l’expression d’un mal-être et amener
à une prise en charge psychologique
spécifique. Il existe aussi des mouve-
ments de déni, l’adolescent mettant à
distance sa maladie en ne la prenant
pas en charge.
LE RÔLE DE LA FAMILLE
ET DES PROCHES
L’adolescence entraîne des change-
ments profonds dans le fonctionne-
ment cognitif et dans la vie relation-
nelle. L’adolescent est pris entre son
désir naturel d’autonomie et les exi-
gences de son traitement. Les pairs
prennent une importance prépondé-
rante tandis que les conflits familiaux
ou les simples difficultés de commu-
nication ont tendance à s’acutiser. Les
parents assurent cependant toujours
une bonne partie de la prise en charge
de la maladie de leur enfant (surveil-
lance du traitement, prise et rappel
des rendez-vous, etc.) et c’est au mé-
decin de travailler l’autonomisation
progressive de son patient.
La bonne qualité des relations fami-
liales permet de résoudre de nom-
breux problèmes pratiques et favorise
l’observance. Le climat émotionnel
familial a été montré, lorsqu’il est dys-
fonctionnel, comme pouvant affecter
la sévérité de l’asthme ou favoriser le
déclenchement des crises. Le fonc-
tionnement familial est également
associé à la qualité de la relation pa-
tient/soignant et à l’observance thé-
rapeutique dans les asthmes sévères.
Les adolescents dont les parents ont
un degré élevé d’estime d’eux-mêmes

La crise (d’asthme!) de l’adolescence
ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 27
sont décrits par les médecins comme
étant capables de former facilement
une alliance avec les soignants. La
qualité de la relation entre parents
et adolescents apparaît donc comme
essentielle à une bonne prise en
charge de l’asthme. De même, des
relations amicales de bonne qua-
lité influencent favorablement la
construction de l’identité, l’image
de soi, l’adaptation psychologique et
l’adhérence au projet thérapeutique.
Une difficulté à assumer son asthme
au quotidien est associée à une
mauvaise observance. L’adolescent
peut également délibérément choisir
de ne pas prendre son traitement pour
éviter d’être interrogé sur son asthme
et d’être ainsi stigmatisé. Les patients
exprimant le moins de difficultés vis-
à-vis de leur maladie vont parler plus
facilement du contrôle de leur asthme
et vont exprimer moins de gêne vis-à-
vis de leurs camarades, ce qui aura
comme conséquence un comporte-
ment plus adapté et indépendant vis-
à-vis de leurs traitements.
ASPECTS
PSYCHOLOGIQUES
DE L’ADOLESCENT
ASTHMATIQUE
De nombreux problèmes de santé
mentale apparaissent à l’adolescence
et il est important de comprendre
l’impact du fonctionnement psycho-
logique de l’adolescent asthmatique.
Les adolescents souffrant d’asthme
sont à risque accru d’anxiété et/ou
de dépression. Ces comorbidités
peuvent être associées à un mau-
vais contrôle de l’asthme, à une
mauvaise observance, à une qualité
de vie réduite et enfin à une morbi-
dité plus élevée. Environ un tiers des
adolescents asthmatiques souffrent
d’un trouble anxieux. Les adolescents
souffrant d’asthme ont un taux d’ago-
raphobie augmenté par rapport à des
témoins sains du même âge (7,5 % vs
3,4 % vs 0,5 %, respectivement (12).
Des études rapportent comme pos-
sibles facteurs de risque de troubles
anxieux chez l’adolescent asthma-
tique : le sexe féminin, le tabagisme
actif, le fait de vivre dans une famille
monoparentale et un diagnostic ré-
cent de l’asthme (12).
Alors que la prévalence des troubles
anxieux dans cette population
semble liée à des facteurs compor-
tementaux et socio-économiques,
plusieurs études ont montré que
l’anxiété n’est probablement pas liée
à la gravité d’asthme. Entre 20 et 50 %
de symptômes dépressifs importants
seraient rapportés chez l’adolescent
asthmatique et une méta-analyse ré-
vèle une prévalence de la dépression
de 27 %, ce qui est plus du double de
celui des adolescents sans asthme
(13). Les symptômes dépressifs, tant
au sein de cette population et dans la
population générale d’adolescents,
semblent surtout liés à d’autres
troubles comportementaux, tels que
les comportements à risque, le taba-
gisme et la toxicomanie. Les troubles
de l’humeur chez l’adolescent ou
ses parents ont été montrés comme
associés à une augmentation des
symptômes de l’asthme et de l’ab-
sentéisme scolaire (2). La maladie
asthmatique et sa prise en charge
au quotidien peuvent contribuer à
l’apparition de troubles anxieux ou
dépressifs pouvant exacerber les
symptômes d’asthme. Le caractère
chronique, mais également imprévi-
sible de l’asthme est anxiogène chez
l’adolescent, pouvant entraîner des
manifestations somatiques liées à
cette anxiété ou dépressives, surtout
si elles s’associent à des interven-
tions médicales ou des hospitalisa-
tions répétées. L’essoufflement, un
symptôme majeur des attaques de
panique, peut conduire à une hy-
perventilation et aggraver la bron-
choconstriction. Inversement, une
diminution de la perception des
prodromes de la crise a été montrée
comme pouvant augmenter le risque
de crise d’asthme sévère. Les syn-
dromes dépressifs sont-ils la consé-
quence de l’asthme chez l’adolescent
comme semble le montrer l’étude de
Bender ? Une autre approche est de
considérer que la dépressivité, plus
fréquente chez l’adolescent, entraîne
une diminution de l’observance et/
ou une majoration de l’inflammation
avec comme conséquence un moins
bon contrôle de l’asthme.
LE TRAITEMENT
DE L’ASTHME
DE L’ADOLESCENT
OU COMMENT AMÉLIORER
L’OBSERVANCE
Le but du traitement de l’asthme,
qui est d’obtenir un contrôle optimal
avec un traitement minimum, prend
tout son sens dans la prise en charge
de l’adolescent. L’amélioration de
l’observance nécessite donc d’agir
tout au long de la chaîne de soins,
d’une part au moment de la consul-
tation et d’autre part, parfois, dans
des structures spécialisées d’édu-
cation thérapeutique. La consulta-
tion est un moment important dans
la mise en place du lien patient-
soignant. Elle doit se faire en trois
temps : le premier, avec les parents,
permet d’avoir un ressenti sur l’évolu-
tion de l’asthme avec le point de vue
du patient, mais également avec celui
des parents (ce qui permet souvent
d’en mesurer l’écart !). Ce premier
temps permet également d’évaluer
de part et d’autre la connaissance du
traitement et de se faire une idée de
l’observance. Le deuxième se fait avec
« La non-observance peut être aussi
l’expression d’un mal-être et amener à une
prise en charge psychologique spécifique. »

PNEUMOLOGIE
28 ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7
l’adolescent seul, ce qui permet d’une
part de recueillir certaines informa-
tions plus “confidentielles” (taba-
gisme, addictions, contraception,
etc.), d’autre part c’est l’occasion de
renforcer le lien avec l’adolescent
dans une relation privilégiée, parfois
complice, en ne restant pas centré
sur la maladie, de le responsabiliser
sans le juger et de favoriser une auto-
nomisation progressive. Le troisième
temps se fait en présence des parents,
avec les éventuelles modifications
du traitement (essai des traitements
en présence des parents) et l’élabo-
ration du Plan d’action personna-
lisé écrit (PAPE), essentielle même
à cet âge. L’implication des parents
dans la délivrance du traitement est
importante pour l’observance. Ainsi,
même si les adolescents recherchent
une autonomie, ils éprouvent un
soulagement lorsque les parents
leur rappellent de prendre leurs
traitements (11).
D’une façon générale, la simplifi-
cation du traitement de fond est
un bon moyen d’améliorer l’obser-
vance. Au-delà de deux prises quo-
tidiennes, l’observance diminue
fortement : 18 % d’observance pour
un traitement en quatre prises par
jour, 34 % en cas de trois prises par
jour et 71 % en cas de deux prises par
jour. L’augmentation du nombre de
molécules prescrites sur une ordon-
nance nuit à l’observance. Lorsque
le traitement d’un enfant néces-
site le recours à une corticothéra-
pie inhalée et un bronchodilatateur
de longue durée d’action, la forme
combinée améliore l’observance en
multipliant par plus de 3 le nombre
de jours où le traitement est cor-
rectement pris (2). Les traitements
corticoïdes à très longue durée
d’action (mométasone, ciclésonide)
en une prise peuvent être envisagés
bien qu’aucune donnée ne permet
de dire pour l’instant si la mono-
prise améliore encore un peu plus
l’observance en comparaison à deux
prises par jour. Lorsque l’observance
est médiocre, une autre stratégie de
traitement, la stratégie SMART (en an-
glais Single Inhaler Maintenance and
Reliever Therapy), avec un seul inha-
lateur et la combinaison formotérol-
budésonide peut être parfois pro-
posée. Le traitement d’entretien
(contrôle de l’inflammation) 2 fois
par jour est associé à des doses ad-
ditionnelles quand un traitement
supplémentaire ou plus aigu devient
nécessaire. Ce traitement est pos-
sible, car le formotérol agit très
rapidement pour dilater les voies
respiratoires tout en soulageant
les symptômes sur une période
prolongée (jusqu’à 12 h), par la
bronchodilatation, et parce qu’on
peut l’utiliser sans danger à des
doses plus élevées pouvant atteindre
72 µg par jour, soit l’équivalent de
12 inhalations puisque chaque dose
inhalée est de 6 µg. Deux études ont
été réalisées (14) sur une période
d’un an auprès de plus de 2 700 pa-
tients qui ont montré une diminution
des exacerbations, des symptômes et
du recours au traitement de secours.
La prévention du tabagisme doit être
effectuée à chaque consultation en
expliquant bien sûr concrètement
le risque du tabac, mais aussi au
cours d’entretiens de type “entretien
motivationnel”, c’est-à-dire aider
l’adolescent tabagique à trouver par
lui-même les ressorts d’un change-
ment possible. En relais de l’éduca-
tion délivrée en individuel lors de la
consultation, il est profitable d’avoir
recours à des structures collectives
telles que les écoles de l’asthme.
Dans ces structures, les enfants et les
parents peuvent bénéficier d’une dy-
namique de groupe et de la compé-
tence d’une équipe pluridisciplinaire
formée spécifiquement à l’éducation
thérapeutique (médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, psychologues), ce
qui permet une réponse adaptée à
l’âge et aux demandes spécifiques de
l’adolescent. Il est important d’en-
courager les adolescents à discuter
Tableau 1 - Programmes destinés à améliorer la transition entre services pédiatrique et d’adultes (15).
Intervention But Stratégie Nombre d’études
(Succès)
Patients Information sur la
maladie
Mieux comprendre la maladie
• les compétences
Enseignement direct
Document
Site dédié
Sessions de groupe
E-learning
5 (4)
• globale
des compétences
• autonomisation
Capacité à naviguer
dans les structures adultes
Enseignement direct
E-learning
3 (2)
Sta Nommer un coordi-
nateur de transition
• continuité des soins
Structurer (planning) la tran-
sition
Contact unique
Suivre les rendez-vous (prise, présence)
Support psychologique
3 (2)
Lien unités Adultes/
pédiatrique
• la continuité des soins
• le partage entre les services
Structurer (planning) la tran-
sition
Accompagnement de personnels
pédiatrique et adultes dans
les 2unités
8 (3)

La crise (d’asthme!) de l’adolescence
ADOLESCENCE & Médecine • Juin 2014 • numéro 7 29
1. Delmas MC, Fuhrman C. L’asthme en France : synthèse des données
épidémiologiques descriptives. Revue des maladies respiratoires 2010 ;
27 : 151-9.
2. Bitsko MJ, Everhart RS, Rubin BK. The Adolescent with Asthma.
Paediatr Respir Rev 2014 ; 15 : 146-153.
3. Raza A, Kurukulaaratchy RJ, Grundy JD et al. What does adolescent
undiagnosed wheeze represent? Findings from the Isle of Wight Cohort.
Eur Respir J 2012 ; 40 : 580-8.
4. Delmas MC, Guignon N, Leynaert B et al. Prévalence de l’asthme chez
l’enfant en France. Arch pediatr 2009 ; 16 : 1261-9.
5. van Gent R, van der Ent CK, Rovers MM et al. Excessive body weight is
associated with additional loss of quality of life in children with asthma.
J Allergy Clin Immunol 2007 ; 119 : 591-6.
6. Iqbal S, Ritson S, Prince I et al. Drug delivery and adherence in young
children. Pediatr Pulmonol 2004 ; 37 : 311-7.
7. Gibson NA, Ferguson AE, Aitchison TC et al. Compliance with inhaled
asthma medication in preschool children. Thorax 1995 ; 50 : 1274-9.
8. Butz AM, Donithan M, Bollinger ME et al. Monitoring nebulizer use in
children: comparison of electronic and asthma diary data. Ann Allergy
Asthma Immunol 2005 ; 94 : 360-5.
9. Kelloway JS, Wyatt RA, Adlis SA. Comparison of patients’ compliance
with prescribed oral and inhaled asthma medications. Arch Intern Med
1994 ; 154 : 1349-52.
10. Soussan D, Liard R, Zureik M et al. Treatment compliance, passive
smoking, and asthma control: a three year cohort study. Arch Dis Child
2003 ; 88 : 229-33.
11. Penza-Clyve SM, Mansell C, McQuaid EL. Why don’t children
take their asthma medications? A qualitative analysis of children’s
perspectives on adherence. J Asthma 2004 ; 41 : 189-97.
12. Katon W, Lozano P, Russo J et al. The prevalence of DSM-IV anxiety
and depressive disorders in youth with asthma compared with controls.
J Adolesc Health 2007 ; 41 : 455-63.
13. Lu Y, Mak KK, van Bever HP et al. Prevalence of anxiety and
depressive symptoms in adolescents with asthma: a meta-analysis and
meta-regression. Pediatr Allergy Immunol 2012 ; 23 : 707-15.
14. Rabe KF, Atienza T, Magyar P et al. Eect of budesonide
in combination with formoterol for reliever therapy in asthma
exacerbations: a randomised controlled, double-blind study. Lancet
2006 ; 368 : 744-53.
15. Crowley R, Wolfe I, Lock K et al. Improving the transition between
paediatric and adult healthcare: a systematic review. Arch Dis Child
2011; 96 : 548-53.
BIBLIOGRAPHIE
sur leur capacité à gérer leur asthme,
mais également sur la façon dont ils
le gèrent à l’école et avec leurs amis.
TRANSITION DES SOINS
DANS LES SERVICES AUX
ADULTES
Le passage dans une structure
Adultes est important et doit être
préparé longtemps (au moins un an
à l’avance), ce d’autant que l’asthme
est sévère et nécessite un suivi rap-
proché. Plusieurs études ont évalué
différents programmes visant à amé-
liorer ce passage dans les maladies
chroniques (Tab. 1). Des approches
différentes incluant des enseigne-
ments spécifiques (E-learning, aides
médicales ou paramédicales) ont
permis d’améliorer le passage dans
un grand nombre de cas (15). Ces ré-
sultats soulignent la nécessité d’une
organisation de ce passage adapté à
chaque structure et mis en place par
les pédiatres et les pneumologues
Adultes.
CONCLUSION
Les changements physiologiques et
psychologiques importants obser-
vés à l’adolescence en font une étape
délicate dans la prise en charge de la
maladie asthmatique. L’anxiété et la
dépressivité peuvent être majorées
(voire chez les proches parfois) et
peuvent affecter plus ou moins direc-
tement la capacité à adhérer au trai-
tement. L’observance, qui est moins
bonne encore que chez l’adulte,
nécessite l’adaptation du traitement
qui doit être le plus simple possible
et s’adapter à la vie (à l’avis !) de
l’adolescent. Mais l’adolescence est
également une période propice aux
changements pendant laquelle il est
possible de se situer dans une dyna-
mique évolutive qui permettra, avec
parfois l’aide d’une équipe multi-
disciplinaire, une autonomisation
progressive de la prise en charge de
l’asthme.
MOTS-CLÉS
Asthme, Observance, Adhérence,
Anxiété, Dépressivité
1
/
5
100%