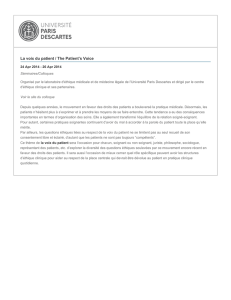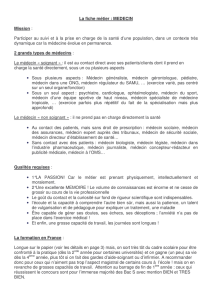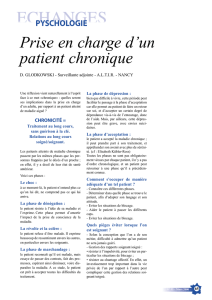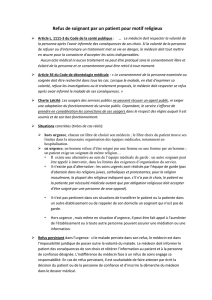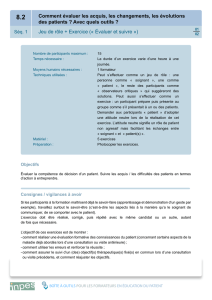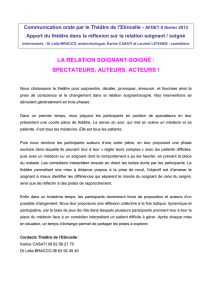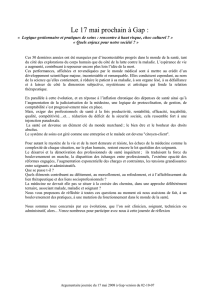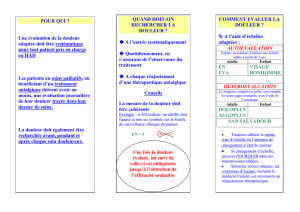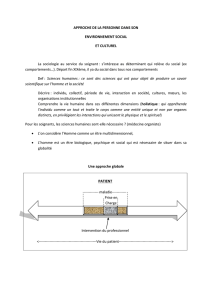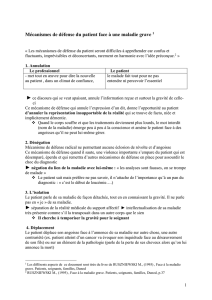Apprendre à « prendre soin » : une mission impossible,… et

1
Apprendre à « prendre soin » : une mission impossible,… et pourtant nécessaire
Vous avez dit éthos ?
Avant de tenter de savoir s’il est possible d’apprendre à prendre soin, je souhaiterai
montrer en quoi cette question est éminemment philosophique. A la manière de
Socrate, qui cherchait par des questions apparemment simples à déstabiliser ces
interlocuteurs, il m’arrive de demander, par provocation, aux formateurs d’IFSI ou
d’IFAS, mais aussi d’IFCS, à quoi ils servent ? En général, ce propos est assez mal
accueilli, car il semble remettre en cause la légitimité de la fonction de formateur.
Pourtant, il faut entendre cette question sans ironie de ma part, car elle pose la question
philosophique par excellence, celle du sens de son action (le « pourquoi » avant le
« comment »). En ce sens, les philosophes restent de « grands enfants » puisqu’ils
demandent toujours « pourquoi » !
Le but d’un formateur est apparemment simple : apporter à des futurs professionnels
des savoirs théoriques mais aussi pratiques. La réponse semble exacte, est-elle pour
autant vraie ? Rappelons d’abord que les savoirs enseignés restent (comme les fleurs
de Jacques Brel) périssables. Il faudrait donc rechercher ce que dans ce que nous
transmettons dans nos instituts de formations a pour vocation à demeurer, ce qui (en
principe) doit rester pérenne. Autrement qu’est ce qui demeure entre l’infirmier qui est
sorti en 1981 de l’école d’infirmière de Paul Brousse (Moi) et l’infirmière qui sort de
l’IFSI aujourd’hui avec un grade licence.
Pour tenter de répondre à cette interrogation, il faut revenir à l’histoire du mot
d’éthique. Comme vous le savez sans doute, le terme d’éthique vient du mot grec
« éthos ». La plus belle définition que je connaisse de ce vocable grec, nous vient
d’Héraclite (penseur présocratique) qui voyait, selon la traduction d’Heidegger, dans
l’éthos « la manière d’habiter le monde ».
A la frontière du philosophique et du sociologique, Il faut savoir que ce terme
d’ « éthos » est toujours utilisé de nos jours. Il renvoie aux traits communs que
partagent un groupe social (par exemple : éthos des médecins, des infirmières, des

2
directeurs d’hôpitaux pour rester dans la sphère hospitalière). L’éthos est évidemment
lié aux processus de socialisation de la profession,… pour le dire simplement à leur
formation à son contenu mais aussi aux modalités notamment de sélection (une
première année médecine n’a rien à voir avec une première année d’IFSI !)
Cette digression sur l’étymologie du mot d’éthique pourrait sembler à première vue
hors sujet. Elle ne l’est pas, car elle me permet de répondre à ma question de départ : à
quoi sert un formateur en institut de formation comme sur le terrain ? Et bien la
réponse semble évidente : il sert à faire acquérir un éthos. En effet, au-delà de l’apport
de connaissance ou de savoir-faire (évidemment utile), la mission implicite d’un
formateur de soignant est d’apporter à celui qu’il forme, en référence à Héraclite, une
manière d’habiter son métier… certains parlent du « cœur de métier »
Acquérir un éthos
Il reste que la construction d’un éthos est un processus souvent long et rarement aisé.
Certains y verront une forme de formatage. Il s’agit, de manière souvent non
consciente, de transférer ainsi un ensemble de valeurs afin de crée un éthos, un habitus
aurait dit Bourdieu. L’effet est bien de réduire les comportements déviants et de les
homogénéiser.
En visant à transformer les individus, les instituts de Formation peuvent dès lors vus
comme des dispositifs au sens qu’en donne Michel Foucault, c’est-à-dire « un
ensemble […] hétérogène comportant des discours, des institutions, des lois, des
mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques,
morales, philanthropiques, des modes d'emploi aussi. »
Il est vrai qu’entre intégration d’une culture professionnelle et formatage des esprits la
frontière s’avèrent parfois mince. Il s’agit de se « conformer », littéralement « se
former avec ». Il reste que cette transformation est nécessaire et qu’en cas d’échec, le
professionnel, sans repères, se retrouvera en souffrance, inadapté à son milieu. A cet
égard, l’intégration réussie d’un éthos professionnel n’empêche pas d’avoir ensuite un
regard critique sur sa propre profession. C’est le méta-professionnel qui, en prenant du

3
recul sur sa pratique, arrive à voir son propre éthos comme éthos parmi d’autres. Pour
être critique vis-à-vis de son éthos professionnel,… faut-il encore en avoir un !!
Et plus précisément pour les formateurs, il me semble que la première condition pour
transmettre un éthos, c’est bien d’en avoir un ! Puisqu’il s’agit d’un véritable
engagement, il me semble essentiel que la formation d’un soignant soit assurée par ses
pairs, et cela même à l’heure de l’universitarisation des IFSI !
Le docteur Karin Parent, membre du collège national des enseignants pour la
formation universitaire en soins palliatifs, parle à ce sujet d’un double engagement
envers le soignant en formation et envers celui qui aura un jour à bénéficier des soins
de ce futur professionnel. Elle écrit en ce sens : « Nous sommes engagés dans deux
relations asymétriques, l’une engendrant l’autre. Nous sommes ainsi responsable deux
fois : une première fois directement, envers le jeune adulte qu’est l’étudiant, qui a
besoin d’apprendre et de se construire en humanité à travers l’apprentissage, jamais
sans épreuves, d’un métier difficile ; et une deuxième fois, indirectement, envers le
patient qui a besoin de soignants compétents et attentifs »
Une mission impossible ?
Pourtant l’enseignement qui consiste à transmettre un éthos soignant, reste une mission
quasi impossible. En faisant référence à Freud – qui pensait qu’il existait trois métier
impossibles: éduquer, psychanalyser, gouverner – il serait tentant d’avance que
transmettre un éthos et plus spécifiquement « apprendre à prendre soin » est également
une mission impossibles.
Reste à comprendre pourquoi Freud associait-il ces trois activités ? La réponse qu’il a
en donnée est simple : avec ces métiers « on peut être sûr d’un succès insuffisant ». La
non-atteinte des objectifs attendus serait dans leur nature. Pour rejoindre Winnicott
quand il parlait des mères suffisamment bonnes, la conclusion semble évidente : nous
ne pouvons aspirer à n’être au mieux que des formateurs (ou des soignants) justes
suffisamment bons (good enough).

4
Il faudrait maintenant s’interroger sur le contenu de cet éthos infirmier à transmettre. Il
me semble que sa spécificité se révèle essentiellement dans un mode particulier de
relation au malade. Je ne reprendrai, une fois n’est pas coutume, et en prenant le risque
de décevoir une partie de l’auditoire, la distinction que nous proposait la Grande Marie
Françoise Collière entre le care, les soins d’entretien de la vie, et le cure les soins de ce
qui fait obstacle.
La relation soignant/soigné a fait l’objet d’un nombre important d’écrits, pour cette
intervention je me référerais à un cadre théorique déjà constitué, mais
malheureusement peu connu, celui d’un médecin allemand du début du XXe siècle
von Gebsattel introduit en langue française par le médecin philosophe Suisse Lazare
Benaroyo.
Si cette grille de lecture concernait d’abord les médecins, je pense qu’elle peut
concerner tous soignants.
Les 3 niveaux de la relation soigné/soignant
Cet auteur allemand mort en 1976 distinguait ainsi trois niveaux dans la relation
soignante. Caractérisons rapidement ces trois niveaux pour voir ensuite s’ils peuvent
s’enseigner, et si oui, de quelle manière ?
Le premier niveau est celui de la sympathie éprouvée par le soignant à l’égard de la
personne souffrante. C’est la rencontre entre une personne diminuée qui demande de
l’aide, et une autre appelée à répondre. Il s’agit d’accueillir la douleur d’autrui,
d’écouter la plainte de celui qui souffre. C’est moins le professionnel de santé qui est
ici convoqué qu’un être humain confronté à la douleur d’un autre être humain.
Levinas et Ricœur ont évoqué cette rencontre à leur manière. Le premier évoque une
responsabilité face au visage d’autrui, le second une sollicitude de l’homme agissant
face à l’homme souffrant. S’instaure à ce moment un rapport asymétrique fondé sur la
vulnérabilité du patient d’une part et, de l’autre, sur l’engagement d’un professionnel,
comme personne, à prendre soin de cette personne fragilisée.

5
Le second niveau est celui où s’élaborent à la fois le diagnostic et les moyens
thérapeutiques qui seront mis en œuvre pour venir en aide au patient. Le patient en
effet réclame, outre une écoute compréhensive ; une compétence pour lutter contre la
maladie. Le professionnel passe d’une attitude de sympathie à un comportement où
s’exerce son expertise.
Dans cette recherche de la nature de la maladie ainsi que de son traitement, le patient
sera inévitablement objectivé. Sa personne sera comme mis entre parenthèse. Le corps
du patient se verra réduit à un objet, voir morcelé en une multitude de « régions ».
Le troisième niveau cherche à équilibrer la relation. Il incombe au soignant de
redonner les informations en sa possession.
Dans ce dernier moment les compétences et l’expertise technique du soignant doivent
être au service de l’autonomie de la personne souffrante. Malgré une position de
vulnérabilité initiale, doit pouvoir s’établir, entre soigné et soignant, une relation plus
équilibrée où la réciprocité est possible.
En reprenant cette grille de lecture je vous propose de nous interroger sur la possibilité
de former les futurs professionnels à assurer ces trois niveaux
Peut-on apprendre la sympathie ?
Le premier niveau renvoie à la responsabilité d’une personne, en l’occurrence la
personne soignante, qui se retrouve convoquée par la souffrance d’un autre. Il s’agit de
faire preuve d’attention à la douleur d’autrui, de savoir écouter ses plaintes. Nous
sommes au cœur de l’engagement soignant qui se traduit par une forme inquiétude
(naturelle ?) face à la vulnérabilité d’autrui.
Il est clair que cette attitude ne saurait au sens strict s’enseigner. Il est également
certain, que selon notre personnalité nous sommes plus ou moins enclins à faire preuve
de sympathie ou de compassion. Certains diront à ce sujet, qu’on ne choisit pas d’être
soignant par hasard !
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%