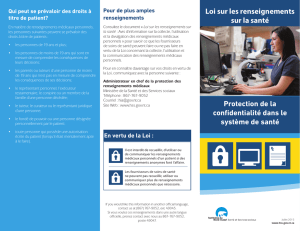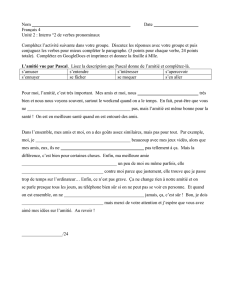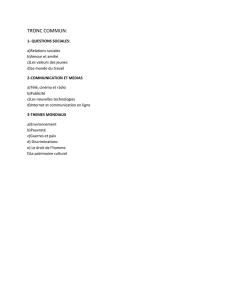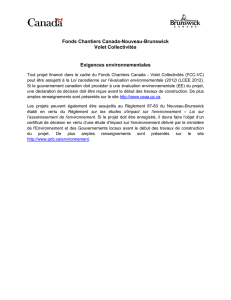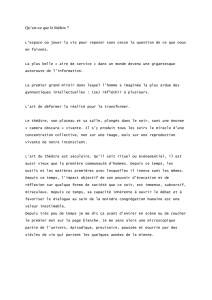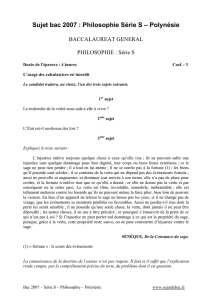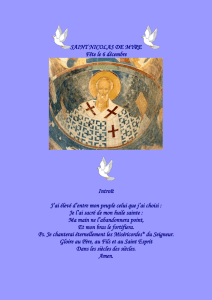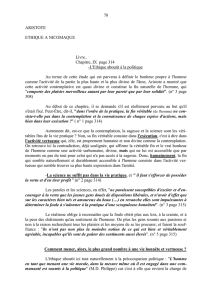Les multiples profils de la vertu

Les multiples profils de la vertu
1. Il n'existe pas de super-vertu, qui embrasse toutes les autres vertus (comme par exemple la
raison ou l'amour), mais plutôt, de nombreuses et hétérogènes vertus. Il n'existe pas non
plus d'unité de la vertu, qui garantisse a priori la cohérence d'un système des vertus.
2. Les vertus sont des réponses axiologiques [responsive to values]; elles consistent en des
réponses (plus ou moins) adéquates à ce qui nous semble être important et de grande
valeur.
3. Nous pouvons nous comporter de différentes manières vis-à-vis des valeurs. Je peux
apprécier une valeur relativement passivement, la respecter et l'honorer, l'exprimer ou la
promouvoir et la faire foisonner, ainsi qu'un capitaliste s'efforce de maximiser son capital .
4. Le conséquentialisme éthique considère que nous devrions promouvoir et faire foisonner
certaines valeurs. Il croit en une « hegemony of promotion » (cf. Swanton 2003, 48-55).
Il s'agit, pour le conséquentialisme, de créer un monde meilleur. Le but, à long terme, est
le meilleur des mondes (envisagé d'un point de vue moral), comme par exemple, un
monde avec une prépondérance maximale du plaisir sur la peine (comme dans
l'utilitarisme classique), ou bien avec une organisation optimale de la justice (comme dans
le dénommé conséquentialisme de la justice.
5. La notion de promotion prend au sérieux l'idée que l'on gagne à ce que le bien soit soutenu
et fortifié (par tous les moyens).
6. La notion de multiplication prend au sérieux l'idée du nombre. Il faut prendre en compte la
notion de quantité dans la perspective morale. Mieux vaut – ceteris paribus – sauver la vie
de x+1 personnes plutôt que celle de x personne(s) seulement. Mieux vaut – ceteris
paribus – mettre deux enfants au monde qu'un seul. C'est un moindre mal, lorsque 100
personnes doivent mourir dans un bombardement, plutôt que 200.
7. Le conséquentialisme prend très au sérieux l'idée que nous sommes responsables, devant
les conséquences de nos actes. Il ne nous reconnaît pas seulement une responsabilité
positive envers ce que nous faisons, mais aussi une responsabilité négative devant les
conséquences de nos omissions. Le fait de tuer cent personnes est moralement équivalent
au fait d'omettre de sauver la vie de 100 personnes. Le conséquentialisme ne défend pas
seulement le dénommé "common sens" moral, mais une morale maximale, bien plus
exigeante et qui demande plus d'engagement et de sacrifice pour l'amélioration du monde
que le "common sens" moral. (cf. Kagan 1989; Mulgan 2001).
8. Le conséquentialisme peut définir la vertu comme une disposition à promouvoir et à faire
foisonner le bien. En ce sens, G.E. Moore définit le concept de vertu ainsi: «a habitual
disposition to perform certain actions, which generally produce the best results.» (Moore
1901, p. 172 § 103). Cette définition est à peu près identique à la définition de Moore du
devoir. Il s'ensuit que la vertu n'a pas une valeur intrinsèque, mais uniquement une valeur
extrinsèque. La vertu est un instrument de la maximisation [maximizing] du bien.
9. Dans de nombreuses théories éthiques, les concepts de vertu et de devoir sont à peu de

choses près interchangeables; le concept de vertu, dans le conséquentialisme, mais aussi
dans l'éthique de Kant, se révèle redondant. Le conséquentialisme se focalise bien plus sur
les actes et les devoirs que sur les motifs et les vertus. Une exception cependant, le
dénommé conséquentialisme des motifs (cf. Adams 1976), qui se réfère directement aux
conséquences espérées de l'existence et de la promotion de certains motifs.
10. Les deux "péchés du conséquentialisme" consistent en une trop grande exigence (à savoir
la maximisation permanente du bien) et en une indifférence à certaines barrières morales
(dans la mesure où la maximisation du bien peut être obtenue par tous les moyens). Il
exige trop et ne proscrit pas assez, comme par exemple, le meurtre de x innocent(s) pour
sauver la vie de x+1 personnes.
11. Le conséquentialisme ignore la pluralité des phénomènes moraux. (cf. Ross 1930). Il
sous-estime la complexité des dimensions morales. On ne peut pas, par exemple, fonder le
devoir de tenir ses promesses de manière purement impersonnelle, en tant que moyen de
favoriser et de faire foisonner des bonnes conséquences. Ce devoir a une dimension
personnelle. Quelqu'un qui fait une promesse, engage une relation qui est moralement
significative. Il renonce ainsi, à pouvoir se dégager (sans raisons graves ou excuses
valables) lui-même de sa promesse.
12. On ne devrait pas fonder l'éthique de la vertu de manière conséquentialiste, mais plutôt
par la diversité des réponses axiologiques [appropriate value responses]. En ce sens, une
vertu ne consiste pas nécessairement en une disposition, à favoriser et à faire foisonner le
bien, mais plutôt, à favoriser différentes sortes et qualités de réponses axiologiques
appropriées.
13. L'«hegemony of promotion» néglige la multiplicité des attitudes que nous pouvons
adopter envers les valeurs ou les bonnes choses. Favoriser et promouvoir [promoting] des
valeurs ne sont pas nos seules possibilités, nous pouvons aussi les apprécier et les honorer
[honoring, respecting] ou bien nous pouvons exprimer [expressing] des jugements de
valeur.
14. Il y a des chances, par exemple pour que quelqu'un, qui honore la justice, soit lui-même
juste. Ce qui réduit la possibilité que la justice soit favorisée par des moyens injustes. Le
profil de la vertu de justice consiste en la réponse axiologique du respect; la justice a une
borne déontologique (l'inviolabilité d'une règle, l'interdiction de l'instrumentalisation), qui
ne se laisse pas comprendre ou fonder d'une manière purement conséquentialiste. Le
respect de la personne est équivalent au respect de la non-violence. Le terrorisme et
l'usage de la violence ne sont pas appropriés, au respect de la valeur d'une personne.
15. Ce n'est pas parce que quelqu'un estime [estimating] l'amitié, qu'il lui faut aussi favoriser
l'amitié chez autrui, ou multiplier le nombre de ses amis. Estimer l'amitié peut signifier,
par exemple, s'efforcer de ne pas détruire l'amitié des autres (on a du respect pour la
valeur de l'amitié), ou exprimer ses sentiments d'amitié (on est attentif à certains amis).
Honorer l'amitié, ne présuppose pas de sentiments amicaux. Je peux rendre visite à
quelqu'un par amitié, sans être capable à ce moment ou bien dans certaines conditions, de
manifester à son égard aucun sentiment amical (comme par exemple à l'égard d'un ami qui
est mal en point à l'hôpital).
16. On peut aussi promouvoir l'amitié, mais il peut y avoir des tensions entre la promotion de
l'amitié et l'expression de l'amitié. Lorsque par exemple je refuse de prêter de l'argent à un
ami, car je suis convaincu qu'il ne peut pas payer ses dettes, je n'exprime pas par ce refus

mon amitié, mais c'est peut-être par amitié, que je contribue à ce que mon ami ne s'endette
pas plus. Une femme peut repousser les avances d'un homme, afin que leur amitié ne soit
pas détruite. Ceci est un conflit entre l'expression et la promotion ou préservation de
l'amitié. («being cruel to be kind» Swanton 1995, 67) Je peux, un soir, ne pas répondre à
un appel de mon amie, car je sais, qu'elle a un examen à préparer, et car je souhaite qu'elle
ne gaspille pas son temps dans une longue conversation avec moi. Dans cet exemple aussi,
on peut être désagréable par amitié.
17. Dans la mesure où l'amitié est une "vertu mixte", il nous faut à la fois la promouvoir et
l'exprimer. Nous n'avons pas le droit de faire seulement l'un et de négliger constamment
l'autre. Un ami, qui ne sourit jamais, est tout autant insupportable qu'un ami qui sourit
toujours et ne sais jamais être dur avec ses amis.
18. La diversité des profils des vertus implique la possibilité de nombreuses et fortes tensions
au sein d'une vertu individuelle. Vis-à-vis de mes valeurs, et vis-à-vie de mes amis, il peut
y avoir des tensions entre différents points de vue, tel l'estime, la promotion, l'expression
ou le respect. («there could be tension between the appreciative, promotional, expressive,
or honoring aspects.» Swanton 1995, 71)
19. On peut aimer une valeur ou une bonne chose, on n'est pas pour autant obligé de la
promouvoir ou de l'incarner soi-même. Je peux, par exemple, regarder des objets de
grande valeur dans un musée, sans pour autant me sentir obligé d'en collectionner de
semblables. Apprécier est plus une réponse passive, qui n'oblige pas à la maximisation
d'une valeur ou à une activité. Il n'y a pas de rapport direct et strict entre l'estime et le
devoir. On ne peut pas dire de quelqu'un qu'il aime moins ou pas assez une bonne chose,
juste parce qu'il ne s'engage pas ou pas assez pour la faire foisonner et la promouvoir.
20. La compassion aussi est une vertu mixte, car elle consiste à aider les autres, et à exprimer
des sentiments de sympathie. Cela peut être suffisant, dans certaines circonstances,
d'exprimer de tels sentiments de sympathie. La compassion exige toujours quelque signe
de compassion, c'est-à-dire l'expression de la compassion, tandis que des actes accomplis
par amitié ne présupposent pas toujours de sentiments amicaux. A l'inverse, un bienfait ou
une aide n'est pas nécessairement accomplie par compassion. Je peux aussi faire le bien ou
aider en vertu de tout autres motifs ou dispositions, comme par exemple pour préserver
une bonne atmosphère dans le voisinage ou améliorer ma réputation. Je peux de même
aider quelqu'un dans la détresse, uniquement parce que je considère cela comme mon
devoir, et car je suis convaincu qu'un tel homme pourrait mourir sans mon aide. Il faut
distinguer l'amour actif de la simple pitié, ou d'un acte dans lequel j'exprime mon regret.
21. Si mon bienfait abaisse le bénéficiaire ou si même j'ai l'intention de l'abaisser, alors je
n'agis pas par compassion. La pitié [pity] peut bien être véritable, cela ne mène pas pour
autant à la vertu ou à la pratique d'un acte d'une grande valeur morale. Un acte qui accepte
l'abaissement de l'autre, ou même y aspire, ne peut être un acte de compassion [act of
compassion].
22. Lorsqu'un bienfait ou une aide est ressentie comme indésirable ou comme une atteinte à la
liberté, il me faut, pour autant que j'ai la vertu de compassion, restreindre son expression,
en gardant le contrôle de mes sentiments ou de mon comportement ou des deux. Celui qui
a la vertu de compassion ne peut être aveugle aux effets secondaires indésirables des
formes de pitié importunes ou inopportunes.
23. La créativité est une vertu. Nietzsche l'entend comme la vertu de renverser les valeurs et

d'empêcher la médiocrité. Il l'entend dans le sens du conséquentialisme et du
perfectionnisme. C'est pourquoi il aime les superlatifs (comme «sur-
homme» [«Übermensch»]) ou les concepts hiérarchiques (comme «hommes
supérieurs» [«höhere Menschen»]). Bien que Nietzsche refuse l'utilitarisme (c'est-à-dire,
l'orientation selon le bonheur ou le plaisir), il adopte pourtant une méthode
conséquentialiste. (cf. Hales 1995) La vertu de créativité est pour Nietzsche une vertu
héroïque. «Heroic virtue is not for everyone.» (Swanton 2003, 172)
24. La psychologie humaniste de Abraham Masslow considère la créativité comme une vertu
pour tout un chacun. Nous pouvons, dans tous les domaines de la vie être plus ou moins
créatif. Nous exprimons ainsi une sorte de santé de l'esprit. La créativité est ici comprise
selon le profil de l'expression, et non selon le profil de la promotion et du
perfectionnement qualitatif, comme avec Nietzsche. La créativité est un moyen de se
soigner et de s'aider soi-même; sa valeur ne consiste pas tant en une puissance, que bien
plus en un enrichissement de la qualité de vie et en une expression d'énergie.
Littérature
Adams, R.M. (1976): Motive Utilitarianism, in: Journal of Philosophy 73, 467-481, reprinted
in Philip Pettit (ed.): Consequentialism (The International Research Library of
Philosophy 6), Aldershot etc.: Dartmouth 1993.
Hales, S.D. (1995): Was Nietzsche an Consequentialist? In: International Studies in
Philosophy 27, 25-34.
Kagan, Shelly (1989): The Limits of Morality (Oxford Ethics Series. Ed. by Derek Parfit),
Oxford: Clarendon Press.
Maslow, A.H. (1968): Toward a Psychology of Being, 2nd edition, New York: Van Nostrand
Reinhold Co.
Moore, George Edward (1901): Principia Ethica, Cambridge UP, revised edition 1993.
Mulgan, Tim (2001): The Demands of Consequentialism, Oxford: Clarendon Press.
Ross, David (1930): The Right and the Good, Oxford: UP, revised edition, ed. by Philip
Stratton-Lake, Oxford: Clarendon Press 2002.
Wolf, Jean-Claude (1996): Ein Pluralismus von Prima Facie Pflichten als Alternative zu
monistischen Theorien der Ethik, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 50,
601-610.
Swanton, Christine (2003): Virtue ethics. A pluralistic view, Oxford: UP.
1
/
4
100%