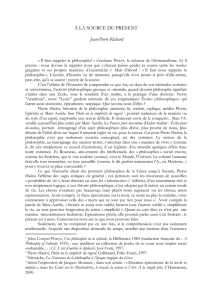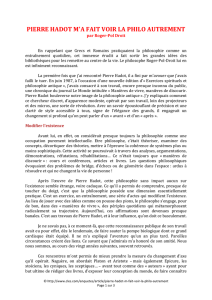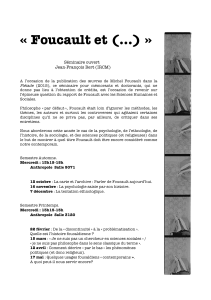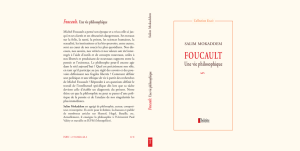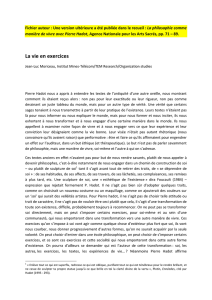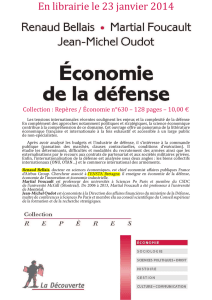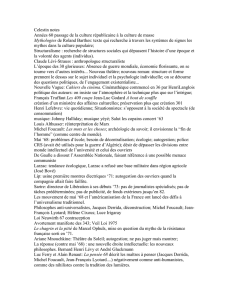L`écriture de soi comme exercice spirituel dans

S
ciences-
C
roisées
Numéro 10 : L'Écriture
L'écriture de soi comme exercice spirituel
dans la philosophie antique
Alice Venditti
Doctorante - Département de Philosophie
Université de Paris 8 - Università Milano-Bicocca
musetta82 @ hotmail.fr
L'ÉCRITURE DE SOI COMME EXERCICE SPIRITUEL
DANS LA PHILOSOPHIE ANTIQUE
Introduction
Pour comprendre les modalités et les finalités des exercices d’écriture
personnelle qu’on pratique aujourd’hui – individuellement ou dans le cadre
d’une formation – il est nécessaire, avant toute autre considération, de saisir
le phénomène « écriture de soi » au moment même de sa naissance et de
suivre ainsi certains agencements propres à son développement. Proposer
un nouveau paradigme de formation fondé sur la pratique d’écriture de soi
requiert en effet une certaine rigueur théorique et méthodologique. Il s’agit
de réaliser une intégration cohérente des prémisses épistémologiques et
philosophiques avec les méthodes et les stratégies cognitives. La première
tradition à laquelle on est obligé de se confronter est donc celle de la
philosophie gréco-romaine, tout du moins comme Pierre Hadot (1995,
2001, 2002) et Michel Foucault (2001a, 2001b) nous la présentent. Les
deux philosophes, en dépit des divergences théoriques qui les scindent, ont
souvent observé que les maîtres et les disciples de l’Antiquité écrivaient à
partir de certaines conditions concrètes ayant tellement marqué l’essence
même de leurs écrits qu’on ne peut pas les éclipser : le cadre de l’école
philosophique, les genres littéraires plus en vogue, les impératifs
dogmatiques, les méthodes traditionnelles de raisonnement, mais surtout la
nature propre de la philosophia. Toute réflexion sur l’écriture doit partir du
fait que la philosophie antique est avant tout une manière de vivre, et non
pas une construction de système.
Pour Hadot, ce qui fait l’essentiel de la vie philosophique à cette époque,
c'est l’expérience vécue de certains états et de certaines dispositions
intérieures, le choix existentiel d’une manière particulière d’exister dans le
monde. La philosophie s’enracine en effet dans le simple fait que son
commencement se situe, pour toutes les écoles, dans la prise de conscience
de l’état d’aliénation, d’inauthenticité et d’angoisse malheureuse dans
- 1 -

lequel vit l’homme, déchiré par le souci et par les passions. Toutes les
écoles supposent aussi que l’homme peut être soigné et délivré de cet état.
La philosophie, depuis l’époque classique et de plus en plus avec les post-
socratiques – les cyniques, les épicuriens, les stoïciens – avait ainsi fixé son
objectif autour de la définition d’une certaine technique de vie (tekhnê tou
biou) à savoir : un art ou une procédure réfléchie d’existence. Et c’est la
liberté humaine qui s’accomplit dans cet art de soi-même et que l’on
pratique soi-même, mais toujours à l’intérieur d’un enseignement
communautaire qu’on reçoit dans une des écoles philosophiques
préalablement choisie. Foucault précise, de manière très soigneuse et en
accord avec Hadot, que la philosophie a une fonction proprement
thérapeutique : il s’agit pour elle de soigner l’homme, de « s’occuper de son
âme » (psukhês epimelêteon)1. On retrouve ici le célèbre impératif du
« souci de soi-même », expression qui traduit une notion grecque très
complexe, mais aussi très répandue, celle d’epimeleia heautou, que les
Latins traduisent avec cura sui. Cette représentation comprend tout un
corpus caractérisé par plusieurs attitudes : des modes de raisonnement, mais
aussi des exercices (askêsis, meletai), volontaires et personnels, inhérents au
mode de vie philosophique. Comme Foucault l'explicite : « Aucune
technique, aucune habileté professionnelle ne peut s’acquérir sans exercice ;
on ne peut non plus apprendre l’art de vivre, la technê tou biou, sans une
askêsis qu’il faut comprendre comme un entraînement de soi par soi […] »
(Foucault, 2001b : 1236).
Chaque école forge ses propres exercices (abstinences, régimes
alimentaires, dialogue, silence, écoute, mémorisation, méditation,
contemplation) d’après sa propre option existentielle, autrement dit, selon sa
propre vision globale du monde et sa manière de se positionner dans le
cosmos. Néanmoins, une des conquêtes théoriques d’Hadot a été celle de
démontrer qu’il y a, pour toutes les écoles, une unité profonde, dans les
moyens employés et dans la fin recherchée par ces exercices. Les moyens
employés sont les techniques rhétoriques et dialectiques de persuasion, les
essais de contrôle du langage intérieur et la concentration mentale. La fin
recherchée ne se situe pas seulement dans l’ordre de la connaissance, mais
dans l’ordre du « soi » et de l’être. Le philosophe désire la sagesse, il
s’efforce de tendre vers une maîtrise de soi (enkrateia) et une ascèse
(askêsis). Une sagesse jamais atteinte mais qui, par le seul fait qu’on
progresse dans sa direction, nous permet de réaliser une conversion
(metastrophè) de notre manière de penser et de notre manière de vivre2.
Foucault désigne ainsi ces pratiques comme des « arts de l’existences »,
ou des « techniques de soi », tandis qu’Hadot les nomme « exercices
spirituels » : « Le mot “spirituel” permet bien de faire entendre que ces
exercices sont l’œuvre, non seulement de la pensée, mais de tout le
psychisme de l’individu […] » (Hadot, 2002 : 21 ; 1995 : 21-22). L’écriture
1 On retrouve la première formulation du « souci de soi-même » chez Platon (1920), dans l'Alcibiade, en 132 c.
2 Cf. Pierre Hadot : « Plus et mieux qu’une théorie sur la conversion, la philosophie est toujours restée elle-même
essentiellement un acte de conversion », un arrachement à l’aliénation de l’inconscience (Hadot, 1953 : 31-36 ;
2002 : 223-235). L’auteur distingue différentes techniques de transformation de la réalité humaine : une
conversion-retour à l’origine, l’epistrophê platonicienne, qui vise un changement d’orientation, un retour à soi ;
une conversion-rupture, une metanoia, qu’on retrouve dans la tradition chrétienne et qui à pour finalité un
changement de la pensée, une rupture profonde de tout l’être.
- 2 -

s’inscrit dans ce cadre particulier et dans cette nécessité d’une tekhnê de
l’existence. Et Foucault précise : « Il semble bien que, parmi toutes les
formes prises par cet entraînement (et qui comportait abstinences,
mémorisations, examens de conscience, méditations, silence et écoute de
l’autre), l’écriture – le fait d’écrire pour soi et pour autrui – se soit mise à
jouer assez tard un rôle considérable. En tout cas, les textes de l’époque
impériale qui se rapportent aux pratiques de soi font une large part à
l’écriture » (Foucault, 2001b : 1236).
On étudiera ainsi les différents types d’exercices d’écriture personnelle
et on cherchera à démontrer comment l’écriture rejoint les finalités de tous
les autres exercices spirituels. On décrira la fonction des carnets des notes
(hupomnêmata) par lesquelles on apprend à lire et à écouter : l’écriture se
présente ici comme point d’application rigoureux des mouvements de la
pensée, telle que la mémorisation (mnemè) et la méditation (meletê).
Ensuite, on montrera comment la correspondance épistolaire permet
d’apprendre à dialoguer, avec soi-même et avec autrui. Enfin, on dévoilera
que l’écriture, surtout envisagée dans son rôle de preuve de vérité ou
d’examen de conscience, a la finalité d’apprendre à mourir, autrement dit,
d’apprendre à vivre. Si Hadot définit la pratique philosophique comme étant
essentiellement un effort pour prendre conscience de nous-mêmes et de
notre être-avec-autrui, mais aussi comme une conversion de notre vision du
monde, alors on verra que l’exercice d’écriture de soi est une pratique qu’il
faut continuellement renouveler.
1. Du logos à l'êthos
C’est dans les écoles hellénistiques et romaines de philosophie –
stoïques et épicuriennes en particulier – que ce phénomène est le plus facile
à observer. Évidemment, l’oralité y joue un rôle encore considérable,
néanmoins, un tout autre rapport à la lecture et à l’écriture, au dialogue avec
soi-même et avec autrui, à la parole et au silence, s'y développe. L’écriture
personnelle en effet prend à cette époque une place fondamentale dans le
processus même d’élaboration des principes rationnels. Déjà pour Épictète
(1965 ; 2000), qui pourtant n’a donné qu’un enseignement oral, l’écriture
est un exercice de la pensée sur elle-même qui rend présents les discours
reçus et reconnus comme vrais, réfléchit sur eux, les assimile et se prépare
ainsi à affronter le réel : « Il est difficile sans doute de dater précisément
l’origine du processus, mais quand on le prend à l’époque dont je parle,
c’est-à-dire au Ier-IIème siècle, on s’aperçoit que l’écriture est déjà devenue,
et ne cesse de s’affirmer toujours davantage comme un élément de
l’exercice de soi. La lecture se prolonge, se renforce, se réactive par
l’écriture, écriture qui est, elle aussi, un exercice, elle aussi un élément de la
méditation » (Foucault, 2001a : 341).
On remarque que cette attitude contemplative de mémorisation et de
méditation est étroitement liée à la lecture des discours philosophiques
- 3 -

théoriques, des œuvres qu’un maître a écrites pour ses disciples3. En effet, le
discours philosophique, présent dans les œuvres antiques, justifie
rationnellement et avec précision les présupposés intellectuels d’une
certaine attitude de vie et explicite ses implications et ses conséquences,
tout en proposant une mise en ordre de sa représentation du monde. Il est à
la fois l’expression indispensable d’un certain mode de vie, mais aussi,
comme on le verra par la suite, le moyen privilégié pour y parvenir. Sans
démentir l’effort de conceptualisation et de rationalisation de ces œuvres,
Hadot remarque qu’elles ne reflètent pas simplement des préoccupations
méthodologiques ou pédagogiques, mais aussi des fonctions
psychagogiques4. Terme que Foucault, lui aussi, utilise et définit ainsi :
« […] on peut, je crois, appeler “psychagogique” la transmission d’une
vérité qui n’a pas pour fonction de doter un sujet quelconque d’aptitudes,
etc., mais qui a pour fonction de modifier le mode d’être de ce sujet auquel
on s’adresse » (Foucault, 2001a : 389).
Dans cette perspective, le discours philosophique du maître prend lui-
même la forme d’un exercice spirituel5. On peut affirmer que l’œuvre,
même la plus théorique et systématique, n’a pas été écrite pour
« informer », mais pour « former » (Goldschmidt, 1947 : 3 ; Hadot, 1995 :
118). Les productions littéraires réalisent cette formation de différentes
manières : elles peuvent suivre une méthode critique – dialectique,
rhétorique ou dialogique – comme celles des sceptiques ou des
académiques, soit proposer un discours purement théorique et dogmatique,
comme les traités de Plotin. Mais elles sont toujours marquées par les
contraintes qu’impose l’enseignement oral et visent à convertir le lecteur
par la force de la rhétoriques et de l’évidence. Toutefois, ces ouvrages sont
réservés aux spécialistes et ne sont pas suffisants pour que se réalise la
conversion à la vie philosophique. Il faut que le lecteur ait déjà une certaine
expérience de ce dont le discours parle et ensuite qu’il s’exerce à une lente
assimilation, capable de créer dans son âme une disposition permanente, un
habitus. Le disciple doit conquérir le savoir par un travail personnel sur soi-
même. Porphyre reprend le thème aristotélicien : « il faut que ces
connaissances “deviennent nature en nous”, “qu’elles croissent avec
nous” » (Hadot, 1995 : 244 ; Porphyre, 1979-1995 : 5-6). Cet effort de
réflexion et d’assimilation théorique aboutit à la rédaction des œuvres
écrites : « C’est pourquoi stoïciens et épicuriens conseillent à leurs disciples
de se remémorer jour et nuit, non seulement mentalement, mais par écrit,
ces dogmes fondamentaux. […] ce qui compte, c’est l’acte d’écrire, de se
parler à soi-même » (Hadot, 1995 : 271-272).
3 Cf. Pierre Hadot : « Pour être clair, il me faut préciser que j’entends le mot “discours” au sens philosophique de
“pensée discursive” exprimée dans le langage écrit ou oral […] » (1995 : 20).
4 Hadot veut rendre raison des répétitions, des incohérences et des apories dans lesquelles la pensée semble
s’enfermer chez Platon, chez Aristote et chez Plotin. Il reprend la position de Pierre Courcelle selon laquelle un
texte doit s’interpréter en fonction du genre littéraire auquel il appartient. Il peut donc affirmer que les œuvres de
l’Antiquité n’étaient pas composées pour exposer un système, mais pour produire un effet de formation, elles ont
une valeur psychagogique.
5 Cf. Pierre Hadot : « Il ne s’agit pas d’opposer et de séparer d’une part la philosophie comme mode de vie et
d’autre part un discours philosophique qui serait en quelque sorte extérieur à la philosophie. Bien au contraire, il
s’agit de montrer que le discours philosophique fait partie du mode de vie » (1995 : 21).
- 4 -

Le genre littéraire le plus important aux Ier et IIe siècle de notre ère était
celui des résumés très denses, des courtes maximes, des hupomnêmata :
« Leur usage comme livre de vie, guide de conduite semble être devenu
chose courante dans tout un publique cultivé. On y consignait des citations,
des fragments d’ouvrages, des exemples et des actions dont on avait été
témoin ou dont on avait lu le récit, des réflexions ou des raisonnements
qu’on avait entendus ou qui étaient venus à l’esprit » (Foucault, 2001b :
1237).
Comme Sénèque (1993) le souligne souvent, l’écriture est ici une
manière de s’approprier intimement des lectures faites et de se recueillir sur
elles. Il est un exercice de la méditation purement rationnelle, qui s’oppose
au grand défaut de la stultitia, de l’éparpillement et de la dispersion. Le
lecteur effectue un travail sur lui-même, il médite afin de fixer les éléments
acquis et de garder ainsi à l’esprit l’intuition globale de l’enseignement
fondamental, des dogmes d’Épicure ou de Chrysippe. Ces carnets de notes
sont ainsi des exercices de la pensée – ils apprennent à pratiquer les
méthodes de la raison – mais ils sont aussi des exercices de la volonté qu’on
retrouve, comme on a déjà observé, chez Sénèque, mais aussi chez
Épictète6. D'ailleurs, les Pensées de Marc Aurèle (1998) en sont un autre
exemple remarquable. Elles nous exposent des formules qui renvoient aux
dogmes du stoïcisme que l’empereur-philosophe s’écrit pour lui-même et
qu’il s’offre pour méditer, afin de rendre vivant ce qui est déjà présent à
l’intérieur de l’enseignement reçu : « Les Pensées de Marc Aurèle sont
donc un document extrêmement précieux. Elles nous conservent en effet un
remarquable exemple d’un genre d’écrit qui a dû être très fréquent dans
l’Antiquité, mais qui était appelé, par son caractère même, à disparaitre
facilement : les exercices de méditation consignés par écrit » (Hadot, 2002 :
150). La méditation consiste ici à se recueillir en soi-même pour avoir
constamment sous la main (procheiron) les règles de vie (Kanôn). Règles
présentées comme sentences relativement courtes (Kephalaia), ou comme
des expressions célèbres très frappantes (apophthegmes). Évidemment, ces
courtes formules avaient une meilleure efficacité mnémotechnique et une
plus grande force persuasive. Toutefois, il n’est pas question d’une
construction conceptuelle qui aurait une fonction de simple support de
mémoire, qu’on pourrait consulter de temps à autre. Il s’agit, au contraire,
de renouveler à tout moment son choix de vie. Ce livre de vie devient ainsi
le matériel pour un exercice à effectuer quotidiennement et ayant comme
finalité la constitution d’un équipement (paraskeuê, ou instructio chez
Sénèque) à savoir : la préparation aux événements de la vie. Cet équipement
est constitué par des logoi : des énoncés parfois très dispersés et
hétérogènes, même si très cohérents entre eux et toujours fondés en raison
d’une rationalité qui dit le vrai et qui constitue en même temps la matrice
des comportements moralement adéquats. Il s’agit de constituer un
équipement de discours secourables (logos bioèthikos) et c’est l’écriture qui
réalise cette fonction éthopoiétique : elle est un opérateur de la
6 Par exemple, le texte que nous appelons les Entretiens d’Épictète n’est rien d’autre que les notes prises par son
élève Arrien pendant les discussions qui suivaient la leçon proprement dite. Cet exercice se diffusera à partir du
IIIe siècle ap. J.-C dans la tradition du commentaire. Et cet œuvre philosophique n’est rien d’autre que la mise
par écrit, soit par le maître, soit par un disciple, d’un examen critique ou d’une explication orale d’un texte, ou
tout au moins, des dissertations sur des « questions » posées par le texte même (Hadot, 1995 : 240).
- 5 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%