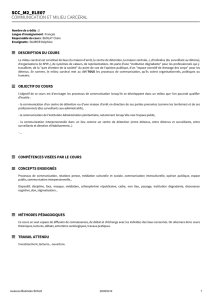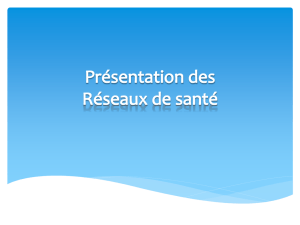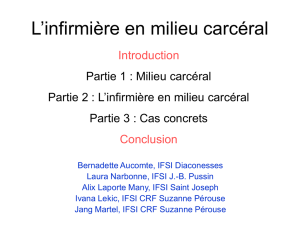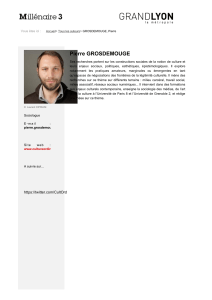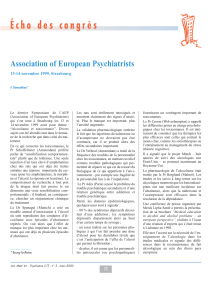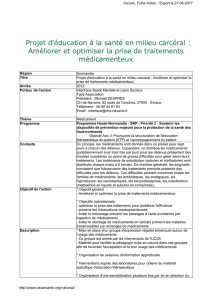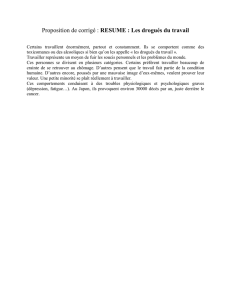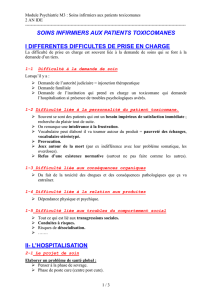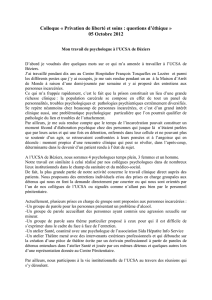Quelles interventions psychologiques possibles auprès des

Pascal Hachet
Psychotropes – Vol. 10 n
o
1 47
Quelles interventions
psychologiques possibles
auprès des toxicomanes incarcérés ?
Pascal HACHET
Psychologue, Docteur en psychanalyse, Membre du Centre de Recherches en Psycho-
pathologie et Psychologie Clinique (CRPPC) de l’Université Lyon 2.
Association SATO — Picardie 2, rue Achille Sirouy 60000 Beauvais.
Tél. 03.44.48.34.40. Fax. 03.44.45.46.57.
Émail : [email protected]
Résumé – L’intervention d’un psychologue auprès de toxicomanes incar-
cérés se heurte à divers obstacles : le patient redoute une collusion avec
la justice, il peut nous utiliser comme des prestataires de service, etc. Mais
ce cadre de travail est intéressant à plus d’un titre. Il donne l’occasion de
rencontrer un patient dont l’habitus toxicomaniaque est défait, à la ma-
nière d’un masque qu’il aurait été contraint d’ôter. De manière spécifi-
que, le caractère clos du milieu carcéral permettrait de mettre en travail
les « cryptes au sein du Moi » (Abraham et Torok) dont certains patients
sont porteurs à la suite d’expériences indicibles. Ces clivages peuvent
commencer à se résorber face à une oreille attentive et sous l’effet d’in-
terprétations sans préjugés.
Abstract – Working as psychologist with drug addicts in a prison set
involves various desadvantages : the patient either fears to be used by
justice system or tries to use the therapist. Nevertheless, it is realy
interesting to work in such a specific set because drug addiction habits

Quelles interventions psychologiques possibles auprès des toxicomanes incarcérés ?
48 Psychotropes – Vol. 10 n
o
1
are reduced. In a specific way, the closing environment of a prison allows
secretely to work through the « crypts in the Ego » (Abraham and Torok)
that some patients bear because of hidden experiences. Thoses psychic
splitting process may began to diminish thanks to a mindful ears and some
neutre interpretations.
Mots clés – Moi – Psychologue – Intervention – Prison – Psychothérapie.
Le cadre de travail
Psychologue dans un Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (CSST), je
me rends une fois par semaine, et depuis dix ans, dans la maison d’arrêt de la
ville de Picardie où ce centre d’accueil ambulatoire est implanté (Hachet, 2002a).
J’interviens alors à titre de ce que l’administration pénitentiaire nomme « visi-
teur professionnel » ; c’est-à-dire un professionnel distinct des administrations
pénitentiaire, judiciaire et hospitalière 1. Afin de prévenir chez le lecteur toute
velléité de partir en croisade éthique -qui reviendrait ici à lutter contre des
moulins à vent -, précisons que cette appellation désigne les professionnels qui
interviennent en milieu carcéral lorsqu’ils y sont sollicités par des détenus ou/
et par d’autres professionnels, c’est-à-dire de manière ponctuelle (même si des
prises en charge régulières peuvent avoir lieu), à la demande (au moins pour le
premier entretien), et non sur le mode d’une permanence, d’un temps de travail
fixe. Le terme de « visiteur professionnel » n’est donc nullement sous-tendu
par un dessein machiavélique de négation de « l’identité » du psychologue…
La maison d’arrêt comporte comme toutes les autres une Unité de Consul-
tations et de Soins Ambulatoires (UCSA), dont le personnel « psy » – psychia-
tres et psychologues – a une approche généraliste de la souffrance psychique.
Autre précision, une psychologue travaillant dans le Centre de Consultations
Ambulatoires en Alcoologie (CCAA) local se rend elle aussi à la maison d’ar-
rêt pour rencontrer une population spécifique : des personnes dépendantes de
l’alcool. Associant un éducateur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Pro-
bation (SPIP), une réunion de synthèse a lieu tous les deux mois entre ces
différents acteurs du « soin psychique ». La situation clinique des détenus que
les uns et les autres prennent en charge y est abordée dans un cadre de « secret
technique partagé » et certains patients sont utilement orientés entre soignants.
Des suivis conjoints – nous veillons à ce qu’ils ne soient pas redondants – ont
également lieu ; par exemple un double suivi psychologique et médical pour
1 La maison d’arrêt où j’interviens est démographiquement trop peu importante pour compor-
ter une Antenne Toxicomanie.

Pascal Hachet
Psychotropes – Vol. 10 n
o
1 49
un toxicomane bénéficiant d’un traitement de substitution. Ces temps de ren-
contre n’annulent bien sûr pas le fait que d’autres réunions de synthèse se
tiennent au sein de chaque institution partenaire.
Lorsqu’il entre en maison d’arrêt, chaque détenu reçoit (en principe…) un
imprimé qui l’informe de la possibilité de me rencontrer, à condition d’avoir
ou d’avoir eu des problèmes de dépendance à une drogue2. Je dispose d’une
boîte aux lettres où le personnel du greffe dépose le courrier que les détenus
rédigent à mon intention. Les Conseillers d’Insertion et de Probation (CIP) du
SPIP et l’équipe de l’UCSA, mais aussi le personnel de surveillance (surtout
au quartier des femmes, où des échanges moins brutaux et basés sur le rapport
de force sont possibles entre surveillants et détenus), font également circuler
des informations au sujet de mes visites. Dans tous les cas, une proposition est
faite – et non une obligation, ce point est crucial sur le plan éthique – aux
toxicomanes incarcérés de me rencontrer. Ces personnes ne sont pas soumises
à une mesure d’obligation de soins3. Précision ergonomique : si le personnel
de l’UCSA dispose de locaux attitrés pour assurer entretiens, consultations et
petits soins, les professionnels « visiteurs » reçoivent les détenus dans de mi-
nuscules pièces sans fenêtre sur l’extérieur et sans ventilation, baptisées « par-
loirs » et qui servent normalement aux rencontres entre les avocats et leurs
clients. Inutile de préciser qu’avant et pendant les sessions d’assises, l’accès à
ces lieux – alors « embouteillés » – devient très difficile.
Après avoir posé le décor de ma pratique, j’en viendrai à l’essentiel de
mon propos : les éléments favorables et les obstacles (avec quelques pistes
pour tenter d’amenuiser ces derniers) aux interventions psychologiques réali-
sées dans ce cadre.
Les éléments qui facilitent
les interventions psychologiques
Tout d’abord, la demande du patient est respectée. L’intéressé n’a nulle
obligation de solliciter ma présence, de sorte qu’il se pose d’entrée de jeu en
acteur de sa démarche.
De plus, mon statut de visiteur professionnel – que j’explique lors du pre-
mier entretien – aide le patient à acquérir une représentation différenciée de
2 Le cahier des charges institutionnel ne m’autorise pas à prendre en charge d’autres person-
nes, en milieu carcéral comme sur le CSST proprement dit.
3 C’est à l’issue de la détention que cette mesure peut être décidée par le juge d’application des
peines.

Quelles interventions psychologiques possibles auprès des toxicomanes incarcérés ?
50 Psychotropes – Vol. 10 n
o
1
mon rôle par rapport à celui de l’administration pénitentiaire et de la justice.
Dans un certain nombre de cas, ceci ôte à l’intéressé le désir de m’utiliser pour
« plaider » son affaire auprès de l’une ou l’autre de ces administrations. Dans
les faits, le patient essaye souvent ; c’est de bonne guerre. Mais il n’est pas trop
difficile de recadrer les choses.
Par ailleurs, je dispose d’une continuité de temps pour ouvrir un espace de
parole et, donc, pour fortifier une demande d’aide. Et le fait que je sache où
trouver le patient est un facteur positif dans son adhésion au caractère régulier
de la prise en charge : à l’issue de chaque entretien, je fixe la date et l’heure du
rendez-vous suivant avec le patient et un surveillant va le chercher dans sa
cellule ou dans la cour de promenade ou encore à l’atelier lorsque ce moment
contractualisé arrive. Par ailleurs, lorsque je présente mon cadre d’interven-
tion à un surveillant nouvellement embauché ou muté, je lui indique que si, à
tel ou tel moment, un détenu avec lequel des entretiens réguliers ont été
contractualisés rechigne à me rencontrer, soit ponctuellement, soit définitive-
ment, je souhaite néanmoins le rencontrer pour qu’il me le dise sans utiliser de
façon désinvolte un intermédiaire.
Un autre point positif réside dans le fait que d’autres professionnels inter-
venant à la maison d’arrêt – comme je l’ai évoqué plus haut – recommandent à
des toxicomanes de s’adresser à moi ; l’accès aux soins est facilité par l’exis-
tence d’un travail en réseau interne à l’établissement carcéral. Tout ne repose
pas sur mes seules épaules ! Cette réalité me protège du désir – qui serait écra-
sant pour moi et menaçant et source de confusion pour le patient – de vouloir
occuper toutes les places dans une prise en charge qui, de façon incontournable
et à l’instar de celle des toxicomanes rencontrés à l’extérieur, requiert fréquem-
ment des interventions pluridisciplinaires et concertées : soutien psychoéducatif,
aide sociale, soins médicaux, etc.
Par ailleurs, en ce qui concerne les toxicomanes ayant un ou plusieurs
enfants, j’ai l’habitude de m’enquérir de ce que l’intéressé a dit ou non à sa
progéniture au sujet de l’incarcération. La tentation est en effet fréquente pour
le patient de faire de son séjour en prison un secret qu’il doit absolument ca-
cher à ses enfants (Hachet, 2002b). Face à un père ou une mère affirmant par
exemple à son fils ou à sa fille lors d’une visite au parloir que « papa ou ma-
man ne rentre pas à la maison parce qu’il a trop de travail, ici, dans cette usine »,
j’invite le patient à faire preuve de franchise et de tact. Il s’agit en effet d’éviter
à l’enfant d’être écartelé entre ce qu’il entend de mensonger au sujet de l’éloi-
gnement prolongé du parent et ce qu’il en perçoit ou observe réellement. Il me
revient d’expliquer au toxicomane qui « croit bien faire » en dissimulant la
vérité – selon lui inassumable par l’enfant ou inutile – de son incarcération
qu’un tel écartèlement psychique est toujours nocif : faisant peu à peu tache

Pascal Hachet
Psychotropes – Vol. 10 n
o
1 51
d’huile, il risque de condamner l’enfant qui le subit à douter systématiquement
et durablement de tout ce qu’il pense, voit, imagine, ressent et fait.
Un dernier point facilitant tient au caractère clos du cadre carcéral4. Cer-
tes, ce cadre attaque foncièrement la capacité des détenus (et sans doute celle
des personnels…) à penser, à ressentir et à sentir (Esneault, 2001) ; et ce fait
est encore accru par le phénomène de « zombification » (Veil, 2000) que pro-
voque la consommation excessive de benzodiazépines et d’hypnotiques, dont
les toxicomanes – on l’imagine sans peine – sont particulièrement friands.
Certes, ces réalités constituent un frein à l’élaboration psychique. Certes, cette
stase relative de la libido se paye souvent – retour du balancier oblige – de
moments où le détenu « déborde » sur un mode mental ou/et comportemental ;
sachant que s’il est alors sanctionné, la détention en quartier disciplinaire le
prive de la possibilité de mettre « à chaud » des mots sur son passage à l’acte
et, partant, de commencer à en enrayer le « montage critique » (Mélèse, 2000).
Pourtant, il semble que le caractère clos du cadre carcéral soit de nature à
favoriser l’émergence d’une forme de vie psychique particulière dans la rela-
tion thérapeutique : j’ai observé à plusieurs reprises dans ce cadre la verbalisa-
tion d’expériences traumatisantes que le patient avait jusqu’alors tues sous
l’effet de la honte et de la peur. Une fenêtre – au sens astronomique d’une
configuration exceptionnelle de corps célestes qui permet de procéder à l’en-
voi d’une fusée ou d’un satellite ou d’effectuer certaines observations au téles-
cope – est alors créée. Dans le détail, cette fenêtre tient à la « conjonction » :
– d’un clivage qui affecte sévèrement le Moi du patient et délimite une zone
où les composantes de sa participation à une ou plusieurs expérience(s)
indicible(s) sont hermétiquement closes (Hachet, 1996),
– d’un espace et d’un temps qui retranchent le patient de la « vie du de-
hors » tout en rendant possible l’instauration d’un espace et d’un temps où
l’intéressé peut tout dire et où le psychologue (ça n’est pas moins impor-
tant !) peut a priori tout entendre.
4 Dissipons toute ambiguïté. Comme je l’ai développé ailleurs (Hachet, 1996b) et à l’instar de
l’ensemble des intervenants en toxicomanie, je rejette sans appel l’idée fascisante selon la-
quelle les murs des établissements pénitentiaires guériraient à eux seuls la toxicomanie. Fausse
sur le plan thérapeutique, car tous les toxicomanes incarcérés et non soignés rechutent à leur
sortie de prison, cette idée est aberrante sur le plan éthique : elle revient à criminaliser un
symptôme et, partant, à cautionner l’équation toxicomane = délinquant avec laquelle les
discours sécuritaires se gargarisent (dont se font l’écho dans notre pays les partisans des lois
d’exception antidrogues et « antidrogués » et le fait que la loi du 31 décembre 1970 prévoit
une amende ou / et une peine d’emprisonnement pour la consommation d’une drogue). Je
constate simplement que la situation d’emprisonnement de sujets qui sont mentalement « pri-
sonniers » du souvenir d’évènements pénibles concourt à l’actualisation des traces psychi-
ques de telles occurrences intrapsychiques et relationnelles dans la relation thérapeutique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%