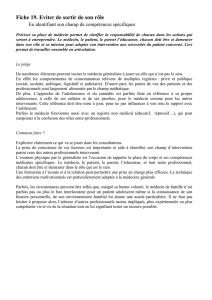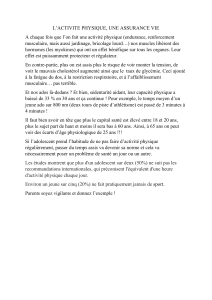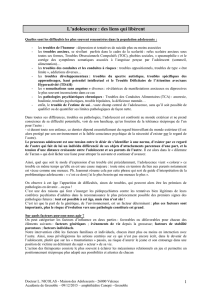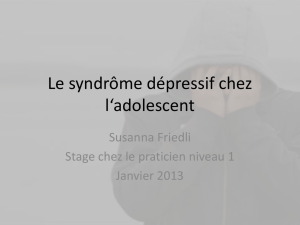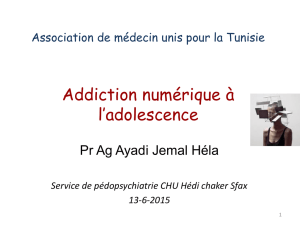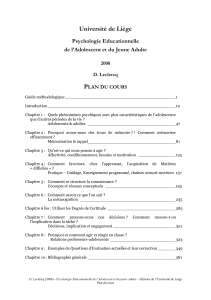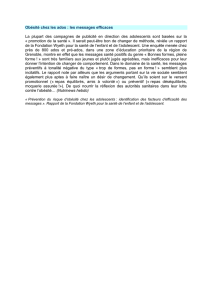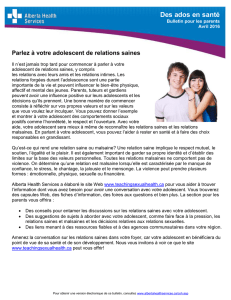Être atteint d`un cancer à l`adolescence : aspects psychologiques

Être atteint d’un cancer à l’adolescence :
aspects psychologiques
Gabrielle Marioni
Introduction
Être atteint d’un cancer à l’adolescence suppose de se confronter à la conjonction de
ces deux événements diffi ciles que sont la maladie et l’adolescence, l’épreuve du cancer
et le travail psychique qui lui est lié entrant en résonance avec les réaménagements
psychiques de la puberté et de l’adolescence. Dans ce contexte, la spécifi cité des enjeux
psychologiques chez les adolescents atteints de cancer repose sur deux problémati-
ques principales qui se font écho. La première est que la survenue d’un cancer en
période pubertaire prend le contre-pied des exigences développementales de l’adoles-
cent. L’adolescent devra mener parallèlement un « travail de la maladie » et un « travail
d’adolescence » dans lesquels corps malade et corps sexué doivent conjointement
faire l’objet d’un travail de représentation. Ce travail d’élaboration est diffi cile, dans
la mesure où le « travail de la maladie » et le « travail d’adolescence » engagent des
enjeux différents, susceptibles de s’opposer, voire de s’effacer l’un l’autre (1, 2). L’ado-
lescence peut alors masquer la maladie ; ou bien, ce qui est plus fréquent, la maladie
masque l’adolescence : l’adolescent met en latence ses interrogations conscientes et
inconscientes sur la transformation de son corps et sur l’avènement d’un corps sexué,
et remet à plus tard la nécessité d’un remaniement des liens avec son entourage.
La deuxième problématique est l’impact de l’adolescence et de ses questionnements
sur l’adaptation à la maladie et à ses traitements. Ceux-ci peuvent, dans certains cas
(de non-compliance par exemple), devenir, pour l’adolescent, des terrains privilégiés
sur lesquels vont se jouer et s’exprimer les confl its pubertaires.
Il apparaît donc fondamental d’analyser et de mieux comprendre la spécifi cité des
diffi cultés psychologiques que peuvent rencontrer les adolescents atteints de cancer,
afi n d’aider les équipes soignantes à répondre le mieux possible, et de façon pluridis-
ciplinaire, aux besoins et aux attentes de cette population.
MP_ados_Dauchy2.indd 37MP_ados_Dauchy2.indd 37 14/10/09 11:42:2614/10/09 11:42:26

38 L’adolescent atteint de cancer et les siens
L’impact sur la structuration de soi à l’adolescence
Hypothèses étiologiques et fantasmes pubertaires
Afi n de la rendre plus tolérable et pensable, l’adolescent essaie de relire et de réécrire
sa maladie en fonction de son histoire individuelle et familiale. Devenant historien
et chroniqueur du passé, il se demande pourquoi la maladie est « tombée sur lui »,
essayant par là-même d’inscrire l’événement dans la continuité d’une quête identitaire
plus profonde et inhérente à cet âge.
La fantasmatique pubertaire infi ltre les théories que l’adolescent se forge sur l’éclo-
sion du cancer et lui donne une coloration toute particulière. Le cancer, d’une part,
peut être vécu comme une punition des premiers élans amoureux, des désirs sexuels
et de la réactualisation des mouvements œdipiens, cette punition venant sanctionner
l’adolescent dans un corps qui se sexualise et qui devient adulte. L’adolescent, d’autre
part, peut inconsciemment percevoir et comprendre la survenue de la maladie comme
un événement venant punir son aspiration à devenir autonome, à se distancier de ses
parents, et à investir l’extérieur du cocon familial : peut-être aurait-il pu éviter le cancer
s’il avait mieux accepté la protection parentale et une certaine dépendance ? Dans ce
contexte et afi n de se protéger, l’adolescent peut inconsciemment choisir de renoncer
aux besoins et aux désirs qui fondent les enjeux de son « travail d’adolescence », et
régresser à des positions de dépendance infantile. Les représentations que l’adolescent
construit sur son cancer et son étiologie sont par ailleurs en partie fonction de l’organe
ou de la partie du corps malades, l’atteinte des sphères génitale et périnéale convo-
quant des problématiques pubertaires particulièrement complexes.
Vécu corporel : un corps étranger doublement persécuteur
Le « travail d’adolescence » concerne particulièrement le corps (3), que les trans-
formations physiologiques liées à la puberté ont fait évoluer vers un corps adulte
en mesure, dorénavant, d’agir les pulsions dans leur double dimension libidinale et
agressive. L’émergence de ce corps nouveau – sexué et désirant – contraint l’adolescent
non seulement à intégrer une nouvelle image de lui-même, mais surtout à subir et
à assister, impuissant, à d’importantes transformations qu’il n’a pas décidées et qui
l’obligent à un travail d’élaboration diffi cile. L’adolescent se demande quand ces chan-
gements vont s’arrêter, à quoi il va fi nalement ressembler. Les manifestations et les
sensations parfois incontrôlables de ce corps nouveau peuvent être vécues avec une
profonde angoisse.
MP_ados_Dauchy2.indd 38MP_ados_Dauchy2.indd 38 14/10/09 11:42:2714/10/09 11:42:27

Être atteint d’un cancer à l’adolescence : aspects psychologiques 39
Dans ce contexte, les transformations corporelles engendrées par la survenue d’un
cancer et par les traitements qui lui sont liés, viennent s’ajouter et se superposer aux
transformations pubertaires, voire les effacer. L’éclosion d’un cancer à l’adolescence
vient donc compliquer voire entraver le travail d’élaboration permettant l’appropria-
tion psychique du corps sexué (ainsi que toutes les problématiques pubertaires qui
lui sont corrélées), corps nouveau que l’adolescent doit pourtant adopter, apprendre
à aimer, et reconnaître comme sien. En outre, le cancer et les traitements qui lui sont
liés, peuvent venir alimenter le sentiment de l’adolescent d’être devenu étranger à lui-
même, voire augmenter le vécu préexistant d’avoir un « corps étranger » persécuteur,
qui l’inquiète et qui fait effraction.
Finalement, l’adolescent doit mener de front un travail psychique important qui
le confronte à un double traumatisme : celui de la violence liée à l’effraction puber-
taire (4, 5) et celui de la maladie. Ce travail d’élaboration psychique apparaît particu-
lièrement complexe et diffi cile, dans la mesure où il confronte l’adolescent, de façon
presque simultanée, à la découverte d’un corps érogène, sexué et de plaisir, très vite
(re)transformé, voire effacé par la maladie et les traitements en un corps agressé,
défaillant et douloureux. Les modifi cations pubertaires et la maladie représentent
ainsi deux phénomènes inédits qui coexistent brusquement, avec la menace toujours
présente que le « corps malade » fi nisse par occulter le « corps sexué », avec toutes les
conséquences que cela peut comporter sur le plan du développement psycho-sexuel.
E ets secondaires des traitements et appropriation du corps sexué
L’appropriation psychique du corps sexué est un enjeu majeur du travail d’adoles-
cence. La possibilité de s’identifi er au parent œdipien de même sexe, l’élaboration de la
bisexualité psychique, la mise en place d’une identité sexuelle défi nitive et d’une orien-
tation sexuelle, la reconnaissance et l’intégration psychique de l’appareil génital du
sexe opposé ainsi que l’acceptation de la masturbation comme moyen de découverte
et d’appropriation du corps sexué, représentent différents éléments qui conditionnent
et favorisent l’accès à une sexualité et à une position subjective adultes.
Dans le contexte de la survenue d’un cancer, l’appropriation du corps sexué est
compliquée voire entravée par les effets secondaires des traitements (perte des poils
et des cheveux, amaigrissement, fonte musculaire, endolorissement de certaines zones
érogènes, atrophie mammaire chez les fi lles). Ces effets secondaires peuvent en effet
être vécus consciemment ou inconsciemment par l’adolescent comme venant effacer
voire attaquer son corps sexué (6), ce fantasme pouvant induire celui d’un retour à
un corps prépubère, infantile et immature ou encore celui d’avoir un corps asexué ou
androgyne. Ainsi, l’effacement du corps sexué par les traitements peut comporter cela
MP_ados_Dauchy2.indd 39MP_ados_Dauchy2.indd 39 14/10/09 11:42:2814/10/09 11:42:28

40 L’adolescent atteint de cancer et les siens
de traumatique qu’il vient non seulement concrétiser et cautionner, par une inscription
corporelle, le désir inconscient et ambivalent de l’adolescent de conserver une position
et une sexualité infantiles – et donc de renoncer à une sexualité adulte – mais aussi
confi rmer et/ou renforcer sa peur inconsciente d’être « incomplet » ou « anormal » sur
le plan sexuel, freiner sa tentative de dépasser l’angoisse sexuelle et pubertaire et enfi n,
justifi er l’interdit fantasmatique, surmoïque et œdipien, de se confronter à l’éveil de la
sexualité et de prendre plaisir aux mouvements libidinaux et érotiques qui lui sont liés.
Dans certains cas plus rares, les effets secondaires des traitements peuvent masquer
voire renforcer, chez l’adolescent, des diffi cultés psychopathologiques d’appropriation
du corps sexué qui préexistaient à la survenue du cancer. L’attaque du corps sexué par
les effets secondaires des traitements vient alors recouvrir et/ou renforcer un rejet déjà
présent, conscient ou inconscient, de la sexualité, qui se traduisait jusque-là par des
troubles des conduites alimentaires ou des conduites à risque à dimension suicidaire,
comportements qui tous témoignaient d’une agressivité exprimée à l’égard du corps
sexué (7). Ce dernier peut en effet être perçu inconsciemment comme un ennemi ou
un persécuteur car source d’éprouvés et de désirs sexuels vécus comme angoissants ou
dangereux. Il importe donc que l’équipe soignante pluridisciplinaire tienne compte de
l’inscription et de la résonance fantasmatique des traitements dans le développement
psycho-sexuel et affectif de l’adolescent atteint de cancer ainsi que de leurs consé-
quences parfois traumatiques.
Parmi ces effets secondaires potentiels des traitements, la question de la préservation
de la fertilité a une place particulière. Les propositions qui visent à préserver la fertilité
(recueil de sperme, préservation ovarienne) sont habituellement abordées avec l’ado-
lescent dès l’annonce du diagnostic, alors que de nombreuses informations concer-
nant le cancer et son traitement doivent également être données. Ces propositions
suscitent des questions complexes qui dépassent les enjeux médicaux soulevés par les
traitements (8, 9) : sont en effet en jeu la sexualité de l’adolescent et son éventuel désir
de devenir parent. Les interrogations liées à l’avenir et à la parentalité (autrement dit
au fait de pouvoir un jour « donner la vie ») se télescopent alors avec celles, opposées,
liées à l’annonce du cancer et des traitements, qui mobilisent chez l’adolescent d’éven-
tuelles angoisses de mort et une diffi culté à se projeter dans le futur. En l’occurrence,
l’adolescent peut avoir du mal à composer avec des questions qui concernent sa sexua-
lité, alors qu’il n’a pas encore nécessairement eu d’expériences sexuelles. L’état de sidé-
ration dans lequel le plonge l’annonce du cancer peut par ailleurs freiner la réfl exion
diffi cile dans laquelle l’engagent les médecins. La préservation de la fertilité convoque
également des questions éthiques et psychologiques complexes qui concernent la place
des parents dans les décisions de l’adolescent. Il s’agit, pour eux, d’accompagner leur
enfant dans ses choix, tout en respectant l’intimité (psychique et corporelle) et l’auto-
nomie dont il a besoin.
MP_ados_Dauchy2.indd 40MP_ados_Dauchy2.indd 40 14/10/09 11:42:2914/10/09 11:42:29

Être atteint d’un cancer à l’adolescence : aspects psychologiques 41
Construction identitaire et sentiment de valeur
L’adolescence constitue une étape majeure de la construction identitaire. En témoi-
gnent d’importantes questions qui apparaissent à cet âge et que l’adolescent se pose
de façon répétitive : « Qui suis-je ? », « Qui souhaiterais-je être ? », « Qui serai-je
effectivement plus tard ? ». En effet, les changements corporels induits par la puberté
entraînent une interrogation anxieuse sur l’identité, une peur concernant la cohé-
sion et l’unité internes ainsi qu’un sentiment d’inadéquation ou d’étrangeté devant la
nouvelle image du corps.
Dans ce contexte, la survenue du cancer à l’adolescence, par l’atteinte corpo-
relle qu’elle suppose et la perte de fonction qu’elle engendre parfois (amputation,
par exemple), renforcent les doutes anxieux de l’adolescent sur son identité. Il existe
notamment une rupture et une discontinuité entre celui qu’il était avant la maladie et
ce que celle-ci a fait de lui.
Atteint dans son corps par la maladie, par les traitements et leurs effets secon-
daires (mucites, alopécie, cicatrices, amaigrissement ou surpoids, séquelles physiques
liées à certaines opérations, etc.), l’adolescent ne se reconnaît plus physiquement. Ces
changements n’apparaissent certes pas brusquement mais sont progressifs et jalon-
nent le parcours médical de l’adolescent. Au cours des traitements, ce dernier doit
successivement composer avec différentes images de lui-même, les assumer et se les
approprier pour ensuite les désinvestir : ceci correspond, par exemple, aux périodes
d’amaigrissement et de prises de poids successives que l’adolescent subit et qui le
mettent en souffrance. L’adolescent se trouve ainsi dans l’obligation d’un perpétuel
réaménagement de l’image physique qu’il a de lui-même, la diffi culté consistant pour
lui à trouver un sentiment de continuité identitaire malgré cette discontinuité et dans
cette discontinuité.
Par ailleurs, l’adolescent ne se reconnaît pas toujours dans ce qu’il est devenu,
psychologiquement, du fait du cancer, et peut en être déstabilisé : « Qu’est-ce que le
cancer a fait de moi ? Qui suis-je à présent ? Mon identité se réduit-elle à celle d’un
cancéreux ? ». Certains adolescents se sentent plus forts et disent que la maladie leur a
donné de l’assurance, une plus grande confi ance en eux-mêmes et en les autres, une
certaine solidité et qu’elle leur a permis de mieux se connaître et de savoir désormais
qui ils sont. D’autres, au contraire, disent se sentir fragilisés par le cancer et craignent
que cette vulnérabilité ne touche de façon durable différents aspects de leur vie. L’ado-
lescent va donc devoir mener un travail psychique particulièrement important, afi n
que la maladie et le corps (même abîmé), puissent malgré tout s’intégrer dans son
identité voire participer à la construction de celle-ci.
MP_ados_Dauchy2.indd 41MP_ados_Dauchy2.indd 41 14/10/09 11:42:3014/10/09 11:42:30
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%