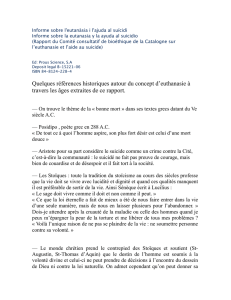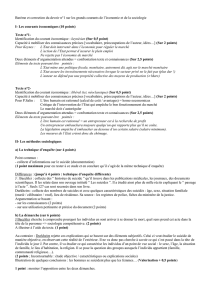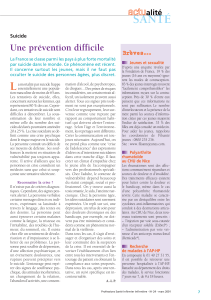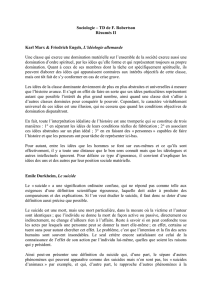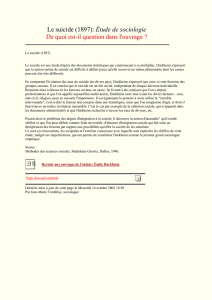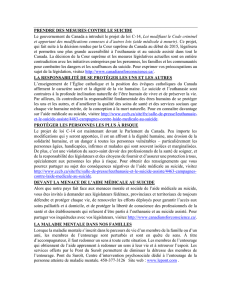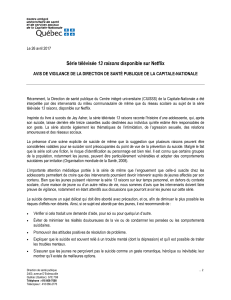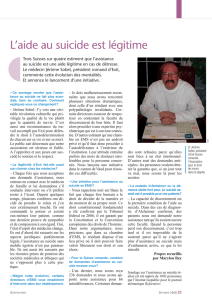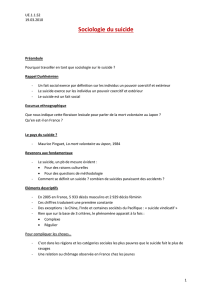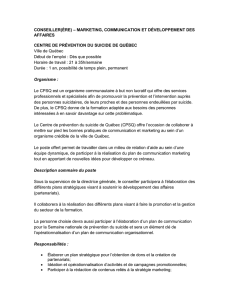I. La méthode sociologique et le suicide

SOCIOLOGIE DE LA SANTE
- Les facteurs sociaux des controverses scientifiques : le cas des neurosciences.
- Un cas d’école : Durkheim et le suicide comme objet sociologique.
- L’anthropologie de la médecine et de la maladie.
- Sociologie de la profession médicale et des professions de santé.
- La maladie comme question politique et problème public.
HISTOIRE DE LA NEUROTRANSMISSION
- L’histoire de la neurotransmission est à la fois :
o L’histoire de la formation d’un concept scientifique : le neurotransmetteur.
o L’histoire de l’opposition de deux théories : théorie chimique contre théorie
électrique.
- En tant qu’histoire de la formation d’un concept scientifique cela relève d’une approche
épistémologique (Georges Canguilhem).
- En tant qu’histoire de deux théories opposées cela relève d’une approche sociologique
(Thomas Kuhn).
- Il faut combiner l’approche épistémologique et sociologique pour comprendre l’histoire
de la neurotransmission.
- L’histoire des concepts scientifiques est expliquée par Georges Canguilhem : « l’histoire
des sciences ne peut être une simple accumulation de faits ni à plus forte raison un tableau
chronologique agrémenté d’anecdotes. Elle doit être une histoire de la formation, de la
déformation et de la rectification des concepts scientifiques. ».
- L’histoire du concept de neurotransmetteur se développe en plusieurs étapes :
1. Naissance : 1900-1910.
2. Validations expérimentales : années 1920.
3. Développements et résistances : années 1930-1950.
4. Maturité : à partir des années 50.
o Synapses.
o Cerveau.
-
- La dynamique générale des sciences. Les idées principales de Thomas Kuhn sont :
o Une révolution est l’abandon d’une structure théorique (paradigme) et son
remplacement par une nouvelle, incompatible.
o Affrontement de communautés : les caractéristiques sociologiques des
communautés guident les décisions. Par exemple la théorie chimique est défendue
par les pharmacologues et les biochimistes. Celle de la théorie électrique est
défendue par les biophysiciens et les électro-physiciens.
- La neurotransmission : dynamique générale
Théorie
Chimique
Electrique
Naissance
1900-1910
1900-1910
Validation expérimentales
Années 20
Années 20
Développement et
résistances
Années 30-50
Années 30-50
Maturité ou régression
Maturité : années 50
Régression Années 50
La théorie électrique suit la même évolution que la théorie chimique. Cette évolution est
symétrique jusqu’aux années 50 où la théorie chimique mature tandis que la théorie
électrique régresse.

I. Construction de la problématique et naissance des hypothèses
- Les neurotransmetteurs sont des molécules de nature variée libérées par des neurones au
niveau des synapses, transmettant des potentiels d’un neurone à un autre neurone, ou
d’un neurone à une cellule effectrice.
- Cette définition montre qu’il est impossible de faire l’historie d’un neurotransmetteur
comme un concept isolé. Il faut comprendre comment est apparu le neurone, la synapse et
le potentiel.
- Pour étudier le concept de neurotransmetteur faut commencer par comprendre comment
s’est construit les notions de bases auxquels il fait référence : c’est la construction de la
problématique.
- Notion de neurone :
o En 1889, l’histologiste Santiago Ramon y Cajal, défend la théorie du neurone (le
tissu est constitué de cellules indépendante).
o A l’époque il y a une autre théorie, de l’italien Camillo Golgi, celle du
réticularisme comme quoi le tissu nerveux est constitué d’un réseau continu.
o Le débat entre ces deux théories à lieu à la fin du XIXème.
o Il faut supprimer la question du réticularisme pour aborder le concept de
neurotransmission.
- Notion de Synapse abordée par Sherrington. Il a comme argument : on ne peut pas
aborder l’action de muscles antagonistes sans avoir recours à l’utilisation de deux
neurones avec deux synapses.
- Le concept d’électrophysiologie. On s’interroge à la fin du XIX sur l’électricité animale,
ce fluide qui est censé se propager à travers les nerfs. Pendant longtemps
l’électrophysiologie hésite, elle passe par plusieurs phases :
o La première phase est une phase italienne avec Galvani, Volta, Nobili, Matteucci.
Elle tend à montrer la vérité de l’existence de l’électricité animale.
o La deuxième phase est une période allemande avec Du Bois-Raymond, Helmholtz,
Hermann, Bernstein. Ils quantifient cette électricité animale.
o Du Bois-Raymond montre l’existence de la différente entre les courants
d’action et ceux de repos.
o Les lois de l’excitation. Le courant nait sous l’électrode
négative : « l’excitation nait à la cathode » (Pflüger en 1848). Ou encore
Du Bois-Raymond (1849) :

La polarisation est liée à la modification de l’orientation des
molécules électromotrices.
Il existe un seuil galvanique indépendant de la durée du courant
excitant.
o Courant locaux.
o Helmholtz (1850) mesure la vitesse de l’influx nerveux qui se propage en
vitesse constance qui est beaucoup plus lente que l’électricité dans les fils
mécanique. Par conséquent il conclut que le courant électrique du neurone
n’est pas analogue à celui d’un fil électrique.
- La neurotransmission chimique. Du Bois-Raymond (1877) : « il doit se former, soit une
sécrétion stimulation sous la forme peut être d’une couche fine d’ammoniac ou d’acide
lactique ou de quelqu’autre substance à la surface du tissu contractile de telle sorte qu’une
excitation violente du muscle ait lieu, soit une influence électrique. ».
On envisage une neurotransmission chimique car on s’intéresse au même moment à
l’action des drogues.
o La théorie qui domine en pharmacologie à l’époque est celle de Claude
Bernard qui étudie les curares. Sa théorie est que les curares agissent sur le nerf
et non sur le muscle : c’est à l’origine de l’action neurotrope des poisons. Le
résonnement pas analogie est moins facile car elle n’implique pas forcément la
neurotransmission.
o Pour Alfred Vulpian le curare n’agit pas sur le nerf mais sur le muscle, il est
contre la théorie d’action neurotrope des poisons. Résonnement par analogie, le
muscle se contracte à l’état naturel grâce à des substances chimiques.
- Il y a d’autres substances chimiques découvertes à la fin du XIX qui ont un rôle de
messager : les hormones. Le contexte devient donc alors favorable à la théorie chimique :
comme il y a une transmission à distance avec des hormones (sang) pourquoi n’en serait-il
pas de même avec la neurotransmission. La première substance proposée comme
neurotransmetteur est l’adrénaline (déjà connue comme neurone).
D’après Claude Bernard la physiologique droit prendre deux directions :
o Physiologie analytique. Identification des hormones et des agents régulateurs.
Démarche vers le moléculaire.
o Physiologie intégrative. Il faut aussi comprendre comment l’organisme fonctionne
comme un tout. Il introduit la notion de système hormonal puis celle de système
nerveux qui arrive, tous deux contrôle l’organisme (deux agents de coordination).
- Physiologie analytique : L’attribution de fonctions moléculaires en physiologie :
o Catalyse (découverte des enzymes).
o Signalisation : transmission nerveuse et endocrine.
o Conduction (fonction dans la conduction des ions). Hypothèses ioniques
membranaires :
o Nernst :
o La « force électromotrice des ions » (1889).
o Hypothèse ionique membranaire de l’excitation (1899).
o Bernstein : hypothèse ionique membranaire de la conduction (1904).
- Physiologie intégrative :
o Claude Bernard, Walter B. Cannon (homéostasie).
o Physiologie nerveuse : Charles Scott Sherrington, Pavlov, Lapicque, ...
o Endocrinologie : Brown-Séquard, Byaliss, Starling, ...
o Ecole de Cambridge : Gaskell, Langley, …
- Naissance du concept : les premiers signaux.
Les « médiateurs chimiques » sont donc à la fois :
o Des agents de la signalisation.
o Des agents humoraux de l’intégration physiologique.

- Commencements historiques des neurotransmetteurs :
o 1901 : Takamine isole l’adrénaline ; Langley étudie ses effets
sympathomimétiques.
o 1904 : Elliott suggère une neurotransmission de nature chimique au niveau des
terminaisons sympathiques.
o 1905 : Langley suggère la notion de récepteur.
o 1914 : Dale étudie les effets parasympathomimétiques de l’acétylcholine et
suggère son rôle de transmetteur au niveau parasympathique.
o 1921 : premières expériences de Loewi.
II. Validations expérimentales
- Il faut prouver l’hypothèse chimique ou électrique.
- L’hypothèse électrique est défendue par un neurophysiologique français appelé Louis
Lapicque.
o La chronaxie est une constante de temps qui sert à quantifier l’excitabilité des
tissus.
o Il est également l’auteur de l’hypothèse électrique de la neurotransmission.
Lapicque dit que pour al transmission électrique est lieu il faut que les éléments est
la même chronaxie.
- L’hypothèse chimique est défendue elle par Otto Loewi. Pour cela il élabore l’expérience
des deux cœurs perforés.
III. Développements et résistances
- Extension périphérique de l’hypothèse chimique :
o Cannon (1921-1931). Il effectue ses hypothèses sur l’organisme entier :
l’homéostasie.
o Henry Dale et Wilhelm Feldberg (1933-1936). Ils prouvent que la transmission
entre le neurone et la cellule musculaire striée est bien également chimique.
- Cette théorie ouvre des perspectives pharmacologiques :
o Identification des neurotransmetteurs : substance ralentissante est identifiée
comme étant l’acétylcholine (Loewi en 1926) et la substance accélérante, la
noradrénaline (Von Euler en 1946).
o Synthèse d’agoniste ou d’antagonistes : développement de la pharmacologie du
SNA :
o Substances sympatho et parasympathomimétiques.
o Substances sympatho et parasympatholytiques.
- Résistances à l’hypothèse chimique :
o Libération du neuromédiateur (par quels mécanismes ?).
o Formation et stockage (on ne connait pas l’existence de vésicule et la chaine
métabolique de synthèse).
o Mode d’action (récepteur pas encore isolé, ce n’est qu’une notion hypothétique).
o Dégradation.
- Résistances à l’hypothèse électrique :
o D’après Nachmanston l’acétylcholine aide au transfert d’énergie.
o John Eccles, lignes de courants permettent la neurotransmission.
IV. Maturité du neurotransmetteur : nouveaux contextes des années 50
- Suite à la guerre il y a trois points importants grâce aux découvertes électroniques :
o Instrumentation nouvelle.
o Nouveau contexte électro-physiologique.
o Nouveau contexte biochimiques.
- Ces trois découvertes permettent :
o La construction de la synapse.
o Extension centrale.
- Théorie ionique de la conduction. On trace le potentiel d’action sur une courbe.

- Preuves électro-physiologiques des synapses chimiques :
o Action post-synaptique de l’acétylcholine (existence des PPM, PPSE et PPSI).
o Caractéristiques temporelles.
- Ces preuves électro-physiologiques des synapses chimiques sont apporté par Hekles
(électrophysiologie qui se reconvertit en chimique). De ce fait de nombreux partisans de la
théorie électrique de la neurotransmission vont le suivre (phénomène sociologique).
- Construction de la synapse chimique : versant post-synaptique.
o Le récepteur comme entité logique : Langley, Clark, Gaddum, Ariens, Stephenson.
o Le récepteur comme entité chimique : Changeux, Nachmananson.
- Extension centrale (au niveau cérébral) de la neurotransmission chimique.
o Avec la découverte de l’axe hypothalamo-hypophysaire amène un nouveau
contexte neurochimique : la neuroendocrinologie.
o Nouveau contexte pharmacologique : l’ère des psychotropes. Avant les années 50
on ne connaissait que quelques psychotropes (LSD, barbiturique). Aujourd’hui on
en connait beaucoup plus (neuroleptiques, etc.). Ces substances révolutionne la
pratique de la psychiatrie on passe de la thérapie de choc (avant guerre) à
l’utilisation de psychotropes. Les médecins vont donc pencher sur la théorie
chimique car cela permet d’expliquer l’action des neuroleptiques. Les médecins
l’adopte même avant l’existence des preuves car elle permet de conforter la
pratique médicale et l’utilisation des médicaments.
Valeur heuristique de la neurotransmission
- Perspectives pharmacologiques.
- Perspectives physiologiques :
o Nouvelles amines cérébrales.
o Cartographie fonctionnelle.
- Perspectives neuro et psycho-pathologiques.
- Neuro-embryologie et synaptogenèse.
- Apprentissage et mémoire.
-
- Extension centrale de la neurotransmission
- Nouveaux transmetteurs : acides amines, peptides.
- La transmission inter-neurale non chimique.
- Les relations neurones / cellules gliales.
L’historie de la neurotransmission
- Montre l’importance des facteurs sociaux alors des controverses scientifiques et médicales
et l’importance de la lutte entre les communautés.
- La révolution des tranquillisants des années cinquante a fait basculer la communauté
médiale dans le camp de la neurochimie alors même que la question de la
neurotransmission n’était pas réglée d’un point de vue fondamental.
UN CAS D’ECOLE : DURKHEIM ET LE SUICIDE
I. La méthode sociologique et le suicide
1. Emile Durkheim et le suicide.
2. Le suicide comme objet sociologique : le fait social
3. Les « règles de la méthode sociologique »
4. Quelques résultats clés de la sociologie du suicide
II. Le suicide : un problème sociologique et un problème social
1. Quelques limites aux résultats : questions d’actualité
2. Représentations du suicide et données statistiques
3. Le suicide comme problème social
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%