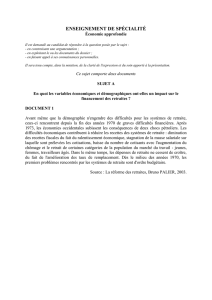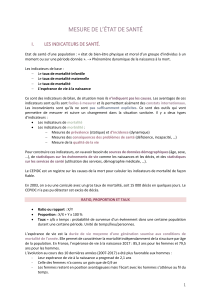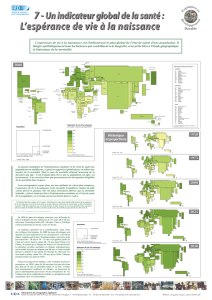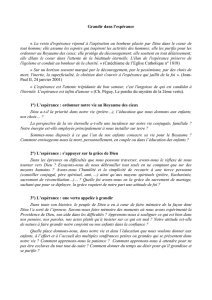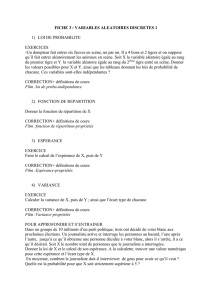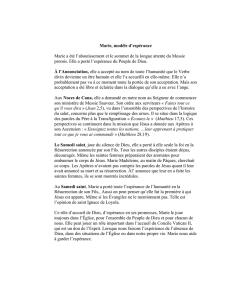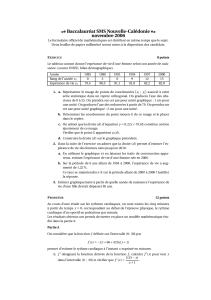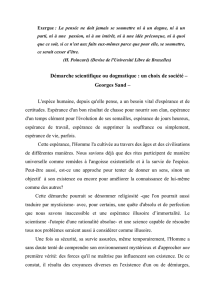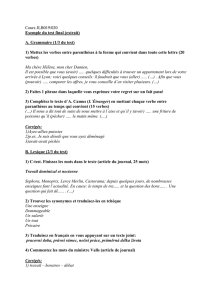L`espérance selon Ricœur

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -
Cracovie, 14-15 octobre 2009.
Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris
-----------------------------------------
1
L’ESPERANCE SELON PAUL RICOEUR
« L’espérance est destinée à ouvrir
ce que le système voudrait fermer »1
Prendre la parole ici, à Cracovie, dans le cadre de l’ « Ignacianum », pour évoquer
« l’espérance selon Paul Ricœur », est à la fois un honneur et une joie. Honneur d’aborder ce
thème dans un pays qui a donné au monde, aux heures les plus sombres de notre commune
histoire, de magnifiques leçons d’espérance, et qui a lié de manière désormais inoubliable
l’espérance et la solidarité. Honneur de le faire dans une ville qui a offert à l’Eglise, pour
entrer dans le troisième millénaire, un pape qui a manifesté à la face du monde que
l’espérance théologale est une force réellement opératoire dans l’histoire humaine, capable de
transformer les situations de mort en promesses de vie. Mais joie aussi de traiter de ce thème
dans le cadre des Facultés jésuites, car j’appartiens à une communauté religieuse qui doit
beaucoup à la tradition spirituelle ignatienne. Et surtout de le traiter selon Paul Ricœur, ce qui
constitue pour moi, en toute rigueur de termes, un « parcours de la reconnaissance ». Il se
trouve en effet qu’en 1961, étudiante à la Sorbonne et devant choisir le thème d’un « diplôme
d’études supérieures », selon la terminologie d’alors, je sollicitai Paul Ricoeur comme
directeur de mémoire, et travaillai sous sa direction justement sur le thème de l’espérance.
Puis les années passèrent et nos liens se distendirent, pour se renouer de manière très profonde
pendant les derniers mois de sa vie, où j’ai pu à plusieurs reprises lui rendre visite à Chatenay
Malabry. Aussi aimerais-je reprendre ici à mon compte les lignes qui ouvrent un de ses
premiers livres, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, en remplaçant simplement le nom de Gabriel
Marcel par celui de Paul Ricœur : « Il fait une expérience étrange, celui qui, ayant un jour
reçu le choc philosophique décisif de la pensée de Paul Ricœur, retourne à l’œuvre qui l’a la
première fois éveillé Cette seconde lecture est pour lui une seconde découverte, comme si le
choc nouveau qu’il en reçoit ne l’atteignait pas au même point de lui-même que la première
rencontre »2. C’est à cette seconde découverte que vous m’avez invitée, et je vous en
remercie.
Une question préalable se pose, quant à la pertinence du choix de ce thème comme clé
de lecture de l’œuvre de Paul Ricœur, et donc aussi quant à sa convenance au thème général
du colloque. En effet, l’espérance n’a pas dans cette œuvre le statut de catégorie
fondamentale, éclairant et renouvelant tout un secteur de pensée, à la différence de notions ou
d’expressions comme celles d’ipséité, d’identité narrative, de configuration/refiguration, de
monde du texte, etc. D’autre part elle n’intervient pratiquement jamais de façon frontale dans
les grandes œuvres de la maturité, même là où on serait en droit de l’attendre, c’est à dire dans
la réflexion sur le temps et sur l’histoire : quelques brèves allusions dans Temps et Récit, et
aucune thématisation explicite dans La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli. Il faudrait plutôt parler
d’un thème en état de diaspora, qui surgit discrètement et disparaît de même, à la manière de
ces sources en terre calcaire dont on suit les résurgences de lieu en lieu sans continuité visible
de l’une à l’autre. En dépit de ces constats, je voudrais défendre l’hypothèse que l’espérance
constitue bien un lieu philosophique de première importance dans la pensée de Paul Ricœur.
Elle traverse l’œuvre entière, depuis l’ouvrage consacré en 1947 à Gabriel Marcel et à Karl
Jaspers auquel je faisais allusion à l’instant, jusqu’à l’émouvant témoignage posthume que
représente Vivant jusqu’à la mort. Plutôt qu’une catégorie, un thème ou même une notion, on
1 CI 486.
2 GM/KJ, 13.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -
Cracovie, 14-15 octobre 2009.
Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris
-----------------------------------------
2
pourrait la définir comme un plan d’intelligibilité spécifique, une sorte d’intentionnalité
irréductible, un selon. C’est ainsi que Paul Ricœur intitule un texte essentiel pour notre propos
« La liberté selon l’espérance », et qu’il y déchiffre, à la suite de Moltmann, le kérygme
chrétien « selon la norme de l’eschatologie », c’est à dire « en termes d’espérance, de
promesse, de futur »3 ; de même il souligne que la description du péché ne peut être que
« l’envers d’une parole de délivrance et d’espérance » qui seule la rend possible4. Ce plan
d’intelligibilité se situe bien souvent comme une région frontière, ou, mieux, une sorte
d’horizon qui ouvre une échappée, comme une trouée entre deux perspectives trop courtes :
entre scepticisme et dogmatisme, entre « consentement stoïcien » et « consentement
orphique », entre une philosophie triomphale de l’histoire et un abandon à l’absurde, entre
une philosophie des limites et une philosophie systématique.
Il s’agit donc, selon l’expression de Ricœur, de déployer un « intellectus spei » qui va
modifier sensiblement, non seulement la conception que le philosophe se fait de sa propre
tâche, mais aussi le type d’articulation qu’il institue entre son travail proprement
philosophique et les sources religieuses auxquelles il se réfère. Peut-être même peut-on tenter
d’y voir, de manière discrète, le nœud qui relie l’une à l’autre son intention philosophique et
ce que j’appellerais volontiers son intention existentielle : la manière qui fut sienne de
formuler le « Me voici » reçu de la Bible ou le « Hier stehe ich » reçu de Luther. Ces trois
manières d’envisager et de pratiquer pour notre compte l’intellectus spei comme une
intentionnalité spécifique et irréductible seront le fil conducteur de mon exposé, et me
permettent de le rattacher sans trop d’artifice à la problématique générale du colloque.
L’espérance, une intentionnalité philosophique spécifique
Il est classique de définir le propos de Paul Ricœur comme une philosophie réflexive,
phénoménologique et herméneutique. De fait, ces trois attributs offrent une structure
commode pour dégager les principaux traits de son approche de l’espérance et en faire
apparaître le caractère décisif. En ce qui concerne le premier, il ne suffit sans doute pas de
noter que Ricœur reçoit de Gabriel Marcel5 une thématique réflexive déjà richement élaborée
sur l’espérance, et de Jean Nabert une profonde méditation sur le mal qui resteront l’une et
l’autre à l’arrière-plan de sa propre pensée. Précoces, ces deux influences seront durables.
Assidu aux fameux « vendredis » où Marcel recevait ses étudiants, Ricœur dit avoir « gardé
de ces séances un souvenir inoubliable » et souligne : « Ce recours à la “réflexion seconde”
m’a certainement aidé à accueillir les thèmes marcéliens principaux sans avoir à renier les
orientations majeures d’une philosophie réflexive elle-même orientée vers le concret6 ». Mais
c’est surtout à Kant qu’il est important de faire référence ici, car c’est la question kantienne de
l’Opus Postumum, « Que m’est-il permis d’espérer ? » qui définit de la manière la plus forte
la composante réflexive de l’intellectus spei. Cette question est en effet en première personne,
et la critique que Ricœur va adresser très vite au cogito cartésien ou au sujet transcendantal
kantien semble laisser indemne, du moins pendant longtemps, le sujet de la troisième question
kantienne. Or celui-ci est non seulement le sujet moral responsable de ses actes, mais, selon la
3 CI 395-396.
4 FC 524.
5 Paul Ricœur n’a pas cessé, tout au long de son œuvre , de marquer sa dette de reconnaissance envers Gabriel
Marcel. : « Gabriel Marcel que j’ose considérer encore comme l’un de mes peu nombreux maîtres, à l’égal de
Husserl et de Nabert » L II, p. 92. Cf. Entretiens Paul Ricœur – Gabriel Marcel, ed. Présence de Gabriel Marcel,
Paris 1967 ; Lectures II, « Entre Gabriel Marcel et Jean Wahl » (1976) ; « Réflexion primaire et réflexion
seconde chez Gabriel Marcel » (1984) ; « Entre éthique et ontologie : la disponibilité » (1988) ; La Critique et la
Conviction (1995), p. 21, 35, 41-44 ; Réflexion faite (1995), p. 16-17.
6 RF 17.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -
Cracovie, 14-15 octobre 2009.
Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris
-----------------------------------------
3
problématique de la Religion dans les limites de la simple raison, celui qui pose et se pose la
question du vœu entier de son vouloir, « die Absicht aufs höchste Gut »7. Il s’agit, dans une
perspective résolument téléologique et réflexive, de l’adéquation de sa volonté au bien et de la
régénération de cette volonté habitée par une visée d’accomplissement, et cependant
incapable de se procurer sa fin par son propre pouvoir. On pourrait en ce sens parler ici d’une
« véhémence du sujet », en quête d’une réappropriation des sources obscures de sa volonté
mauvaise et des fins ultimes de sa volonté bonne - comme Paul Ricœur parle ailleurs de
« véhémence ontologique ». C’est au cœur de cette véhémence du sujet que l’intellectus spei
va se frayer une route.
A cette première caractérisation réflexive, il faut tout de suite ajouter la note
phénoménologique. Elle vaut déjà, dans une large mesure, pour la description que Gabriel
Marcel donnait de l’espérance, et qu’il intitulait de manière significative Esquisse d’une
phénoménologie et d’une métaphysique de l’espérance8. Ricœur commente ce titre en ces
termes : « Le mot phénoménologie rappelle qu’on ne s’attarde pas au contexte psychologique
en tant qu’éprouvé, mais que l’on cherche l’intention de l’expérience sans souci de
l’expliquer, c’est à dire de la réduire à des éléments simples. Respecter le “phénomène”, c’est
à dire la réalité intégrale telle qu’elle s’offre, c’est la comprendre dans sa visée la plus
signifiante et non l’expliquer par sa composante la plus insignifiante »9. Plusieurs des traits
que Ricœur retient de cette phénoménologie marcélienne de l’espérance vont être comme la
cellule mélodique de ses propres développements : la transcendance de l’espérance vis à vis
de tout l’ordre empirique, de tout savoir d’entendement comme de toute maîtrise technique,
sans pour autant s’exiler hors du monde ; sa proximité avec les thèmes de l’épreuve, du mal et
du malheur ; son rattachement au soi et au toi plutôt qu’au moi ; enfin son lien avec « le fond
des choses », qui confère à toute cette description une portée proprement ontologique.
C’est surtout à la fin du premier tome de la Philosophie de la Volonté que la
phénoménologie de l’espérance trouve sa place, mais en même temps sa mise en question,
après la longue enquête qui étend l’analyse eidétique husserlienne au domaine de la volonté et
de l’affectivité. Dans ces pages s’élève, entre stoïcisme et orphisme, la voix frêle et têtue de
l’espérance : « L’admiration, chant du jour, va à la merveille visible, l’espérance transcende
dans la nuit. L’admiration dit : ”le monde est bon, il est la patrie possible de la liberté ; je
peux consentir“. L’espérance dit : “le monde n’est pas la patrie définitive de la liberté ; je
consens le plus possible, mais j’espère être délivré du terrible…”10 Mais surgit en même
temps la question : jusqu’à quel point est-il permis d’introduire l’espérance dans le champ
d’une eidétique de la volonté ? et en retour jusqu’à quel point est-il permis d’en faire
abstraction ? Ce « m’est-il permis d’espérer ? » d’ordre épistémologique, accompagne en
sourdine le « que m’est-il permis d’espérer ? » kantien et souligne le caractère « atopique » et
« aporétique »11 de l’espérance. Il dépasse et déplace l’enquête proprement
phénoménologique. Il la dépasse, car l’espérance ne peut surgir qu’aux confins de la
phénoménologie, là où elle « se transcende elle-même dans une métaphysique », orientant une
« double option » sur la faute et sur la transcendance. Mais il la déplace aussi, car la prise en
compte de la « nuit » d’où monte le chant de l’espérance fait apparaître « une nouvelle
thématique » qui appelle « une nouvelle méthode d’approche »12 : ce sera, avec l’émergence
7 CI 406.
8 Gabriel Marcel, Homo Viator, Prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, Ed. Présence de Gabriel
Marcel, Paris.
9 GM/KJ 77.
10 VI 599.
11L III 40 : L’herméneutique philosophique de l’espérance « est sans lieu, proprement atopique » ; CI 402 :
« L’espérance, en son jaillissement, est aporétique, non par manque, mais par excès de sens. »
12 FC 25.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -
Cracovie, 14-15 octobre 2009.
Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris
-----------------------------------------
4
de la question du mal, la greffe de l’herméneutique des symboles sur la démarche
phénoménologique.
De manière significative, L’Homme faillible ne comportait pas de référence à
l’espérance, car celle-ci ne pouvait intervenir au plan des structures eidétiques encore
abstraites de la volonté ; elle ne le peut que lorsqu’on passe du thème de la finitude à celui de
la culpabilité, c’est à dire au moment où est pris en compte « le régime concret, historique, de
la volonté »13. Le Sitz im Leben de l’espérance est le lieu même où la volonté se heurte à
l’opacité du mal. Dès lors, inséparable de l’épreuve concrète d’une volonté non seulement
faillible, mais coupable, l’intellectus spei doit être médiatisé par les symboles et les mythes
qui font venir « à la lumière de la parole »14 l’expérience obscure du mal humain. On sait que
ce détour par les symboles et les mythes, que Ricœur qualifiera ultérieurement comme sa
première herméneutique15, organise de manière dynamique le champ des mythes du mal
autour du « mythe adamique », affirmé comme « le lieu où on peut le mieux écouter, entendre
et comprendre l’instruction des mythes dans leur ensemble »16. Ce privilège du mythe
adamique le constitue ainsi lui-même en clé herméneutique de l’ensemble de la symbolique
du mal. Il permet à l’auteur, tout en maintenant une épochè rigoureuse de la conviction de foi,
de dépasser le simple comparatisme d’un « don Juan des mythes » pour engager la question
proprement philosophique de la vérité17. Mais pourquoi ce privilège du mythe adamique ?
Son « pouvoir révélant » lui vient certes de sa convenance à l’expérience intégrale, qui lui
permet d’assumer en lui-même les ressources d’intelligibilité portées par les autres mythes18.
Mais surtout, à travers son déploiement et ses reprises dans le corpus des Ecritures juives et
chrétiennes, par le relais des figures d’Abraham, du Fils de l’Homme, du Roi Messie, du
Serviteur de Yahvé, puis du symbolisme paulinien du « second Adam », ce mythe ne regarde
pas tant vers le passé que vers l’avenir, un avenir selon l’espérance : « Dans son passé
repensé, l’Israélite voit une flèche d’espérance ; avant même toute eschatologie, il se
représente l’histoire de ses “pères” comme une histoire dirigée par une “promesse”, tendue
vers un “accomplissement” »19. D’autre part, le mythe adamique, en affirmant, cette fois en
amont du péché, la bonté originaire de toute la création, pose une limite au vertige tragique.
La création est bonne, le péché n’est pas plus la réalité humaine originaire qu’il n’en est la
réalité dernière. Par là même, face à l’opacité récurrente du mal, subi ou commis, le mythe
autorise la « timide espérance », qui « seule pourrait anticiper en silence la fin du phantasme
du « dieu méchant »20.
Nous pouvons dès lors comprendre en quel sens l’espérance peut être dite « entre
phénoménologie et herméneutique » : c’est l’enquête herméneutique, convoquant le mythe
adamique et le mettant en perspective avec la totalité de l’expérience d’Israël et de la
confession chrétienne du salut en Christ, qui permet de dessiner les traits majeurs d’une
véritable phénoménologie de l’espérance. On peut résumer ces traits à l’aide des catégories
pauliniennes maintes fois reprises par Ricœur : l’intentionnalité propre de l’espérance est un
« en dépit de », un « combien plus », et un « afin que ». J’espère en dépit du mal ; j’espère
aussi que là où il abonde, le salut peut surabonder ; j’espère enfin que tout cela advient afin
que miséricorde soit faite à tous. Ou, pour le dire en d’autres termes, l’espérance renvoie à
une phénoménologie en tant qu’elle est une structure intentionnelle spécifique de la
13 RF 25.
14 FC 476.
15 RF 54.
16 FC 523.
17 Cf. FC 525.
18 Cf. FC 549.
19 FC 477.
20 FC 544.

Colloque « Intentionnalité dans la Phénoménologie française : inspirations, controverses, perspectives » -
Cracovie, 14-15 octobre 2009.
Marguerite Léna, Communauté Saint-François-Xavier, Paris
-----------------------------------------
5
conscience ; mais cette structure ne s’atteint pas directement. En raison de son lien avec
l’obscur du mal et avec l’ouverture eschatologique du salut, elle ne peut être décrite que par le
détour des figures et des symboles qui en préservent le sens et l’élan. Le Nouveau Testament
le sait bien, lui qui parle de l’espérance selon la riche symbolique de l’« ancre qui pénètre par-
delà le voile » (Hb 6,19), ou des « arrhes » (Ep 1,14) de l’héritage promis.
Mais alors surgit la question : en recourant à la symbolique biblique et en lui accordant
un statut privilégié, n’avons-nous pas outrepassé le discours philosophique, et glissé
subrepticement vers le discours de confession de foi qui porte les textes bibliques21 ? Comme
on sait, Paul Ricœur pose lui-même la question au terme de son enquête, et y répond par le
cercle herméneutique du « croire pour comprendre » et du « comprendre pour croire ». Ce
cercle impose à la pensée le risque d’un pari, mais aussi l’obligation de vérifier ce pari et « de
le saturer en quelque sorte d’intelligibilité »22. Ce double trait nous conduit au plus près de
l’intention philosophique de Paul Ricœur et nous autorise, me semble-t-il, à faire de
l’espérance moins un thème que le style même de sa philosophie. Un pari sur le sens, qui soit
en même temps une obligation ardente de le chercher et de le promouvoir, n’est-ce pas en
effet une autre façon de définir l’espérance ? Dans l’article consacré à « L’espérance et la
structure des systèmes philosophiques », Ricœur écrit : « L’espérance n’est pas un thème qui
vient après d’autres thèmes, une idée qui clôt le système, mais une impulsion qui ouvre le
système, qui rompt la clôture du système »23. Cette formule rejoint l’analyse beaucoup plus
ancienne d’Histoire et Vérité, consacrée à « L’histoire de la philosophie et l’unité du vrai ».
Après avoir dépassé l’aporie de la tentation sceptique ou éclectique induite par la pluralité
contingente des philosophies, comme celle de leur totalisation en un impérialisme oublieux
des singularités, Ricœur s’arrête à la formule : « J’espère être dans la vérité » et la commente
en ces termes : « Je ne peux pas dire cette unité (du vrai), l’articuler rationnellement et
l’énoncer (…). Je ne peux pas englober dans un discours cohérent l’“ouverture” qui fonde
dans l’unité toutes les questions (…). Et pourtant cette “ouverture” n’est pas absolument
dissimulée ; l’espérance ontologique a ses signes et ses arrhes : plus on approfondit une
philosophie, plus on accepte de se laisser dépayser par elle, (…) plus alors on est récompensé
par la joie de toucher à l’essentiel. » Et il ajoute : « La fonction de cette espérance est de
maintenir le dialogue toujours ouvert et d’introduire une dimension fraternelle dans les plus
âpres débats »24.
Règle de lecture de l’histoire de la philosophie – et on sait combien Ricoeur fut un
fraternel lecteur -, l’espérance est aussi l’impetus qui impose de chercher toujours le « surplus
de sens », l’excès du comprendre sur l’expliquer, la ligne dynamique qui va de l’archéologie
du désir à la téléologie de l’espérance, et qui est mise exemplairement en œuvre dans
l’interprétation de l’œuvre de Freud ou dans le débat avec le structuralisme. On sait que cette
tension de l’expliquer et du comprendre, « thème et enjeu majeur de l’herméneutique »25,
traverse toute l’œuvre, s’enrichissant, se dialectisant et se nuançant de plus en plus, comme si,
là encore, l’espérance d’un sens en excès, d’un « orient du texte » ne pouvait naître que d’un
long affrontement de la pensée aux conditions et conditionnements des réalités en cause, qu’il
s’agisse de la conscience ou de ses œuvres, textes ou institutions. Plus radical que le Credo ut
intelligam, s’élève donc un Spero ut intelligam26, dans lequel on pourrait sans artifice
retrouver la structure du « en dépit de », « combien plus », « afin que » : en dépit du soupçon,
21 FC 566 : « Le hiatus entre la réflexion pure sur la « faillibilité » et la confession des péchés est patent. »
22 FC 574.
23 HB 122.
24 HV 59-60.
25 RF 49.
26 HB 117.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%