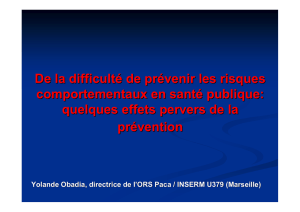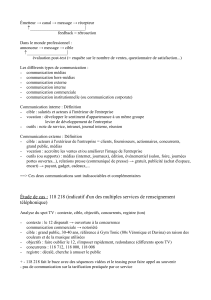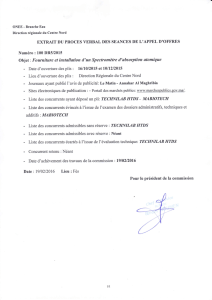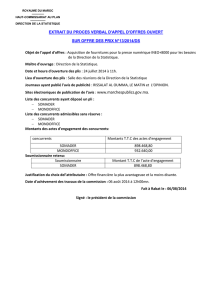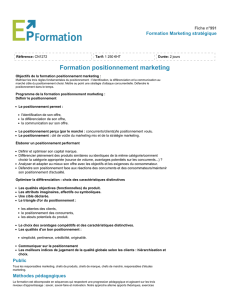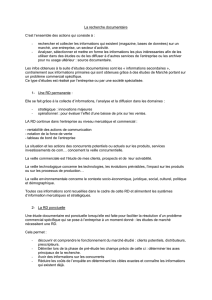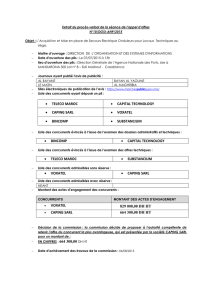1 De quelques causes probables des effets pervers de la

1
De quelques causes probables des effets pervers de la prévention des risques sanitaires :
risques concurrents, risques substituables et déni du risque…
Comment promouvoir la prévention des multiples facteurs de risque pour la santé qui
découlent directement de comportements individuels ou sont aggravés par ces
comportements ? Comment informer le public des risques auxquels il est exposé, pour qu’il
renonce à en courir certains, ou pour le convaincre que d’autres en valent la peine ? Ces
questions ont fait l’objet de nombreuses recherches depuis les années 1980, d’abord dans le
monde anglo-saxon, avec le développement du paradigme psychométrique. Initialement, ces
travaux ne relevaient pas de préoccupations sanitaires : il s’agissait plutôt de comprendre
pourquoi le public percevait « mal » les risques, et plus précisément surestimait ceux associés
à certaines activités industrielles (au premier rang desquelles le nucléaire civil), pour
déterminer comment rendre plus acceptables ces activités et les risques associés, notamment
en les comparant à d’autres.
Au cours des années 1990 les sciences sociales se sont emparées de ces questions pour les
inscrire dans une thématique de santé publique, mais en privilégiant les situations de crise,
par exemple en s’intéressant à la façon dont les autorités sanitaires ont géré telle ou telle
« affaire » (sang contaminé, vache folle…), en particulier du point de vue de la
communication dans les médias. Ces travaux ont mis en évidence les effets pervers parfois
dévastateurs des actions de communication sur les risques : si de façon générale la stratégie
de la transparence tend à supplanter celle de la dissimulation, la première s’avère bien
délicate à mettre en œuvre lorsque la situation est marquée par une incertitude scientifique
forte.
Au-delà de ces « affaires », les fortes difficultés rencontrées par certaines campagnes de
vaccination (en France avec le vaccin de l’hépatite B, en Grande-Bretagne avec le MMR) ont
également montré de façon patente qu’en santé publique aussi la gestion d’un risque doit tenir
compte des risques associés (par exemple, se soustraire à un risque implique souvent de

2
s’exposer à un autre : sclérose en plaque pour le vaccin de l’hépatite B, autisme pour le
MMR), et qu’en la matière l’expert et le profane partagent rarement le même point de vue.
Toutefois, la réflexion sur les effets pervers potentiels des actions de communication sur les
risques, comme sur les risques concurrents (ces deux questions étant bien sûr liées) ne devrait
pas être cantonnée aux situations de crise et de forte incertitude.
Cette réflexion devrait aussi être posée dans le cadre des actions de prévention menées de
façon continue ou régulière sur des grands problèmes de santé publique pour lesquels les
connaissances scientifiques sont solides, et qui relèvent donc bien de la prévention des
risques, et non de la précaution face à l’incertain. Dans ce domaine, la France est
indubitablement en retard sur le monde anglo-saxon, dans lequel les actions de prévention
s’appuient sur des recherches qui constituent un domaine de recherche à part entière, avec par
exemple des tests d’expérimentation de l’efficacité de tel ou tel message préventif, conduits
avec les mêmes protocoles que ceux qui visent à évaluer l’efficacité d’une innovation
thérapeutique, ou encore des enquêtes à grande échelle. Il existe pourtant en France des
gisements d’expérience et de connaissances, sur « ce qui marche » et « ce qui ne marche
pas », ou sur les effets parfois inattendus de tel ou tel type de message préventif. Toutefois
ces gisements restent fragmentaires, et sont concentrés dans certains domaines bien précis :
sécurité routière et sida en particulier, et plus récemment conduites addictives.
L’histoire de la sécurité routière française depuis ces trente dernières années s’avère ainsi
riche d’enseignements, avec une succession de politiques qui marque une inflexion vers une
prise en compte croissante du contexte de la conduite, des motivations et des contraintes de
l’automobiliste, des risques concurrents auquel il est confronté comme de ce qu’il sait ou croit
savoir. Cette inflexion a notamment été initiée en réponse à l’échec relatif de la politique de
résorption des « points noirs » (zones de concentration des accidents) par des actions
préventives excluant les automobilistes, politique qui s’est vite heurtée aux comportements
adaptifs de ces derniers, susceptibles de « compenser » un surcroît de sécurité par une prise de
risque supplémentaire (cf. la théorie dite du « risque homéostatique »).
Dans le cas du sida, les recherches menées en France ont montré l’importance des risques
concurrents (négocier l’usage du préservatif, c’est prendre le risque d’essuyer un refus du
partenaire ou de susciter sa méfiance, risque auquel certaines minorités et certaines tranches
d’âge s’avèrent particulièrement sensibles), mais elles ont aussi exploré les résistances que
rencontre le message préventif. Ces travaux remettent en cause le schéma qui réduit la
communication à une transmission unilatérale d’un émetteur à un récepteur, transmission
éventuellement déformée par des parasites. En effet ces perturbations sont essentielles : elles

3
manifestent la capacité du récepteur à s’emparer du message, à lui donner du sens. Elles ne
sont donc pas réductibles à de simples erreurs, à de la « friture sur la ligne ». Cette
réinterprétation du message préventif a pu ainsi, au moins au début de l’épidémie, contribuer
à nourrir l’idée selon laquelle le sida ne concernerait que certaines minorités (toxicomanes et
homosexuels). En conséquence, une partie de la population a pu penser (et pense toujours)
que pour se prémunir du sida il ne serait pas nécessaire de mettre un préservatif : il suffirait
de bien choisir ses partenaires, en écartant ceux dont on pense qu’ils sont susceptibles
d’appartenir à un « groupe à risque ». Outre son potentiel discriminatoire (qui constitue
finalement un autre risque, social celui-là), ce déni du risque se traduit par un report des
conduites à risque, la stigmatisation des uns contribuant à s’exposer avec (et à exposer) les
autres.
Plus récemment, dans le champ des usages de drogues et des addictions, des phénomènes
similaires ont pu être observés, en particulier aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, mais
aussi en France. Ainsi, avec certes des nuances selon les pays, les politiques de prévention
des usages de drogues menées dans les années 1980-1990, dans un contexte marqué par le
développement de la consommation d’héroïne, ont souvent dressé un portrait très stigmatisant
du toxicomane injecteur, et ont contribué à convaincre la nouvelle génération de l’innocuité
relative de ses propres consommations (de cannabis, d’ecstasy). Il arrive même que des
jeunes qui ont conscience d’avoir un problème avec leur consommation de drogue supposée
« douce » se refusent à franchir la porte d’un centre de soins spécialisés, pour ne pas être
confondus avec « les vrais drogués, ceux qui se piquent ». Quant aux messages préventifs qui
tentent au contraire de lutter contre ce déni en adoptant sans nuance une posture qui fait
l’amalgame entre cannabis et héroïne, des travaux récents suggèrent qu’ils sont inefficaces,
voire même contre-productifs. En outre, le report d’un risque vers un autre ne concerne pas
que la population adolescente et les produits illicites : il semble aussi que les adultes qui
stigmatisent le stéréotype du « camé » soient moins enclins à penser que l’alcool et le tabac
posent aujourd’hui des problèmes de santé publique.
Inversement, la diversification des messages préventifs sur les substances psychoactives
licites et illicites illustre aussi un autre écueil de la communication sur les risques. En effet,
les campagnes de prévention ciblant les usages de tabac et d’alcool à l’adolescence ont nourri
au sein de cette population un discours de déni du risque justifiant par exemple l’usage de
cannabis au motif que les autorités sanitaires elles-mêmes établissent une hiérarchie de
dangerosité des drogues qui situe ce produit à un niveau inférieur à celui auquel sont placées
des substances licites. Plus généralement, cet effet pervers illustre le problème de la

4
multiplication des objets sur lesquels portent les messages préventifs. On trouve aujourd’hui
dans la littérature épidémiologique quantité de conduites à risque et de facteurs de risque,
pour telle ou telle pathologie. A titre d’exemple, on compte ainsi aujourd’hui plusieurs
centaines de facteurs de risque avérés pour les maladies cardiovasculaires. Ne faut-il pas alors
limiter et soigneusement sélectionner les conduites à risque sur lesquels communiquer, pour
éviter d’une part de susciter la lassitude, la saturation du public, et d’autre part de nourrir une
relativisation des risques ?
Cette relativisation peut aboutir à un arbitrage apparemment sous-optimal entre deux
risques (au niveau individuel : refuser de faire vacciner son enfant par crainte d’un effet
secondaire très hypothétique ; au niveau collectif : renoncement d’un pays en développement
à importer du lait, bon marché et riche en nutriments, à cause d’un lien statistique très
controversé entre troubles cardiovasculaires et consommation de lait), ou alors nourrir un
discours de déni fondé sur la comparaison entre risques. On se souvient que dans les années
1990, face à la montée des préoccupations sanitaires concernant le tabagisme passif, Philip
Morris avait réalisé une contre-campagne médiatique s’appuyant sur une littérature
épidémiologique de première main, pour montrer que le risque induit par le tabagisme passif
était en fait plus faible que celui déjà estimé pour de nombreux comportements quotidiens
que nous croyons anodins : boire du lait, boire l’eau du robinet, poivrer son steak, cuisiner à
l’huile de colza, etc. On voit ici que la profusion des facteurs de risque peut devenir un
handicap pour la prévention…
Par ailleurs, pour en revenir aux risques associés, outre les risques concurrents, il importe
de prendre en compte les « risques substituables ». Avant de s’attaquer à une conduite à
risque, il importe de savoir quels besoins elle satisfait, et quels autres moyens l’individu est
susceptible d’utiliser pour y parvenir. Par exemple, si certaines personnes renoncent à utiliser
le tabac pour gérer leur stress et leur anxiété ou pour garder la ligne, alors pour se prémunir
face aux risques concurrents (craquer nerveusement, prendre du poids) ces personnes
pourraient substituer de nouvelles conduites à risque aux précédentes, pourquoi pas en
prenant des médicaments psychotropes sans suivi médical, ou en développant des carences
alimentaires. Bien prévenir une conduite à risque, c’est donc aussi se demander comment
éviter qu’une autre conduite à risque ne s’y substitue pour remplir le même besoin. Bien sûr,
cette question se pose avec une acuité particulière lorsque la conduite à risque en question
constitue en fait une prise de risque délibérée, pratiquée pour les sensations, l’estime de soi ou
encore les ressources identitaires qu’elle procure : il importe donc bien de comprendre la
signification que revêt une telle conduite pour l’individu qui s’y adonne.

5
Pour achever ce panorama très incomplet des gisements de connaissances disponibles sur
les effets pervers des actions de prévention, et sur les premières questions que ces effets
amènent à se poser, ajoutons que les nouvelles dispositions légales prises en 2002 imposent
aux médecins une lourde charge en termes de communication sur les risques avec leurs
patients, en particulier au sujet des risques concurrents (par exemple bénéfices attendus et
risques induits par une intervention chirurgicale). La pratique médicale pourrait donc
constituer une autre source de données sur ces questions, en puisant en France comme à
l’étranger (ainsi le British Medical Journal a-t-il consacré l’an dernier un numéro spécial à la
question : communicating risks : illusion or truth ?).
*
* *
En résumé :
! les actions de prévention qui mettent l’accent sur la contrôlabilité individuelle d’un
risque pourraient accroître les réactions négatives à l’égard des victimes de celui-ci, et
nourrir un déni du risque qui s’appuie sur une stigmatisation de ces victimes (sida,
drogues, mais aujourd’hui aussi, semble-t-il, cancer) ;
! la multiplication des conduites à risque, dans le champ scientifique et corrélativement
dans les messages préventifs, pourrait nourrir également le déni du risque, et aboutir à
des arbitrages inattendus entre risques concurrents ;
! pour prendre la mesure de ces effets pervers, il apparaît nécessaire d’admettre que le
public a des connaissances ou croit en avoir, qu’elles sont souvent vissées à
l’expérience quotidienne et qu’il est difficile de les remettre en cause, les individus
étant prompts à filtrer et réinterpréter le message préventif pour réassurer leurs
pratiques ;
! mieux comprendre et anticiper ces effets pervers implique aussi de recontextualiser la
conduite à risque visée, en définissant quels sont les risques concurrents et quels sont
les risques substituables.
Bien sûr, il s’agit là de pistes de réflexion encore fragmentaires, pas de conclusions
opérationnelles. Mais ces premiers éléments montrent combien il est nécessaire aujourd’hui
de procéder à un travail de synthèse des expériences et des recherches théoriques ou
 6
6
1
/
6
100%