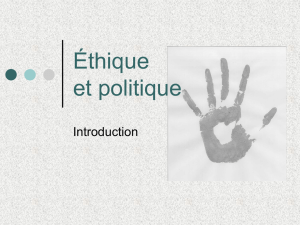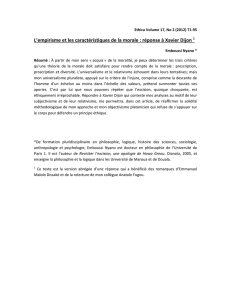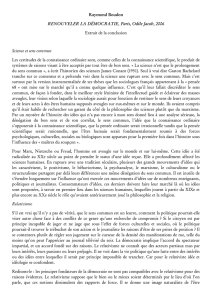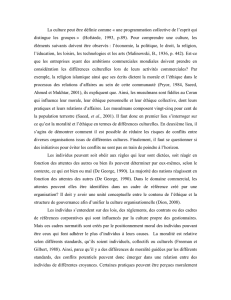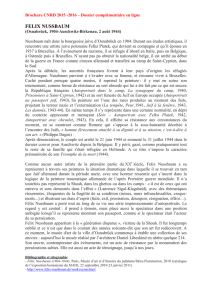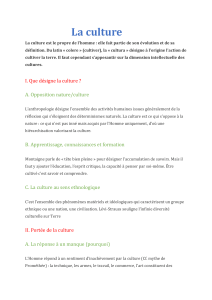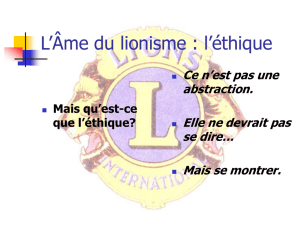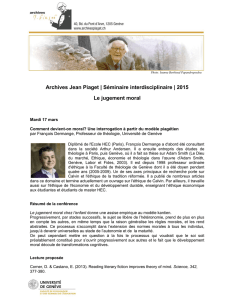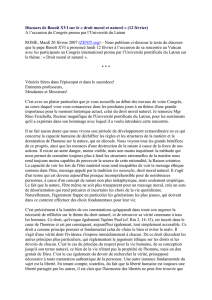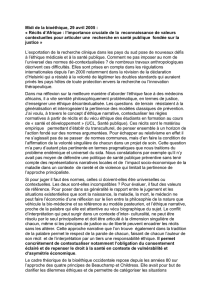Tracés 12 - Tracés. Revue de Sciences humaines

Qui (n’)a (pas) peur
du relativisme (culturel) ? *
NADER N. CHOKR
Pourquoi une question différente ?
À mesure que l’interconnexion et l’interdépendance s’accroissent dans le
monde, et que nous en arrivons peu à peu à reconnaître et à faire le bilan des
« conséquences de la complexité culturelle » (Chokr, a, a) qu’un
tel monde engendre et révèle, on pourrait s’attendre à observer un degré
plus élevé de « convergence morale » entre des individus appartenant à des
cultures variées, ou, du moins, à un « consensus par recoupement »¹ plus
substantiel. De même, on pourrait s’attendre à ce que la « perspective cos-
mopolite » et l’« universalisme moral » qu’elle présuppose aient gagné du ter-
rain pour devenir, à défaut d’être largement acceptés, au moins largement
tolérés². Au lieu de cela, ils sont perçus comme l’expression menaçante de
*Je voudrais exprimer ma gratitude la plus profonde à Li Xiaolin dont la « mélodie de l’âme » me
permet de persévérer, convaincu que la vie n’est pas une erreur. Je voudrais également remercier
la rédaction de Tracés, tout spécialement Eric Monnet et Paul Costey, pour leurs suggestions
bienvenues et leurs commentaires stimulants tout au long du processus de parachèvement de cet
essai dans sa double version. Finalement je remercie les traducteurs pour avoir eu la gentillesse
et la générosité de traduire cet essai en français alors même que la date limite approchait et que
le temps venait à manquer.
J’utilise ici l’expression de Rawls (), en anglais overlapping consensus, sans pour autant
embrasser ni l’étiquette du « libéralisme politique », ni les restrictions ou les conditions parti-
culières qui sous-tendent la pertinence que ces notions ont pour lui. Je l’entends plutôt dans
le même sens que Nussbaum, comme nous le verrons plus tard.
La notion, la question et le problème de la « tolérance » seront, bien entendu, au centre de
ma réfl exion et de ma discussion pour de nombreuses raisons. On l’évoque et on l’utilise sou-
vent, tant pour justifi er le relativisme culturel (en tant qu’il est normatif) que pour critiquer
l’hégémonie occidentale et l’impérialisme culturel. On fait aussi appel à cette notion parce
qu’elle constitue une vertu cardinale du libéralisme occidental et une des valeurs principales
des Lumières, dont le legs est justement remis en question aujourd’hui (voir Graham, ;
Harrison, ).
TRACÉS 12 2007/1 PAGES 25-60

26
l’hégémonie occidentale et de l’impérialisme culturel. En conséquence, ces
dernières années ont vu la prolifération d’affi rmations répétées sur la dis-
tinction culturelle et l’identité nationale, ainsi que de célébrations véhé-
mentes du provincialisme, de l’esprit de clocher, du sectarisme, du commu-
nautarisme, du nationalisme et de fondamentalismes en tous genres, qu’ils
soient religieux ou laïcs. Il va de soi que le spectre du « relativisme culturel »
hante une large part de toutes ces affi rmations et célébrations. L’idéologie
cosmopolite et le chauvinisme culturel (ou le nationalisme étriqué) ne sont,
semble-t-il, plus opposés aujourd’hui, bien au contraire ; ils se renforcent et
se défi nissent mutuellement. A mesure que l’un s’accroît, il gonfl e l’autre.
Cette hypothèse sera aisément confi rmée par quiconque a observé l’état du
monde ces deux dernières décennies.
On peut se demander pourquoi la thèse du relativisme culturel s’est
révélée si résistante sous la lame puissante du « couteau » froid et rigoureux
de la logique et des démonstrations rationnelles. Est-ce parce que, malgré
ses apparents problèmes de constance et de cohérence³, il off re, semble-t-il,
la possibilité d’une exploration en profondeur de la condition humaine et
qu’il nous rend attentifs à de réels et délicats (voire insolubles) problèmes
moraux ? Ou est-ce parce que, bien qu’il soit fondé sur un mode de pensée
profondément problématique et controversé, il peut néanmoins servir les
desseins personnels, idéologiques et politiques (et même confl ictuels) de
ceux qui le défendent ?
Il convient de tenir compte de ces deux types de considérations si l’on
souhaite que la discussion proposée ici soit juste, nuancée et porteuse de
sens. Cependant, en raison des réactions hautement controversées et pro-
fondément troublantes qu’elle pourra entraîner, surtout d’un point de vue
éthique et politique, il est nécessaire d’assurer quiconque les endossera que
nous avons de bonnes raisons de craindre le relativisme, et qu’une telle
crainte (réaction à la fois émotionnelle et intellectuelle) est, de plus, tout
aussi justifi ée que raisonnable. Ce qui attire mon attention ici est le fait
que le relativisme culturel exclut de l’analyse ultime tout jugement norma-
tif ou critique, tant sur le plan intra-culturel que sur le plan inter -culturel.
Selon Putnam, « nous savons tous que le relativisme culturel est inconstant » (, p. ) ;
voir Brandt, , pour une réfutation. Voir cependant Steven D. Hales () pour un bel
eff ort visant à démontrer la constance du relativisme d’un point de vue logique. Voir également
Harman (, , a, b), Wong (, , , ), Walzer () pour d’autres
tentatives, quoique diff érentes, de défense du relativisme moral. Voir enfi n Williams () pour
une tentative d’affi rmation du relativisme normatif de façon cohérente et non défaitiste. Voir
Chokr, *, pour une discussion plus consistante.
NADER N. CHOKR

27
C’est, je suppose, ce qui constitue l’implication la plus accablante d’une
telle thèse d’un point de vue éthique et politique. La voix de la discorde et
de la contestation est rarement, sinon jamais, rarement prise en considéra-
tion (voir Benhabib, ; Wellman, , ). Ma réponse à la ques-
tion normative suivante : « devons-nous craindre le relativisme ? », découle
évidemment de cela.
Cependant, je pense qu’il est nécessaire de faire progresser le débat et
gagner ainsi en clarté dans notre compréhension du problème en se posant
une autre question : « Qui craint (ou ne craint pas) le relativisme (culturel) ? »⁴.
Je soumets cette question avec l’objectif de déterminer qui s’y intéresse,
qui ne s’y intéresse pas, et, plus précisément, pourquoi certains s’y inté-
ressent et d’autres non ; c’est en se concentrant ainsi sur l’enjeu qui oppose
les deux camps que nous pourrons mieux comprendre la façon dont on
use, ou plutôt dont on abuse du relativisme culturel. C’est également ainsi
que nous arriverons peut-être à une meilleure compréhension des éventuels
confl its, divisions et tensions qui risquent de surgir ultérieurement entre
ces deux camps. En outre, c’est en examinant non seulement les arguments
et contre-arguments des partisans et des opposants du relativisme, mais
aussi leurs motivations respectives, les présuppositions qui les sous-tendent,
ainsi que leurs objectifs personnels, idéologiques ou politiques, que nous
pourrons montrer de façon plus eff ective pourquoi le relativisme culturel
est intenable et inacceptable aujourd’hui, en dépit des arguments invoqués
par ses défenseurs. Tour à tour, nous tenterons de déterminer la meilleure
manière de relever et de contrer le défi qu’il implique (Rachels, ; Ren-
teln, ).
Dans cet essai, je propose de discuter la thèse du « relativisme culturel »
tant dans sa version descriptive que dans sa version normative⁵, dans un
eff ort visant à établir puis à remettre en question les raisons de sa persis-
Naturellement, j’ai conscience que cette dernière question a des relents d’empirisme et qu’elle
bénéfi cierait peut-être plus d’un traitement socio-historique, alors que la précédente (telle que
la posent les éditeurs de Tracés) doit être comprise à proprement parler comme une question
normative, ce qui la situe par conséquent dans les limites de la philosophie morale et politique.
Et je n’ai nullement l’intention de me lancer dans une défense de « l’illusion naturaliste », ni
de chercher, de façon quelque peu triviale, à faire glisser vers un « devoir » (une norme, ce que
nous devrions faire) ce qui est de l’ordre de l’« être » (des faits, ce que nous sommes et ce que
nous faisons). Néanmoins, je suis convaincu que notre pensée normative est la meilleure (la
plus réaliste et la plus convaincante) lorsqu’elle est contrainte, d’une certaine façon, par des
questions empiriques pertinentes, sans pour autant qu’elle soit déterminée par ces questions
ou qu’elle en dérive purement et simplement.
Une partie entière est consacrée à une discussion sur la variation normative et sa justifi cation
présumée dans une version plus longue de cet essai (Chokr, *).
QUI (N’)A (PAS) PEUR DU RELATIVISME (CULTUREL) ?

28
tance dans un monde profondément ancré dans une nième vague de « mon-
dialisation »⁶.
Mon angle d’attaque ici est celui que recommande Bernard Williams
dans Ethics and the Limits of Philosophy. « Plutôt que de chercher à savoir
si nous devons penser de façon relativiste, pour des raisons logiques et
conceptuelles, ou si cela est impossible, nous devrions plutôt demander quelle
place nous pouvons raisonnablement trouver pour une pensée de ce genre, et
dans quelle mesure elle répond plus adéquatement à la réfl exion » (, trad.
française , p. ; je souligne). C’est précisément la question princi-
pale qui motive mon enquête. Je suis convaincu que si l’on pousse l’in-
jonction de Williams jusqu’aux limites de sa pertinence, et que si l’on con-
centre nos eff orts à l’intérieur de ces limites, nous parviendrons à mettre au
jour cer taines diffi cultés et certains problèmes moraux réels et sérieux, aux-
quels nous n’aurions peut-être pas assez prêté attention. Mais, plus que tout
encore, nous parviendrons peut-être aussi à mieux appréhender (les raisons
de) l’attraction persistante et puissante que le relativisme exerce depuis plus
de deux mille ans, et qu’il continue d’exercer aujourd’hui sur des indivi-
dus et des groupes d’appartenances philosophique, politique et idéologique
variées, et ce quelles que soient les entraves que leur imposent des considé-
rations purement logiques et conceptuelles⁷. Cette manière d’appréhender
la singulière « résistance » du relativisme à l’analyse logique et conceptuelle
nous off rira alors un point de vue unique, de par son caractère informé, à
partir duquel nous pourrons traiter (la question de) la « crainte du relati-
visme » (Scanlon, ).
Pour rendre plus clairs mes engagements théoriques et méthodolo-
giques, j’insiste sur les avertissements suivants. Bien que j’aie suivi la recom-
mandation de Williams et que je m’approprie et utilise un certain nombre
Contrairement à nombre d’auteurs contemporains qui traitent de ce sujet, je prends ici une posi-
tion bien plus informée d’un point de vue historique, et donc bien plus nuancée et amendée,
sur le concept de « mondialisation » (Chokr, *). Le défi que nous devons relever consiste à
déterminer le sens de ce concept par rapport à la conception (ou plutôt à la fausse conception)
communément acceptée de ce qu’est la « culture » en cette période charnière de l’histoire. Je
montrerai en temps voulu que la thèse du « relativisme culturel » repose sur une conception
inadéquate du concept de « culture », fondée sur des affi rmations et des thèses douteuses et
problématiques. En bref, les relativistes omettent de tenir compte de ce que j’appelle « les consé-
quences de la complexité culturelle » (Chokr, a, a, b [en préparation]), et plus
spécifi quement le fait que la « mondialisation » est invariablement accompagnée de l’adaptation
et de l’appropriation de phénomènes globaux en termes de facteurs et de considérations locales
et particulières (n.d.t. : glocalisation dans la version originale en anglais).
Dans Chokr, *, une longue section est consacrée à ce que j’appelle « d’autres raisons de
son rayonnement persistant quoique fourvoyé ».
NADER N. CHOKR

29
de ses concepts et notions les plus fructueux dans ma démonstration, je n’ai
pas l’intention de situer pleinement mon analyse entière dans le schéma
conceptuel et explicatif que son œuvre suggère. Bernard Williams nous a
indubitablement off ert une des discussions du relativisme moral les plus
profondes, perspicaces et nuancées. Je suis donc favorablement disposé à
utiliser quelques-unes de ses idées, mais seulement comme une partie de
l’arrière plan de mon enquête. Je crois néanmoins, avec quelques autres
sympathiques critiques, que sa contribution est au fi nal confrontée à des
apories, tensions et autres diffi cultés sérieuses (Nussbaum, , p. - ;
Scheffl er, , p. -). Je ne pense pas que sa proposition alterna-
tive à la théorie éthique, ou pour reprendre son expression, au « système
de moralité » (morality system), pourra être suffi sante et satisfaire l’inten-
tion d’une critique normative sociale et politique, qu’il a engagée et qu’il
juge utile. J’essaierai d’expliquer brièvement pourquoi j’entretiens de tels
doutes quand je reprendrai mon examen critique de la proposition alterna-
tive de Williams fondée sur la « réfl exion » et sa recommandation de rempla-
cer les concepts « fi ns » (thin) favorisés par le « système de moralité » par des
concepts « épais » (thick), du genre de ceux qui étaient prédominants dans
la pensée éthique de la Grèce ancienne⁸.
Au fi nal cependant, je suis d’accord avec Williams sur le point suivant.
Bien qu’il soit admis que le relativisme culturel fasse apparaître un pro-
blème général, il vient en réalité soit trop tôt, soit trop tard (Williams, ,
, ). Dans notre cas, et à ce moment charnière de l’histoire, nous
devons reconnaître que l’heure est plutôt tardive. Dans un monde où vont
croissant la mondialisation, la « glocalisation », l’interdépendance et l’inter-
connexion, nous devons tenir compte des conséquences de la « complexité
culturelle » et construire une conception de la « culture » alternative, et plus
appropriée, que celle qui sous-tend le relativisme culturel (Chokr, a,
a, b)⁹. En faisant cela, nous serons mieux capable de saisir les
besoins normatifs, pragmatiques et politiques qui nous sont imposés à ce
Pour les détails, voir Chokr, *.
Parmi les relativistes ici en question, j’inclus tous ceux auto-proclamés et les élitistes « gardiens
de la pureté et de l’intégrité culturelle », comprenant, entre autres, l’ancien Premier ministre
de Singapour, Li Kuan Yew, les offi ciels et plusieurs intellectuels de la République populaire de
Chine, plusieurs autres leaders politiques et intellectuels d’Asie, Afrique et Amérique Latine,
plusieurs chefs religieux et laïques et des universitaires du monde musulman, et un certain
nombre d’intellectuels et de philosophes occidentaux tel que Rorty (), Lévi-Strauss ()
et Lyotard () par exemple, ainsi que de nombreux autres protagonistes dans le monde qui
n’ont pas le courage de se tenir clairement et fermement derrière leur position et croyance et
qui peuvent donc être caractérisés comme des « relativistes cachés et réticents ».
QUI (N’)A (PAS) PEUR DU RELATIVISME (CULTUREL) ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%