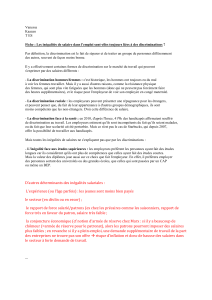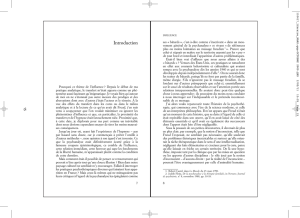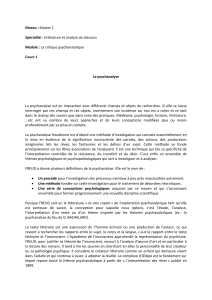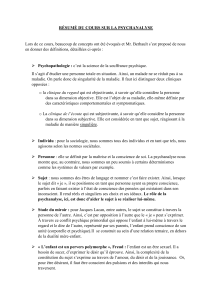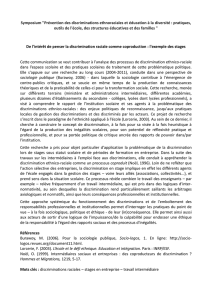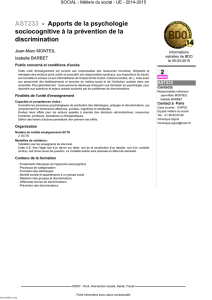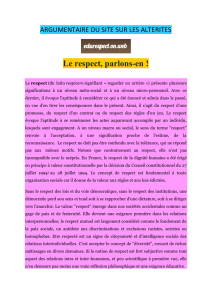Les discriminations sur le marché du travail : le point de vue

Business School
W O R K I N G P A P E R S E R I E S
IPAG working papers are circulated for discussion and comments only. They have not been
peer-reviewed and may not be reproduced without permission of the authors.
Working Paper
2014-408
Les discriminations sur le marché du
travail : le point de vue de la
psychanalyse
Fredéric Teulon
http://www.ipag.fr/fr/accueil/la-recherche/publications-WP.html
IPAG Business School
184, Boulevard Saint-Germain
75006 Paris
France

1
Les discriminations sur le marché du travail :
le point de vue de la psychanalyse
________________________________________________________________________
Fredéric Teulon
IPAG Research Lab, IPAG Business School, Paris, France
« La psychanalyse peut apporter une perspective scientifique aux sciences
psychologiques et sociales déjà constituées, l’inconscient jouant un rôle,
bien souvent primordial, dans la totalité des conduites humaines »
Freud, L’intérêt de la psychanalyse (1913, p. 12)

2
Résumé
Les discriminations en entreprises sont liées à des comportements en partie conscients
et en partie inconscients des employeurs. Elles sont le sous produit d’une circulation
imparfaite de l’information ou la conséquence d’un goût ou d’un « dégoût » vis-à-vis
de certaines catégories de personnes (comportement peu ou pas rationnel lié à des
préjugés). L’article fait le lien entre les discriminations et des schèmes de pensée
intériorisés et refoulés. Les structures symboliques de cet inconscient collectif,
androcentrique ou xénophobe sont mises en avant. Paradoxalement les discriminations
sont renforcées par le fait que les victimes finissent par adopter inconsciemment le
raisonnement qui justifie le maintien des discriminations.
Mots clés Inconscient collectif, discriminations, comportements non conscients,
stéréotypes.
Abstract
Discrimination behaviors in business are related in part to the conscious or
unconscious attitudes of employers. They are the byproduct of a situation where
information flows imperfectly or the result of a taste (or disgust) of some of the
employers (non-rational behavior related to bias). The article makes the link between
discrimination and internalized patterns of thought and turned back. The symbolic
structures of the collective unconscious, male-centered and xenophobic are
highlighted. Paradoxically discrimination are reinforced by the fact that the women or
ethnic minorities dominated, subconsciously, end up adopting the reasoning behind the
continuation of discrimination.
Key words Collective unconscious, discriminations, nonconscious behavioral,
stereotypes.

3
Qu’est-ce que la psychologie et la psychanalyse peuvent apporter à la
compréhension de l’entreprise ? Cette dernière est un monde social et psychique au
moins à un quadruple titre : 1/ la firme résulte d’un acte créateur. L’entrepreneuriat
peut être analysé comme une sublimation, une réalisation détournée d’un désir
socialement inacceptable (pulsion érotique ou de mort) transformée en désir que la
société peut accepter ; 2/ la firme est un assemblage de liens humains qui ne peut
fonctionner que si les sentiments trop négatifs ou hostiles sont refoulés.
L’appartenance de l’individu à un groupe professionnel modifie son comportement
(celui-ci est façonné par le filtre de ce qui est dicible et recevable par les membres
du groupe). L’entreprise peut donc être à l’origine de souffrances psychiques chez
les salariés, mais elle peut être aussi le lieu et le moyen de la réalisation imaginaire
des désirs infantiles (Anzieu, 1975) ; 3/ Le salarié se soumet à la « direction » de
l’entreprise, comme l’enfant qui suit les consignes de ses parents1. Ainsi, le
Directeur général d’une firme occupe la place symbolique du père (identification
liée à l’angoisse originelle de la séparation d’avec les parents, d’où la tendance
régressive des subordonnés). Ceci rejoint la thématique de la « toute puissance »
des managers ou encore celle des rapports entre sexualité et fonctionnement des
organisations (Acker & Van Houten, 1974) et la problématique du leadership
comme construction mentale (Zaleznik, 1989) ; 4/ la firme est prise dans un
environnement qui non seulement agit sur elle (et avec lequel elle doit composer),
mais surtout qui est présent au travers de ses membres, porteurs d’un inconscient
collectif (Jung, 1913).
Dans les sciences de gestion, cette influence du monde psychique sur les
discriminations à l’égard de groupes minoritaires ou stigmatisés est un domaine qui
commence à être exploré notamment dans des travaux anglo-saxons : sur l’identité
au travail (Tajfel & Turner, 1985), sur les stéréotypes masculins (Duehr & Bono,
2006) ou sur le formatage des différences sexuelles par les structures
organisationnelles (Ely & Padavic, 2007). Ces approches se démarquent des études
standards qui ont fait de la discrimination un phénomène essentiellement
économique.2
1 Freud (1927-a) montre que les individus se sont créés un Dieu/Père car ils ont des difficultés à assumer leur
condition d’adulte. La figure du père instaure une relation réconfortante.
2 Voir la section 2 qui présente les travaux de Gary Becker et d’Edmund Phelps.

4
L’objet de cet article est de s’appuyer sur l’approche psychanalytique pour
traiter des discriminations - en matière d’embauche ou de carrière (questionnées
avec les concepts de la psychanalyse). Nous souhaitons contribuer à une meilleure
compréhension des mécanismes inconscients qui sont à l’origine de processus
discriminatoires dans le monde de l’entreprise. La première section rappelle la
réalité des discriminations dans le monde de l’entreprise. Les limites des
explications économiques sont présentées dans la section 2. La section suivante
présente le paradigme psychanalytique comme grille de lecture des comportements
humains. Enfin la section 4 rappelle que la domination dans le monde du travail a
une dimension symbolique.
1. Les discriminations en question
L’ampleur des discriminations est difficile à évaluer car on les assimile souvent
aux inégalités ou à des différences liées à des effets de structure. Sur le marché du
travail, elles correspondent néanmoins à une réalité maintes fois constatée par des
travaux empiriques.
1.1. Un certain aveuglement
Une partie de la littérature s’efforce de minorer l’importance des discriminations.
Ainsi, selon Gilder (1981), il faut dégonfler le « mythe de la discrimination »; la
différence de revenu entre les Noirs et les Blancs aux Etats-Unis reflèterait surtout
une réalité sociodémographique (et donc des effets de structure) : l'âge moyen de la
population noire est inférieure à celle de la population blanche, les Noirs vivent plus
souvent dans le Sud des États-Unis, c'est-à-dire dans des États plus pauvres en
matière de revenus. Enfin, les Noirs sont les principaux bénéficiaires des programmes
d'aide fédéraux ce qui les incite à rester dans la pauvreté. De même Heckman (1998)
estime que la plus grosse part de la disparité de salaires entre Blancs et Noirs est due
à des différences de qualification et non à des discriminations.
En ce qui concerne les discriminations liées au genre, les féministes américaines
estiment que le caractère sexiste de l’entreprise est en partie masqué par la
représentation abstraite du travail (Acker & Van Houten, 1974) ou par la neutralité
apparente des règles de fonctionnement des organisations (Ely & Padavic, 2007). La
pensée organisationnelle traditionnelle que l’on trouve dans les manuels de
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%