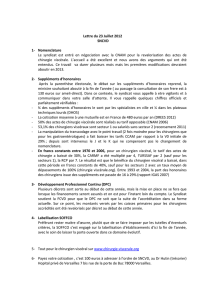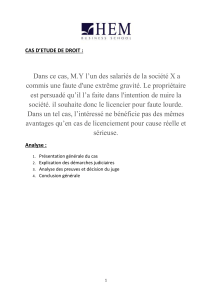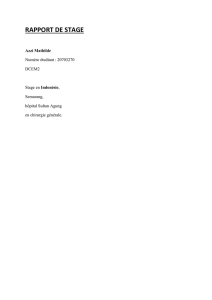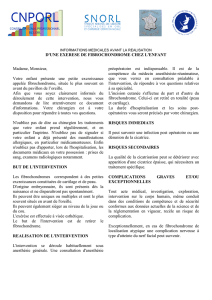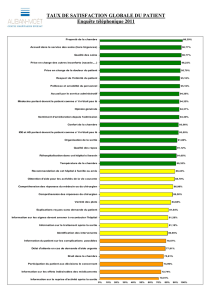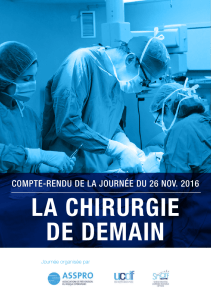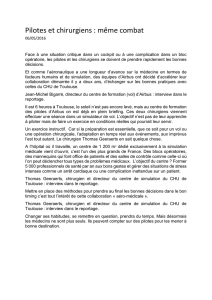La notion de risque en chirurgie - Quand la complication est au

Le Courrier de colo-proctologie (III) - n° 1 - mars 2002
7
ar une première approche juri-
dique, la Cour de cassation avait,
le 20 mai 1936, transformé la responsabi-
lité délictuelle ou quasi délictuelle des
médecins (art. 1382 et 1383 du Code
civil), dont la durée de prescription était
de trois ans, en responsabilité contrac-
tuelle, dont la prescription était trente-
naire ; c’est le fameux arrêt Mercier, qui
stipule qu’un contrat se forme entre le
médecin et son patient.
En vertu du code civil, nul n’a le droit de
porter atteinte à l’intégrité du corps d’une
autre personne. Or, la relation contrac-
tuelle médecin-malade porte sur des
soins, non sur le corps, sauf à considérer
le corps humain comme un objet. C’est
donc le caractère thérapeutique de l’acte
qui autorise, par le biais de la loi, le
médecin à toucher au corps du patient. Ce
n’est pas le consentement d’un patient qui
autorise le médecin à intervenir sur son
corps ; seule la loi le permet, en fonction
de conditions dont le consentement,
obtenu après information, fait partie. Sur
la base de ce contrat, le patient qui s’es-
time victime d’un dol peut engager des
poursuites judiciaires à l’encontre du
médecin. Il lui est malheureusement sou-
vent difficile de prouver la faute du méde-
cin et, jusqu’à récemment, des accidents
médicaux graves n’étaient pas indemni-
sés, faute de responsable.
Les patients et les juges ne l’entendent
Dossier thématique
La notion de risque en chirurgie
Quand la complication est au cœur de l’information
* Institut de la Main, hôpital Saint-Antoine, labora-
toire d’éthique, faculté de médecine Necker-Enfants
malades, Paris.
●
C. Dumontier*
P
CPMars 2002 OK 18/04/02 16:55 Page 7

Le Courrier de colo-proctologie (III) - n° 1 - mars 2002
8
plus ainsi ; la formidable efficacité de la
médecine s’est doublée d’une complexité,
d’une dangerosité, voire d’une agressivité
qui peuvent être à l’origine de dommages
dont on explique parfois mal l’origine.
L’évolution des responsabilités profes-
sionnelles, liée au courant consumériste
des années 1970, a renforcé les obliga-
tions et les contraintes à l’égard des pro-
fessions indépendantes. Cela s’est traduit
par une limitation des clauses visant à
restreindre les responsabilités profession-
nelles. Un des moyens de procéder a été
de renforcer les règles. Le code de déon-
tologie, dans sa dernière version de 1995,
commence par un rappel de ce qu’il ne
faut pas faire. À côté de ces règles clas-
siques, on a vu apparaître un grand
nombre de textes réglementaires “tech-
niques”. Ce renforcement des contraintes
a été accentué par la jurisprudence qui,
d’une part, a pris l’initiative de créer de
toutes pièces certaines obligations acces-
soires et, d’autre part, a renforcé avec une
sévérité particulière l’appréciation de la
portée des obligations imposées aux pro-
fessionnels en développant des régimes
de responsabilité du fait des choses et du
fait d’autrui. Ainsi les chirurgiens ont-ils
une obligation de sécurité vis-à-vis du
matériel utilisé.
L’incursion du judiciaire dans le monde
médical n’est cependant pas un coup de
semonce ni une nouveauté. Elle est,
certes, progressive mais de plus en plus
prégnante. De sujet médical, l’individu
innommé est devenu un malade, puis un
patient (1),un usager, et c’est maintenant
un client qu’il faut satisfaire. Le monde
judiciaire a suivi cette évolution ; l’indi-
vidu a d’abord eu le droit de bénéficier du
savoir médical ; il en est maintenant la
victime plus ou moins consentante.
L’évolution du droit positif, dans notre
pays, se fait vers la responsabilité sans
faute. Pour permettre une indemnisation
plus facile des patients, la Cour de cassa-
tion a rendu un nouvel arrêt, déjà célèbre,
le 25 février 1997, qui renverse la preuve
de la charge, cette dernière incombant
désormais aux médecins. Cet arrêt,
qui s’appuie sur l’article 1315 du Code
civil, est un énoncé général qui relève
qu’“actuellement, tous les professionnels
sont considérés comme tenus, vis-à-vis de
leurs clients, de cette obligation qui revêt,
selon les secteurs d’activité, des formes
diverses, mais qui concerne aussi bien les
prestataires de services matériels que les
professionnels de la vente, les construc-
teurs, les assureurs, les agents immobi-
liers, les agents d’affaires, les agences de
voyages, les notaires, les avocats, les
banquiers, etc.”.
Depuis cet arrêt, qui a déjà transformé
nos pratiques, plusieurs autres arrêts ont
confirmé cette nouvelle tendance : le
médecin doit informer le patient des
risques encourus, de tous les risques, y
compris des plus exceptionnels. Mais
qu’entend-on par risque ?
Q
UELQUES DÉFINITIONS NON
MÉDICALES DU MOT RISQUE
La première difficulté que l’on rencontre
pour définir le risque tient justement à la
multitude des définitions. Ainsi, Le Petit
Robert propose : “Danger éventuel plus
ou moins prévisible”. Le risque, dans son
sens commun, c’est la survenue éven-
tuelle d’un événement négatif (le danger),
qui n’est donc pas obligatoire (“éventuel”
signifie qu’il doit être possible d’y échap-
per), mais qui n’est pas non plus totale-
ment une surprise (donc prévisible).
Les juristes et les avocats ont une définition
très agréable à l’oreille des chirurgiens :
“Éventualité d’un événement ne dépen-
dant pas exclusivement de la volonté des
parties et pouvant causer la perte d’un
objet ou tout autre dommage.” Le terme
“éventualité” a une acception plus scien-
tifique, statistique, qu’“éventuel”. “Évé-
nement” a une connotation plus neutre que
“danger”, mais la fin de la phrase montre
qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur le caractère
négatif de l’événement pour les juristes.
Enfin, je trouve particulièrement savou-
reux le “ne dépendant pas exclusivement”.
Si apparemment les juristes acceptent
qu’existent des aléas, que le chirurgien ne
soit pas toujours responsable de ce qui
survient, il n’en est pas moins sûrement
coupable quelque part.
En médecine, le mot risque est employé
très souvent, mais avec des sens variables.
On parle ainsi du risque de complications,
mais aussi de facteurs de risque, d’un
risque statistique (risque αde première
espèce, risque βde deuxième espèce),
d’un risque relatif, d’un risque absolu,
sans oublier les terrains à risque.
Ces risques concernent les patients, bien
sûr, mais également les chirurgiens !
L
ES RISQUES DU MÉTIER
DE CHIRURGIEN
Malgré sa position apparemment enviable
et son pouvoir “de vie ou de mort” sur le
patient, le chirurgien prend également des
risques en opérant, et c’est volontaire-
ment que je les ai soulignés ici, car ils ne
sont que rarement signalés dans la littéra-
ture non médicale. À une époque où les
chirurgiens revendiquent, comme d’autres
salariés, l’application des 35 heures ou de
divers droits sociaux, il est logique que
les médecins du travail se penchent sur
les travailleurs que nous sommes et sur
les risques auxquels sont soumis les pro-
fessionnels de santé. Stress, angoisse et
fatigue arrivent en premier, mais je ne
connais pas d’études spécifiques aux chi-
rurgiens. Chaque année, un certain
nombre de nos collègues abandonnent la
profession, certains parce qu’ils se sentent
incapables d’en supporter les contraintes.
Le chirurgien abattu par un patient
mécontent reste encore du domaine de
l’anecdote ; toutefois, il nous arrive régu-
lièrement de nous faire insulter, parfois
malmener par des patients irascibles ou
drogués. Ces risques, les médecins en tant
que groupe se doivent de les assumer ;
mais, parce que leur fréquence est incon-
nue, c’est la perception individuelle que
nous en avons qui peut les rendre intolé-
rables.
Le seul risque fréquent pour le chirurgien
est la blessure, avec pour conséquence
l’infection, notamment virale. La préva-
lence des patients infectés par le VIH
(virus du sida) varie, selon les études, de
0,1 à 7,8 % ; mais jusqu’à 19,4 % des
Informer en proctologie
CPMars 2002 OK 18/04/02 16:56 Page 8

Le Courrier de colo-proctologie (III) - n° 1 - mars 2002
9
adultes admis pour une infection de l’ap-
pareil locomoteur sont séropositifs. La
prévalence du virus de l’hépatite B, en
France, est de moins de 2 % mais varie de
moins de 2 à 20 % selon l’origine géogra-
phique des patients. Seuls 10 % de ces
patients sont infectants de façon chro-
nique. La prévalence du virus de l’hépa-
tite C varie de 1 à 2 %, mais la plupart des
sujets sont potentiellement infectants.
Les blessures sont fréquentes en chirur-
gie : 72 % des chirurgiens, toutes spécia-
lités confondues, ont observé du sang sur
leur main en fin d’intervention, et 36 %
ont eu une ou plusieurs projections ocu-
laires (2). La grande majorité des chirur-
giens (86 %) se blessent en moyenne
deux fois par an. Le risque de séroconver-
sion après exposition au sang est très
variable et tient compte de nombreux fac-
teurs. Il varierait, pour une piqûre par
aiguille creuse, de 0,1 à 0,42 % pour le
virus du sida et de 2 à 40 % pour l’hépa-
tite B (dont la vaccination est obligatoire
pour les professionnels de santé) ; il serait
de l’ordre de 1,5 à 7 % pour l’hépatite C.
Bien que faible, le risque de séroconver-
sion n’est pas nul, et, à titre de comparai-
son, rappelons que le risque de décès d’un
soldat américain au Vietnam, en 1968,
était de 0,3 % (3).
Le risque infectieux n’est pas nouveau ;
il fait partie des contingences du métier
et c’est notre honneur d’y répondre. Le
code de déontologie de 1995 rappelle
d’ailleurs, dans ses articles 7 et 9, qu’il est
obligatoire, pour un médecin, de soigner
les patients infectés sans discrimination.
Mais le débat n’est pas clos dans la litté-
rature médicale, notamment chez les plas-
ticiens qui pratiquent des actes de chirur-
gie esthétique, souvent considérés comme
non justifiés médicalement. Si la vision
éthique autonomiste qui prévaut actuelle-
ment considère qu’un patient a le droit de
refuser des soins parce qu’il ne veut pas
prendre un risque opératoire, même si son
attitude paraît “médicalement” déraison-
nable, pourquoi un chirurgien, qui est
aussi un individu autonome et respec-
table, ne pourrait-il pas choisir de ne pas
prendre de risque pour lui-même, sa
famille, son personnel et s’il estime l’in-
dication non justifiée médicalement ? En
France, l’article 47 du code de déonto-
logie dit que c’est possible si un autre chi-
rurgien accepte de s’en charger. Cette dis-
cussion est cependant faussée par le lien
social différent aux États-Unis et en
France. L’autonomie est ainsi mise en
avant dans le monde anglo-saxon et
notamment aux États-Unis, qui sont une
démocratie. En France, nous sommes en
république, et le lien social, fondé sur la
solidarité nationale, ne “permettrait” pas
un tel raisonnement.
Bien que la fréquence des risques pris par
les médecins soit faible, il est important
de rappeler que, dans la relation particu-
lière, privilégiée, du patient avec son
médecin, les difficultés et les risques sont
parfois partagés.
L
ES RISQUES ENCOURUS
PAR LES PATIENTS
Pour les patients, qui sont tout de même
ceux qui prennent le plus de risques, la
notion de risque peut être abordée à plu-
sieurs stades :
●
lors de l’établissement du diagnostic ; en
pratique, on ne parle pas de risque pour le
diagnostic car, le plus souvent, un dia-
gnostic est certain ou non ;
●
quand, après le diagnostic, il faut avan-
cer un pronostic au patient. La notion de
risque est également peu adaptée car, lors
de l’établissement d’un pronostic, le
“risque de se tromper” n’a pas de consé-
quences pratiques. Si un patient a des méta-
stases non vues au terme du bilan, le méde-
cin se trompera dans le pronostic de survie,
mais personne, à aucun moment, n’aura le
sentiment d’une faute, ne croira avoir sous-
estimé un risque qui, par définition, est
inconnu des deux acteurs ;
●
c’est donc surtout avant la réalisation de
gestes invasifs, donc dangereux, au pre-
mier rang desquels figure la chirurgie, que
la notion de risque est importante. Ce
risque, il faudra le définir puis le chiffrer.
Le chiffrage du risque
Les épidémiologistes, dont les travaux
nous servent à établir des pronostics, uti-
lisent également le mot risque. Ils définis-
sent un risque relatif, chiffre sans dimen-
sion qui est le plus souvent un facteur
multiplicateur : “Le fait de ne pas porter
la ceinture de sécurité multiplie par deux
le risque de blessure grave lors d’un acci-
dent de voiture.” Ce risque relatif intro-
duit une notion complémentaire : le fac-
teur de risque qui peut augmenter ou
diminuer le risque de maladie ou de com-
plications. Le chirurgien n’est plus, alors,
le seul responsable de la survenue d’un
risque.
Le risque absolu des épidémiologistes est
un pourcentage : “La probabilité de décès
par maladie cardio-vasculaire est de
10 % à 5 ans chez les hypertendus.” Le
mot “probabilité” renvoie aux statis-
tiques dont la médecine est friande. La
statistique est un mode de raisonnement
permettant d’interpréter des données,
dont le caractère essentiel est la variabi-
lité. On confond souvent variabilité et
imprécision. En médecine, l’imprécision
n’est pas liée à la faiblesse des moyens de
mesure. Elle est intrinsèque à la biologie.
Le nombre de personnes qui auront une
complication dans l’année qui vient ne
peut qu’être estimé. On ne peut que don-
ner une fourchette, et cette fourchette,
qu’on appelle un intervalle de probabilité,
ne contient d’ailleurs pas forcément la
valeur exacte, puisque, très souvent, le
risque α (encore un autre sens du mot
risque : celui de se tromper) est choisi à
5%.
En statistique, on définit une population
à partir d’un échantillon. C’est-à-dire
qu’on ne peut pas connaître le résultat
a priori, mais seulement a posteriori
par l’observation, ce qui est très difficile
à accepter pour les patients. C’est a pos-
teriori qu’une technique prometteuse se
révèle plus dangereuse qu’une autre.
Notre pratique abonde ainsi en techniques
ou en médicaments qui ont disparu
pour avoir entraîné des complications
majeures. Les publications initiales de
nouvelles techniques ne comportent pas,
le plus souvent, l’ensemble de leurs com-
plications potentielles. Ces complications
apparaissent petit à petit, sous la forme de
Dossier thématique
CPMars 2002 OK 18/04/02 16:56 Page 9

Le Courrier de colo-proctologie (III) - n° 1 - mars 2002
10
cas cliniques, l’ensemble formant un
corpus de données dont la fiabilité et la
précision augmentent avec le temps. La
pratique de la chirurgie, spécialité qui
évolue très vite, rend très difficile l’acqui-
sition de connaissances fiables et vali-
dées. En orthopédie, on a ainsi, pendant
plus de cinq ans, conduit une étude très
coûteuse sur l’intérêt de certains ciments
dans l’implantation des prothèses. Les
résultats sont sans intérêt, car les tech-
niques ont changé (4) !
Très souvent, l’information n’est même
pas disponible dans la littérature ; la méde-
cine fondée sur des preuves ne représente
au mieux qu’un tiers de la pratique médi-
cale !
Dans une enquête en chirurgie de la main,
que nous avons menée sur les complica-
tions de la chirurgie des lambeaux (5),les
données intéressant les patients (durée
d’arrêt de travail, pourcentage de nécrose,
etc.) étaient inconnues dans la littérature
dans plus d’un tiers des cas. Comment
informer un patient d’un risque, alors que
l’information sur la fréquence de ce
risque n’existe pas ? Quand les données
étaient connues, leur fréquence de surve-
nue présentait des marges de variation
énormes ; le taux de douleur au froid
après chirurgie des lambeaux variait de
0 à 100 % selon les publications !
Difficile, dans ces conditions, de fournir
une information de qualité à un patient.
Le chiffrage du risque tel que le demande
les patients et les juges est en fait une
donnée floue, imparfaite, une estimation,
une probabilité. Ce chiffrage est encore
modifié par le terrain (à risque) du
patient, donnée également mal connue. Il
est impossible d’indiquer le risque précis
d’une complication à un patient. Quand
les données sont connues, le chirurgien ne
peut que proposer une estimation qui,
pour être exacte scientifiquement (risque
αchoisi à 5 %), est obligatoirement large
et donc peu informative.
Le risque pour le patient tel qu’il est
perçu par le chirurgien
La notion de risque, telle qu’elle est per-
çue par les patients et les chirurgiens,
s’applique surtout aux actes invasifs, au
premier rang desquels sont les actes chi-
rurgicaux.
Pour le patient, il y a deux sortes de risque :
celui des complications périopératoires
et celui d’avoir un mauvais résultat. À
l’heure actuelle, la relation contractuelle
qui prévaut depuis l’arrêt Mercier, même
si elle a évolué, prévoit une obligation de
moyen mais non de résultat. Je n’entrerai
donc pas dans l’appréciation du mauvais
résultat mais seulement dans celle des
complications périopératoires.
Si on demande aux chirurgiens de définir
les “complications” auxquelles est exposé
le patient, on s’aperçoit qu’ils les perçoivent
comme étant liées au patient. Nous avons
parfois peur de ne pas pouvoir réaliser le
geste technique demandé, de ne pas réus-
sir. Mais, dans notre perception, c’est en
général la faute du patient si les éléments
anatomiques sont difficiles à disséquer, si
les vaisseaux sont fragiles et saignent
facilement, si la cicatrisation est lente. Il
est évident que tous les patients ne se res-
semblent pas, et que des gestes courants
sont parfois difficiles sur certains terrains.
C’est aussi à la notion de terrain que le
chirurgien se raccroche pour expliquer
pourquoi certains patients sont plus sus-
ceptibles que d’autres d’avoir des compli-
cations : le diabétique ou le coronarien
qui décompense ; l’obèse ou le tabagique
chez qui les études, notamment nord-
américaines, ont montré la plus grande
propension à avoir des complications,
renvoyant ainsi au patient la responsa-
bilité des complications. Le malade
“pourri” (parce que très fragile et deman-
dant encore plus d’attention) devient ainsi
un “mauvais” malade.
Cependant, et sous réserve que les expli-
cations aient été correctement données et
adaptées au degré de compréhension du
patient, il reste des patients qui prennent
eux-mêmes des risques supplémentaires.
Celui qui enlève son plâtre avant consoli-
dation, qui ne fait pas ses pansements, ne
se présente pas aux contrôles, ne prend
pas son traitement, etc.
Quelle que soit l’opinion que l’on puisse
avoir sur une attitude qui paraît “médicale-
ment” déraisonnable, ces risques, ce sont
quand même les patients qui les prennent.
Peut-on les définir plus précisément?
Les risques encourus par les patients
On peut les diviser en trois groupes : les
risques d’infection et les autres complica-
tions périopératoires, arbitrairement répar-
ties en complications liées à une faute du
chirurgien et en complications sans faute
décelée – le fameux aléa thérapeutique.
L
ES COMPLICATIONS INFECTIEUSES
Elles sont séparées pour deux raisons : la
première est inhérente à leur fréquence et
à leur gravité. Selon les estimations, on
considère que 7 à 10 % des patients hos-
pitalisés sont victimes d’une infection
contractée à l’hôpital. La mortalité
annuelle de ces infections est supérieure à
celle des accidents de la route. En chirur-
gie, une infection est dite nosocomiale si,
absente lors de l’admission, elle survient
dans les trente jours qui suivent une inter-
vention, ou s’il y a mise en place d’une
prothèse ou d’un implant dans l’année qui
suit l’intervention.
La deuxième raison est liée aux nom-
breux textes de lois et décrets parus pour
lutter contre ces complications, car le
patient se croit fondé “à exiger une sorte
de droit à la sécurité physique”, selon les
termes du doyen Auby. Ces textes disent
clairement qu’en cas d’infection noso-
comiale, la faute est présumée. Cette pré-
somption de faute a été instituée dès 1988
par le Conseil d’État, et la Cour de cassa-
tion est allée plus loin, dès 1996, en par-
lant de présomption de responsabilité.
Depuis trois arrêts rendus le 29 juin 1999,
la Cour de cassation a introduit la notion
d’une “obligation de sécurité résultat” au
visa de l’article 1147 du Code civil. Le
médecin est tenu vis-à-vis de son patient,
en matière d’infection nosocomiale,
d’une obligation de sécurité-résultat dont
il ne peut se libérer qu’en apportant la
preuve d’une cause étrangère.
Et pourtant, tous les patients ne sont pas
égaux devant le risque infectieux, ce dont
Informer en proctologie
CPMars 2002 OK 18/04/02 16:56 Page 10

Le Courrier de colo-proctologie (III) - n° 1 - mars 2002
11
le législateur ne semble pas avoir pris
conscience. Si certains terrains (diabé-
tiques, immuno-déprimés, etc.) sont plus
à risque que d’autres, quelle attitude doit-
on avoir en préopératoire ? Si une attitude
éthique commande de ne pas faire de dis-
crimination, la réalité pratique, et notam-
ment la pression assurantielle, pousse,
pour ne pas prendre le risque d’être
condamné, à refuser certains patients.
L
ES COMPLICATIONS FAUTIVES
Elles sont rarement mises en avant, et la
compétence du médecin reste un tabou.
Les ordonnances de 1996, dites ordon-
nances Juppé, avaient bien prévu que les
médecins soient évalués, mais le corps
médical dans son ensemble a refusé une
mesure que je trouve, à titre personnel,
parfaitement logique et même souhai-
table.
Car certaines complications sont liées à
une faute du chirurgien. En théorie, nous
devrions être condamnés, sans discussion
de notre part ; mais il est souvent très dif-
ficile à un patient de prouver la faute
médicale. Les chirurgiens se défendent en
plaidant la difficulté technique, la variabi-
lité anatomique, la fragilité particulière
du patient ; on invoque le code de déonto-
logie pour ne pas dénoncer un confrère
fautif, et les experts, eux-mêmes chirur-
giens, protègent parfois outrageusement
les collègues accusés.
Celui qui fait n’importe quoi, ou qui le
fait mal parce qu’il ne sait pas le faire, est
fautif, dit le code de déontologie dans son
article 70. Aux États-Unis, le code
d’éthique des médecins énonce qu’il est
du devoir des chirurgiens de protéger les
patients en dénonçant les collègues mau-
vais et/ou dangereux !
Ces notions peuvent paraître provoca-
trices, mais le Dr Bolsin raconte très bien
le véritable combat qu’il a dû mener pour
tenter d’empêcher deux chirurgiens car-
diaques pédiatriques de réaliser certaines
interventions. Sur 53 interventions réali-
sées, ces deux chirurgiens avaient eu
vingt-neuf décès et quatre séquelles céré-
brales majeures, un taux de complication
cinq à dix fois supérieur à la moyenne
nationale anglaise ! Malgré des enquêtes,
des réunions de travail avec l’ensemble
des anesthésistes, les autres chirurgiens
cardiaques et même le responsable médi-
cal de l’université, il a fallu plus de six
ans à cet anesthésiste pour qu’une
enquête soit diligentée et les responsables
punis. Les chirurgiens ont continué
d’opérer pendant plusieurs mois après
leur mise en cause dans la presse natio-
nale ! L’anesthésiste a été obligé d’émi-
grer en Australie, la communauté médi-
cale locale lui reprochant trop
ouvertement d’avoir jeté l’opprobre sur
les médecins !
Comme l’incompétence n’est pas une
faute reconnue par la loi, les chirurgiens
en question ont été condamnés pour ne
pas avoir précisé aux parents le risque de
mortalité, entre leurs mains, lié aux inter-
ventions pratiquées (on voit apparaître ici
la notion de défaut d’information person-
nalisée), et le responsable médical du
CHU a également été condamné pour ne
pas avoir su faire cesser ces pratiques. À
la suite de ce scandale, qui coûtera au
contribuable anglais plusieurs millions
d’euros, le système universitaire a été
entièrement repensé en Angleterre, et la
notion de centres de références mise en
exergue.
Cet exemple est, bien sûr, extrême, mais
de plus en plus, et fort logiquement, il
nous sera demandé de prouver notre com-
pétence. Sommes-nous capables de don-
ner les résultats de telle ou telle tech-
nique, quand c’est nous qui la réalisons ?
Nous sommes-nous évalués?
En théorie, une nouvelle technique s’ap-
prend dans des livres (non oralement dans
un congrès), se pratique sur des sujets
anatomiques, puis sur des patients sous le
contrôle de quelqu’un qui sait. En théorie
toujours, le patient devrait être prévenu
lorsque nous réalisons une technique pour
la première fois… L’expérience quoti-
dienne montre que nous sommes loin
d’être irréprochables, et qu’il est alors
logique que les patients perdent la
confiance qu’ils nous témoignent si
volontiers. Le risque que prend le patient
est aussi fonction de la compétence du
chirurgien : c’est un paramètre que l’on
ne peut pas négliger. L’évaluation propo-
sée par les ordonnances Juppé aurait été,
à mon sens, un des moyens de regagner la
confiance des patients en prouvant au
moins notre compétence théorique et
technique.
Alors, certes, l’erreur est humaine, mais
c’est le patient qui en est la victime, et la
logique voudrait qu’il soit protégé. C’est
pour cette raison que l’obligation d’infor-
mation a été opposée aux médecins.
Puisqu’on ne peut pas prouver la faute
face à une complication grave, le méde-
cin doit prouver qu’il avait prévenu des
risques qui sont survenus.
L
ES COMPLICATIONS NON FAUTIVES
Ce sont les complications qui viennent en
premier à l’esprit, raison pour laquelle je
les aborde seulement en dernier. Chaque
pathologie a ses propres complications :
en colo-proctologie, la chirurgie hémor-
roïdaire peut se compliquer de sténose, la
chirurgie des fistules, non. Il y a égale-
ment des complications générales com-
munes à une spécialité : la phlébite de la
chirurgie digestive, les hémorragies post-
opératoires. La connaissance de ces com-
plications passe par une analyse complète
de la littérature. Elles sont plus fréquentes
chez certains patients (les patients à
risque !), qui peuvent également faire des
complications d’ordre général – la dé-
compensation du diabétique, du corona-
rien, de l’insuffisant rénal – et celles
induites par cette décompensation.
Quand survient une complication et
qu’aucune faute ne peut être mise en évi-
dence (avec les réserves déjà émises), on
parle alors d’aléa thérapeutique, qui
devrait bientôt être indemnisé si le projet
de loi voté par l’Assemblée l’est égale-
ment par le Sénat.
Les chirurgiens attendent avec impatience
ce projet de loi sur l’aléa thérapeutique,
dont ils pensent qu’il permettra d’indem-
niser les patients victimes de risques qui
nous paraissent imprévisibles. Si cette loi
a mis tant de temps à être proposée, c’est
Dossier thématique
CPMars 2002 OK 18/04/02 16:56 Page 11
 6
6
1
/
6
100%