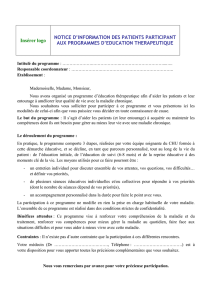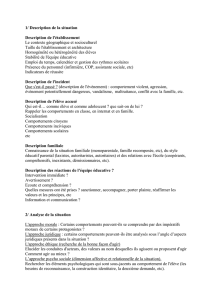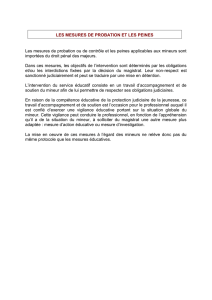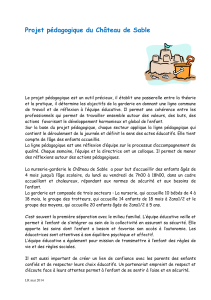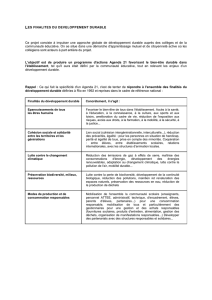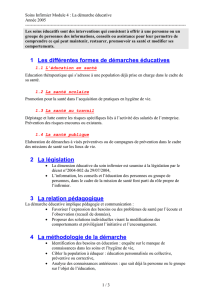communauté éducative ou société scolaire démocratique

Ce livre est tout à fait passionnant, il démontre comment la question des rapports
entre les parents et l’école reçoit des réponses diversiées sans qu’une ligne
cohérente se dégage. Cette dispersion des expériences vient, nous semble-t-il, parce
que, pour une part, ce problème est mal posé. L’intérêt du livre réside notamment
dans la qualité du recueil des expériences et dans le respect de ce foisonnement.
Cela permet de prendre conscience que tous les registres ne sont pas possibles en
même temps, que les expériences ne renvoient pas toutes à la même conception
de la démocratie scolaire. Cette préface, en prenant appui sur une sociologie de la
modernité démocratique, tente d’opérer des distinctions conceptuelles an de ne
pas établir une équivalence entre toutes ces expériences, même si elles partent d’une
même et bonne intention initiale.
La «communauté éducative» n’existe pas
Le livre commence par le rappel d’une citation de Nicolas Sarkozy pendant
la campagne présidentielle de 2007: «Les parents ne sont pas membres de la
communauté éducative, ils sont les premiers responsables de l’éducation de leurs
enfants.» C’est un renvoi explicite à la loi d’orientation sur l’éducation – n° 89-486
du 10 juillet 1983 – (dite loi Jospin) et plus précisément à l’article 11. «Les parents
d’élèves sont membres de la communauté éducative.» L’énoncé polémique, si je le
comprends, insiste sur la hiérarchisation, les parents sont «premiers» et non pas
simplement membres de la communauté. Si cet énoncé est possible, c’est parce que,
dès le départ, il y a ambiguïté sur le sens du mot «éducation» dans la loi, et bien
PréFaCE
Communauté éduCative
ou SoCiété SColaire démoCratique ?
FraNçois dE siNgly

4 12
Préface
au-delà. Faisons un détour en sciences sociales. Quand on évoque «la sociologie
de l’éducation», on pense en réalité aux travaux sur l’institution scolaire, et rares
sont les recherches sur l’éducation dans la famille, et lorsqu’elles existent, elles sont
davantage classées en sociologie de la famille. La loi d’orientation sur l’éducation,
après l’armation du droit à l’éducation, comprend le titre «La vie scolaire et
universitaire». Elle joue donc aussi sur les mots: éducation signie éducation à
l’intérieur de l’école. Les parents ne sont que des parents d’élèves. Tout, à mon
sens, se joue là, sur cette réduction formidable du terme éducation: en tant que
parent d’élève, le père ou la mère est second, objectivement, dans la «communauté
éducative» qu’il faudrait rebaptiser «communauté éducative scolaire», mais
cet homme, ou cette femme est aussi parent de son enfant, il est alors premier,
objectivement au sein de la communauté éducative familiale. C’est ainsi. Tant que
nous raisonnerons avec une catégorie inexacte «communauté éducative» pour ne
désigner que la «communauté éducative scolaire», les tensions resteront. La réalité
sociale n’existe qu’une fois nommée, et les catégories sont des enjeux centraux dans
la construction de cette réalité.
Il n’y a donc pas une seule «communauté éducative», il y en a au moins deux,
l’une scolaire, l’autre familiale. Les parents sont seconds dans la communauté
scolaire, et premiers dans la communauté familiale. Pour être encore plus précis,
examinons aussi le terme «communauté» qui sert de référence à la loi et à bien
des textes de l’ouvrage. Quel sens a-t-il? D’un point de vue sociologique, il s’agit
d’une absurdité, anti-démocratique! En eet la sociologie, à la n du dix-neuvième
siècle, avec notamment Ferdinand Tonnies, distingue la communauté et la société.
La communauté est caractérisée «par l’attachement, l’aection qu’a l’individu
envers sa famille (lien de sang), son village et ceux qui y habitent et les pratiques
coutumières et religieuses y existant». La société est, au contraire, une organisation
au sein de laquelle les liens sont contractuels. Quand Max Weber reprend cette
distinction avec les termes «communalisation» et «sociation», il insiste sur les
diérences de rationalité: au sein de la «communalisation», les relations sont
aectives et spirituelles et l’autorité s’exerce selon le registre traditionnel, et au
sein de la «sociation», les rapports reposent sur la science, la raison, et l’autorité
est de type «rationnelle». Dans cette optique, l’école dans le monde moderne est
tout sauf une «communauté», et la famille s’éloigne également pour une part (du
fait notamment des droits des femmes et de l’enfant) du régime communautaire.
L’école est tout sauf une communauté, ou devrait l’être. La séparation de l’école
et de la famille, la méance de l’école vis-à-vis de la famille, très forte sous la
Troisième République – cela est visible chez Durkheim chargé d’élaborer les cours
d’éducation morale pour l’école 2, – reposent sur cette distinction: à l’école, l’aectif
2. Cours de 1902-1903, publié sous le titre L’éducation morale.

Communauté éducative ou société scolaire démocratique ?
13 3
doit être réprimé an que l’enfant découvre les lumières de la raison, grâce à son
instituteur ou professeur.
L’invention d’une «société scolaire, éducative et démocratique»
Pourquoi diable s’emmêler théoriquement en rééchissant sur le développement
de la démocratie au sein de la communauté éducative scolaire puisque, idéalement,
l’école devrait être une «société» démocratique, avec un type d’autorité rationnelle,
des contrats, des règles explicites auxquels tous les membres de la société scolaire
sont soumis. On peut prolonger en sociologie le raisonnement en pensant que la
forme «communauté » est la forme dominante des groupes traditionnels et qu’avec
la modernité, très progressivement, la forme «société» s’impose. Cette forme
«société» évolue: dans la première modernité (de la n du e siècle jusqu’aux
années soixante), sans doute comme transition avec la forme antérieure, la démo-
cratie est devenue «représentative»: il y avait des représentants de la raison,
l’intérêt général en est une des expressions. Le savant, le député, l’instituteur sont
les représentants légitimes de cette démocratie. Sous la seconde modernité, on passe
à un stade supérieur de la démocratie: les «petits», dans le régime démocratique,
veulent être aussi participants. La démocratie devient «participative», déstabilisant
la relation d’autorité «rationnelle». Les médecins ne sont plus maîtres de la relation,
ce sont les malades qui prennent la décision, ils donnent leur «consentement».
Même dans la famille, la loi de 2002, non avant-gardiste, une fois que les parents
sont reconnus comme disposant de l’autorité, souligne: «les parents associent
l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité».
«La société éducative scolaire» connaît la même évolution: les parents et les
enfants pensés comme «petits» dans la société antérieure (seuls les instituteurs,
les professeurs savent, et surtout lorsque les familles sont populaires). Aujourd’hui,
ce n’est plus possible, ils veulent être considérés comme des «individus» ayant
des droits, y compris à l’école. Il faudra un jour se demander pourquoi la famille,
«communauté éducative» s’est davantage transformée que l’école, «société» sous
la seconde modernité, mais c’est une autre question.
Il faut rompre avec le langage de la communauté. L’objectif de l’école républi-
caine est de créer un espace démocratique, une «société démocratique éducative».
Signalons que les leçons de morale relèvent d’un fonctionnement propre à la pre-
mière modernité, à la première phase démocratique, les enfants doivent apprendre
les règles, doivent savoir obéir, aujourd’hui on apprend ou on devrait apprendre
la démocratie autrement, comme les tenants de l’école «nouvelle» (en avance,
historiquement) l’ont prôné. Il est impossible de fonder une communauté éducative
regroupant parents, enfants et professeurs, et ce n’est pas non plus un objectif dési-
rable. En revanche, il est possible de fonder une société éducative scolaire, avec des
droits et des devoirs pour chaque groupe de cette société. Peu d’exemples, me semble-

4 14
Préface
t-il, sont donnés sur les «droits et les devoirs» des professeurs vis-à-vis des deux
autres groupes, et sur la manière dont il faudrait que les trois groupes participent,
discutent des droits et des devoirs réciproques. La tentation est grande de repenser
le lien grâce à la formation des parents an qu’ils deviennent de bons membres de
la communauté scolaire, en restant donc dans une relation pédagogique classique.
Les conditions d’une société éducative démocratique
À la n du livre notamment, des récits d’expériences permettent d’avancer. Des
proviseurs, des professeurs vont dans les familles, non pas à la manière des dames
patronnesses pour contrôler le mode de vie des familles, mais comme marque de
respect. «Vous n’êtes plus convoqués à venir, nous venons à vous.» Autour d’une
tasse de café. La création d’une «société éducative» n’exclut pas le lien personnel.
Dans la même optique, il existe des réunions de cette société, non plus à l’école,
mais dans les familles, réunions décentralisées. On le sait, se développe aussi ce
mode de rencontre en politique: les réunions de préau où les candidats, «éclairés»
parlaient au peuple, ignorant, ont peu de succès (heureusement que des militants
sont là pour écouter ce qu’ils savent par cœur!) sont remplacés par des rencontres
décentralisées. Prenons au sérieux le mot proposé dans le récit sur «le collège dans
les familles», décentraliser: changer de centre. Pour combler le décit de la recon-
naissance – historique – des parents vis-à-vis de l’école, la seule solution est de
mettre les parents au centre! Comment peut-on croire un instant à une démocratie
participative lorsque les parents se rendent au collège et écoutent une «leçon» ? (cela
m’est arrivé dans mon expérience de parent, d’où le fait que je ne m’y rendais plus).
Parler ensemble suppose un changement radical – se rendre dans les appartements
et les maisons – rend visible la rupture: nous allons être ensemble pour parler de
quelque chose qui nous est commun, la scolarité de mon élève et de votre ls/lle.
Le second élément positif de ces réunions décentralisées se joue dans le fait
d’inviter plusieurs parents. En eet la visite d’un enseignant, d’un proviseur, d’un
membre de la société scolaire dans une famille peut engendrer, malgré toute la bonne
volonté, éventuellement des malentendus (assimilation à la visite des travailleurs
sociaux, notamment), et la recréation d’une relation inégalitaire. Il n’y a pas d’eet
magique de l’espace en soi. Si plusieurs parents sont réunis, les chances que les
expériences soient partagées sont plus grandes. Dans le soutien à la parentalité,
au Québec, par exemple avec des pères séparés ou divorcés, l’expert, le psychologue
ne fait pas «cours» : il anime une réunion où chacun exprime ses dicultés, ses
réussites. On déscolarise ainsi la rencontre. Les réunions décentralisées relèvent
du même registre. Elles mettent en œuvre une démocratie participative. C’est une
réponse, fondée, à la question du lien école/parents: faire en sorte que les parents
puissent parler, pas seulement écouter ou «avouer» leur faute (éducation trop ou
pas assez) ou passer un examen.

Communauté éducative ou société scolaire démocratique ?
15 3On peut s’inspirer pour une part de ce qui passe dans certaines facultés de méde-
cine française (s’inspirant d’ailleurs): à côté des cours classiques, sont introduits
de nouveaux cours dans les premières années, faits par les usagers. Il ne s’agit pas
d’«éduquer les patients», d’enseigner comment gérer la relation médecin-malade,
en prenant provisoirement la place de ce dernier. Il s’agit de donner la parole à des
malades pour qu’ils expliquent leurs points de vue, leurs expériences de la maladie
et aussi de la relation. Le terme utilisé en France est celui de «patient-formateur»,
ou de «patient-partenaire».
Ainsi un formateur dans une des universités canadiennes (bien classée au niveau
mondial) soutient ce nouveau type d’intervention 3: « La Faculté de médecine qui
a un programme pour les étudiants en médecine où l’on demande aux patients, qui
ont une certaine expérience, un certain savoir de parler aux étudiants, non pas de
l’aspect purement médical de la maladie, cela viendra dans leur études. Mais de
parler de ce que c’est que d’être patient avec cette pathologie-là, face au médecin
et de les éduquer, et de leur provoquer des réponses, donc de créer un dialogue qui,
espérons-le, les amène à une réexion face à leur rôle de médecin avec des patients
qui ont des pathologies diciles 4. »
Cette orientation remet en question la coupure entre ceux et celles qui savent et
ceux et celles qui ne savent pas. L’expérience est de plus en plus considérée comme un
savoir certes profane, mais un savoir qui est aussi utile à ceux et celles qui détiennent
le savoir savant. L’expérience des parents d’enfants (adolescents), et pas seulement
d’élèves (au sens énoncé ci-dessus) et l’expérience des enfants (adolescents), et pas
seulement d’élèves (idem) devraient faire partie de toute relation entre l’école et la
famille. Quand on évoque à juste titre l’ouverture de l’école, on doit penser aussi à
cette manière d’ouvrir, de s’ouvrir au savoir profane des usagers directs ou indirects
de l’enseignement. La prise en compte de cette expérience, de ce savoir, constitue,
constituera, intrinsèquement un approfondissement de la démocratie scolaire. Un
grand pas vers la constitution d’une société scolaire démocratique.
François S, professeur de sociologie, université Paris Descartes 5.
3. Glenn Fash est un militant Canadien, lui-même patient formateur.
4. Cité dans Luigi Flora. Le patient formateur auprès des étudiants en médecine. Mémoire de maîtrise en droit de la
santé, Spécialité : Information, médiation, accompagnement en santé. Sous la direction d’Alexandre Lunel. Université
Paris 8, Vincennes, 2007. Disponible à l’adresse : http://gino.flora.free.fr/IMG/pdf/maitrise_droit_flora_2007.pdf
5. François de Singly est l’auteur notamment de Comment aider l’enfant à devenir lui-même ?, collection Pluriel,
2010.
1
/
5
100%