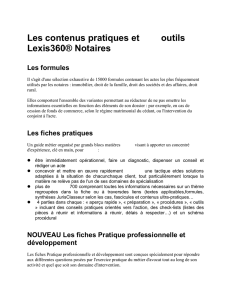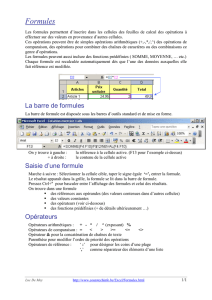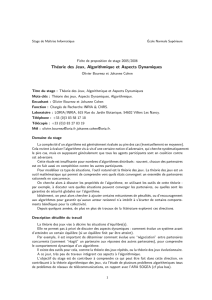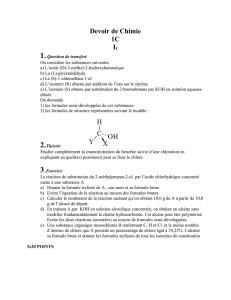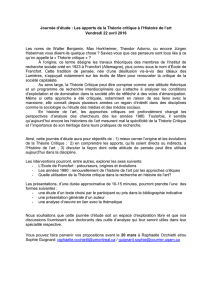Logique du premier ordre - Département de Mathématiques

CHAPITRE VII
Logique du premier ordre
R´
esum´
e. •La logique du premier ordre est la logique des formules usuelles, avec la
contrainte que les variables repr´esentent toutes des objets du mˆeme type.
•Une signature Σest un choix de symboles de constante, d’op´erations et de relations
sp´ecifiques, et on lui associe une logique du premier ordre LΣ.
•Les termes de LΣsont construits r´ecursivement `a partir des variables et des symboles
de constantes `a l’aide des symboles d’op´eration; les formules atomiques de LΣsont
construites `a partir des termes en utilisant l’´egalit´e et les symboles de relation; les
formules de LΣsont construites `a partir des formules atomiques `a l’aide des connecteurs
bool´eens et des quantifications. Une formule close est une formule sans variable libre.
•La s´emantique de LΣtranscrit la notion usuelle de satisfaction d’une formule Fdans
une structure, ou r´ealisation, R, not´ee R|=F. On dit qu’une r´ealisation Mest un
mod`ele d’un ensemble de formules Tsi M|=Fest vrai pour tout Fdans T.
•Une preuve de LΣformalise la notion usuelle de d´emonstration ; on utilise les r`egles
de coupure et de g´en´eralisation, plus des axiomes correspondant `a des sch´emas usuels.
•Toute formule close prouvable est valide. Le th´eor`eme de compl´etude affirme la r´ecipro-
que : toute formule close valide est prouvable. Plus g´en´eralement, tout ensemble con-
sistant (fini ou infini) de formules closes a un mod`ele.
•Le th´eor`eme de compacit´e affirme l’existence d’un mod`ele pour une th´eorie du premier
ordre dont tout sous-ensemble fini a un mod`ele.
•Le th´eor`eme de Lowenheim–Skolem affirme que toute th´eorie du premier ordre dans
une signature d´enombrable qui a des mod`eles infinis a des mod`eles infinis de toute
cardinalit´e.
•La logique du premier ordre ne permet pas de caract´eriser la structure (N,+,×):
il existe des mod`eles non-standards de l’arithm´etique, structures non isomorphes `a
(N,+,×)mais v´erifiant exactement les mˆemes formules closes du premier ordre.
•Pour toute propri´et´e Pexprimable en logique du premier ordre par une formule F,
il est raisonnable de mod´eliser l’existence d’une d´emonstration pour Ppar l’existence
d’une preuve formelle pour F.
•Comme tous les objets usuels peuvent ˆetre repr´esent´es par des ensembles purs, il est
raisonnable d’adopter le cadre «th´eorie des ensembles + logique du premier ordre »
comme cadre formel global, c’est-`a-dire de tenir pour ´etablis les r´esultats dont la for-
malisation a une preuve au sens de la logique du premier ordre `a partir des axiomes de
la th´eorie des ensembles.
•Chaque r´esultat de prouvabilit´e est lui-mˆeme ´etabli dans un contexte m´etamath´ema-
tique, qui peut ˆetre formalis´e.
•La logique du second ordre a un pouvoir d’expression sup´erieur `a la logique du premier
ordre, mais elle ne satisfait aucun des th´eor`emes g´en´eraux satisfaits par celle-ci.
!L’objet de ce chapitre est d’introduire la logique du premier ordre,
et d’en d´emontrer les r´esultats de base qui seront utilis´es dans la suite
du texte, `a savoir principalement le th´eor`eme de compl´etude de G¨odel,
le th´eor`eme de compacit´e, et le th´eor`eme de Lowenheim–Skolem.
179

180 Logique (Patrick Dehornoy), VII. Logique du premier ordre [version 2006-07]
Le plan du chapitre est le suivant. Dans la premi`ere partie, on
d´efinit la syntaxe de la logique LΣ, sa s´emantique bas´ee sur la no-
tion de structure de type Σ, et on examine le pouvoir d’expression des
logiques du premier ordre en discutant quelques exemples de propri´et´es
exprimables par des formules du premier ordre. Dans la seconde par-
tie, on d´efinit une notion de preuve formelle fond´ee sur les r`egles de
coupure et de g´en´eralisation et sur une famille infinie d’axiomes cor-
respondant `a des sch´emas de d´emonstration usuels. On ´etablit ensuite
par la m´ethode dite de Henkin le th´eor`eme de compl´etude de G¨odel,
qui garantit que toute formule valide est prouvable. La troisi`eme partie
regroupe quelques applications du th´eor`eme de compl´etude, `a savoir le
principe des d´emonstrations s´emantiques, les th´eor`emes de compacit´e
et de Lowenheim–Skolem, et la notion d’´equivalence ´el´ementaire, qu’on
applique au cas des mod`eles non-standards de l’arithm´etique, dont on
montre qu’il existe une famille non d´enombrable. Dans la quatri`eme par-
tie, on discute l’adoption de la logique du premier ordre et de la notion
de preuve associ´ee comme mod`ele du raisonnement math´ematique. En-
fin, en appendice, on mentionne bri`evement la logique du second ordre
et on montre que celle-ci ne satisfait ni le th´eor`eme de compacit´e, ni le
th´eor`eme de Lowenheim–Skolem. "
!La logique du premier ordre, aussi appel´ee calcul des pr´edicats, est la logique des formules
math´ematiques usuelles, telles que
∀x, y ∃z(x+z=y+ 1),ou
∀ε>0∃δ>0 (|x−x0|<δ⇒|f(x)−f(x0)|<ε).
Il n’est pas surprenant qu’on puisse codifier l’emploi des diff´erents symboles de fa¸con `a d´ecrire
pr´ecis´ement les formules, puis, suivant le sch´ema g´en´eral pr´esent´e au chapitre VI, d´efinir une
s´emantique calqu´ee sur l’usage courant et pouvant ˆetre qualifi´ee de naturelle et, par ailleurs,
d´egager des r`egles de d´eduction valides elles aussi fond´ees sur les principes de d´emonstration
habituels. Tout cela n’est que la mise en forme d’une st´enographie.
L’int´erˆet de cette formalisation tient `a la possibilit´e de d´emontrer des th´eor`emes portant
sur les d´emonstrations prises elles-mˆemes comme objet d’´etude. On peut se douter qu’il n’y a
`a esp´erer aucune recette nouvelle pour inventer des d´emonstrations et r´esoudre miraculeuse-
ment des probl`emes ouverts, mais on constatera que l’approche m`ene `a des r´esultats non tri-
viaux, dont certains ont eu r´ecemment des applications inattendues dans divers domaines des
math´ematiques. Pour ce qui est de la th´eorie des ensembles, o`u les formules jouent un rˆole
fondamental, il n’est pas ´etonnant que les th´eor`emes de logique y soient importants et, de fait,
on verra dans la troisi`eme partie de ce texte que le th´eor`eme de compl´etude de la logique du
premier ordre m`ene directement au changement radical de point de vue qui marque le d´ebut de
la th´eorie moderne.
L’existence de r´esultats non triviaux, typiquement le th´eor`eme de compl´etude qui montre que
les formules valides sont exactement celles qui poss`edent une preuve d’un certain type syntaxique
simple, explique l’int´erˆet sp´ecifique apport´e `a la logique du premier ordre, par opposition `a
d’autres logiques peut-ˆetre aussi naturelles. Le cas des logiques du second ordre sera mentionn´e
afin justement de mettre en ´evidence toutes les lacunes de celles-ci et faire ressortir par contraste
les qualit´es propres `a la logique du premier ordre. $
1. Logiques du premier ordre
!On d´ecrit la syntaxe et la s´emantique de la logique du premier or-
dre LΣassoci´ee `a un choix de symboles Σ: on d´efinit la famille des
formules, et on montre comment attribuer une valeur de v´erit´e `a une

VII.1. Logiques du premier ordre 181
formule dans le cadre d’une r´ealisation convenable, ici une structure de
type Σ. Cette section est purement descriptive. "
!Comme au chapitre VI avec la logique propositionnelle, le principe est de mimer autant
que faire se peut l’usage courant : autrement dit, il s’agit d’organiser en un syst`eme formel
pr´ecis les ´enonc´es math´ematiques usuels. Les d´efinitions dans la suite sont multiples, mais on
devrait se convaincre rapidement que toutes les notions sont, au moins implicitement, d´ej`a
toutes famili`eres : la logique du premier ordre est la prose du math´ematicien... $
1.1. Formules du premier ordre.
!On commence par la d´efinition des formules. Le point sp´ecifique, qui
explique qu’il y ait des logiques du premier ordre plutˆot qu’une seule, est
l’option consistant `a fixer un ensemble de symboles non logiques, appel´e
signature. "
!L’examen d’un texte math´ematique quelconque permet de constater que les formules qui y
apparaissent ob´eissent `a un mˆeme sch´ema g´en´eral, `a savoir assembler, `a l’aide de connecteurs
bool´eens ∧,∨,¬,⇒,⇔et de quantifications ∀et ∃, des formules simples du type t1=t2,
t1<t2,..., d’une fa¸con g´en´erale r
r
r(t1, ..., tk)o`u r
r
rd´esigne une relation k-aire, et o`u t1,..., tk
repr´esentent des ´el´ements de la structure consid´er´ee et sont eux-mˆemes soit des variables,
soit des noms d’´el´ements particuliers, soit des combinaisons de variables et de noms `a l’aide
d’op´erations ou de fonctions, sur le mod`ele de
∀x
x
x1∀x
x
x2(x
x
x1#x
x
x2⇔ ∃x
x
x3(x
x
x1+x
x
x3=x
x
x2)).(1.1)
C’est ce type de formule qu’on se propose de d´efinir et d’´etudier ici sous le nom de formule du
premier ordre.
Deux options sont retenues. La premi`ere est que, le but ´etant d’exprimer les propri´et´es
de structures vari´ees, il est plus commode d’introduire une famille de logiques plutˆot qu’une
logique unique. Ces logiques sont toutes bˆaties sur le mˆeme mod`ele, mais chacune d´epend d’un
choix sp´ecifique des op´erations et des relations consid´er´ees. Par exemple, en sus des variables
et des symboles logiques (dont l’´egalit´e) communs `a toutes les logiques du premier ordre, la
formule (1.1) met en jeu une relation binaire #et une op´eration binaire +, et on dira qu’il
s’agit d’une formule du premier ordre relativement `a la signature 1consistant en un symbole de
relation binaire #et un symbole d’op´eration binaire +ou, plus g´en´eralement, `a toute signature
contenant ces symboles.
La seconde option est d’´etablir une claire distinction entre les symboles qui figurent dans
une formule et les objets math´ematiques qu’ils repr´esentent : mˆeme si le contexte sugg`ere que
#repr´esente une relation d’ordre, voire plus pr´ecis´ement un certain ordre, par exemple l’ordre
canonique des entiers naturels, il est utile pour la suite de maintenir les formules `a un niveau
purement syntaxique, afin notamment de pouvoir interpr´eter une mˆeme formule dans plusieurs
contextes distincts et, par exemple, pouvoir d´eclarer que la mˆeme formule (1.1) est vraie dans N
et fausse dans Z. De la sorte, la formule elle-mˆeme, qui n’est qu’un mot, n’est ni vraie ni fausse
hors d’un contexte sp´ecifique. Pour rendre cette distinction visible, on utilisera, au moins dans
un premier temps, des notations distinctes, typiquement pour une relation (ensemble de k-
uplets) et pour le symbole qui la repr´esente ; pour ne pas compliquer, lorsqu’une notation pour
une relation ou une op´eration est usuelle, on utilisera par d´efaut la mˆeme notation en gras pour
le symbole correspondant. Par exemple, `a cˆot´e de la relation d’appartenance ∈, on utilisera ∈
∈
∈
comme un symbole de relation binaire. La distinction est que ∈est un ensemble de couples,
alors que ∈
∈
∈n’est qu’une lettre. $
D´
efinition 1.1.(signature) On appelle signature un ensemble, fini ou in-
fini, de symboles avec, pour chacun, la sp´ecification d’un type pouvant ˆetre
1ici au sens d’ensemble de signes

182 Logique (Patrick Dehornoy), VII. Logique du premier ordre [version 2006-07]
«constante »2,«op´eration », ou «relation », et, dans les deux derniers cas, d’un
entier naturel non nul appel´e arit´e.
A chaque signature Σon va associer une logique du premier ordre LΣ.
Exemple 1.2.(signatures Σens,Σarith, logiques Lens,Larith) On a d´ej`a men-
tionn´e la signature ensembliste Σens comprenant un unique symbole de relation
binaire ∈
∈
∈; on a donc Σens ={∈
∈
∈}, qu’on peut ´ecrire plus pr´ecis´ement comme
Σens ={∈
∈
∈r
2}pour indiquer que ∈
∈
∈est un symbole de relation («r») binaire. De
mˆeme, les formules ensemblistes ´etendues du chapitre III correspondent `a la sig-
nature {∅
∅
∅c,{
{
{•,•}o
2,!
!
!o
1,∪
∪
∪o
2,P
P
Po
1,∈
∈
∈r
2,⊆
⊆
⊆r
2}, qu’on notera Σens+, et l’arithm´etique de
Peano est exprim´ee par des formules mettant en jeu la signature {0
0
0c, S
S
So
1,+
+
+o
2,·
·
·o
2},
qu’on notera Σarith, voire la signature {0
0
0c, S
S
So
1,+
+
+o
2,·
·
·o
2,#
#
#r
2}not´ee Σarith+. Dans toute
la suite, on notera Lens la logique du premier ordre associ´ee `a la signature Σens,
et, de mˆeme, Lens+,Larith et Larith+les logiques associ´ees `a Σens+,Σarith et Σarith+
respectivement.
La construction des formules de LΣse fait en plusieurs ´etapes. On commence
avec des termes, destin´es `a repr´esenter des objets math´ematiques du domaine
´etudi´e. Comme dans le cas du calcul propositionnel, on fixe une suite infinie
de variables x
x
x1, x
x
x2, . . . ; on s’autorise `a utiliser des m´etavariables, c’est-`a-dire `a
utiliser x
x
x, y
y
y,etc. pour repr´esenter une variable non sp´ecifi´ee.
D´
efinition 1.3.(terme) Soit Σune signature. On appelle terme de LΣtout
mot obtenu `a partir des variables x
x
xiet des constantes de Σen appliquant un nom-
bre fini de transformations (t1, ..., tk)+→ s
s
s(t1, ..., tk) avec s
s
ssymbole d’op´eration
k-aire dans Σ.
Exemple 1.4.(terme) Les mots
∅
∅
∅, x
x
x2,P
P
P(∅
∅
∅)∪
∪
∪x
x
x2,P
P
P(P
P
P(x
x
x1∪
∪
∪∅
∅
∅)) ∪
∪
∪x
x
x2
(1.2)
sont des termes de Lens+. On suit l’usage d’´ecrire (t1)s
s
s(t2) pour s
s
s(t1,t2) quand s
s
s
est un symbole binaire, et, comme pour le calcul propositionnel, on omet des par-
enth`eses pour all´eger l’´ecriture lorsqu’il n’y a pas d’ambigu¨ıt´e. Noter que, si une
signature Σne comporte aucun symbole de constante ou d’op´eration, ainsi que
c’est le cas de la signature Σens, alors les seuls termes de LΣsont les variables x
x
xi.
On introduit maintenant les formules, qui expriment des relations entre des
termes.
D´
efinition 1.5.(formule) Soit Σune signature. On appelle formule ato-
mique de LΣtout mot de la forme t1=t2ou r
r
r(t1, ..., tk) avec r
r
rsymbole de
relation k-aire de Σ, et t1, ..., tktermes de LΣ. On appelle formule de LΣtout
mot pouvant s’obtenir `a partir de formules atomiques en Σen appliquant un
2L’usage qu’on en fera dans la suite montrera qu’on peut assimiler les constantes `a des
op´erations `a z´ero argument, et donc ne distinguer que deux types de symboles, d’op´eration et
de relation.

VII.1. Logiques du premier ordre 183
nombre fini de transformations F+→ ¬(F), (F,G)+→ (F)∧(G), (F,G)+→ (F)∨(G),
(F,G)+→ (F)⇒(G), F+→ ∃x
x
xi(F), et F+→ ∀x
x
xi(F).
Comme dans le cas des logiques propositionnelles du chapitre VI, et comme
il est d’usage, on s’autorisera `a supprimer des parenth`eses dans les termes et les
formules pour autant que ceci ne cr´ee pas d’ambigu¨ıt´e.
Exemple 1.6.(formule) Le mot x
x
x2∈
∈
∈P
P
P(∅
∅
∅)∪
∪
∪x
x
x2est une formule atomique
de Lens+, tandis que
∃x
x
x2(x
x
x2∈
∈
∈(P
P
P(∅
∅
∅)∪
∪
∪x
x
x2))⇒(P
P
P(x
x
x3)⊆
⊆
⊆ ∅
∅
∅)(1.3)
est une formule (non atomique) de Lens+.
Tant l’ensemble des termes de LΣque celui des formules de LΣest d´efini
comme clˆoture d’un ensemble de base par un certain nombre de transformations.
Comme dans le cas des formules propositionnelles, on en d´eduit un crit`ere de
d´emonstration par induction.
Proposition 1.7.(induction) Soit Σune signature. Pour montrer qu’une
propri´et´e Pest vraie pour tous les termes de LΣ, il suffit de montrer
•que Pest vraie pour les variables x
x
xiet les symboles de constante de Σ,
•et que, pour chaque symbole d’op´eration k-aire s
s
sde Σ, si Pest vraie
pour t1,..., tk, alors elle est vraie aussi pour s
s
s(t1, ..., tk).
Pour montrer qu’une propri´et´e Pest vraie pour toutes les formules de LΣ, il
suffit de montrer
•que Pest vraie pour les formules atomiques,
•que, si Pest vraie pour F, alors elle est vraie aussi pour ¬F,
•que, si Pest vraie pour Fet G, alors elle est vraie aussi pour F∧G,F∨G, et
F⇒G, et
•que, si Pest vraie pour F, alors, pour toute variable x
x
x, elle est vraie pour
∃x
x
x(F)et ∀x
x
x(F).
Une formule ´etant un mot, chaque symbole qui y figure a une position bien
d´efinie, qu’on peut rep´erer par son rang en partant du d´ebut. On appelle occur-
rence d’un symbole sdans une formule Ftout entier ntel que le n-`eme symbole
de Fsoit s. Par exemple, x
x
x2a trois occurrences dans (1.3), `a savoir 2, 4, et 12 3.
D´
efinition 1.8.(libre, li´ee) Pour chaque variable x
x
xiet chaque formule F, on
d´efinit inductivement l’ensemble des occurrences li´ees et libres de x
x
xidans Fpar
les r`egles suivantes :
•si Fest sans quantificateur, toutes les occurrences de x
x
xidans Fsont libres ;
•si Fest ∀x
x
xi(G) ou ∃x
x
xi(G), toutes les occurrences de x
x
xidans Fsont li´ees ;
3en prenant ici le parti de compter x
x
x2comme un symbole unique ; une option alternative
(plus pertinente pour les questions de complexit´e algorithmique) serait de consid´erer x
x
x2comme
´etant un mot de longueur 2
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
1
/
39
100%