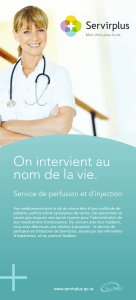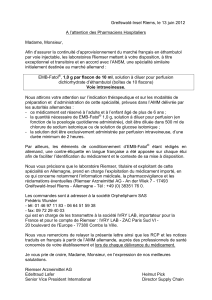Mercredi 2 octobre ABECASSIS Anna L2 BMCTTM Pr

BMCTTM- Devenir du médicament dans l'organisme et paramètres pharmacocinétiques
Mercredi 2 octobre
ABECASSIS Anna L2
BMCTTM
Pr SIMON
10 pages
Devenir du médicament dans l'organisme et paramètres pharmacocinétiques
A. Injection directe (bolus)
Dans ce cas, on atteint d'emblée la concentration maximale Cmax et il ne peut y avoir qu'une décroissance.
Lorsqu'on double la dose (au lieu de 500 mg on injecte 1000mg) si le médicament a une cinétique linéaire, le
rapport entre la dose et la concentration sera linéaire c’est-à-dire que la concentration de départ sera doublée et
que la surface sous la courbe sera également doublée. Cependant la courbe de décroissance n'est pas linéaire.
B. Perfusion voie veineuse
1/10
Plan
A. Injection directe
B. Perfusion voie veineuse
C. Voie orale
D. Cas d'une perfusion continue

BMCTTM- Devenir du médicament dans l'organisme et paramètres pharmacocinétiques
Le tracé ci-dessus représente 4 exemples de l'administration d'une même dose de 2g avec des durées de
perfusion différentes.
Ici non seulement la dose sera à prendre en compte mais également la durée de perfusion.
*A 8h
On administre 2g en 8h. Le pic survient à 8h c'est à dire à la fin de la perfusion. Les concentrations augmentent
pour atteindre C max à la fin de la perfusion. Il appartient donc au médecin de choisir le moment de ce pic.
La perfusion en 1h étant très rapide et l’exposition identique quel que soit la durée de perfusion (elle dépend
seulement de la dose) on aura donc une Cmax plus importante car le débit d'entrée est plus rapide.
Si on souhaite une présence plus longue du médicament dans le temps on optera pour une perfusion plus
longue, en revanche la Cmax sera diminuée.
Comme les quantités administrées sont égales, la surface sous la courbe est égale, mais aura une forme
différente selon la durée de la perfusion.
C. Voie orale
En considérant que ce médicament a une cinétique linéaire (comme la plupart des médicaments), si on
augmente la dose, le pic surviendra à une concentration plus élevée. Il est plus progressif. On ne peut pas savoir
avec exactitude quand ce pic surviendra (c'est variable d'un individu à l'autre, à cause de l'alimentation par
exemple, mais on peut réaliser une moyenne des populations). On observe aussi que quelle que soit la dose, le
2/10

BMCTTM- Devenir du médicament dans l'organisme et paramètres pharmacocinétiques
pic de concentration est obtenu au même moment (même si le moment n'est pas déterminé avec une grande
précision).
Lorsqu'on double la dose d'un médicament linéaire, Cmax et l'aire sous la courbe doublent: on parle de
médicament proportionnel.
En revanche, les médicaments non linéaires sont exposés à des phénomènes de saturation (saturation de
l’absorption ou bien au contraire de l’élimination) : il est indispensable d'effectuer un prélèvement sanguin pour
estimer ces données. En doublant la dose, on ne doublera pas forcément la surface sous la courbe (=
exposition).
D'un point de vue pharmacocinétique, le pic de concentration (Cmax) survient au temps Tmax.
Si on s'intéresse à l'effet du médicament on peut voir que la courbe représentant l'effet est souvent décalée par
rapport à l'évolution des concentrations. En effet Emax ne survient pas forcément à Tmax, il apparaît la plupart
du temps après le pic de concentration donc après Tmax.
PK et PD sont donc reliés mais pas de façon directe (''délai'' sur le schéma de droite).
Exemple: on administre 2 médicaments; Tmax1= 1heure et Tmax2= 2heures. Dans ce cas on ne peut pas savoir
lequel aura un effet le plus rapide car T max dépend des concentrations et non pas des effets.
Le Tmax ne peut pas nous renseigner sur le moment de la survenue de l’effet. Tmax nous renseigne sur le pic
de concentration.
Exemple : les antidépresseurs ont en général un délai d’action de 3 semaines.
Remarque :
Si on administre un médicament et on effectue régulièrement des prélèvements pour évaluer les concentrations :
Ci-dessus on effectue 7 prélèvements et on déduit que T max=1heure
Mais si on oublie d'effectuer un prélèvement on voit ci-dessous qu'on peut estimer le Tmax à 2h30.
L’intervalle des prélèvements est choisi arbitrairement, donc si le prélèvement ne se fait pas exactement au
3/10

BMCTTM- Devenir du médicament dans l'organisme et paramètres pharmacocinétiques
moment du Tmax, on n’aura pas la bonne valeur de Cmax.
L'estimation du Tmax dépend donc des moments où les prélèvements sont réalisés (il est impossible de prélever
du sang du patient toutes les minutes). Cmax observée est par conséquent une estimation de la réalité.
5 facteurs expliquant les phénomènes consécutifs à l'administration par voie orale :
1) Demi-vie
Temps nécessaire pour que les concentrations diminuent de moitié. C'est un paramètre constant, quelle que soit
la dose, pour un médicament donné (la seule exception étant les médicaments à cinétique non linéaire). La
demi-vie s'obtient à partir de la pente terminale, sur une représentation semi-log.
T1/2 = log(2)/pente = 0,693/pente pente = pente de décroissance des concentrations
La pente est appelée λz.
La demi-vie est utile pour connaître quand le médicament sera éliminé lors d'un surdosage, ou bien pour éviter
un surdosage lorsqu'un médicament doit être remplacé par un autre afin d'éviter d'additionner les deux
médicaments.
Les courbes ci-dessus représentent les log de concentrations en fonction du temps. On aperçoit que la
décroissance linéaire des pentes est similaire quelle que soit la dose: T1/2 est bien indépendant des doses.
Entre 5 et 7 demi-vies on considère le médicament comme éliminé.
4/10

BMCTTM- Devenir du médicament dans l'organisme et paramètres pharmacocinétiques
2) Surface sous la courbe
C'est la quantité de médicament qui est passé dans le sang, c’est le reflet de l’exposition de l’organisme. Elle est
évaluable par prélèvement sanguin, calculable par la méthode des trapèzes. Quand la dose augmente la surface
sous la courbe augmente et ce de façon proportionnelle à condition que la cinétique soit linéaire. Pour chaque
dose on calcule la surface sous la courbe et on espère obtenir une courbe proportionnelle et linéaire.
3) Biodisponibilité (F)
Correspond à la fraction de dose de médicament passant dans la circulation générale (par rapport à une autre
voie d’administration).
La voie de référence est la voie IV ce qui lui confère une biodisponibilité de 100%.
En haut à gauche : Pour la voie IV la biodisponibilité est de 100%, et pour la voie orale elle est inférieure. Les
surfaces sous les courbes sont à peu près équivalentes.
En haut à droite : la surface sous la courbe est plus faible pour la voie orale, cela signifie que seulement une
partie du médicament atteint la circulation sanguine à cause de l'effet de premier passage (dont l’effet de
premier passage hépatique). F (le rapport entre les 2 surfaces sous la courbe) est égal à 20% , autrement dit 20%
de la dose atteint la circulation générale. D'où l'intérêt d'adapter la dose en fonction de F.
En bas au milieu : les deux médicaments possèdent une biodisponibilité quasiment égale, le même Tmax. La
bioéquivalence est nécessaire dans le développement des génériques.
On distingue deux types de biodisponibilité :
- la biodisponibilité absolue (par rapport à la voie IV) : surtout utilisée pour le développement de
nouveau médicaments
- la biodisponibilité relative (comparaison de 2 voies d'administration différentes de la voie IV) : surtout
utilisé pour le développement de médicaments génériques pour démontrer la bioéquivalence.
On dit que deux médicaments sont bioéquivalents lorsqu’ils ont le même F, Cmax et Tmax.
5/10
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%