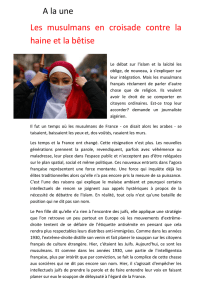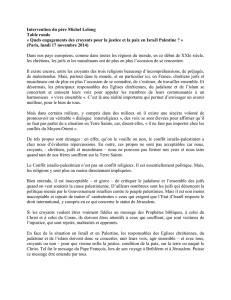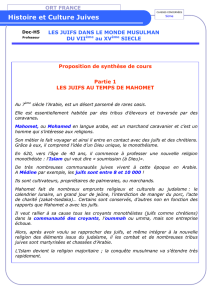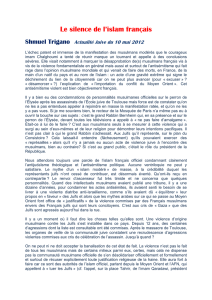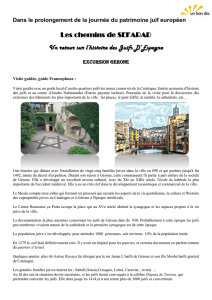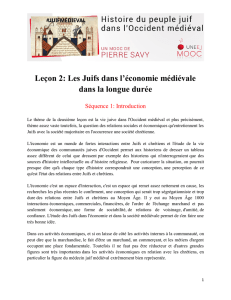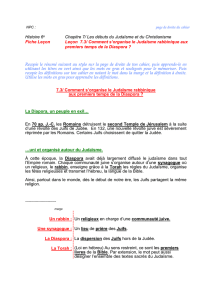JUIFS ET MUSULMANS AUX MÊMES PUPITRES : L

1
JUIFS ET MUSULMANS AUX MÊMES PUPITRES :
L’INTERCULTUREL DANS LES ECOLES JUIVES DE CASABLANCA
(MAROC)
Annick Mello, doctorante à l’Institut d’ethnologie de Neuchâtel1.
amello@infomaniak.ch
Il est midi dans le réfectoire de l’Ecole primaire Narcisse Leven de Casablanca.
Autour des tables, les enfants s’apprêtent à déjeuner. Des garçons portent la kipah
(calotte), les juifs, et d’autres ont la tête nue, les musulmans. Quelques élèves juifs
brandissent en l’air un morceau de pain en récitant une bénédiction2, tandis que les
musulmans ne font pas ce geste.
Contexte
Si des élèves juifs et musulmans se retrouvent actuellement dans les mêmes institutions
éducatives, il n’en a pas toujours été ainsi au Maroc. En effet, avant le protectorat français
(1912), juifs et musulmans fréquentaient des écoles distinctes. Il s’agissait d’établissements
dispensant aux garçons un enseignement religieux. A la fin du 19ème siècle, l’enseignement
juif subit de profondes mutations. L’Alliance Israélite Universelle (A.I.U.)3 ouvrit sa première
école à Tétouan en 1862, puis d’autres suivirent et un véritable réseau scolaire se constitua au
Maroc. Dans tout le pays, le nombre d’enfants juifs scolarisés par l’Alliance augmentait
régulièrement (de 360 élèves en 1911 à plus de 10 000 en 1954). Ces écoles se caractérisaient
par une ouverture aux matières profanes, la possibilité pour les filles de s’instruire et un
enseignement dispensé en français. L’influence française se diffusa d’ailleurs fortement par le
biais de l’école, toutefois, le colonisateur s’attachait à maintenir les enseignements
« européen », « musulman » et « israélite » séparés.
Après la seconde guerre mondiale, l’éducation juive au Maroc connut un développement
important et plus diversifié. C’est à cette époque que les groupes sionistes et les mouvements
juifs orthodoxes américains exercèrent une influence importante par le vecteur de l’éducation.
Après l’indépendance du Maroc (1956), les écoles de l’Alliance durent introduire dans leurs
programmes l’enseignement de l’arabe. Le nom même de l’association fut arabisé, elle
devint : l’Ittihad-Maroc. C’est alors que ses écoles commencèrent à admettre quelques élèves
musulmans.
Il reste actuellement au Maroc quatre écoles appartenant à ce réseau, elles se trouvent toutes à
Casablanca. Elles sont homologuées par le Ministère de l’Education Nationale français et
dispensent un enseignement de type français, des matières hébraïques et quelques heures
d’arabe. Les élèves y sont de moins en moins nombreux, les effectifs diminuent au rythme des
1 Cette recherche repose sur une enquête de terrain d’une année (septembre 99-septembre 00), financée par le
Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique.
2 La bénédiction sur le pain, Ha-motsi, est précédée d’une ablution rituelle des mains et suivie de la bénédiction
netilat yadayim qui dispense de réciter celles qui concernent les autres aliments pris durant le repas, à l’exception
du vin et des fruits. (Wigoder, 1996 : 757)
3 Cette association, fondée à Paris en 1860, se proposait une triple activité : philanthropique (concours financier),
de protection générale (défense des droits de l’homme, lutte contre l’antisémitisme) et une action éducative.

2
départs. En effet, depuis la création de l’Etat d’Israël, l’indépendance du Maroc et les
différents épisodes du conflit israélo-palestinien, les juifs marocains ont émigré massivement
en Israël, en France, aux Etats-Unis et au Canada, principalement. La communauté juive est
passée de 300 000 membres en 1953 à 5000 environ aujourd’hui. Pour compléter leurs
effectifs, deux de ces établissements accueillent également des élèves musulmans, il s’agit de
l’Ecole primaire Narcisse Leven et du Lycée Maimonide.
Cadre théorique
Afin de tenter de percevoir comment les élèves juifs se définissent par rapport à leurs
camarades musulmans, le concept d’ethnicité m’a semblé pertinent.
Barthes analyse les processus d’émergence et la persistance des groupes ethniques, en
centrant sa recherche sur les frontières ethniques et leur entretien : « (…) le point crucial de la
recherche devient la frontière ethnique qui définit le groupe et non le matériau culturel qu’elle
renferme. » (Barth, 1995 : 205). Les identités ethniques ne sont pas des réalités primordiales,
elles sont liées aux situations sociales.
« L’ethnicité est une forme d’organisation sociale, basée sur une attribution
catégorielle qui classe les personnes en fonction de leur origine supposée, et qui se
trouve validée dans l’interaction sociale par la mise en œuvre de signes culturels
socialement différenciateurs. » (Poutignat et Streiff-Fenart, 1995 : 154).
L’ethnicité est relationnelle et dynamique : elle varie selon le contexte, selon le groupe face
auquel il s’agit de se différencier. L’ethnicité n’est pas vide de contenus culturels, mais elle
n’est pas non plus l’expression d’une culture prédéfinie. L’interaction est régie selon une série
de prescriptions et de proscriptions, censées maintenir la frontière entre les deux groupes.
Il s’agit d’analyser les processus de marquage : l’attribution de nom(s), les traits culturels mis
en avant par les individus eux-mêmes pour marquer leur différence et les traits qui leur sont
attribués par les groupes voisins (Poutignat et Streiff-Fenart).
Il convient également de tenir compte d’autres dimensions de la vie sociale comme la classe
sociale et le sexe (gender), les effets de l’ethnicité pouvant être renforcés ou, au contraire,
contrebalancés par ces dimensions (Martiniello).
Le concept d’ethnicité, ou de groupe ethnique, appliqué aux Juifs apparaît le plus souvent
sous la plume d’anthropologues anglo-saxons, les chercheurs français utilisent plutôt le
concept d’identité. Il me semble toutefois que ce dernier se réfère plus intimement au fait
d’être juif, de se reconnaître en tant que juif, alors que l’ethnicité juive a une connotation
plus collective, il s’agit de se reconnaître en tant que membre d’un groupe partageant
quelques traits communs et se définissant comme différent des autres.
L’ethnicité juive paraît très difficile à définir. Elle peut recouvrir une grande diversité de
contenus. « (…) to be Jewish is to be a particular kind of Jew. » (Glazier, in Zenner, 1989 :
17). L’ethnicité juive existe, mais il ne s’agit pas d’une entité primordiale et figée, elle peut
revêtir des aspects très différents selon les contextes. C’est dans l’interaction avec les autres
groupes que les traits considérés comme pertinents seront mis en avant par ceux qui se
reconnaissent comme juifs.

3
Il apparaît souvent que les juifs sont plutôt perçus comme un groupe religieux que comme un
groupe ethnique.
Actuellement, bon nombre de juifs athées revendiquent leur appartenance au judaïsme. Il
semble donc difficile que les juifs se définissent comme un groupe religieux uniquement.
Pour Webber (1997), les juifs ont connu un mouvement allant de la «religion» à l’ «ethnicité»
en Europe. Il prend l’exemple des juifs de France. Après la Révolution, ceux-ci sont devenus
des citoyens français à part entière, leur identité collective en tant que juifs a été redéfinie par
l’Etat comme étant exclusivement religieuse. Les juifs devenaient des Français de confession
israélite. Dans la majorité des pays d’Europe, leurs coreligionnaires connurent le même
processus. La religion était reléguée à la sphère privée. Cependant, suite aux lois de Vichy,
qui dénièrent aux juifs le statut de citoyens et surtout à l’holocauste, «Jews slowly began to
develop the institutions suitable for self-expression as a recognized ethnic community within
the state, that is a public identity additional to that of Frenchness.» (1997: 266). Selon
Webber, le même mouvement vers une identité ethnique s’est développé ailleurs en Europe.
Les juifs ne se regroupent plus forcément autour de la synagogue, mais créent des associations
culturelles, politiques, des clubs sportifs, plutôt dans le but de se retrouver entre juifs, mais
pas nécessairement pour y développer des activités «juives». Le fait de ne plus définir les juifs
comme un groupe exclusivement religieux s’inscrit également dans la tendance générale à la
sécularisation et à la laïcisation en Europe et aux Etats-Unis. Au Maroc, même si les juifs ont
été très largement influencés par la France, la dimension religieuse reste importante.
En outre, comme le souligne Webber, le fait de considérer les juifs comme un groupe
ethnique ne signifie pas forcément qu’ils ne sont pas religieux, de même la composante
religieuse ne doit pas être requise a priori.
Ainsi, de nombreuses recherches, menées aux Etats-Unis, au Canada et en France notamment,
mettent l’accent sur l’aspect religieux. Il ressort souvent que la majorité des juifs ne pratiquent
pas ou peu leur religion. Néanmoins la pratique religieuse demeure un thème central, abordé
aussi bien par les chercheurs, qui tentent souvent d’évaluer le degré d’observance des
prescriptions religieuses, que par les personnes interrogées elles-mêmes. Allouche-Benayoun
rapporte les résultats d’une enquête réalisée auprès de jeunes juifs en France : «La
représentation dominante concernant l’individu juif pour nos sujets, c’est celle d’un juif
pratiquant, très attaché aux préceptes religieux. (…) C’est l’idée qu’être juif, c’est être
religieux, sous peine d’incomplétude grave. » (1979 : 85). En outre, le mariage endogame et
la tendance à avoir un habitat regroupé semblent se retrouver dans des environnements très
différents. Les processus de maintien de la frontière ethnique sont ici évidents.
Selon la société majoritaire, les juifs vont mettre l’accent sur certains contenus afin de se
distinguer des non-juifs, en maintenant ou en tentant de maintenir la frontière. Il s’agit
d’appréhender les juifs en tant que groupe ethnique à travers la problématique de l’altérité.
Pour Jean-Christophe Attias, penser le judaïsme, c’est le penser en contact, en mouvement. Il
affirme que c’est le judaïsme qui est né du christianisme et de l’islam et non le contraire. Le
judaïsme a été profondément transformé par ces confrontations, il est donc devenu ce que les
deux autres religions ont fait de lui : «Qu’auraient eu les juifs pour se penser eux-mêmes s’il
n’y avait pas eu Jésus ou Muhammad ? » (conférence publique, Université de Genève, le
17.01.01). Il met cependant en garde contre une approche de l’altérité qui serait trop binaire :
dans la littérature rabbinique il existe une pensée de la frontière : entre le permis et l’interdit,
entre «nous » et «les autres », mais cette frontière est très mobile. L’étude des marges permet
de mieux appréhender l’identité juive. «Ce sont les zones frontières plus encore que les

4
frontières elles-mêmes qui devraient retenir l’attention des chercheurs aussi bien que des
enseignants, espaces identitaires, littéraires, géo-culturels ou chronologiques mixtes et
perméables, lieux de passage et de partage. » (Attias 1998 a : 58).
Objectifs
Au sein de certaines écoles juives, deux groupes culturels (religieux) sont en contact. Elèves
juifs et musulmans se considèrent comme étant culturellement distincts. Il s’agit alors
d’appréhender les marqueurs identitaires sur lesquels se base cette distinction, la manière
dont se dessine la frontière, zone de contact et d’évitement entre les deux groupes et enfin
d’estimer le rôle de l’institution scolaire dans le maintien de cette frontière.
Méthodologie
Afin d’explorer ces pistes, une enquête de terrain d’une année a été menée à Casablanca. Les
relations entre élèves juifs et musulmans constituent l’un des aspects de cette recherche. Il
s’agit d’un sujet délicat, car le discours officiel évoque une cohabitation idyllique entre les
élèves des deux confessions. On ne peut donc s’en tenir uniquement au discours, c’est
pourquoi j’ai plutôt privilégié l’observation, dans un premier temps du moins. J’ai procédé à
des observations répétées dans les classes de l’école primaire et du lycée, j’ai pu également
pratiquer l’observation participante dans deux classes de CE2 (remplacements), j’ai eu de
nombreux entretiens semi-dirigés avec des enseignants, des parents d’élèves, les directeurs
d’établissements et quelques membres de la commission scolaire. Je me suis entretenue avec
des élèves, juifs et musulmans, de classe terminale du Lycée Maimonide. Enfin, j’ai effectué
des recherches documentaires sur l’histoire des relations judéo-musulmanes au Maroc au
Centre de recherches sur les juifs du Maroc à Rabat ainsi qu’à la bibliothèque de l’Alliance
Israélite Universelle à Paris.
Quelques résultats
Les résultats sont partiels, puisqu’il n’a pas encore été procédé à l’analyse de toutes les
données de terrain.
Un certain nombre de marqueurs identitaires permettent aux élèves et aux enseignants de
savoir immédiatement à quel groupe appartient tel ou tel enfant. Tout d’abord, le prénom
permet cette différenciation : les prénoms hébraïques, français ou américains ne sont portés
que par les juifs. Juifs et musulmans évoquent également la couleur de peau comme élément
distinctif : les premiers étant censés avoir la peau plus claire que les seconds. Si un juif a la
peau foncée, on dit de lui qu’il a l’air d’un «Marocain », c’est-à-dire d’un musulman.
La nomination est également productrice d’ethnicité. Chaque groupe se nomme et nomme les
autres. Dans une classe de CE2 (élèves de huit ans), j’ai demandé aux enfants quelle était leur
nationalité, les juifs m’ont répondu : « juifs marocains » et les musulmans : « marocains ».
Ainsi, l’adjectif juif précise et marque la différence et fait de l’élève musulman, un Marocain
seulement. Ces appellations se retrouvent également hors de l’école. Selon Tessler (1978), au
moment de l’indépendance, au Maroc, l’islam s’est vu de plus en plus associé au
nationalisme, de même que la langue arabe. L’identité marocaine étant liée à l’islam, les juifs
n’ont pas pu s’intégrer pleinement au tissu social de la nation. Ceci expliquerait l’attribution
de l’adjectif « marocain » aux personnes de confession musulmane exclusivement.
Cependant, puisque c’est ici l’appartenance religieuse qui permet au groupe de se distinguer

5
des autres, on peut imaginer que dans un autre contexte, au sein d’une communauté juive
française, israélienne ou américaine, les juifs marocains pourraient plutôt revendiquer leur
« marocanéïté ».
En ce qui concerne les juifs, et particulièrement les juifs religieux, la pratique de certains rites
et le respect de prescriptions les distinguent non seulement des musulmans, mais aussi de
leurs coreligionnaires moins pratiquants. Ainsi, les enfants qui embrassent la mezouza4 avant
d’entrer en classe sont immédiatement reconnus en tant que juifs, de même les garçons
portant la kipah.
La langue peut constituer un autre facteur de distinction : l’enseignement est dispensé en
français, langue maternelle de la majorité des élèves juifs. Les musulmans, généralement
arabophones, ont souvent plus de difficultés en français, principalement les élèves qui ne
commencent leur scolarité francophone qu’au secondaire.
L’institution contribue au maintien de la frontière entre les élèves des deux confessions. En
effet, au cycle primaire les élèves musulmans suivaient tous les cours de matières hébraïques,
excepté la liturgie. Dès la rentrée scolaire 2000, ils n’assistent désormais qu’aux cours de
langue hébraïque. Ce changement est dû aux problèmes rencontrés par les enseignantes,
principalement durant le cours de Torah. En effet, certains passages de la Bible sont
interprétés différemment par les juifs et les musulmans (notamment le sacrifice d’Isaac ou
d’Ismaël). En outre, les enseignants craignent toujours d’être accusés de faire du prosélytisme
auprès des musulmans.
Le fait que les musulmans ne suivent plus les cours de matières hébraïques (excepté l’hébreu)
s’inscrit dans la logique du maintien de la frontière : celle-ci ne doit pas être franchie : les
musulmans ne peuvent et ne doivent se convertir.
Ces dernières années le nombre de musulmans a augmenté régulièrement. Ce phénomène
inquiète certains parents juifs (religieux), ils craignent ce qu’ils appellent « les
fréquentations » et, surtout, « le mélange », le mariage mixte. Bon nombre de parents mettent
en garde leurs enfants, lorsqu’ils changent d’école pour aller au Lycée Maimonide, les filles
reçoivent des consignes quant à leur rapport avec les garçons musulmans.
Il existe également un consensus tacite concernant Israël, sujet tabou par excellence, les
mentions du conflit ne semblent apparaître, au lycée, que lors de moments de tension. Lors du
cours d’histoire – géo. concernant le Proche-Orient, le professeur n’a eu droit à aucun
commentaire, chacun ayant gardé le silence.
Le contact existe cependant, si les frontières sont des zones d’évitement, elles constituent
également des zones de contact. Ces élèves ont des points communs : ils appartiennent tous à
la classe moyenne, voire supérieure ; ils ont la « chance » de recevoir un enseignement de
type français, si prisé au Maroc. Ils partagent sans doute aussi le sentiment d’appartenir à une
élite. La marocanéïté des juifs peut aussi être revendiquée, la nationalité peut constituer un
point de contact, particulièrement à l’étranger ou face à des étrangers au Maroc.
De plus, certaines valeurs sont communes. Les parents musulmans préfèrent souvent les
écoles juives aux écoles françaises pour des raisons morales : selon eux, les enfants y sont
4 La mezouza, « montant de porte » est un petit rouleau de parchemin contenant certains passages de la Bible,
traditionnellement fixé sur les montants des portes d’une habitation juive.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%