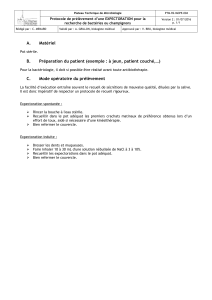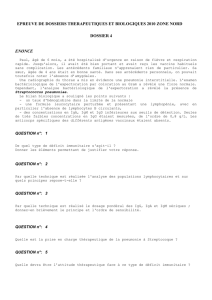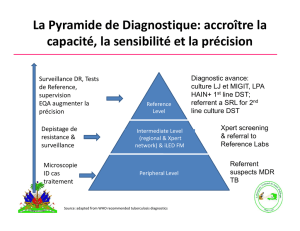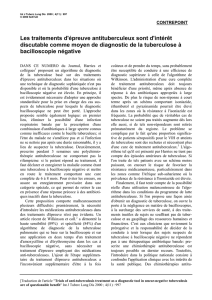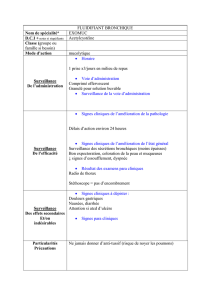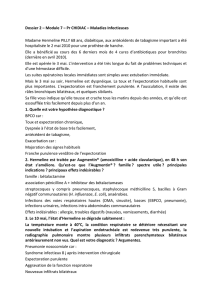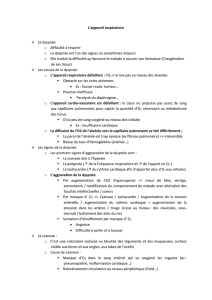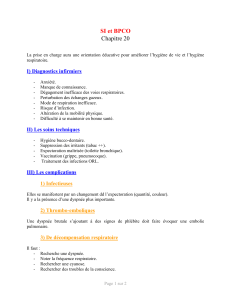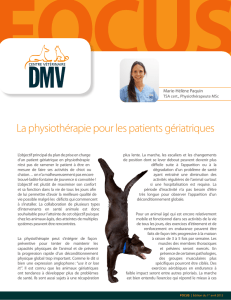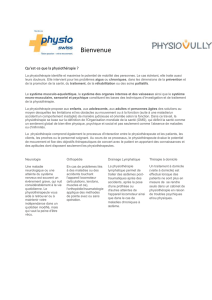Pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire au Malawi, des

INT J TUBERC LUNG DIS 13(1):99–104
© 2009 The Union
Pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire au Malawi,
des mesures simples sont aussi effi cientes que des
techniques invasives
D. J. Bell,*† R. Dacombe,‡ S. M. Graham,†§ A. Hicks,¶ D. Cohen,# T. Chikaonda,† N. French,†,**
M. E. Molyneux,†,†† E. E. Zijlstra,# S. B. Squire,†† S. B. Gordon†,‡‡
*
Tropical and Infectious Diseases Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, UK ; †
Malawi-Liverpool-Welcome
Trust Clinical Research Programme, College of Medicine, University of Malawi, Blantyra, Malawi ; ‡
Liverpool Associates
in Tropical Health, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK ; §
Centre for International Child Health,
Department of Paediatrics, University of Melbourne and Murdoch Children’s Research Institute, Royal Children’s
Hospital Melbourne, Parkville, Victoria, Australia ; ¶
Department of Respiratory Medicine, University Hospital Aintree,
Liverpool, UK ; #
Department of Medicine, College of Medicine, University of Malawi, Blantyra, Malawi ; **
Department
of Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, ††
Clinical Group, and
‡‡
Pulmonary Immunology Group, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK
Auteur pour correspondance : David Bell, Tropical and Infectious Diseases Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liver-
CONTEXTE : La détection des cas de tuberculose pulmonaire (TP) à bacilloscopie positive est un élément vital pour la
lutte contre la tuberculose (TB). Les méthodes d’amélioration du recueil de crachats sont disponibles, mais leur avan-
tage additionnel reste douteux dans les contextes à faibles ressources.
OBJECTIF : Comparer au Malawi les rendements diagnostiques de cinq méthodes d’obtention des crachats chez des
adultes diagnostiqués comme TP à bacilloscopie négative.
SCHÉMA : On a prélevé dans le laboratoire de l’étude les crachats expectorés spontanément sous supervision pour
examen microscopique et culture. Chez les patients à bacilloscopie négative, on a prélevé des échantillons d’expecto-
ration à l’aide de la physiothérapie, de l’induction des crachats et le lendemain matin les produits de lavage gastrique
et de lavage broncho-alvéolaire.
RÉSULTATS : On a exploré 150 patients chez qui le service hospitalier avait diagnostiqué une TP à bacilloscopie né-
gative. Chez 39 d’entre eux (26%), les frottis provenant d’une expectoration spontanée supervisée se sont avérés posi-
tifs au laboratoire de l’étude. On a enrôlé les 111 patients restants, con rmés comme à bacilloscopie négative ; 89%
d’entre eux étaient séropositifs pour le virus de l’immunodé cience humaine. Les techniques d’amélioration du re-
cueil des expectorations ont permis de diagnostiquer sept cas supplémentaires à bacilloscopie positive. On n’a pas ob-
servé de différence entre les diverses méthodes pour le nombre de cas détectés ; 44 (95,6%) des 46 cas à bacilloscopie
positive ont pu être détectés à partir d’échantillons d’expectorations spontanées ou assistées par physiothérapie.
CONCLUSIONS : Pour des pays comme le Malawi, l’utilisation optimale des ressources limitées de détection des cas
de TP à bacilloscopie positive consisterait à améliorer la qualité de la collecte des crachats expectorés spontanément
et celle de l’examen microscopique. Le rendement diagnostic supplémentaire du recours au lavage broncho-alvéolaire
est limité par rapport à l’expectoration induite.
MOTS-CLES : expectoration induite ; lavage gastrique ; physiothérapie ; LBA ; VIH
[Traduction de l’article : « Simple measures are as effective as invasive techniques in the diagnosis of pulmonary tuberculosis
in Malawi » Int J Tuberc Lung Dis 2009; 13 (1): 99–104]
RÉSUMÉ
LA PANDÉMIE du virus de l’immunodé cience hu-
maine (VIH) a provoqué une augmentation exponen-
tielle du nombre de patients diagnostiqués comme tu-
berculeux (TB) à bacilloscopie négative en Afrique.1
Au Malawi, le diagnostic de tuberculose pulmonaire
(TP) à bacilloscopie négative est porté sur la base d’une
toux de plus de 3 semaines, d’un échec de réponse
aux antibiotiques standard, d’un cliché thoracique
anormal (quand il est disponible) et d’un examen mi-
croscopique négatif à la recherche des bacilles acido-
résistants (BAAR) provenant de trois échantillons de
crachats expectorés spontanément et prélevés sur une
période d’au moins 2 jours. Les résultats du traite-
ment au Malawi sont plus mauvais chez les patients
atteints de TP à bacilloscopie négative que chez ceux
à bacilloscopie positive ; ceci est dû en partie au fait
que l’on traite pour TB des patients qui ne souffrent
pas de TB mais d’autres formes de maladies pulmo-
naires liées au VIH.2
Nous avons évalué les améliorations qu’on pour-
rait attendre dans le rendement diagnostique par des
méthodes renforcées de recueil des crachats utilisant

2 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
l’examen microscopique et la culture mycobactérienne
des expectorations. Nous avons comparé l’expecto-
ration spontanée avec celle assistée par physiothéra-
pie, avec le lavage gastrique, l’expectoration provo-
quée et le lavage broncho-alvéolaire (LBA). Le recueil
des crachats assisté par physiothérapie est une mé-
thode simple qui n’exige qu’une formation du per-
sonnel et aucun équipement sophistiqué, et pourrait
être adoptée facilement dans des contextes à ressour-
ces limitées.
POPULATION ET MÉTHODES DE L’ÉTUDE
Sujets et contexte
Cette étude a été menée au Queen Elizabeth Central
Hospital de Blantyre, Malawi, entre juin 2005 et août
2006. Ont été invités à participer à l’étude les patients
adultes hospitalisés, chez qui le diagnostic de TP à
bacilloscopie négative avait été porté, qui n’étaient
pas encore sous traitement antituberculeux et chez
lesquels trois échantillons de crachats expectorés spon-
tanément et récents avaient été considérés comme à
bacilloscopie négative sur base de l’examen direct des
frottis au laboratoire de l’hôpital. On a identi é les
recrues potentielles pour l’étude à l’endroit de l’en-
registrement pour traitement de TP à bacilloscopie
négative ou après transfert à partir d’autres clini-
ciens du département. On a exclu les patients atteints
d’épanchement pleural, d’ascite ou d’asthme ainsi que
ceux dont la saturation en oxygène était <94% sous
air ambiant.
L’étude a béné cié de l’approbation éthique des
Comités d’Ethique de la Recherche du Collège de Mé-
decine au Malawi et de la Liverpool School of Tropi-
cal Medicine au Royaume-Uni.
Recueil des échantillons et schéma de l’étude
On a recueilli un échantillon satisfaisant de crachats
(muqueux et non salivaire) expectoré spontanément
sous observation directe chez tous les sujets en vue d’un
examen au laboratoire de recherche. Si cet échan-
tillon de crachats s’avérait positif pour les BAAR, le
patient était exclu des investigations ultérieures. Les
patients con rmés comme à bacilloscopie négative
qui ont donné leur consentement éclairé ont été en-
rôlés et on a recueilli une expectoration assistée par
p hysiothérapie ainsi que des échantillons d’expectora-
tion provoquée. On a recueilli les données cliniques,
y compris le statut VIH (quand il était connu) ainsi
que les antécédents médicaux anciens et actuels. En
vue du recueil de l’expectoration assistée par physio-
thérapie, on a demandé au patient de pratiquer des
respirations profondes pendant qu’un clinicien lui
percutait le thorax à mains creuses. On a ensuite se-
coué le thorax du patient pendant approximativement
5 minutes. Finalement, on lui a demandé d’expirer
sur lèvres serrées. La procédure a été interrompue à
n’importe quel moment de ce processus si le patient
se mettait à tousser et produisait un échantillon satis-
faisant.3 L’expectoration provoquée a été recueillie en
utilisant des techniques standard. En bref, on a utilisé
un nébuliseur ultrasonique Mistogen EN145 (Misto-
gen Equipment, Oakland, CA, USA) contenant de
15 à 20 ml d’une solution saline stérile à 3%. Le pa-
tient a respiré dans le nébuliseur pendant 10 à 20 mi-
nutes ou jusqu’au moment où un échantillon satisfai-
sant était obtenu.
Des échantillons de tubage gastrique ont été re-
cueillis le matin suivant, avant toute consommation
de liquide ou d’aliments. On a introduit une sonde
naso-gastrique de gauge 14 et pratiqué l’aspiration
gastrique avec ou sans lavage au moyen de 20 ml de
solution saline isotonique en fonction du volume ob-
tenu par aspiration. Immédiatement après ceci, on a
pratiqué une bronchoscopie selon une technique dé-
crite antérieurement.4 On a utilisé de la xylocaïne par
voie locale et recueilli le LBA dans le lobe moyen
droit en utilisant des volumes de 50 ml de solution
saline isotonique stérile répétées jusqu’à un volume
de lavage maximum de 200 ml ou jusqu’au moment
où l’on a pu aspirer 50 ml de liquide. On a revu les
patients dès que l’ensemble des résultats de l’examen
microscopique a été disponible, et le traitement ap-
proprié leur a été prescrit par le clinicien en charge de
leur traitement. Aucun suivi complémentaire n’a été
mis en place au sein de cette étude.
Examen microscopique et culture
des mycobactéries
Les échantillons de LBA et de lavage gastrique ont été
centrifugés à 3.000 tours/min pendant 15 minutes et
on a écarté le surnageant. Les crachats obtenus par
expectoration spontanée, par aide physiothérapique
ainsi que l’expectoration provoquée et les culots de
lavage gastrique et de LBA ont été d’abord déconta-
minés par un isovolume de soude caustique à 4%.
Ce mélange a été agité au vortex, laissé à tempéra-
ture ambiante pendant 15 minutes et soumis à nou-
veau au vortex à la 10ème minute. Après 15 minutes,
le mélange a été agité au vortex, puis centrifugé à
3.000 tours/min pendant 15 minutes et l’on a écarté le
surnageant. On a préparé les lames à partir des sédi-
ments et on les a colorées par la méthode de Ziehl-
Neelsen en vue de l’examen microscopique. Pour
chaque échantillon, on a inoculé deux gouttes de sé-
diment sur la pente des tubes de Löwenstein-Jensen,
un tube contenant acide et œuf et l’autre acide et
œuf + pyruvate. Ces tubes ont été incubés à l’air à
37°C jusqu’à 8 semaines. Les tubes ont été contrôlés
chaque semaine à la recherche d’indices de croissance
de colonies.
Méthodes statistiques
Au total, nous avions plani é le recrutement de 150 pa-
tients, puisque les études antérieures avaient montré
qu’un tiers des patients à bacilloscopie négative serait

Diagnostic de la TB pulmonaire 3
con rmé comme TP par l’examen microbiologique.5
Cinquante patients atteints de TP con rmée (intervalle
de con ance [IC] 95% 25–41) auraient permis de
mettre en évidence une différence statistiquement si-
gni cative entre les diverses méthodes de diagnostic
par diminution de moitié du nombre de cas détectés
(25 cas, IC95% 11–23), calculée selon la version 9
Stata (StataCorp, College Station, TX, USA).
Contrôle de qualité
Une assurance externe de qualité de l’examen micro-
scopique a été réalisée à la Liverpool School of Tropi-
cal Medicine sur 100 lames consécutives et sur toutes
les lames positives. Le lecteur des 100 lames consécu-
tives ignorait les résultats. La détermination de l’es-
pèce mycobactérienne a été menée sur les cultures po-
sitives transférées au Royaume-Uni.
RÉSULTATS
On a dépisté en vue de l’étude 154 patients chez qui
le diagnostic clinique de TP à bacilloscopie négative
avait été porté ; quatre d’entre eux ont refusé de par-
ticiper. Les 150 patients restants ont tous fourni un
échantillon de crachats expectorés spontanément sous
observation ; à partir de cet échantillon, 39 (26%)
ont été diagnostiqués comme TP à bacilloscopie posi-
tive. Les 111 patients restants, chez qui une TP à ba-
cilloscopie négative avait été con rmée, ont accepté
des techniques invasives : leur âge moyen était de
36 ans (extrêmes 18–71), 58% étaient de sexe mas-
culin et 84 patients (75,6%) connaissaient leur statut
VIH : 75 (89%) étaient séropositifs pour le VIH et
presque tous étaient au stade 3 ou 4 de la maladie.
Chez toutes les recrues, les résultats récents de l’exa-
men des crachats expectorés spontanément avaient
été négatifs au laboratoire de l’hôpital. La durée mé-
diane entre le résultat négatif et le recrutement a été
de 4,5 jours (extrêmes 1–21).
Chez 18 des 111 patients recrutés, le diagnostic de
TP à bacilloscopie et/ou à culture positives a été con-
rmé grâce aux méthodes renforcées de recueil des
expectorations et à la culture mycobactérienne. Les
caractéristiques cliniques, y compris l’âge, les antécé-
dents de TB, la prévalence du VIH et les symptômes
ont été similaires entre ces 18 patients et les 93 où le
diagnostic de TP n’avait pas été con rmé. Une con r-
mation du diagnostic de TP a été plus probable chez
les patients signalant un contact TB dans le ménage
(odds ratio [OR] 3,4 ; IC 95% 1,16–10 ; P = 0,017).
Chez neuf des 18 diagnostics, celui-ci a été acquis
par la culture de l’échantillon de crachats expectoré
spontanément. L’inclusion des méthodes renforcées
de recueil des crachats n’a obtenu au total que neuf
diagnostics complémentaires de TP. L’expectoration
assistée par physiothérapie a détecté cinq de ces neuf
nouveaux cas, l’expectoration provoquée quatre des
neuf, le tubage gastrique quatre des neuf et le LBA
deux des neuf. Le diagnostic de TP à bacilloscopie
et/ou à culture positive a été acquis chez 15 des 18 pa-
tients (83,3%) sans nécessiter un lavage gastrique ou
un LBA.
Un grand nombre de pays à ressources limitées re-
courent seulement à l’examen microscopique des cra-
chats pour le diagnostic de TP, et en général les cul-
tures mycobactériennes ne sont pas disponibles. Grâce
à l’emploi de techniques renforcées de recueil des cra-
chats, on a pu diagnostiquer sept cas supplémentaires
à bacilloscopie positive sur les 111 patients con rmés
précédemment comme à bacilloscopie négative. L’ex-
pectoration assistée par physiothérapie a détecté cinq
de ces nouveaux cas à bacilloscopie positive sur sept,
l’expectoration provoquée quatre/sept, le lavage gas-
trique trois/sept et le LBA trois/sept. Deux des cinq
nouveaux cas à bacilloscopie positive détectés à par-
tir d’expectoration assistée par physiothérapie ont été
également positifs à la culture du crachat expectoré
spontanément.
Diagnostic par les méthodes de recueil
d’échantillons
La Figure met en évidence le gain diagnostique sup-
plémentaire obtenu grâce aux échantillons prélevés
par les différentes méthodes de recueil utilisées dans
l’ordre d’accroissement du caractère invasif, c’est-à-
dire l’expectoration spontanée suivie de l’expectora-
tion assistée par physiothérapie, l’expectoration pro-
voquée, le lavage gastrique et nalement le LBA. On
a tracé deux lignes, une montrant uniquement les ré-
sultats du frottis et l’autre considérant ensemble les
résultats des frottis et des cultures. Le Tableau met en
évidence le nombre de procédures pratiquées sur les
111 patients qui ont été retenu pour les méthodes in-
vasives (puisqu’il avait été démontré qu’ils avaient
une bacilloscopie négative sur l’échantillon expectoré
spontanément), ainsi que le nombre de résultats à
Figure Nombre de diagnostics de TP confi rmés par les frottis
(ligne continue) et par les frottis et la culture (ligne discontinue)
en utilisant des échantillons obtenus par des techniques de plus
en plus invasives. TP = tuberculose pulmonaire ; LBA = lavage
broncho-alvéolaire.

4 The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
bacilloscopie positive ou de résultats à bacilloscopie
e/ou à culture positive (ainsi que leurs IC à 95%) que
chacune des méthode avait obtenu. Nous n’avons pas
été à même de pratiquer l’ensemble des techniques
sur l’ensemble des 111 patients en raison de limita-
tions d’équipement et/ou de personnel (deux expec-
torations assistées par physiothérapie, cinq lavages
gastriques et 18 LBA), par suite d’un refus de consen-
tement (13 lavages gastriques, 14 LBA) et en raison
de mauvais état de santé du patient (trois lavages gas-
triques et huit LBA). On n’a pas noté de différences
signi catives dans les taux de détection obtenus par
les différentes méthodes car les IC à 95% se super-
posaient pour chacune des méthodes. On a décelé des
lésions de sarcome de Kaposi dans l’arbre bronchique
de six des 71 patients (8,5%) qui avaient subi une
bronchoscopie ; les résultats TB n’ont été positifs
chez aucun de ces patients.
Toutes les lames signalées comme positives par le
microscopiste de l’étude ont été con rmées comme
positives lors du réexamen à Liverpool ; aucune lame
positive supplémentaire n’a été mise en évidence. Les
cultures mycobactériennes provenant de six des pa-
tients à culture positive ont été soumises à la détermi-
nation de l’espèce. Il s’agissait dans tous les cas du
complexe Mycobacterium tuberculosis.
DISCUSSION
La détection des cas de patients atteints de TP par
l’examen des frottis est un élément essentiel pour la
stratégie de lutte antituberculeuse, en particulier dans
les pays à endémie VIH comme le Malawi.6 On dis-
pose de diverses méthodes pour obtenir des échan-
tillons chez les patients suspects de TP, bien que leur
degré d’accessibilité varie entre les pays plus pauvres
et plus riches. Nous avons comparé les rendements
diagnostiques des crachats obtenus en utilisant des
méthodes d’agressivité croissante chez les patients chez
qui le diagnostic clinique de TP à bacilloscopie néga-
tive avait été porté. Nous n’avons pas trouvé de diffé-
rences signi catives dans les taux de détection de ces
diverses méthodes.
Sur les 150 patients diagnostiqués comme TP à ba-
cilloscopie négative par le service de l’hôpital, chez
57 (38,7%) le diagnostic nal de TP con rmé par
frottis et/ou culture a été porté, un résultat en accord
avec des études antérieures d’origine africaine.5 Par la
simple amélioration de la qualité du recueil des cra-
chats expectorés spontanément et de l’examen mi-
croscopique, nous avons détecté 39 cas (26%) à ba-
cilloscopie positive. Par l’utilisation des méthodes
renforcées de recueil des crachats, nous avons détecté
sept cas supplémentaires à bacilloscopie positive. Au
total, on a trouvé 46 cas à bacilloscopie positive dont
44 (95,7%) pouvaient être détectés par l’utilisation
de la seule expectoration spontanée ou assistée par
physiothérapie. Il s’agit d’un fait encourageant pour
un contexte comme le Malawi où les méthodes plus
invasives ou plus sophistiquées de recueil des crachats
ne sont que rarement disponibles.
L’utilisation de la culture mycobactérienne et des
méthodes renforcées de recueil de l’expectoration nous
a permis de diagnostiquer une TP à bacillo scopie et/
ou à culture positives chez 18 (16,2%) des 111 pa-
tients con rmés antérieurement comme à bacillo-
scopie négative ; 54 (93%) de ces 57 cas de TP con-
rmés comme à bacilloscopie et/ou à culture positive
ont été détectés sans nécessiter de lavage gastrique ou
de LBA. La Figure illustre que, dans ce groupe de pa-
tients, le rendement diagnostique supplémentaire en
cas de TP con rmée diminue rapidement lorsque l’on
utilise des méthodes plus invasives et plus coûteuses.
Chez 93 patients, nous n’avons pas pu établir un
diagnostic nal ferme expliquant leur toux chronique.
D’autres causes habituelles chez les patients séro-
positifs pour le VIH dans ce contexte comportent la
pneumonie à Pneumocystis jirovecii, le sarcome pul-
monaire de Kaposi, la pneumonie bactérienne et les
infections à salmonelles non-typhiques. Les lésions
du sarcome de Kaposi ont été observées dans l’arbre
bronchique de six des patients (8,5%) de cette étude
chez qui une bronchoscopie avait été pratiquée.
Le pouvoir statistique de cette étude peut avoir été
insuf sant pour la détection de différences dans les
taux de détection des différentes méthodes de recueil
de crachats, et le nombre de patients con rmés comme
atteints de TP que nous avons détectés aurait pu être
supérieur si nous avions recouru à l’expectoration
provoquée plus d’une fois chez chaque patient.7 En
outre, on n’a pratiqué le LBA que dans le lobe moyen
droit, sans tenir compte de la localisation de la maladie
Tableau Nombres de chacune des procédures pratiquées et nombres d’échantillons à bacilloscopie positive et à bacilloscopie
et /ou culture positives obtenus chez les 111 patients retenus dans l’échantillonnage invasif*
Expectoration
spontanée
(n = 111)
Expectoration
assistée par
physiothérapie
(n = 109)
Expectoration
provoquée
(n = 111)
Lavage
gastrique
(n = 91) LBA
(n = 71)
Frottis positif,
n (%), (IC 95%) 0 5 (4,6), (1,5–10,4) 4 (3,6), (0,9–9,0) 3 (3,3), (0,6–9,3) 3 (4,2), (0,9–11,9)
Frottis et /ou culture positifs
n (%), (IC 95%) 9 (8,1), (3,8–14,8) 10 (9,2), (4,4–16,2) 13 (11,7), (6,4–19,1) 10 (11), (5,4–19,3) 6 (8,5), (3,2–17,5)
*
Trente-neuf patients chez qui une bacilloscopie positive avait été obtenue par répétition de l’expectoration spontanée n’ont pas été inclus.
LBA = lavage broncho-alvéolaire ; IC = intervalle de confi ance.

Diagnostic de la TB pulmonaire 5
sur le cliché thoracique, ce qui peut avoir causé un
plus faible rendement.
Il a été démontré antérieurement que l’amélioration
de la qualité des crachats augmentait le rendement de
l’examen microscopique des crachats. Dans une étude
provenant du Pakistan chez les femmes ayant béné-
cié de directives sur la façon de produire un bon
échantillon de crachats avant de fournir l’échantillon,
les chances de positivité ont été plus grandes que chez
les contrôles.8 Dans une autre étude provenant d’In-
donésie, la formation des patients préalable au recueil
des crachats a entraîné un taux de détection de 15,1%
supérieur par comparaison avec le groupe contrôle.9
A côté de la qualité obtenue de l’échantillon de cra-
chats, d’autres facteurs peuvent avoir contribué à
l’ac croissement du rendement diagnostique provenant
d’échantillons répétés produits spontanément. Ceux-
ci comportent la qualité de l’examen microscopique,
la progression de la maladie entre le premier prélève-
ment de crachats au sein du système de santé de rou-
tine ainsi que la répétition des prélèvements dans
l’étude. La concentration de l’expectoration par l’eau
de Javel et la centrifugation avant l’examen microsco-
pique augmentent la sensibilité par comparaison avec
l’examen microscopique direct du frottis ;10 dans une
étude d’une cohorte séropositive pour le VIH, on a sig-
nalé une augmentation de sensibilité de 11%.11 Dans
cette étude, l’examen microscopique a été pratiqué
dans un laboratoire de recherche utilisant des produits
concentrés alors que l’examen microscopique initial
a été pratiqué sur des frottis directs dans un labora-
toire hospitalier très actif où un certain nombre de
contraintes compromettaient la qualité de l’examen
microscopique.12 La durée médiane entre le résultat
du crachat négatif provenant du laboratoire hospita-
lier et celui du recrutement a été brève, se situant à
4,5 jours (extrêmes 1–21) ; pour cette raison, la pro-
gression de la maladie doit avoir été limitée dans la
plupart des cas, mais peut avoir expliqué la détection
de quelques uns des cas supplémentaire à bacillo-
scopie positive dans l’étude.
Des travaux sur les rendements diagnostiques par
les différentes méthodes de recueil des crachats va-
rient ; une étude provenant de Nouvelle-Zélande a
montré que les tests sur expectoration provoquée
étaient plus sensibles que le LBA pour la détection de
la TP,13 et une autre étude a trouvé que l’expectoration
provoquée étaient plus sensible que le lavage gastrique
chez de jeunes en Afrique du Sud.14 L’expectoration
provoquée s’est avérée antérieurement améliorer le
diagnostic de la TP chez les enfants et les adultes au
Malawi.3,15 Elle a l’avantage de ne pas exiger une ad-
mission hospitalière (comme c’est la cas pour le la-
vage gastrique) ou un équipement et une expertise so-
phistiqués, comme c’est la cas pour le LBA), mais elle
exige un équipement (nébuliseur) qui n’est habituelle-
ment pas disponible. La technique d’expectoration
provoquée inclut habituellement une physiothérapie
thoracique ; une étude chez les enfants en Afrique du
Sud a signalé que la physiothérapie thoracique à elle
seule était aussi ef cace que l’expectoration provo-
quée pour le diagnostic de la TP (données non pu-
bliées, S Kara). Nos résultats sont concordants avec
une étude récente au Royaume-Uni qui a comparé de
multiples procédures d’expectorations provoquées et
de tubage gastrique au LBA pour le diagnostic de la
TP chez 107 patients incapables de produire une ex-
pectoration spontanée. Environ 3,5% de ces patients
étaient séropositifs pour le VIH. L’étude a conclu que
dans ce groupe de patients, trois échantillons d’ex-
pectoration provoquée étaient plus sensibles que trois
échantillons de lavage gastrique, et que la broncho-
scopie et le LBA n’amélioraient pas la sensibilité du
diagnostic.16
Nos données suggèrent que dans les pays endé-
miques à la fois pour la TB et le VIH, comme le Ma-
lawi, la meilleure utilisation des ressources limitées
pour la détection des cas de TP à bacilloscopie posi-
tive consisterait à améliorer la qualité du recueil des
crachats expectorés spontanément ainsi que l’examen
microscopique. Pour des pays comme le Royaume-
Uni, où les services de culture mycobactérienne sont
présents et où l’accès à l’expectoration ou au LBA est
facile, les médecins devraient être conscients du fait
que lors d’une investigation de cas suspects de TP, le
rendement diagnostique supplémentaire obtenu par
le LBA après expectoration provoquée pourrait être
limité. Dans notre étude, la technique simple de phy-
siothérapie thoracique pour aider à la production de
crachats a entraîné cinq diagnostics supplémentaires
à bacilloscopie positive de plus que ceux obtenus par
l’expectoration spontanée. Bien que ceci ne soit pas
signi cativement supérieur au rendement après utili-
sation des autres méthodes, la physiothérapie n’exige
ni solution saline hypertonique ni équipement, et elle
n’est pas invasive. Il y aurait lieu de plani er des
études ultérieures en Afrique sub-saharienne pour éva-
luer son rôle possible dans un contexte opérationnel.
Remerciements
Les auteurs remercient S Kara, physiothérapeute, pour la forma-
tion du personnel aux techniques de physiothérapie thoracique et
d’expectorations provoquées. Ils remercient également R Cooke,
l’équipe de l’étude, G Mwafulirwa, R Malamba, N Mthunkama,
M Kunkeyani et G Musowa ainsi que les patients et le personnel
du Queen Elizabeth Central Hospital, Malawi. Cette étude a béné-
cié de subsides du Trust Wellcome (WT). D J Bell a obtenu une
bourse de formation WT en Médecine Clinique Tropicale (no.
066681), S M Graham a obtenu une bourse WT (core grant
074124/Z/04/Z), N French a obtenu une bourse d’élaboration de
carrière de WT (no.061230) et S B Gordon a obtenu une bourse
d’élaboration de carrière de WT (no. 061231). Le Wellcome Trust
n’a eu aucun rôle dans la plani cation de l’étude ni dans l’analyse
des données ou la préparation du manuscrit.
Références
1 Harries A D, Hargreaves N J, Kemp J, et al. Deaths from tuber-
culosis in sub-Saharan African countries with a high preva-
lence of HIV-1. Lancet 2001; 357: 1519–1523.
 6
6
1
/
6
100%