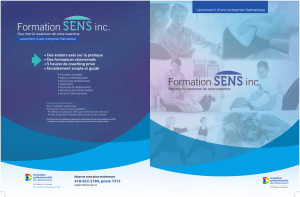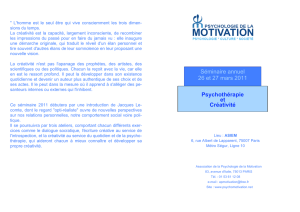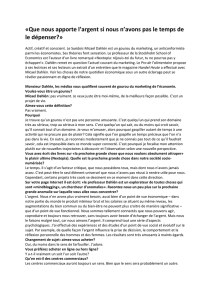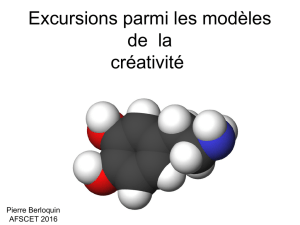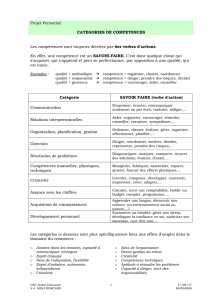Format PDF - Communiquer

Communiquer
Revue de communication sociale et publique
Créativité et organisation : une tension communicationnelle
Coordination du dossier par :
Dany Baillargeon, Université de Sherbrooke, Canada
Alexandre Coutant, Université du Québec à Montréal, Canada
Édition électronique
URL : http://communiquer.revues.org/1839
ISSN : 2368-9587
Éditeur
Département de communication sociale et
publique - UQAM
RÉFÉRENCE ÉLECTRONIQUE
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-strict.dtd"> Créativité et organisation : une tension
communicationnelle strong { font-weight: normal; } h3 { margin-bottom: 0; }
p { margin-top: 0; } sup { vertical-align: top; }
POUR CITER CET ARTICLE
Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.
© Communiquer

Créativité et organisation :
une tension communicationnelle
Coordination du dossier par :
Dany Baillargeon, Université de Sherbrooke, Canada
Alexandre Coutant, Université du Québec à Montréal, Canada
Le terme créativité a envahi les organisations. Celle-ci n’est plus seulement
cantonnée aux métiers traditionnels de la création. Elle domine maintenant discours
et considérations organisationnelles : au cœur des préoccupations des PME
(Chanut-Guieu et Guieu, 2014) ; en tant que compétence prisée par les
employeurs ; participant des discours de rationalisation et d’efficacité (Breen, 2004) ;
s’invitant dans les processus d’innovation (Auger, 2009), du management (Bardin,
2006 ; Davis et Scase, 2000 ; Paris, 2010) et dans les modèles économiques des
milieux professionnels (Eisenberg, Goodhall et Trethwey, 2014), voire politiques (Le
Corf, 2012). Ainsi, on ne dénombre plus les formations professionnelles, sites et
manuels proposant de « booster »1 sa créativité dans le cadre professionnel.
Au regard des métiers de la communication, censés traditionnellement la mobiliser,
en communication marketing (Cossette, 2009 ; McFall, 2004 ; Nixon, 2003 ; Tungate,
2007) mais également dans toute entreprise du savoir (Alvesson, 2004), la créativité
paraît se révéler de nouvelles manières. Loin de se cantonner aux bureaux des
créatifs, elle doit désormais être mobilisée par les concepteurs des différents
supports de communication, les rédacteurs, les stratèges en communication et
consultants spécialisés mais aussi par les chefs de projets, les animateurs de
communautés, les responsables RH, la comptabilité ; bref tous sont appelés à la
barre de la créativité (Auger, 2009), supposant que tous y contribuent (Bouquillion,
2012). Dans ce régime, doit-on conclure qu’en communication, on ne peut pas ne
pas être créatif ?
1 http://www.journaldunet.com/management/direction-generale/booster-creativite.shtml

Cependant, son omniprésence ne va pas sans une impression de flou associée à
son emploi. Entend-on strictement la même chose dans tous ces domaines ? Peut-
on distinguer au contraire différentes formes de créativité mobilisées au sein des
organisations, chacune identifiable à travers les discours mais également retrouvée
dans les productions de ces dernières (Michaud, 2011) ? À quel élément essentiel à
la vie des organisations est-elle censée répondre pour être ainsi constamment
mobilisée, voire galvaudée ? Est-elle si facilement inoculable au sein des différents
services ? Comment s’accommode-t-elle avec une logique gestionnaire de plus en
plus rationalisante où le risque économique inhibe l’ambigüité inhérente à la mise
en place de réels processus de création ?
Nombre d’auteurs ont abordé la relation organisation et créativité du point de vue
de la gestion de l’innovation (Auger, 2009 ; Hauch, 2002 ; King, 1990 ; Paris, 2007), du
climat ou, encore, des conditions facilitatrices (Amabile et al., 1996). Plusieurs ont
investi le champ des industries créatives et de la sociopolitique de la créativité et de
l’innovation, tentant de repérer les conditions socioéconomiques produisant des
externalités créatives (Delgado, Porter et Stern, 2010 ; Florida, 2003 ; Hutton, 2006 ;
Simon, 2009).
Toutefois, la dimension communicationnelle est souvent occultée, comme si les
fonctions et les structures se vivaient hors des interactions et des relations (Trujillo,
1983).
Ainsi, quel rôle joue la communication organisationnelle dans sa dissémination, sa
légitimation ou, à l’inverse, son inhibition ? Comment, d’un point de vue
communicationnel, performe-t-on ou incarne-t-on la créativité au sein des
organisations (Cooren, 2010 ; Gaertner, 2010), et comment se transmettent et se
débattent les différentes idéologies de la créativité (Baillargeon, 2014 ; Hackley et
Kover, 2007) entre les corps de métiers (Drazin, 1990, Drazin et al., 1999 ; Hirschman,
1989), malgré l’apparente incommunicabilité de la nature même de la création
(Paris, 2010). Ainsi, nous proposons d’encourager l’étude de la créativité en
interrogeant le caractère constitutif ou organisant des tensions, des performances et
des discours faits au nom de cette créativité.
Ce dossier thématique a pour objectif de susciter la réflexion autour de l’inflation de
l’emploi du terme créativité au sein des organisations, plus particulièrement au
regard des métiers et des usages de la communication. Outre l’intention de penser
de manière critique son emploi dans un tel contexte, nous appelons des textes
portant « une réflexion théorique ancrée dans des observations empiriques [afin de]
contribuer au renouvellement des pistes de recherche ou des pratiques »2 autour de
quatre axes apparaissant particulièrement problématiques.
2 http://www.revuecsp.uqam.ca/ojs/index.php/communiquer/about/editorialPolicies#focusAndScope

Axe 1 : Management de la créativité
Quel management de la créativité ? Les managers disposent
traditionnellement d’outils de gestion les aidant à prévoir ou reproduire un
ensemble d’actions (Chiapello et Gilbert, 2013). Dès lors, comment repérer
des démarches créatives qui se logent souvent dans la pratique
professionnelle ordinaire (Alter, 2010) ? Comment identifier des profils de
praticiens susceptibles de la stimuler ? À ce titre, quelles caractéristiques
professionnelles et culturelles attendre des praticiens de ces nouveaux
métiers (Florida, 2012) ? Quelle forme de carrière leur prévoir ? Surtout, au
regard de l’orientation communicationnelle de ce dossier thématique, de
quelle façon ce management de la créativité est-il pratiqué, communiqué,
performé et reçu (Rouleau, Allard-Poesi et Warnier, 2007 ; Trujillo, 1983) ?
Axe 2 : Légitimation, validation, évaluation et mesure de la créativité
N’est créatif que celui qui est reconnu comme tel. Au vu d’une sociologie de
la créativité (Csikszentmihalyi, 1998) et des industries du savoir (Alvesson,
2004), la créativité est constamment sujette à des entreprises rhétoriques pour
légitimer qui est et ce qui est créatif, statut jamais stabilisé (Drazin, Glynn et
Kazanjian, 1999) et constamment mis en tension (Gotsi et al. 2010 ; Michaud,
2011 ; Smith et Lewis, 2011). Cette ambiguïté contribue à l’émergence de
nombreux et nouveaux outils pour en évaluer l’efficacité, la pertinence,
l’originalité. Quels rôles jouent ces évaluations dans la dynamique
organisationnelle ? Quels (nouvelles ?) formes et (nouveaux ?) outils sont mis
en œuvre pour « mesurer » cette créativité ? Quelles rationalités en justifient
l’usage ? Quels discours sont portés au nom de ces outils ? Et, surtout,
comment comprendre la circulation et l’appropriation de ces outils dans une
perspective communicationnelle (Alvesson, 1994 ; Cooren, 2010 ; Cooren,
2013) ?
Axe 3 : Tous créatifs ? Créativité ordinaire, créativité marginale et métiers
paracréatifs
Les injonctions à la créativité sont nombreuses, celle-ci devenant une
condition sine qua non à l’embauche dans de nombreux secteurs de
l’organisation pourtant non associés à la création de contenu. Par ailleurs, le
culte de la créativité dans l’industrie des communications est souvent
préempté par les grandes agences et organisations aux budgets, forces de
travail et clients nourrissant cet éthos (Dru, 1984 ; Chomarat, 2013 ; Nixon,
2003 ; Séguéla, 1992). Qu’en est-il de « l’autre » créativité, celle qui opère loin
des clusters créatifs et des villes créatives (Bell et Jayne, 2006) et des grandes
organisations ? Quels sont ces autres acteurs organisationnels qui influent sur
les processus créatifs, y participent sans pour autant revêtir le titre de créatif
(Negus, 2002) ?

Axe 4 : Créativité et risque organisationnel
La créativité comme risque organisationnel ? Agir dans un monde incertain
revient à mettre en place des outils et techniques tentant de limiter les risques
(Beck, 1992). Néanmoins, le passage de ces outils et techniques de
diagnostic à une décision d’action demeure en partie une gageure. Intégrer
un processus créatif à une organisation qui cherche davantage la
reproductibilité et tente de minimiser les prises de risque peut alors paraître
une tâche insurmontable (Paris, 2010). Comment mettre en place une
organisation permettant son expression sans pour autant déstabiliser les
processus organisationnels traditionnels (Bouchard et Bos, 2006) ? Au
contraire, la créativité et sa libre circulation constitue-t-elle un moyen
d’assurer le passage du diagnostic à l’action ? Face à l’incertain, peut-elle
même se substituer aux outils d’aide à la décision classique des managers ?
Constitue-t-elle une nouvelle valeur centrale pour garantir le succès d’une
entreprise innovante ? Auquel cas, est-il possible d’envisager de classer des
formes de créativité en fonction de leur apport au succès d’une
organisation ?
Dates importantes (calendrier prévisionnel)
Date limite de réception des articles : 15 décembre 2016
Retour vers les auteurs : 1er mars 2017
Envoi des révisions par les auteurs : 15 juin 2017
Parution : premier trimestre 2018
Directives
Les articles complets seront soumis à Communiquer, Revue de communication
sociale et publique en sélectionnant le dossier « Article – Sur appel ». Le processus et
exigences de soumission sont indiqués à l’adresse :
http://communiquer.revues.org/1275
Les consignes de mise en forme d’un article sont consultables sur la page :
http://communiquer.revues.org/1276
Afin d’éviter les conflits d’intérêts potentiels, les personnes qui soumettent des
manuscrits peuvent, si elles le souhaitent, transmettre à la revue une liste des
personnes évaluatrices ou responsables de manuscrit qui pourraient occasionner de
tels conflits.
Les propositions de communication feront l’objet d’une évaluation en « double
aveugle » par les membres du comité scientifique.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%
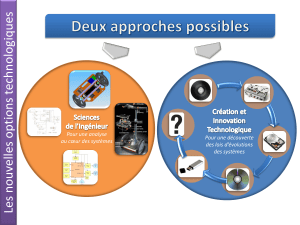

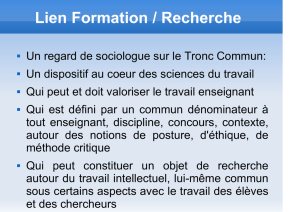
![voir syllabus [DOCX - 22 Ko ] - Université Toulouse 1 Capitole](http://s1.studylibfr.com/store/data/000144218_1-a5d99772cdb68f111ddc624587c5eb25-300x300.png)