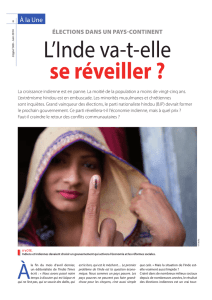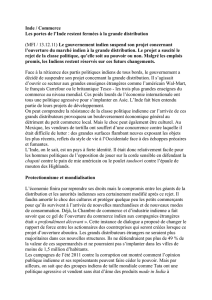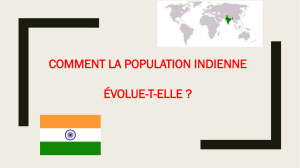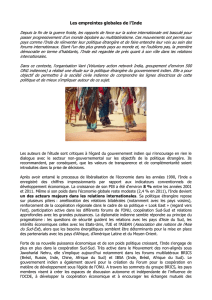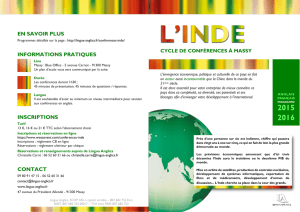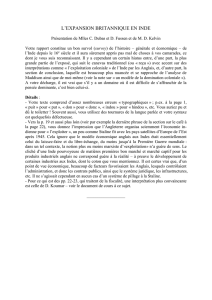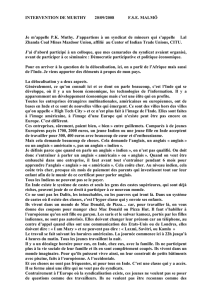Les dynamiques de politique interne face aux conflits ethniques et

Les conflits ethniques et religieux en Inde : logiques
internes et conséquences internationales.
Les dynamiques de politique interne face aux conflits ethniques et
religieux
Introduction
I. Les obstacles au développement d’une stratégie de rayonnement international
A. La plus grande démocratie, colosse aux pieds d’argile
1/ Les tensions intercommunautaires et le nationalisme hindou
2/ Le régionalisme
3/ Le système des castes comme structure de la société indienne
B. Les difficultés intrinsèques à la démocratie indienne
1/ L’éclatement des partis
2/ L’immobilisme des partis et la bureaucratie
C. Les limites économiques
1/ Une ouverture graduelle sur le monde
2/ Des résultats décevants : la politique monétaire et budgétaire
II. Les manipulations politiques à but électoraliste
A. La théorie de la diversion utilisée par le BJP
1/ L’instrumentalisation des tensions intercommunautaires et l’exemple
d’Ayodhya
2/ L’utilisation de la répression américaine du terrorisme par le gouvernement
indien depuis le 11 Septembre 2001
3/ Les essais nucléaires indiens sur la scène interne indienne
B. La réplique du Parti du Congrès
1/ L’utilisation du communalisme
2/ L’utilisation des castes
3/ La recherche d’un pouvoir charismatique
Conclusion : une politique interne instable, risquant de fragiliser sa stratégie de
développement international

INTRODUCTION :
Depuis les années 50, l’Inde revendique le titre de « plus grande démocratie du monde » en
vertu, notamment, de l’indépendance de la justice, du contre- pouvoir exercé par la presse et de
tenue d’élections libres à intervalles réguliers. Ce dernier élément est sans doute le plus décisif car
il a permis l’alternance au pouvoir, le parti du Congrès ayant été battu trois fois, en 1977, 1989,
1999 par le BJP (Bharatiya Janata= Parti du Peuple Indien).
La démocratie Indienne est l’héritière de l’Empire Britannique par son parlementarisme. Ce qui
n’est pas sans posé des écueils dès qu’une alternance existe. Autant l’alternance peut être
bienfaitrice dans un système parlementaire fondé dans un Etat unitaire comme l’est la France ou le
Royaume Uni, autant ce même facteur peut devenir dangereux pour la vie politique d’un Etat
fédéral, comme l’est l’Inde. La responsabilité ministérielle devant le Parlement Indien, Sansad et sa
chambre basse, le Lok Sabha, nécessite forcément d’avoir une majorité au sein du Lok Sabha. Or
dans un Etat hétéroclite, comme l’est l’Inde, avec ses 25 Etats et 7 territoires, ses 18 langues
officielles et ses 7 religions, parvenir à une majorité est loin d’être aisé. Cela semblait cependant
réalisable : jusque dans les années 90, un seul parti parvenait à réunir une majorité : le Parti du
Congrès. La prépondérance de ce parti était alors obtenu grâce à trois facteurs : la lutte anti-
coloniale menée par une intelligentsia nationaliste dont Nehru fournit l’archétype, le charisme de
Gandhi, dont le rayonnement devait beaucoup à son image d’ascète dévoué au service de la
nation, et enfin un réseau de notables. Mais son audience s’est érodée au fil des années et les
années 90 constituent le paroxysme de ce déclin. La vie politique indienne est principalement
dominée par deux lignes de clivage qui se superposent et qui opposent l’une, des hindous aux
musulmans, et l’autre, des castes supérieurs à des castes inférieures. Ces conflits sont le produit
de manipulations politiques entretenues notamment par le parti nationaliste, le BJP, qui parvient au
pouvoir en 1999 et s’impose comme une force incontournable de la vie politique indienne.
Au-delà des clivages politiques, le BJP comme le Parti du Congrès, ont le point commun d’avoir
adopté la même stratégie pour l’Inde : lui donner un rayonnement et un prestige international et
cela malgré les conflits ethniques et religieux. La question se pose alors de savoir si la politique
indienne est tributaire des conflits ethniques et religieux ou si au contraire la politique indienne
utilise ces mêmes conflits à son profit, pour leurs vertus électoralistes et pour se voir accorder
toutes les attentions de la communauté internationale ? Autrement dit, comment interfère la
politique indienne sur les conflits ethniques et religieux et réciproquement ?
Il est tout d’abord notable que la politique indienne semble gênée pour atteindre son objectif de
rayonnement international par les difficultés internes et intrinsèques à l’Inde (I). Mais in fine ces
obstacles constituent autant de points forts pour les partis indiens (II).

I. LES ENTRAVES AU DEVELOPPEMENT D UNE STRATEGIE DE
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Les équilibres régionaux, le jeu des alliances et de l’ingérence, les tendances à
l’unilatéralisme, auront leur effet sur le discours stratégique indien. Mais ils ne seront pas les seuls.
L’influence de facteurs régionaux et d’acteurs internes, caractéristiques de la scène sous
continentale, pèsera également de tout son poids, généralement défavorablement, sur les attentes
de New Delhi. Autant de difficultés et de probables désappointements pour une nation rêvant de
prestige. Parmi celles-ci, les limites ethniques et socioculturelles (A), les limites politiques (B) et les
limites économiques (C) auront une importance particulière. À la différence d’éléments dont elle
ne saurait avoir la maîtrise (comme la politique américaine ou le contexte économique
international), certaines "faiblesses" de politique intérieure pénaliseront ses objectifs, et mettront
en avant sa propre responsabilité.
A. La plus grande démocratie, colosse aux pieds d’argile
1/ Les tensions intercommunautaires et le nationalisme hindou
Comme il a été démontré dans le précédent exposé général, l’Inde est composée à 80%
d’Hindous et habite six autres religions. Dans ce pays, encerclé par deux frères musulmans que
sont le Pakistan à l’Ouest, et le Bangladesh à l’Est, la cohabitation est bien loin d’être
harmonieuse.
La progression de l’idéologie nationaliste hindoue devrait influer d’une manière croissante
sur la stratégie de l’Inde au xxie siècle. Le renouveau des valeurs traditionnelles hindoues,
longtemps laissées de côté, a gagné en ampleur sous l’impulsion de courants politiques tels que le
RSS, le World Hindu Council, le Shiv Sena ou le BJP. Le rappel de l’héritage des millénaires passés,
la particularité des valeurs de l’hindouisme (hindutva) et leur rayonnement sur l’environnement
régional, largement surévalué, sont des éléments susceptibles de diriger la stratégie nationale vers
des horizons incertains. Les réalisations inachevées des époques lointaines ou récentes, placées
dans une logique de montée en puissance des références nationalistes, peuvent constituer autant
d’orientations dangereuses.
La "plus grande démocratie du monde" ses vingt-cinq États et sept territoires associés
(Union Territories), ses dix-huit langues officielles, ses sept religions
1
et ses cent quinze millions
d’étudiants, ne sont pas à l’abri de quelques comportements sectaires, dégénérant en de sanglants
affrontements intercommunautaires. La destruction en décembre 1992 de la mosquée Babri à
Ayodhya (édifiée sur l’emplacement même d’un temple dédié au Dieu hindou Ram) par des
fanatiques hindous provoqua les plus graves incidents entre hindous et musulmans de cette fin de
1 Les sept religions principales sont l’hindouisme, l’islam, le bouddhisme, le christianisme, le sikhisme, le
jaïnisme et le zoroastrisme.

siècle2. Un événement presque fondateur de la montée en puissance des courants nationalistes
hindous au pays de Gandhi. On imagine quel peut être le poids de tels événements dans un
contexte de tensions régionales récurrentes, avec deux pays musulmans de plus de 130 millions
d’âmes pour voisins immédiats, à l’est comme à l’ouest.
La communauté musulmane indienne n’est pas la seule à être exposée à un possible
vindicte de la large majorité hindoue. En 1998, la petite communauté chrétienne de l’Union (2,4 %
de la population totale) a fait les frais d’attaques violentes et meurtrières de la part d’éléments
extrémistes hindous3, totalisant en une seule année autant d’incidents à son encontre qu’au cours
des cinquante années précédentes. Cette situation crisogène, susceptible des pires débordements,
attira sur New Delhi la condamnation d’une communauté internationale inquiète pour le sort d’une
minorité jusqu’alors épargnée.
Les tensions intercommunautaires, œuvre de la majorité dirigée contre une minorité
ethnico religieuse, ne crédibilise pas à l’étranger le gouvernement central d’un État où elles
surviennent. Les capitales, inquiètes devant les débordements mal contenus d’un exécutif
impuissant, témoigneront à son égard d’un scepticisme servant mal d’ambitieux intérêts
stratégiques. Or, la montée en puissance des mouvements nationalistes, parvenus par trois fois en
trois ans au pouvoir à New Delhi, ne permet pas d’imaginer un affaiblissement du risque
d’affrontements entre communautés religieuses. Le discours sectaire de certains courants radicaux,
ouvertement hostiles aux "privilèges" garantis par la constitution aux minorités, ne semble pas sur
le point de s’atténuer. Si elle venait à se renforcer, l’influence des idéologues nationalistes hindous
sur le gouvernement agirait négativement sur l’harmonie de cet État laïc et démocratique ; elle
constituerait une véritable menace pour sa stabilité interne. Son image à l’étranger s’en trouverait
affectée, ce qui finirait par avoir une implication sur la réussite de ses projets.
2. Le régionalisme
W.H Morris montra que l’expression des besoins politiques en Inde mettait en œuvre
plusieurs langages, selon les circonstances et les questions soulevées : un langage laïque et
moderne, un langage traditionnel de la caste et celui de la religion. La démocratie indienne a dû
s’insérer dans un tissu d’une société profondément hétérogène. La force du patriotisme régional
appartient à ces contraintes, au même titre que la contrainte des castes et communautés. Le
patriotisme régional s’incarne dans la culture, la langue, et parfois dans la religion ou la secte Les
clivages régionaux sont si forts qu’ils laissent émerger des quasi-nations fortement individualisées :
le Tamil Naidu, l’Orissa, le pays telugu, le Kerala au sud, le Bengale et l’Assam à l’est, le Pendjab
au nord-ouest, le Gujarat et le Maharastra à l’ouest. La force des coutumes, cultures et des langues
confère alors de l’importance aux partis régionaux ce qui conduit à une multiplication des
2 La démolition de cette mosquée du xvie siècle située en Uttar Pradesh (nord de l’Inde) provoqua les pires
émeutes entre hindous et musulmans depuis la partition de 1947. On estime le nombre des victimes à plus de
3 000.
3 La minorité chrétienne d’Inde a été victime d’une centaine d’agressions de la part d’extrémistes hindous entre
début 1998 et février 1999. Durant Noël 1998, des destructions d’églises ont eu lieu dans l’État du Gujarat.

représentations possibles et à une scène politique éclatée. Ces partis n’ont cessé de se multiplier
depuis l’indépendance.
L’électeur indien distingue bien entre les scrutins nationaux et régionaux : il est plus porté
à voter pour les partis régionaux voire régionalistes lors des élections régionales, quitte à ce que
ceux–ci appartiennent à l’opposition. On peut donc imaginer aisément l’instabilité du paysage
politique que cela entraîne.
B. Les difficultés intrinsèques à la politique indienne
1/ L’éclatement des partis
Traditionnellement marquée par une domination absolue du parti du Congrès (la puissante
machine politique de la dynastie Nehru-Gandhi), la scène politique interne témoigne, depuis la fin
des années 1990, d’une diminution continue de l’influence et du prestige de ce parti. Miné par
l’absence de leader charismatique depuis la disparition de Rajiv Gandhi en 1989, par de sombres
affaires de corruption et des luttes intestines altérant davantage son crédit, le Congrès n’est plus la
première force politique du pays. La montée en puissance des formations politiques régionales et la
progression fulgurante du parti nationaliste hindou du Bharatiya Janata Party (BJP), ont traduit ce
déclin, faisant éclater une scène politique désormais offerte à l’instabilité gouvernementale. Or, en
dépit du retour (éclatant et précipité) du mythe de la dynastie Nehru-Gandhi, rien ne semble
indiquer que l’on revienne à moyen terme à une véritable stabilité gouvernementale. L’influence
désormais notable des partis régionaux et la place acquise par le BJP sur l’échiquier politique
contemporain ne seront pas des épiphénomènes sans lendemain. Cette fragilité interne, conduisant
à une valse des gouvernements et à une mise en route partielle de projets, pénalise toute
entreprise nécessitant un minimum de pérennité. La défense d’une politique stratégique ambitieuse
s’accommode mal d’un tel environnement. On ne saurait en effet maintenir une dynamique en lui
faisant subir ralentissements, arrêts fréquents et demi-tours.
2/ Des partis et une bureaucratie sclérosée
L’immobilisme bureaucratique indien, assez largement dénoncé, s’avère lui aussi être un
bien mauvais allié. Phénomène observable dans une majorité d’États appartenant tant au monde
occidental qu’au monde en développement, l’immobilisme de la classe bureaucratique en Inde
atteint cependant des niveaux difficilement compatibles avec ses objectifs stratégiques. Un
problème de plus en plus dénoncé par ses "victimes" : "Le contrôle bureaucratique, injustifié et
contreproductif, permet à des fonctionnaires civils d’exercer une autorité quasi-illimitée sur les
forces armées, une situation sans équivalent dans les démocraties occidentales ou les pays
socialistes" s’insurge un expert. En dépit de nombreuses critiques, le phénomène semble avoir
encore de beaux jours devant lui, et peu de gouvernements prendront le risque d’une action
majeure, face à une situation dont beaucoup entendent encore longtemps tirer profit. Un problème
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%