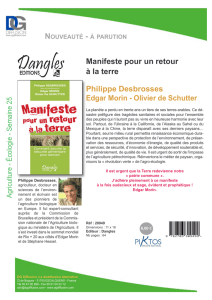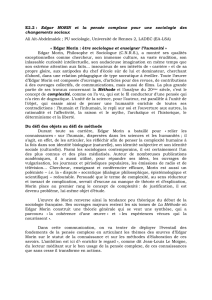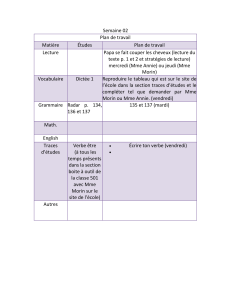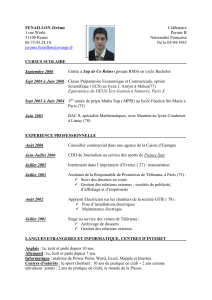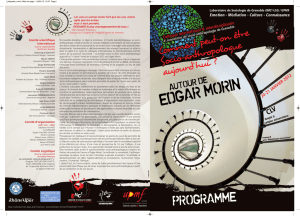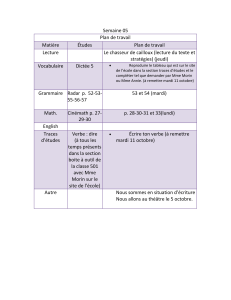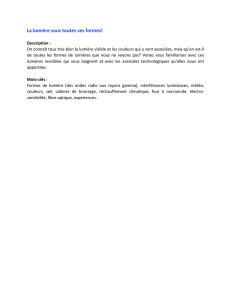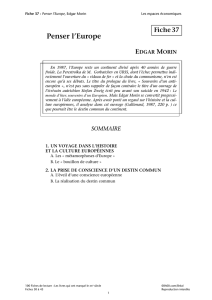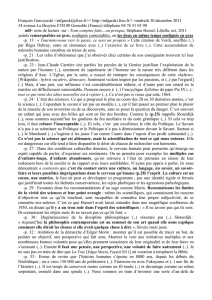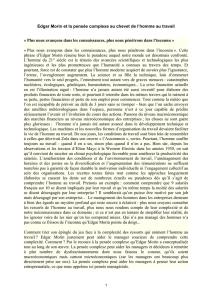Télérama : Quelle place accordez-vous à l`héritage des Lumières

Télérama : Quelle place accordez-vous à l’héritage des Lumières ?
Edgar Morin : On l’invoque aujourd’hui en réaction à la montée d’un obscurantisme,
essentiellement religieux, comportant des régressions fanatiques. Ceux qui plaident pour
un retour aux Lumières se réfèrent à une source lumineuse qui est esprit d’ouverture et de
tolérance. Je revendique, évidemment, cet héritage mais je crois qu’il faut aller au-delà des
Lumières. Au-delà signifie à la fois conserver et dépasser. Il faut par exemple accepter
l’idée que notre raison a des limites. Dans les Lumières, il y a trop de lumière. En réalité, la
lumière suppose de l’ombre autour, du mystère, voire de l’inexplicable. Il faut concevoir
qu’il n’y a pas de raison pure, mais une dialogique incessante entre le rationnel et l’affectif
– c’est déjà ce qu’évoquait Rousseau. A la rationalité critique qui s’est développée à
l’époque des Lumières, il faudrait ajouter une rationalité autocritique elle-même née aux
débuts des temps modernes avec Montaigne, mais toujours minoritaire.
Télérama : Qu’est ce qui, selon vous, caractérise ces temps modernes ?
Edgar Morin : Il est impossible de définir « la modernité » par un maître mot. Sur le
plan des idées, elle commence à la Renaissance avec la redécouverte de l’antiquité grecque
et d’une philosophie qui n’est plus la servante de la religion. La modernité, c’est l’ouverture
des esprits à tous les savoirs, l’essor de la science, celui de la technique. Le conflit entre la
foi et la raison, typiquement moderne, trouve son centre dans l’œuvre de Pascal au XVIIe
siècle. Historiquement, la modernité est à la fois productrice et produit de l’ère planétaire,
qui commence avec les grands voyages autour du monde et la conquête des Amériques. La
modernité naît en fait de la conjonction de plusieurs dimensions, non seulement
intellectuelles et idéologiques, mais aussi politiques (la constitution des nations
modernes), économiques (l’essor du capitalisme et des villes), sociales (le développement
de la bourgeoisie puis du prolétariat), techniques (la révolution industrielle). C’est en
même temps la laïcisation des esprits et des Etats. Les Lumières ont joué évidemment un
rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces voies ouvertes à la Renaissance. Il faut
maintenant revoir cet héritage en tenant compte de ce qu’il a produit et de ce que nous
affrontons aujourd’hui.
Télérama : Qu’est-ce qui à vos yeux est le plus brisé dans cet héritage ?
Edgar Morin : Ce qui est vraiment brisé, mais n’apparaît pas encore de façon vraiment
consciente, est l’assurance d’une rationalité close, c’est-à-dire la prétention de l’Occident à
incarner seul la raison tandis qu’ailleurs tout ne serait que superstitions, erreurs et
illusions. La rationalité souffre d’une maladie infantile qu’on peut appeler la «
rationalisation », qui conduit à élaborer un système tout à fait logique mais fondé sur des
bases limitées ou erronées. Ainsi, nous avons cru – et ce jusqu’au XXe siècle – que les

peuples dits « primitifs » étaient enfermés dans le mythe et la pensée magique. Or, leurs
techniques, notamment de chasse, leur connaissance des vertus de plantes, nous montrent
une rationalité qui coïncide avec leurs mythes. Toutes les sociétés, dont la nôtre,
comportent une part rationnelle et une part mythologique. Les Lumières elles-mêmes ont
mythifié la Raison et le Progrès.
Télérama : La raison séparée de la foi, c’est pourtant une idée essentielle pour la
séparation de l’Etat et des Eglises, pour la démocratie...
Edgar Morin : Bien sûr ! Et il est vrai que dans l’Europe occidentale s’est développé
l’humanisme moderne comportant les principes de démocratie, de tolérance, de droits des
hommes, plus tard de droits des femmes. Ce sur quoi j’insiste c’est que cette Europe, foyer
des idées émancipatrices dont les colonisés eux-mêmes s’empareront pour réclamer leurs
droits à l’indépendance et à la reconnaissance de leur pleine humanité (on le voit bien
aujourd’hui dans les revendications des descendants d’esclaves), a été aussi le foyer de la
domination la plus longue et la plus dure sur le monde, qui commence au XVIe siècle et ne
s’achève qu’à la fin du XXe siècle.
Télérama : Plus généralement, n’est-ce pas notre foi dans le progrès qui est mise à mal ?
Edgar Morin : En tout cas, le progrès conçu comme une nécessité historique inéluctable.
Ce progrès-là est mort et c’est une idée clé de la modernité qui s’effondre. Désormais, le
nouveau n’est plus nécessairement meilleur que l’ancien, ni même bon en soi, et même,
dans certains cas, on constate qu’on ne peut plus faire du nouveau. La philosophie de la
modernité, telle qu’elle est bien exprimée par Descartes, donne à la science la mission de
faire de l’homme le « maître et possesseur de la nature », idée reprise par Buffon au siècle
des Lumières, puis par Marx. Cette croyance dans la maîtrise de la nature est devenue
absurde puisqu’on sait qu’elle conduit à la dégradation de la biosphère qui elle-même se
répercute sur les vies humaines et menace le destin de l’humanité. Autrement dit, l’aspect
euphorique des Lumières est en crise.
Télérama : Et maintenant, que fait-on de cette crise du progrès ? Un « no future » ?
Edgar Morin : Le progrès comme certitude est mort, mais le progrès comme possibilité
demeure. On peut croire à un progrès possible en le sachant réversible, et il doit être
toujours régénéré. En Europe, la torture a été supprimée au XIXe siècle – pour les
Européens bien sûr, pas pour les autres ! ; au XXe siècle, elle a réapparu dans tous les pays
d’Europe. Prenons la démocratie. La France, qui a proclamé d’une façon grandiose la
démocratie, est tombée dans une dictature de salut public, puis il y a eu le bonapartisme,
l’Empire, la Restauration... La démocratie est une régime fragile et difficile. Elle n’est pas
que la loi de la majorité, elle comporte aussi le respect des minorités.

Télérama : Comment alors concilier progrès et précaution ?
Edgar Morin : Le principe de précaution est nouveau pour nous et nous ne savons pas
bien le situer par rapport à cet optimisme conquérant auquel nous n’avons pas vraiment
renoncé. Je pense à une formule de Périclès : « Nous autres Athéniens, nous unissons la
hardiesse et la prudence alors que les autres sont soit téméraires soit couards. » Il faut
unir le principe de précaution à un principe d’audace, et il n’y a pas de formule magique
pour cela. Je suis en tout cas persuadé que si le vaisseau spatial Terre continue d’être
emporté par ses quatre moteurs sans pilote – la science, la technique, l’économie, le profit
–, nous allons vers de multiples catastrophes. Pour conserver l’humanité, il faut la
révolutionner. Un monde est en train de mourir mais ne meurt pas, et un monde veut
naître mais n’arrive pas à naître.
Télérama : Sommes-nous des modernes fatigués de l’être ?
Edgar Morin : La modernité est toujours conflictuelle, faite de continuités et de ruptures.
Elle est complexe et ambivalente. Les expressions « postmodernité » et « modernité
tardive » expriment chacune un aspect de notre situation, mais les transformations en
cours ne nous permettent pas encore de définir le nouveau visage de notre époque. Nous
voyons bien que les grands principes unificateurs modernes (la technique, l’économie
mondialisée, la communication...) fabriquent de l’uniformité plus que de l’unité.
L’universalisation de la civilisation occidentale suscite des adhésions matérielles
(techniques, économiques...) en même temps que des rejets profonds dans plusieurs pays
du monde, qui, pour sauvegarder leur identité et ayant perdu l’espoir d’un avenir nouveau,
se referment en des régressions religieuses ou culturelles. Or, si nous voulons échapper à
l’alternative funeste entre unité et diversité, il nous faut penser que l’unité humaine
comporte de la diversité et que la diversité humaine comporte de l’unité.
Télérama : Parmi les hommes des Lumières, duquel vous sentez-vous le plus proche ?
Edgar Morin : Je ne peux pas choisir Voltaire contre Rousseau ou Rousseau contre
Diderot. Je ne suis satisfait qu’en les embrassant tous. Mais, en fait, je me sens plus proche
de l’esprit de la Renaissance. J’aime l’esprit polyvalent de Léonard de Vinci, qui était
peintre, ingénieur, inventeur. Aujourd’hui, on dit que ce n’est plus possible car les savoirs
se sont multipliés, affinés, cloisonnés jusqu’à découper la réalité en petits morceaux. Moi
qui aime me définir comme un « braconnier des savoirs », je milite pour une pensée qui
relie, c’est-à-dire complexe. Une phrase de Pascal, que j’aime particulièrement, est pour
moi la clé : « Toute chose étant médiate et immédiate, causée et causante, je tiens
impossible de connaître la partie si je ne connais le tout, ni de connaître le tout si je ne

connaissais les parties. » Et, au-delà de la connaissance, reste le pari de Pascal sur ce en
quoi l’on croit. Je ne parie pas comme lui sur l’existence de Dieu, mais sur la fraternité
humaine.
Télérama : Mais pour se sentir frères, il faut avoir une mère ou un père commun. Si le
père n’est ni Dieu, ni le roi, ni la nation, quel est-il ?
Edgar Morin : Ce n’est pas par hasard que j’ai intitulé un de mes livres : Terre-patrie. La
Terre est la matrice dont nous sommes issus. L’humanité planétaire est désormais liée par
une communauté de destin. L’ultime mondialisation a créé les infrastructures d’une
éventuelle « société-monde », mais elle empêche cette société-monde d’advenir.
Télérama : Dans « liberté, égalité, fraternité », c’est souvent la fraternité qu’on oublie...
Edgar Morin : La liberté, on peut l’instituer. L’égalité, on peut l’imposer. Mais la
fraternité, non. Elle ne peut venir que d’un sentiment vécu de solidarité et de
responsabilité. Et pourtant, la fraternité est ce qui fait tenir le triptyque. La liberté seule
tue l’égalité ; l’égalité imposée en principe unique tue la liberté. Seule la fraternité permet
de maintenir la liberté tout en luttant contre les inégalités. Le problème est que la
modernité a provoqué la destruction de toutes les solidarités traditionnelles – la grande
famille, la petite famille, le village – et nous n’en avons pas vraiment créé de nouvelles,
sinon bureaucratiques comme la Sécurité sociale. Le développement de l’individualisme
est très positif pour l’autonomie et la responsabilité personnelle, mais il s’accompagne d’un
accroissement de l’égoïsme et de l’égocentrisme. Et pourtant, la solidarité se manifeste
(mais seulement de façon provisoire) lors d’un grand désastre collectif (le tsunami, le
tremblement de terre de Mexico...). Nous avons soif, dans notre esprit, dans notre âme,
dans notre corps, d’une autre façon de vivre. La potentialité de fraternité sommeille en
nous. Comment la réveiller ? C’est une autre histoire...
Propos recueillis par Catherine Portevin et Véronique Brocard
1
/
4
100%