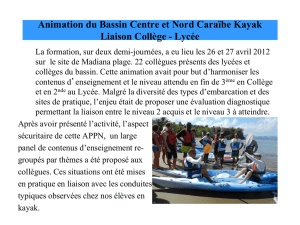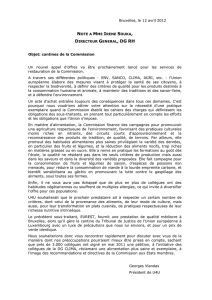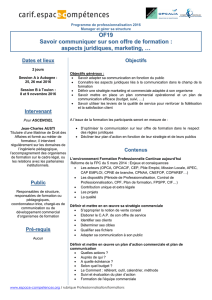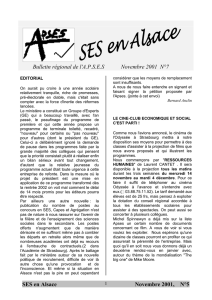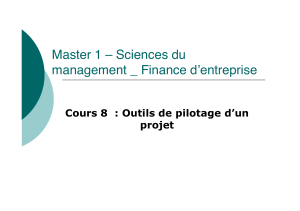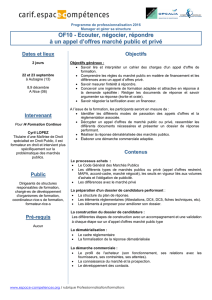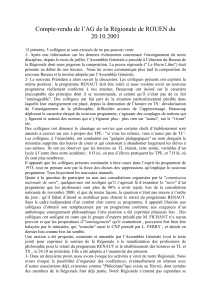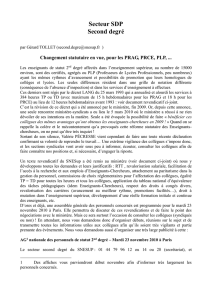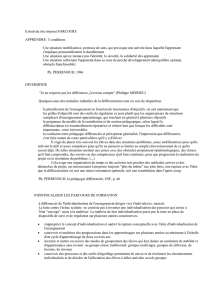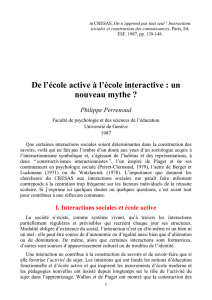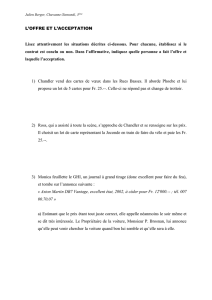La coopération par Monica Gather

L’exercice d’une profession exige-t-il
une coopération régulière ?
Monica Gather-Thurler, enseignante, universités de Genève et
Fribourg
Extraits de Coopération et professionnalisation : compétences nécessaires et liens
possibles, Monica Gather-Thurler, faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation de Genève, 1994.
En reprenant les critères de Lemosse [1], on s’aperçoit que la coopération n’est pas nécessairement
un élément central de la définition d’une profession. En effet, cette définition laisse dans le flou la
question de savoir si l’exercice du métier est mieux garanti par des combattants solitaires ou par des
gens travaillant en équipe. Un seul des critères fait référence au groupe professionnel, en parlant
d’une « activité régie par une forte organisation et une grande cohésion internes ». Mais
l’appartenance à une corporation n’implique pas une coopération professionnelle au jour le jour.
Médecins, avocats, architectes, chercheurs, créateurs ne travaillent pas systématiquement en
équipe. Ils travaillent même chacun pour soi, qui dans son cabinet, qui dans son bureau, pour se
retrouver, de temps à autre, dans le cadre de congrès, de rencontres organisées par leur
corporation, de groupes informels, ou de projets communs de recherche et de développement.
Il y a des raisons de penser que l’efficacité du professionnel n’est pas systématiquement plus grande
s’il travaille en équipe. Pour décider de trépaner un accidenté de la route qui risque une hémorragie
cérébrale, pour défendre une cause difficile devant le tribunal, pour peaufiner un projet de
construction, pour interpréter une analyse biochimique, le médecin, l’avocat, l’architecte et le
chercheur se trouveront souvent seuls, sans recours à des collègues, compte tenu du moment de la
journée, de l’urgence de la tâche, du prestige, des revenus ou des responsabilités personnelles en
jeu. S’ils travaillent en équipe, elle sera d’ordinaire pluridisciplinaire : en tant que spécialiste, chacun
assumera seul ses responsabilités dans son domaine d’expertise.
« A poor lonesome teacher » ?
Face à leurs élèves, les enseignants se trouvent également seuls, la plupart du temps, à l’exception
de quelques dispositifs de formation ayant introduit le team-teaching et le décloisonnement. Dans la
plupart des systèmes scolaires, ils fonctionnent comme individus, et cherchent, en tant que tels, à
améliorer leur pratique. Certains résultats de recherches, dont ceux de Philippe Perrenoud [2],
suggèrent même qu’il vaut mieux être efficace tout seul que membre d’une équipe sans âme ni
cohérence…
Lorsqu’on interroge les enseignants sur l’efficacité du travail en équipe, ils sont généralement assez
critiques ; ils évoquent l’absence d’animation qui entraîne une mauvaise gestion du temps, la
difficulté de s’en tenir à l’essentiel, le fait que la plus grande partie des réunions est consacrée aux
questions administratives, l’incapacité de prendre des décisions concertées, etc. Ils préfèrent
souvent d’autres formes de coopération, notamment la conversation dans un réseau informel,

comme façon économique de résoudre les problèmes et d’obtenir un minimum de soutien. Ces
solutions spontanées suffisent à éviter le sentiment d’isolement et à partager les responsabilités face
aux difficultés du métier, sans pour autant tomber dans la lourdeur des réunions d’équipe. Ne
pourrait-on alors se contenter d’affirmer qu’à l’instar d’autres professions, il suffirait que les
enseignants soient bien préparés à faire leur travail dans le cadre de leur classe, qu’ils suivent des
cours de perfectionnement lorsque cela s’avère nécessaire, qu’ils se tiennent au courant des
nouveautés pédagogiques, didactiques et méthodologiques ? Pourquoi alourdir leur tâche avec des
exigences de travail en équipe ? Pourquoi imposer une coopération dont la plupart ne veulent pas ?
Pourquoi se disperser dans des réunions d’équipe ? N’est-il pas plus simple et plus réaliste de
renforcer la responsabilité individuelle des enseignants face à leurs élèves, de leur donner les outils
nécessaires pour mieux gérer leur classe, de réduire les réunions avec leurs collègues au strict
nécessaire, de dégager un maximum de temps pour la programmation didactique individuelle,
d’éviter les interminables négociations dues aux divergences d’objectifs, aux conflits d’opinions, aux
rapports de force ?
La coopération quand même nécessaire
Contre cette tentation et ce mythe de « l’individualisme efficace », aussi compréhensibles soient-ils,
je soutiendrai que le travail d’équipe et la coopération intensive font partie de la profession
enseignante si on la souhaite à la hauteur des enjeux. Les entraides occasionnelles, les
conversations de salle des maîtres, les « trucs qu’on se passe » ne suffisent pas pour venir à bout
des problèmes que pose le métier, soit dans le quotidien, soit dans la gestion à moyen et à long
terme. Ainsi, lorsqu’il doit réorganiser sa classe pour tenir compte de l’arrivée de plusieurs enfants
migrants, l’enseignant peut tenter de gérer ce problème tout seul. Il peut aussi faire appel à des
intervenants externes ou demander des « tuyaux » à un collègue qui a vécu ou est en train de vivre
une situation semblable. Il peut encore présenter le problème lors d’une réunion à la salle des
maîtres, pour s’entendre dire qu’il n’est pas le seul et que chacun porte sa croix, ou, dans le meilleur
des cas, pour recevoir l’expression de l’empathie de ses collègues. Il est seul, néanmoins, pour
décider d’alléger le programme ou d’aménager l’évaluation pour ces élèves, afin de leur laisser le
temps de s’adapter ; seul pour affronter les parents, pour se défendre face à l’inspecteur ; seul, en
fin de compte, pour décider de se battre ou de laisser tomber. À la fin de l’année, lorsqu’il s’agira de
décider de la promotion ou du redoublement de ces élèves, il se retrouvera seul à prendre les
risques ; seul, mais pas indépendant, car il sait que ses collègues vont hériter de ses élèves et qu’on
ne lui pardonnerait pas de trop grands écarts à la norme. Pour créer des solutions à la mesure du
problème de l’accueil simultané de nombreux enfants migrants, ne sachant pas la langue de
l’enseignant, d’origines diverses, parfois très peu ou pas du tout scolarisés, il faut inventer des
dispositifs qui dépassent la classe et exigent la mise en commun des forces, des espaces, des
talents de plusieurs enseignants, bref, l’émergence d’une véritable équipe.
On pourrait multiplier les exemples pour montrer que la réalité à laquelle les enseignants sont
confrontés appelle la coopération, plus souvent sans doute que dans d’autres métiers. Le médecin,
l’avocat, le chercheur sont moins dépendants les uns des autres, alors que les enseignants sont
« embarqués dans la même galère », une école de quartier, avec des familles qui ont plusieurs
enfants, des élèves qui suivent leur scolarité en passant d’un enseignant à l’autre. En dépit des mille

et une raisons qui plaident pour l’individualisme, l’enseignant, s’il veut affronter les vrais problèmes,
ne peut échapper à la coopération, parce qu’il travaille dans un champ où son action est
constamment et fortement dépendante de l’action des autres.
Quelle coopération ?
Reste à préciser à quel niveau cette coopération est requise. Elle peut représenter, dans sa forme la
plus simple et modeste, une forme de cohabitation pacifique entre les membres du groupe, qui
définissent clairement les territoires et les tâches des uns et des autres, qui conviennent d’un certain
nombre de règles de jeu permettant d’éviter les conflits et les confusions de rôles, de dépasser
l’isolement et de garantir un bon climat et un certain bien-être des divers acteurs. Sous la forme la
plus complexe et exigeante, la coopération peut résulter d’une longue négociation, qui aboutit à un
contrat, avec des objectifs communs et l’organisation correspondante. Il ne s’agit pas ici uniquement
d’un aménagement « pratique », au sens d’une meilleure répartition des tâches et d’une clarification
des rôles, mais au contraire, d’une prise de conscience et d’un parti pris : conscience que travailler
ensemble permet d’avancer autrement que de travailler chacun pour soi, qu’un travail en équipe
permet d’autres confrontations, d’autres ambitions, d’autres formes d’échange ; et parti pris de faire
avancer l’ensemble des personnes concernées, de profiter au maximum de l’apport de chacun, de
former un tout, avec des valeurs, croyances et objectifs partagés, régulièrement rediscutés et mis à
jour.
Pour devenir une véritable profession, le métier d’enseignant devrait, à mon avis, s’approcher de ces
formes exigeantes de coopération, qui pourraient s’incorporer progressivement à la culture
professionnelle de la majorité des enseignants. Face à un problème complexe, lorsque chacun
mesure sa propre incompétence ou du moins ses limites, il deviendrait facile d’admettre qu’il vaut
mieux coopérer que tâtonner seul dans son coin, partager les risques et périls, se constituer en
équipe efficace, au moins le temps de surmonter le problème en cause.
À la question de savoir si « l’exercice d’une profession exige une coopération régulière ? », je
réponds donc clairement par l’affirmative, du moins pour ce qui concerne l’enseignement.
C’est aussi la conclusion de Philippe Perrenoud, qui inclut la coopération dans son inventaire des
« corollaires de la professionnalisation ». Selon cet auteur, la professionnalisation :
met l’accent sur le contrôle et la supervision par des pairs, de même formation, voire de
même statut, par opposition au contrôle par des supérieurs hiérarchiques étrangers à la
profession ;
suppose une capacité collective d’auto-organisation de la formation continue, sa prise en
charge par la corporation ;
invite le maître à inventer ses propres réponses, à condition qu’elles se construisent sur la
base d’un savoir commun etd’une interaction entre professionnels ;
construit une identité professionnelle claire, alimentée par une culture intellectuelle
commune (au-delà de l’esprit de corps et du partage de trucs et d’attitudes).
Des compétences à développer

La coopération passe par une attitude et une culture, mais exige aussi des compétences. J’en
distinguerai trois, étroitement complémentaires :
Savoir travailler efficacement en équipe et passer d’une « pseudoéquipe » à une véritable
équipe.
Savoir discerner les problèmes qui appellent une coopération intensive. Ëtre professionnel,
ce n’est pas travailler en équipe « par principe », c’est savoir le faire à bon escient, lorsque
c’est plus efficace. C’est donc participer à une culture de coopération, y être ouvert, savoir
trouver et négocier les modalités de travail optimales, en fonction des problèmes à
résoudre.
Savoir percevoir, analyser et combattre les résistances, obstacles, paradoxes et cuIs-de-sac
liés à la coopération, savoir s’auto-évaluer, porter un regard compréhensif sur un aspect de
la profession qui n’ira jamais de soi, vu sa complexité.
[1] Les critères de Lemosse sont les suivants :
l’exercice d’une profession implique une activité intellectuelle qui engage la responsabilité individuelle
de celui qui l’exerce ;
c’est une activité savante, et non de nature routinière, mécanique ou répétitive ;
elle est pourtant pratique, puisqu’elle se définit comme l’exercice d’un art plutôt que purement théorique
et spéculative ;
sa technique s’apprend au terme d’une longue formation ;
le groupe qui exerce cette activité est régi par une forte organisation et une grande cohésion internes ;
il s’agit d’une activité de nature altruiste au terme de laquelle un service précieux est rendu à la société.
[2] Philippe Perrenoud, La formation des enseignants entre théorie et pratique, l’Harmattan, 1994. Voir
aussi « Travailler en équipe pédagogique, c’est partager sa part de folie », Cahiers pédagogiques n° 325,
p. 68-71.
1
/
4
100%