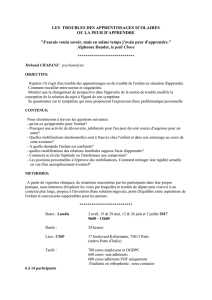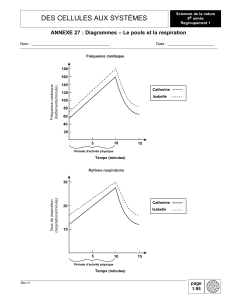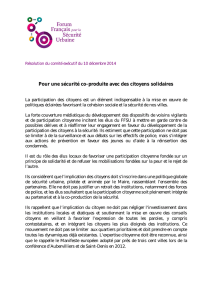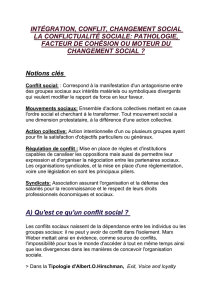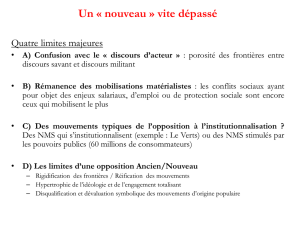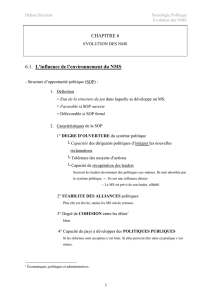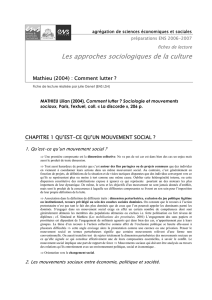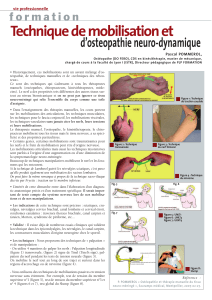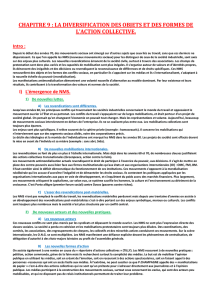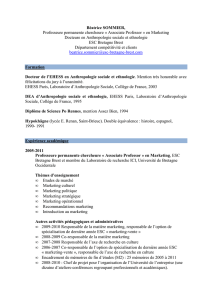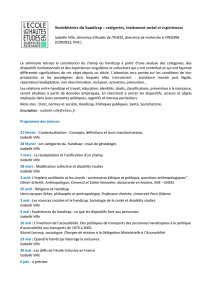Le renouveau des mouvements contestataires à - prepa-bl

Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation.
Isabelle Sommier, éditions Champs Flammarion, 2003 (première publication en
2001).
Résumé :
Avant-propos : Après un recul des conflits sociaux dans les années 1980 on assiste à leur
réapparition dans les années 1990. Ce réveil est surprenant car le contexte qui avait permis
l’essor des mouvements sociaux dans les années 1970 s’est totalement transformé. Cependant
les Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS) de la décennie 1990, bien qu’en apparence très
différents, sont le fruit de longs processus historiques et, de fait, héritent de certaines
caractéristiques des mouvements sociaux des années 1970.
1. Le paysage recomposé des minorités actives
*Minorités actives = « groupes restreints actifs et idéologiquement cohérents capables
d’entraîner des conflits et des changements dans leur société d’appartenance. »
L’essoufflement des organisations syndicales traditionnelles
Les organisations syndicales traditionnelles sont en déclin depuis la fin des années 1970. Il
s’agit d’une crise quantitative (moins de sympathisants, d’adhérents, de militants) et
qualitative (difficulté d’adaptation aux thèmes des revendications et aux modes d’action des
acteurs des nouveaux conflits). Cette crise est aggravée par la montée en puissance des
associations qui s’adaptent plus facilement aux nouveaux enjeux grâce à leur souplesse de
fonctionnement. Mais ce qui fragilise surtout les syndicats c’est le développement des
coordinations, à savoir « des structures unitaires organisant une mobilisation de grévistes,
sans distinction syndicale, selon les principes de la démocratie directe ». Cependant il ne faut
pas opposer radicalement ces deux structures car ce sont souvent les militants syndicaux qui
sont à l’origine des coordinations et ces dernières permettent parfois la création de nouveaux
syndicats. C’est en cela que l’on peut parler d’une recomposition du syndicalisme avec
apparition d’aspirations nouvelles telles l’unité syndicale, la priorité donnée à l’efficacité
immédiate, la sensibilité aux questions sociétales ainsi qu’une organisation souple et plus
démocratique. Malgré tout il existe une opposition majeure entre les « syndicats
représentatifs » reconnus par l’Etat (CGT, FO, CFTC, CFDT, CGC-CFE), qui ont l’avantage
de conduire les négociations et d’être officiellement consultés par les pouvoirs publics, et
ceux qui ne le sont pas. Ces derniers contestent cet état de fait et radicalisent leur position.
Cols bleus et cols blancs, « garantis » et « exclus »
L’essoufflement des organisations syndicales ne peut s’expliquer uniquement par ces
divisions. Le phénomène est aussi dû à de fortes mutations socio-économiques et culturelles
comme le déclin de la classe ouvrière, les déstabilisations des noyaux durs du militantisme
restant, la précarisation qui favorise le repli sur la sphère privée, la stratégie patronale qui
cherche à affaiblir le rôle des syndicats. De plus, le modèle d’engagement a lui aussi évolué :
on est passé d’un modèle qui faisait s’imbriquer la vie privée et la vie militante à un modèle
qui distancie ces dernières dans une logique d’individualisation. Cela explique en partie le
succès des NMS qui font appel à ce dernier modèle.
L’émergence des mobilisations des « sans »
L’émergence des « groupes à faibles ressources » est surprenante car du fait de leur
marginalisation il leur est difficile d’acquérir une conscience de groupe et de concevoir un
projet collectif de mobilisation. Cet essor peut donc être perçu comme un désaveu pour les
organisations traditionnelles qui n’ont pas su intégrer dans leur lutte les exclus du rapport
social. Les premières associations des « sans » ont été celles créées par les sans-emplois
(1982), suivies par celles des sans toit (1987), puis par celles des sans-papiers (présidentielles
de 1995). Ces nouvelles associations ont pour but de réintroduire les personnes exclues dans

la mobilisation. Les associations de « sans » travaillent souvent ensemble car elles luttent
contre des phénomènes transversaux ce qui a permis d’unifier leurs revendications et de les
rendre plus visibles.
Le bouillon de culture du « mouvement social »
La construction d’un acteur collectif pour les « sans » a été une réussite dans le sens où elle a
donné une identité et une force symbolique aux groupes préalablement exclus. C’est en 1995
(réforme des retraites) que l’union des syndicats et du mouvement des « sans » donne
naissance au terme de « mouvement social » en tant qu’initiative contestataire. Le fort
activisme des années 1990 contraste avec la faiblesse des contestations dans la décennie
antérieure. Cela confirme l’analyse d’Albert Hirschman. En effet, selon lui, les cycles
d’engagement sont consécutifs à des phases de retrait dans la sphère privée (comme dans les
années 1980). Cette analyse se vérifie aussi au niveau international avec l’observation
historique de vagues de protestations. Le renouveau de l’action collective française s’alimente
donc de l’essor des mobilisations transnationales avec le mouvement antiglobalisation. Pour
Verta Taylor il existe des « structures de rémanence » qui permettent aux mouvements
sociaux de se remettre efficacement et rapidement en mouvement après un repli dû à la fin
d’une lutte ou à un changement de conjoncture. Quand ce phénomène de rémanence se joint à
d’autres mobilisations, l’environnement est réceptif à la protestation, ce qui renvoie à la
question des cycles tels qu’ils ont été analysés par Sidney Tarrow. Selon ce dernier les
« cycles de protestation » commencent lorsque les « conflits structurels » sont suffisamment
importants et que la « structure des opportunités politiques » est favorable. Or dans les années
1990 la prise de conscience des problèmes sociaux est concomitante de l’émergence de la
mondialisation si bien que ces problèmes vont être imputés au nouveau régime capitaliste. À
cela vient s’ajouter la polarisation de la scène politique française qui entraîne l’émergence de
mobilisations dans le pays. Mais comment expliquer la simultanéité des mouvements sociaux
au niveau international et en particulier ceux dénonçant la globalisation ?
2. Les instruments de la contestation
Victimes, « militants professionnels » et « personnes-ressources »
Les NMS rassemblent trois types de population :
- les personnes victimes du problème pour lesquelles s’organise la mobilisation. Leur
mobilisation est spectaculaire du fait de leur déclassement. De plus les NMS, au lieu d’effacer
les particularismes, se proposent d’exposer l’expérience personnelle malheureuse à l’origine
de l’engagement dans une logique d’individualisation.
- les militants et les dirigeants des associations qui ne sont en général pas touchés par les
difficultés qu’ils dénoncent. Ce sont des individus politisés ayant un longue expérience du
militantisme, ce sont des professionnels de la contestation. Leur engagement est vécu comme
le moyen le plus propice à l’exercice démocratique et semble donc être une réponse à la crise
des représentations politiques. Ces dirigeants sont pour la plupart issus des fractions dominées
des classes dominantes au sens de Bourdieu, en lien direct ou indirect avec l’Etat. Ainsi, le
militantisme tend à recruter dans le secteur public plutôt que dans le secteur privé où il
comporte plus de risques.
- les « personnes-ressources » qui apportent un soutien extérieur à l’association. Par leur
prestige social, elles permettent de sensibiliser l’opinion publique, et par leurs compétences
elles sont en mesure de réaliser des « contre-expertises » qui rendent la contestation
constructive. Cela semble marquer le retour de l’engagement des intellectuels.
Entre coups de force et lobbying, un répertoire d’action original
Les nouveaux mouvements contestataires ajoutent aux actions traditionnelles du mouvement
ouvrier (grèves, manifestations) de nouvelles formes d’actions. Les coups de force
caractérisent principalement les mouvements des « sans » qui ont souvent recours à des
modes d’action non-conventionnels. Il s’agit d’une action directe contre une cible
symboliquement forte. Le but est d’obtenir par la provocation une couverture médiatique

importante. Il peut s’agir d’actions violentes (attaque contre les biens), non-violentes
(désobéissance civile), voire festives (festivals). Le recours à ces actions, souvent illégales,
s’accompagne d’actions plus classiques (pétitions, grèves, manifestations…). Enfin, le
lobbying est un mode d’action de plus en plus utilisé s’appuyant sur les contre-expertises afin
d’influencer la sphère politico-administrative. La combinaison des différents modes d’action
donne force aux mouvements.
L’effet multiplicateur de l’hacktivisme et des réseaux transnationaux
La contraction des mots « hacker » et « activisme » a donné naissance au terme
d’« hacktivisme ». Ce dernier s’est développé grâce aux multiples avantages que présente
internet (communication intra et inter associations, information du public et propagande
rapides et à moindre coût). L’hacktivisme permet l’autonomie politique et technique de la
prise de parole ainsi que l’élargissement de l’espace public. La mobilisation de l’opinion
publique internationale par les NMS contraste avec la difficulté des syndicats à sortir des
frontières nationales (à l’exception de SUD : Solidaires, Unitaires, Démocratiques). Mais ces
derniers, bien qu’actuellement affaiblis, maintiennent leur supériorité numérique par rapport
aux NMS. C’est pourquoi ces deux types de structure auraient intérêt à unir leurs efforts et à
élaborer des projets communs afin de mieux se faire entendre.
3. Des revendications… aux alternatives ?
Le registre moral de la prise de parole
Les mobilisations sont motivées par un sentiment d’indignation, d’injustice, et cherchent à
provoquer l’émotion du public. Cela n’a rien de nouveau. Leur originalité vient du fait
qu’elles intègrent aujourd’hui des arguments d’ordre moral. On assiste donc à un glissement
du registre politico-offensif à un registre humanitaro-défensif. Ce glissement peut s’expliquer
par la montée d’un sentiment d’impuissance politique et par la dégradation des idées de
classes sociales et d’exploitation. Les organisations agissent à la fois sur le court terme, dans
un souci d’immédiateté, et sur le long terme avec un horizon idéal. D’autre part elles ont de
plus en plus recours au droit afin de contester juridiquement une décision administrative ou
soulever les contradictions internes du cadre normatif.
Un pragmatisme radical ?
Les organisations de contestation pratiquent une politique dualiste car elles poursuivent des
objectifs à la fois offensifs et défensifs. Il s’agit donc d’un « radicalisme autolimité » puisque
des luttes pour la défense et la démocratisation de la société civile sont menées sans remise en
cause de l’intégrité des systèmes politiques et économiques. Pour obtenir des résultats à court
terme les associations vont être amenées à collaborer avec les pouvoirs publics qu’elles
combattent pourtant sur le long terme. C’est le degré d’intégration dans les politiques
publiques qui est usuellement utilisé pour différencier les associations de lutte des
associations caritatives, qui collaborent avec les pouvoirs publics dans la gestion des
problèmes sociaux. Les deux pôles sont cependant complémentaires. La relation ambivalente
entre l’Etat et les mouvements contestataires est flagrante en ce qui concerne la globalisation :
en dénonçant les choix politiques qui sacrifient le bien du plus grand nombre aux lois du
marché, ces mouvements incitent les Etats à reprendre leur rôle de protecteurs des citoyens et
de garants de l’intérêt général. Cependant la sincérité de l’engagement de l’Etat est mise en
doute par la violence de la répression des mobilisations et la volonté de « criminalisation du
mouvement social ».
La question en suspens du débouché politique
Le temps militant envahit aujourd’hui moins le quotidien que dans les décennies précédentes.
Ceci est dû à la fin des idéologies et à la montée de « petites causes » à plus court terme.
Cependant il est rare que soit proposée une idéologie qui remplacerait le néolibéralisme.
Seules certaines organisations comme AC! effectuent un travail d’idéologisation. Mais leurs
propositions ne font pas l’unanimité à cause de l’hétérogénéité des NMS. Un autre sujet de

discorde est le rapport à entretenir (ou non) avec les partis politiques. Il est en effet douteux
qu’une mobilisation puisse se passer d’une traduction politique et en même temps les
mouvements contestataires craignent d’être « récupérés » par les politiques. Cette
ambivalence a conduit d’un côté à un renouveau des minorités radicales et de l’autre à l’essor
des listes citoyennes aux municipales souvent liées à des associations de quartiers voulant
faire de la politique autrement.
Conclusion : Durant les années 1990, on assiste non pas à la fin annoncée du conflit social
mais à la remise en mouvement des minorités. Les nouvelles mobilisations ont permis aux
« sans » de s’exprimer et de mettre le thème de l’exclusion dans le débat. Les
questionnements sur les sources des problèmes ont conduit à la remise en question de la
mondialisation et à l’apparition de mouvements antiglobalisation. Le succès de ces
mouvements est notamment dû au nouveau modèle d’engagement qu’ils proposent et à
l’apparition d’un savoir-faire militant. Leur action vise à perturber les institutions en place
afin de sortir ces dernières de leur inertie tout en proposant une nouvelle façon de faire de la
politique.
Critique interne :
À l’origine de ce livre il y a l’engagement personnel de l’auteure, Isabelle Sommier,
dans la lutte antiglobalisation. Elle a par exemple participé au sommet alternatif contre la
réunion du G8 à Evian, en 2003. Du fait de l’intérêt qu’elle porte aux mouvements
contestataires, son ouvrage est très bien renseigné. De nombreux exemples viennent alimenter
son propos et elle précise scrupuleusement toutes ses sources. Elle fournit aussi au lecteur des
documents bruts sous forme d’encadrés qui viennent corroborer ses affirmations. Sa
présentation est claire : elle énonce ce qu’elle va développer en début de paragraphe puis
affine son analyse avec des exemples. Son analyse s’attache à replacer les évènements qu’elle
relate dans leur contexte et à les mettre en relation entre eux. C’est en passant d’un exemple à
l’autre que l’analyse progresse. Malheureusement, l’auteure nous livre parfois des listes
entières de dates et de lieux de sommets ou de pourcentages électoraux sans analyser les
évènements correspondants. Ces énumérations, à mon avis, ne font pas progresser le
raisonnement même si l’on peut considérer que cette précision documentaire est justifiée
puisque le but d’Isabelle Sommier est de dresser un état des lieux le plus précis possible de la
scène contestataire française.
L’auteure rend compte de l’éventail des mouvements contestataires en France dans la
décennie 1990 et choisit d’analyser ces derniers selon trois éclairages : elle montre tout
d’abord comment les nouvelles minorités actives sont apparues dans un paysage politique
recomposé, puis elle présente les modes d’actions de ces mouvements contestataires, et enfin
expose leurs revendications, leurs contradictions et les éventuelles alternatives proposées au
néolibéralisme. L’analyse que propose Isabelle Sommier suit donc une progression
parfaitement claire et cohérente.
L’analyse descriptive de Sommier a le mérite d’être objective malgré l’engagement
déclaré de l’auteure dans l’altermondialisme. En effet Isabelle Sommier n’hésite pas à
montrer les points faibles des NMS, comme par exemple leur hétérogénéité qui ne leur permet
pas de proposer une alternative au néolibéralisme. On peut cependant reprocher à l’auteure
d’avoir restreint son analyse aux mouvements contestataires français et de ne pas l’avoir
étendue à ceux des autres pays puisqu’elle-même signale que nombre de ces NMS ont un
caractère transnational. Par ailleurs nous allons voir à travers la critique externe en quoi son
approche est sans doute quelque peu statique puisqu’elle n’analyse les mouvements sociaux
qu’à travers leurs causes et leurs conséquences et non dans une perspective de dynamique
interne.
Critique externe :
Le travail d’Isabelle Sommier suit le « modèle classique » d’analyse des mouvements

sociaux. En effet comme le montre Lilian Mathieu dans son article Des mouvements sociaux
à la politique contestataire : les voies de tâtonnement d’un renouvellement de perspective
(Revue française de sociologie, 2004), il existe aujourd’hui un volonté de révision critique de
cette perspective classique dominante, souvent trop statique et objectiviste, avec la parution
récente de trois ouvrages qui posent les bases d’une approche davantage dynamique et
relationnelle de l’action collective protestataire : dans Silence and voice in the study of
contentious politics, R. Aminzade et al. se donnent pour tâche de combler les principaux «
silences » de la sociologie des mobilisations, tandis que dans Dynamics of contention, D.
McAdam, S. Tarrow et Ch. Tilly posent les bases d’une approche unifiée des différentes
formes de politique contestataire et que J. Goldstone, dans States, parties and social
movements, tente d’en développer le potentiel pour l’étude des rapports entre politiques «
institutionnelle » et « non institutionnelle ».
Le modèle classique se structure autour de trois pôles d’analyse :
- le premier pôle s’intéresse à la structuration des univers sociaux dans lesquels émergent les
mouvements sociaux et aux formes organisationnelles par lesquelles se réalise la mobilisation
;
- le deuxième est celui de la structure des opportunités politiques ;
- le troisième pôle est celui de l’activité de « cadrage » des revendications par les
organisations de mouvement social et de la « résonance » de leur discours auprès des
sympathisants ou militants potentiels qu’elles cherchent à convertir ou à recruter.
Les auteurs ont selon les cas soit privilégié l’étude d’une de ces dimensions, soit traité les
trois parallèlement, soit depuis peu tenté de les synthétiser. L’originalité de leur démarche
réside dans le fait que le travail de révision théorique entrepris dans les trois ouvrages est le
fruit, non d’une controverse scientifique, mais d’un retour critique de sociologues aujourd’hui
consacrés sur les carences de leurs propres contributions au développement de leur domaine
de recherche.
L’analyse qui me paraît la plus intéressante pour compléter celle d’Isabelle Sommier
est celle que développent les auteurs à partir du constat suivant : la sociologie des
mouvements sociaux ne porte justement que sur ces derniers alors que d’évidentes similarités
les unissent à d’autres phénomènes contestataires comme les révolutions, les luttes
nationalistes ou les transitions à la démocratie. Les auteurs cherchent un cadre unifié pour
traiter l’ensemble de la politique contestataire qui est « épisodique plutôt que continue, se
déroule en public, suppose une interaction entre des requérants et d’autres, est reconnue par
ces autres comme pesant sur leurs intérêts, et engage le gouvernement comme un médiateur,
une cible ou un requérant », selon la définition de McAdam, Tarrow et Tilly. Le but de cette
nouvelle approche est de surmonter les divisions artificielles qu’une hyper-spécialisation
disciplinaire impose à l’appréhension sociologique d’un ensemble d’objets phénoménalement
proches. Ces auteurs proposent un ensemble d’outils conceptuels aptes à rendre compte de
mécanismes et de processus similaires. L’avantage de cette approche est de ne pas étudier que
les causes et les effets des mouvements mais aussi ce qui se passe dans le cours même de
l’épisode contestataire. De plus les auteurs ouvrent leur analyse à d’autres pays que ceux de la
démocratie occidentale veillant ainsi à tester la pertinence du modèle pour la compréhension
de phénomènes situés dans des contextes historiques et politiques des plus divers. Dans
Dynamics of contention, parmi les nombreux concepts que les trois auteurs développent, celui
de courtage (brokerage) apparaît comme un des plus importants, en ce qu’il participe à la
dynamique de la quasi-totalité des phénomènes abordés dans l’ouvrage. Il est défini comme «
la connexion, par une unité médiatrice, d’au moins deux sites sociaux auparavant sans
contact. Sous sa forme la plus simple, les sites et les unités sont des personnes singulières,
mais le courtage opère également entre cliques, organisations, lieux et, à la limite,
programmes » ; il « réduit les coûts de communication et de coordination entre sites, facilite
l’usage combiné de ressources présentes dans différents sites, et crée de nouveaux acteurs
collectifs potentiels ». Les agents de ce mécanisme, les courtiers (brokers), sont présentés
comme variant « significativement selon leur localisation sociale et leur modus operandi,
avec des conséquences importantes pour la contestation à laquelle ils participent » ; les
marchands itinérants kenyans, par exemple, auraient joué ce rôle en connectant Nairobi et les
 6
6
1
/
6
100%