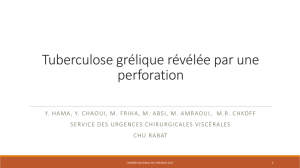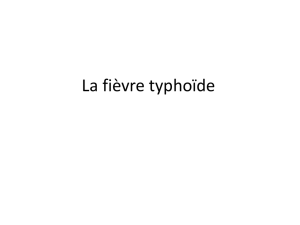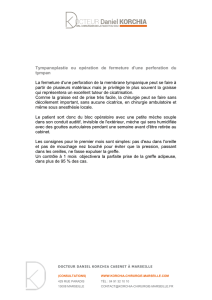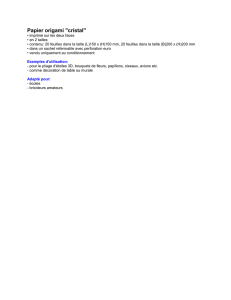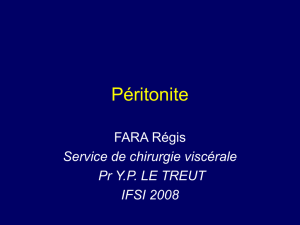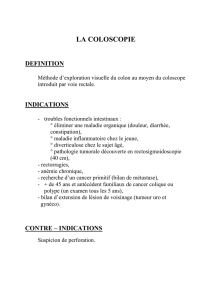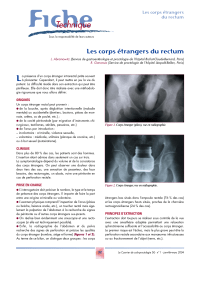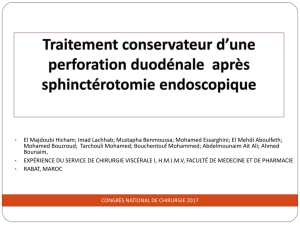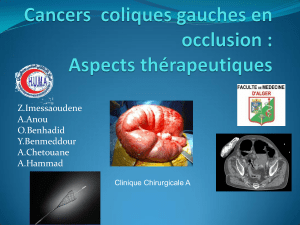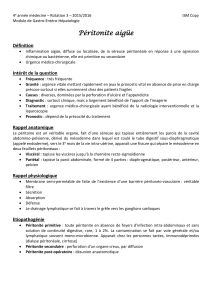Lire l`article complet

Péritonite par perforation typhique
par T. Ngandu*
* Chirurgien-urologue, Hôpital Miba, Mbuji-Mayi, Zaïre.
La fréquence et la gravité des péritonites par perforation typhique en zone tropicale
rend toute réflexion sur ce thème opportune.
Les facteurs socio-économiques qui constituent l'origine lointaine de ce fléau
dépassent le cadre de cet article. Nous insisterons plutôt sur les particularités
locales de cette complication de la fièvre typhoïde et sur notre conduite pratique face
à elle avec les moyens limités dont nous disposons au sein de l'hôpital.
I. Étiologie
La péritonite par perforation typhique est une complication de la fièvre typhoïde
causée par la virulence des germes ou par la défaillance des moyens de défense de
l'hôte. L'insuffisance ou l'absence de traitement, la malnutrition ou d'autres affections
débilitantes la favorisent. Il s'agit presque toujours d'une péritonite fibrino-purulente
généralisée.
La perforation unique ou multiple siège sur l'iléon terminal et rarement sur le caecum.
Salmonella typhi est le principal germe responsable de la fièvre typhoïde. Il s'agit
d'une affection strictement humaine au mode de transmission direct par ingestion de
boisson ou d'aliments souillés (mouches, mains sales, etc.), par les déjections des
sujets infectés.
1. Fréquence
La perforation typhique survient dans 10 à 18 % des fièvres typhoïdes. C'est l'une
des premières causes de laparotomie d'urgence en zone tropicale. Sa fréquence
augmente avec celle de la fièvre typhoïde en saison des pluies.
2. Profil des malades
Tous les âges et les deux sexes sont concernés. Les patients sont issus des
couches sociales pauvres du milieu urbain. Peu de cas viennent des campagnes.
Il. Physiopathologie
Après une phase d'incubation d'une à deux semaines, certains germes essaiment
dans le sang créant une septicémie (tableau n° 1). D'autres sont détruits dans les
ganglions mésentériques et libèrent des endotoxines aux multiples effets nocifs dont
la nécrose des plaques de Peyer, qui conduit à la perforation intestinale à partir de la
troisième semaine. Les conséquences de cette dernière sont indiquées au tableau
n°2. La déshydratation engendrée par les pertes liquidiennes dans le péritoine et le
troisième secteur, la péritonite, la septicémie, la toxémie, et la décompensation des
organes essentiels qui s'ensuit, tout converge vers l'installation rapide du choc et la
survenue de la mort.
1. Symptômes

L'histoire correspond à un tableau de fièvre typhoïde depuis une ou deux semaines
avec des troubles digestifs: diarrhée ou constipation, douleur abdominale et nausées
ou vomissements. Insuffisamment ou pas du tout traités, les patients se plaignent à
l'admission, de l'installation depuis plusieurs jours de :
- arrêt des matières et des gaz,
- ballonnement abdominal,
- aggravation des douleurs abdominales,
- rarement quelques selles liquides persistent et la douleur est peu intense.
À l'examen, l'état général est altéré avec des signes de déshydratation, de choc et
d'anémie. La respiration est superficielle et rapide. L'ictère est rarement présent.
On note :
- ballonnement abdominal modéré,
- défense ou contracture abdominale généralisée,
- météorisme péri-ombilical, mais percussion mate des flancs traduisant
l'épanchement péritonéal,
- au toucher rectal: douleur exquise du Douglas et vacuité rectale.
Face à un tel tableau, le diagnostic est quasiment certain.

III. Examens paracliniques
1. Biologie
Hémoglobine, globules blancs, temps de saignement et de coagulation, groupe
sanguin et rhésus sont réalisés en urgence. L'anémie est habituelle et les globules
blancs sont élevés seulement dans la moitié des cas.
2. Radiologie
L'abdomen sans préparation (ASP), debout de face, montre des niveaux
hydroaériques du grêle (iléus), une grisaille diffuse (épanchement péritonéal), un
croissant gazeux sous-diaphragmatique (air libre péritonéal). Le thorax de face
évalue l'état pleuro-pulmonaire et cardiaque en prévision de l'anesthésie générale.
La réalisation de ces radiographies ne doit pas retarder l'acte opératoire.
IV. Diagnostic
Les moyens de diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde (hémoculture et
coproculture) et le sérodiagnostic de Widal et Félix n'ont pas de place dans ce
contexte d'urgence abdominale. C'est la clinique surtout et la radiologie dans une

moindre mesure qui nous orientent. Finalement ce sont les constatations
peropératoires qui établissent le diagnostic.
Péritonite fibrino-purulente sur perforation de l'iléon terminal avec adénopathies
mésentériques et lésions perforatives éventuelles équivaut en zone d'endémie
typhique à une péritonite par perforation typhique.
V. Conduite à tenir
1. Au poste de santé
L'infirmier confronté à une perforation typhique doit organiser le transfert rapide du
malade vers un hôpital à même de le prendre en charge. L'arrêt de l'alimentation
solide et l'administration du chloramphénicol à une dose de 50 mg/kg/jour sont
indiqués.
2. En milieu hospitalier
Trois étapes doivent être distinguées.
a. Pré-opératoire
Une réanimation visant à corriger les perturbations décrites (tableau n°2) et rendre le
patient opérable est entreprise.
Perfusion de sérum physiologique ou Ringer Lactate altemant avec du sérum
glucosé à 5 ou 10 %. La quantité de liquide par 24heures est déterminée par l'état
et la réponse clinique du malade; mais elle commence sur une base de 3 à 4
litres/24 heures chez l'adulte et 120 millilitres/kg/24 heures chez l'enfant de moins
de 25 kg.
Sonde nasogastrique de bonne taille et surveillance des sorties.
Sonde vésicale et surveillance de la diurèse horaire et de l'aspect des urines.
Antibiothérapie intraveineuse au chloramphénicol d'emblée, à la dose de 3 g/jour
(50 mg/kg/jour).
Les corticoïdes (hydrocortisone) ne sont utilisés que dans les plus mauvais cas
(choc).
La correction de l'anémie si l'hémoglobine est inférieure à 9 g pour cent
(transfusion).
Prévision d'une autre unité de sang pour l'opération.
Cette réanimation doit être la plus courte possible car la mortalité augmente avec le
délai opératoire. Cependant, la réanimation doit au moins atteindre des objectifs
essentiels tels que la restauration d'une bonne hydratation et d'une diurèse adéquate
de 50 ml/heure chez l'adulte et 2 ml/kg/heure chez l'enfant jusqu'à 25 kg, la levée de
l'état de choc et la correction de l'anémie. Nombre de patients perforés depuis
plusieurs jours arrivent à l'hôpital moribonds. L'acte opératoire dans ce cas est
parfaitement inutile !
b. Opératoire

L'acte chirurgical mené sous anesthésie générale avec intubation est fonction des
lésions. La majorité de nos péritonites sont anciennes (plusieurs jours) avec
beaucoup de pus, d'adhérences intestinales, une fibrine épaisse et une paroi
intestinale oedématiée autour de la perforation iléale. Exceptionnellement, la
perforation intéresse la vésicule biliaire.
Les temps opératoires comprennent:
- l'abord par voie médiane sus- et sous-ombilicale;
- l'aspiration du pus, la libération des anses, l'exploration de la cavité péritonéale et
l'identification des lésions;
- la vidange de l'intestin grêle;
- la suture de la perforation;
- la toilette péritonéale au sérum physiologique tiède avec ablation de la fibrine lâche
;
- la fermeture pariétale sur drainage de la cavité péritonéale.
Selon les lésions, on pratiquera une bourse d'enfouissement à la soie fine (3 ou 2/0)
pour les orifices punctiformes et des points séparés extramuqueux vers les lésions
plus larges. La résection-anastomose dans ce milieu purulent est évitée autant que
possible. L'iléostomie pose plus de problèmes qu'elle n'en résout (prise en charge
postopératoire, appareillage).
La durée moyenne de l'opération est de 1 heure et demie. Il faut s'efforcer de faire
vite mais bien.
c. Postopératoire
Tous les patients séjournent en réanimation jusqu'à la reprise de l'alimentation orale
vers le sixième jour postopératoire. La sonde nasogastrique est conservée quatre
jours au moins jusqu'à la reprise du transit (gaz, péristaltisme). Les perfusions sont
abondantes (3-4 litres/jour chez l'adulte). L'antibiothérapie est poursuivie pendant dix
à quinze jours. La paroi abdominale est soutenue par un bandage de corps.
VI. Pronostic
La mortalité de la perforation typhique reste importante (autour de 40% des cas). Le
pronostic est lié au délai opératoire et aux perturbations physiopathologiques dont il
permet l'installation. Il est également lié au terrain et en particulier à l'état
nutritionnel. La réanimation et la chirurgie jouent un rôle non négligeable quand le
délai et le terrain le permettent. La mortalité postopératoire est dominée par les
infections de la paroi.
L'éviscération, les abcès intrapéritonéaux et surtout la fistule stercorale sont des
complications redoutables qui remettent en question la survie.
Conclusion
 6
6
1
/
6
100%