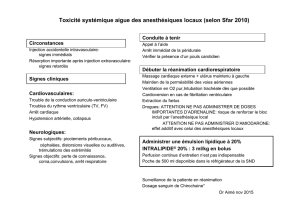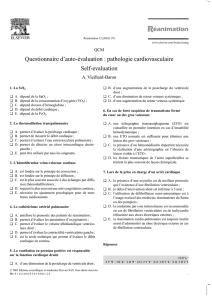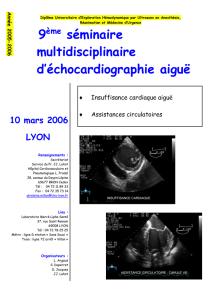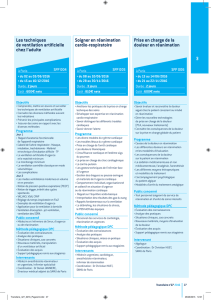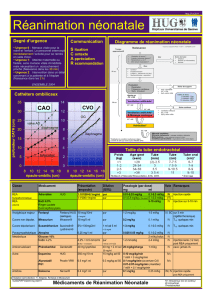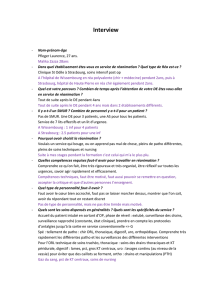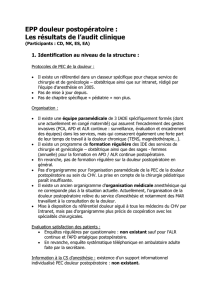SOMMAIRE - NTE Lyon 1

La réanimation postopératoire en chirurgie cardiaque
S. ESTANOVE, L CHEBANCE, P BLANC, JJ LEHOT - Mise à jour août 2004
1
HOPITAL LOUIS PRADEL – LYON
Service d’Anesthésie Réanimation
Professeur JJ. LEHOT
LA REANIMATION
POSTOPERATOIRE
EN CHIRURGIE CARDIAQUE
S Estanove, L Chebance, P Blanc, JJ Lehot
Mise à jour : août 2004

La réanimation postopératoire en chirurgie cardiaque
S. ESTANOVE, L CHEBANCE, P BLANC, JJ LEHOT - Mise à jour août 2004
2
SOMMAIRE
INTRODUCTION Principes généraux de la réanimation / Objectifs de soins ................................................ 2
1. MATERIEL A PREVOIR ............................................................................................................... 2
2. TRANSPORT EN REANIMATION ................................................................................................ 3
3. ACCUEIL DU MALADE ET INSTALLATION ................................................................................. 3
3.1 Branchement du respirateur
3.2 Installation du système pour la mesure du CO2 expiré
3.3 Mise en place de l’électrocardiogramme
3.4 Installation des capteurs de pression
3.5 Raccordements des drains
3.6 Installation des perfusions
3.7 La sonde urinaire et la sonde naso-gastrique
4. REANIMATION POSTOPERATOIRE ............................................................................................ 4
5. L’ECG ........................................................................................................................................... 5
5.1 Son intérêt
5.2 Diagnostic des complications
6 MONITORAGE HEMODYNAMIQUE ............................................................................................. 6
6.1 Son intérêt
6.2 Rappel des différents facteurs de performance
6.3 Complications hémodynamiques
6.3.1 Hypotension
6.3.2 Poussées hypertensives
6.3.3 Bas débit cardiaque
6.3.4 Choc cardiogénique
6.3.5 Tamponnade
7 VENTILATION ASSISTEE ............................................................................................................ 9
7.1 Son intérêt
7.2 La surveillance de la ventilation assistée
7.3 Le sevrage
7.4 Les complications respiratoires
8 LES DRAINS ............................................................................................................................... 11
9 SURVEILLANCE NEUROLOGIQUE ............................................................................................. 11
10 SURVEILLANCE RENALE ........................................................................................................... 12
10.1 Contrôle de la diurèse
10.2 Complications rénales
11 LA TEMPERATURE ..................................................................................................................... 12
12 SURVEILLANCE DIGESTIVE ...................................................................................................... 12
13 PREVENTION DE L’INFECTION ................................................................................................ 13
14 PROBLEMES SPECIFIQUES ....................................................................................................... 13
13.1 A la chirurgie coronaire
13.2 A la transplantation cardiaque
13.3 A la chirurgie cardiaque du nouveau-né et du nourrisson
CONLUSION ..................................................................................................................................... 14

La réanimation postopératoire en chirurgie cardiaque
S. ESTANOVE, L CHEBANCE, P BLANC, JJ LEHOT - Mise à jour août 2004
3
INTRODUCTION
La surveillance et la réanimation postopératoire en chirurgie cardiaque ont pour but de détecter et traiter
précocement la survenue éventuelle de complications. La durée de séjour varie de moins de 24h à plusieurs jours.
Cette surveillance peut être prolongée en raison :
de la gravité de l’intervention, de l’état préopératoire : patient opéré à un stade évolué de sa cardiopathie,
en défaillance cardiaque mal contrôlée par le traitement, asthénique, cachectique ou présentant une
hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) ou un facteur de risque associé (diabète, insuffisance rénale
préopératoire…)
de la survenue d’une complication : bas débit cardiaque (BDC), complication infectieuse, pneumopathie,
insuffisance rénale, complication neurologique…
Les âges extrêmes de la vie (<1 an, >80 ans) requièrent souvent après chirurgie cardiaque une surveillance
prolongée au-delà de 2 jours, même en l’absence de toute complication (notamment pour la prise en charge d’une
kinésithérapie active).
Principes généraux de la surveillance / Objectifs de soins
Le but essentiel est :
de maintenir une fonction cardiocirculatoire correcte chez un patient qui doit s’adapter à un nouvel état
hémodynamique.
de détecter toute modification clinique, électrique, hémodynamique et biologique avant la survenue d’une
complication avérée ou de détecter très rapidement une complication pour entreprendre une thérapeutique
qui sera d’autant plus efficace qu’elle sera mise en route précocement.
de demander éventuellement des examens complémentaires pour préciser le diagnostic et l’origine de la
complication.
de contrôler l’efficacité du traitement.
de prévenir les risques infectieux.
Favoriser le retour à l’autonomie des différentes fonctions vitales
1. MATERIEL A PREVOIR
En chirurgie cardiaque majeure, la surveillance postopératoire est lourde et comporte, outre la surveillance
clinique, une surveillance électrocardiographique, hémodynamique, biologique, radiologique, le contrôle des
paramètres de ventilation, des drainages : ceci implique une préparation de l’accueil du patient, nécessitant 20 à
30 minutes.
Monitorage cardiaque : moniteur, capteurs de pressions avec chaîne de pression
Respirateur ayant fait l’objet des contrôles et pré réglé en fonction du patient (check-list)
Système de ventilation manuelle avec raccord d’intubation et masque pour parer à toute éventualité :
panne de respirateur, extubation accidentelle.
2 systèmes de vide branchés :
- 1 pour aspiration trachéale
- 1 pour drainage médiastinal et éventuellement pleural,
Des pousse-seringues électriques à prévoir en fonction du nombre de médicaments à poursuivre
(inotropes, vasodilatateurs, antiarythmiques)
Défibrillateur externe avec plaques de taille adaptée
Pace-maker externe
Matériel d’intubation
Matériel de perfusion et de transfusion et médicaments d’urgence à disposition

La réanimation postopératoire en chirurgie cardiaque
S. ESTANOVE, L CHEBANCE, P BLANC, JJ LEHOT - Mise à jour août 2004
4
2. TRANSPORT EN REANIMATION
La première étape de la surveillance postopératoire débute avec le transport entre le bloc opératoire et la
réanimation qui ne doit être effectué que lorsque l’état hémodynamique est stable, les pertes sanguines par les
drains faibles et après un remplissage vasculaire correct.
En effet les chutes de pression artérielle (PA) ne sont pas exceptionnelles au cours du transport, par modifications
de répartition du volume sanguin chez un patient encore sous anesthésie avec persistance d’un certain degré de
vasoplégie.
Le transport est effectué sous ventilation assistée manuelle ou instrumentale, en 02 pur et sous contrôle continu de
l’ECG, et pour les interventions majeures ou chez les patients à risques, sous contrôle de la PA par voie sanglante
et de la SpO2. Une grande attention est donnée à la poursuite des traitements inotropes parfois nécessaires après
l’arrêt de la CEC (par seringue électrique alimentée par batterie).
3. ACCUEIL DU MALADE ET INSTALLATION
Le médecin anesthésiste réanimateur aura transmis auparavant les consignes concernant la surveillance à prévoir,
et les traitements postopératoires à préparer. Le patient est installé en décubitus dorsal avec fixation souple des
poignets pour faciliter la surveillance immédiate et éviter les artéfacts au niveau du recueil des pressions.
3.1. Branchement du respirateur :
Un préréglage des différents paramètres : fréquence respiratoire, mode d’insufflation (temps d’insufflation, temps
de pause, rapport I/E, FIO2, fréquence respiratoire), ainsi que les niveaux d’alarme de pression, de volume expiré
haut et bas ont été réalisés avant le branchement.
Les préréglages utilisés le plus souvent chez l’adulte sont les suivants : FIO2 40-50%, Vte 8-10 ml/kg, FR 12-15
cycles/min, maxima du pic de pression : 30 cmH2O.
Un contrôle du soulèvement rythmique de la cage thoracique, et la recherche par auscultation du murmure
vésiculaire au niveau des 2 champs pulmonaires sont effectués pour s’assurer du bon positionnement de la sonde
endotrachéale et de l’absence d’intubation sélective.
3.2. Installation du système pour la mesure du CO2 expiré :
Son intérêt est d’être une alarme précise des principales complications graves (circulatoires, respiratoires,
métaboliques).
3.3. Mise en place de l’électrocardiogramme (ECG) :
La dérivation choisie sera celle donnant la meilleure captation de la fréquence cardiaque et du rythme (DII-DIII)
ou après pontage aorto-coronarien (PAC) celle informant le plus précisément sur la survenue d’un décalage de ST
(V5), dans le territoire gauche, avec réglage des alarmes.
3.4. Installation des capteurs de pression :
Pression artérielle systolique, diastolique et moyenne (PAS, D, M) mesurée par cathéter intra-artériel
(radial, plus rarement huméral ou fémoral) mis en place par voie percutanée le plus souvent
Pression auriculaire droite (POD) ou veineuse centrale (PVC)
Éventuellement pression auriculaire gauche (POG) mis en place chirurgicalement en fin d’intervention
(chez l’enfant essentiellement)

La réanimation postopératoire en chirurgie cardiaque
S. ESTANOVE, L CHEBANCE, P BLANC, JJ LEHOT - Mise à jour août 2004
5
Pression artérielle pulmonaire (PAP) par cathéter de Swan-Ganz introduit le plus souvent par voie jugulaire
interne qui permet, outre la mesure de la POD, la mesure de la pression artérielle pulmonaire d’occlusion
(PAPO), du débit cardiaque, de la saturation en 02 du sang veineux mêlé (SvO2), le calcul de l’index
cardiaque, du travail ventriculaire externe, gauche et droit et des résistances vasculaires systémiques et
pulmonaires.
Le réglage des niveaux d’alarme haut et bas sera fonction du patient, de son état cardiaque préopératoire et
des niveaux de pression assurant la meilleure performance cardiaque pour ce type d’intervention.
3.5. Raccordements des drains :
Branchement des drains médiastinaux et pleuraux, avec réglage du niveau de dépression sur des systèmes
de drainage à usage unique : (-20 à -30 cm H2O chez l’adulte, -10 à -15 cm H2O chez le petit enfant et le
nourrisson).
3.6. Installation des perfusions :
Mise en route immédiate des perfusions nécessaires (inotropes, vasodilatateurs, antiarythmiques) sur
indication médicale, par seringue électrique à débit réglée.
Branchement des perfusions ou transfusions programmées sur les voies veineuses centrales ou
périphériques prévues à cet effet.
3.7. La sonde urinaire et la sonde nasogastrique
Elles auront été préalablement raccordées à un collecteur au bloc opératoire. Chez le nourrisson, le petit enfant, et
chez les patients en oligurie préopératoire (choc cardiogénique), ou en présence d’un bas débit cardiaque
postopératoire, un système de recueil horaire gradué des urines est utilisé (Urimeter)
4. REANIMATION POSTOPERATOIRE
Les différents paramètres surveillés se répartissent en paramètres surveillés en continu, toutes les heures, de
façon plus séquentielle (toutes les 3 à 4 h) et quotidiennement.
En continu :
- ECG selon l’équipement
- PAS, D, M avec alarmes hautes et basses, visuelles et sonores
- PAP, S, D, M
- PVC ou POD
- Débit cardiaque
- SvO2
- Ventilation
Répétée, toutes les heures ou plus fréquemment (toutes les 15 ou 30 minutes dans les périodes d’instabilité
cardio-vasculaire) :
- débit des drains
- débit des PS
- diurèse
- douleur
- sédation
Séquentielle :
- examen clinique : coloration de la face et des extrémités, température cutanée, cyanose, présence de
sueurs, état de conscience, hépatomégalie…
-
- échocardiographie-doppler : échographie transthoracique ou transoesophagienne (ETO ou ETT).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%