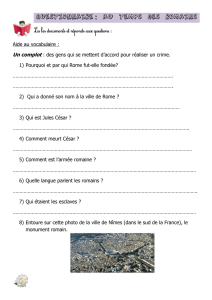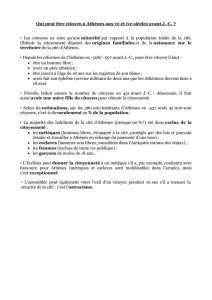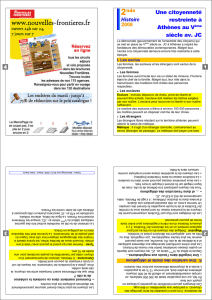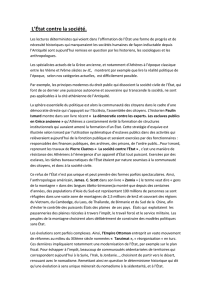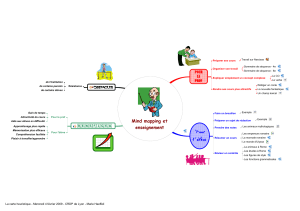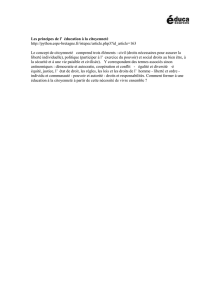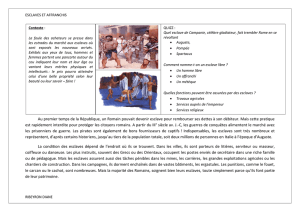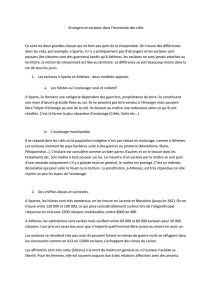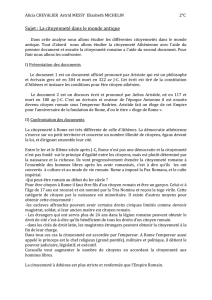Citoyens et non-citoyens : l`Antiquité peut

1
Citoyens et non-citoyens : l’Antiquité peut-elle servir de modèle ?
1
Dans la représentation que nous en avons les concepts de cité et de citoyen sont entiè-
rement positifs, et du strict point de vue historique c’est effectivement le cas puisque la
naissance de la cité constitue un réel progrès en matière d’organisation sociale. Mais on
oublie trop souvent que le principe d’inclusion de l’individu dans une communauté, qui
est à la base de la cité antique, se double d’une logique d’exclusion puisqu’on ne peut
définir qui est citoyen sans définir en même temps qui ne l’est pas. Et s’il est une
évidence, c’est que ce n’est pas le lieu de résidence qui fait le citoyen ; comme l’écrit
Aristote
2
: « des métèques et des esclaves partagent leur résidence avec les citoyens ».
Les habitants d’une cité
Dans toutes les cités antiques on peut ainsi classer les habitants dans différents cercles
selon le rapport de proximité ou d’éloignement qu’ils entretiennent avec la cito-
yenneté
3
:
le premier cercle regroupe les citoyens et leurs fils – à condition qu’ils soient lé-
gitimes : avant d’atteindre leur majorité civique (autour de 17/18 ans), condition
de la citoyenneté, les fils de citoyens ne sont en effet que « des citoyens en puis-
sance », mais cette situation est par essence seulement provisoire.
le deuxième cercle est celui des épouses et des filles de citoyens, dont le statut
est assez paradoxal. Comme elles sont, juridiquement parlant, d’éternelles mi-
neures, elles ne peuvent évidemment pas accéder à la citoyenneté … et jamais la
question ne sera même envisagée. Mais elles seules peuvent, avec un époux
citoyen, engendrer de futurs citoyens ou des jeunes filles susceptibles à leur tour
d’engendrer de futurs citoyens. Elles jouent également, en Grèce comme à Rome,
un rôle non négligeable dans la religion de la cité : on peut penser par exemple
aux Vestales, qui à Rome sont les gardiennes du feu, garant de la vie de la cité. En
1
Ce texte reprend et développe une conférence faite par l’auteur dans le cadre du Festival international du
latin et du grec, organisé à Lyon du 23 et 25 mars 2016 et dont le sujet était « Nous citoyens ».
2
Aristote, Politique, 3, 1, 3.
3
Je reprends ici, en le modifiant très légèrement, Raoul Lonis, La cité dans le monde grec, Paris, Armand
Coiin, 1994 .

2
ce sens, elles appartiennent à ce que l’on peut définir comme « la communauté
civique » dont sont en revanche exclus les membres des deux cercles suivants.
le troisième cercle est composé des « libres non citoyens », à savoir les étrangers
qu’ils soient de passage (parfois pour d’assez longs séjours s’ils sont venus par
exemple pour faire du commerce) ou installés à demeure dans la cité, généra-
lement en tant qu’artisans, comme les métèques athéniens dont parle Aristote
ou, à Rome, ceux que l’on nomme les pérégrins (peregrini). Normalement, ils
sont citoyens de leur cité d’origine sauf bien sûr s’ils ont été déchus de leur
citoyenneté à la suite d’une condamnation. Ils ont vis à vis de la cité qui les
accueille un certain nombre d’obligations : les métèques athéniens s’acquittaient
d’une taxe spécifique de résidence (le metoikion) et il semble bien qu’ils ser-
vaient dans l’armée puisque Xénophon
4
propose de les verser non plus dans l’in-
fanterie lourde mais dans la cavalerie. Mais, même s’il participe à la défense de la
cité, un étranger doit totalement s’abstenir de toute activité politique. Comme le
dit Cicéron
5
: « Le devoir de l’étranger de passage et de l’étranger résident est de
ne rien faire en dehors de son occupation, de ne se mêler en rien des affaires
d’autrui et de ne montrer, quand il s’agit d’un État étranger, absolument aucune
curiosité ».
Le dernier cercle est celui des individus “non-libres” : sa composition diffère se-
lon les cités. Un certain nombre d’entre elles pratiquent ce qui s’apparente à une
forme de servage, même si le terme est en soi anachronique. Le cas le plus connu
est celui des hilotes de Sparte, attachés au lot de terre attribué par la cité à cha-
cun de ses citoyens avec mission de le cultiver pour que les Spartiates eux-mê-
mes puissent se consacrer totalement à la guerre. On considère généralement
qu’il s’agit de populations antérieurement établies sur le futur territoire de la
cité et réduites en servitude – donc exclues de la citoyenneté – par les nouveaux
venus. Ce mode d’asservissement est totalement inconnu dans le monde romain
et il est minoritaire dans le monde grec lui-même. Dans les cités qui ne prati-
quent pas l’esclavage de type hilotique, comme Athènes ou Rome, le groupe des
non-libres est constitué d’esclaves au sens strict, que l’on a coutume d’appeler
aujourd’hui, parce qu’ils étaient vendus et achetés comme n’importe quel autre
4
Xénophon, Sur les revenus, 2.
5
Cicéron, Les Devoirs, 1, 125.

3
bien, « esclaves-marchandises ». Les esclaves-marchandises sont doublement ex-
clus de la citoyenneté, par leur asservissement et parce qu’ils sont des étrangers
dans la cité.
Combien de citoyens et combien de non-citoyens ?
Les spécialistes ont, depuis très longtemps, cherché à mesurer l’importance relative des
différents groupes qui cohabitent dans la cité. À partir des recensements qu’effectuaient
les cités nous devrions pouvoir connaître au moins le nombre de citoyens : mais les chif-
fres qui nous donnés par les historiens anciens – par exemple 30 000 pour Athènes au
début du Vè s. av. J.-C. ou 312 000 pour Rome en 168 av. J.-C. – sont fragmentaires,
souvent contradictoires et font l’objet d’interprétations divergentes. Par ailleurs, même
si nous avions des certitudes sur le nombre de citoyens, nous ne pourrions déterminer le
nombre de personnes appartenant à la communauté civique (les citoyens, leurs femmes
et leur enfants) qu’en appliquant l’un des modèles démographiques définis pour les
sociétés modernes avec tous les risques que cela comporte, puisque le coefficient multi-
plicateur varie selon les démographes de 3 à 5. Pour les dates prises comme exemples et
en adoptant le chiffre moyen de 4 on aboutirait pour Athènes à un total de 120 000
personnes et pour Rome à un total de 1 500 000 personnes.
Le nombre d’étrangers résidents est en revanche difficilement déterminable, sans parler
du nombre des esclaves, hilotes ou esclaves-marchandises : pour ceux-ci, les chiffres
donnés par les spécialistes modernes varient de 1 à 5 (par exemple pour Athènes de 80
000 à 400 000) en fonction de présupposés qui ne sont pas scientifiques mais idéo-
logiques, selon que l’on veut louer ou dénoncer le modèle antique. C’est ainsi qu’au 18ès.
Volney, l’un des rédacteurs de l’Encyclopédie, désireux de blâmer ceux de ses contem-
porains qui n’avaient à la bouche que le modèle athénien, choisissait de donner un
nombre élevé d’esclaves : cela lui permettait de leur reprocher, dans l’une de ses Leçons
d’histoire, d’oublier « qu'à Athènes, ce sanctuaire de toutes les libertés, il y avait quatre
têtes esclaves contre une tête libre »
6
.
En fait, la seule certitude que nous ayons, c’est que dans une cité antique, il y a toujours
infiniment moins de citoyens que d’habitants qui ne le sont pas : à Athènes comme à
6
Volney, Leçons d'histoire, 6. Volney est le pseudonyme, transparent pour un admirateur de Voltaire
(Vol<taire/Fer>ney) du comte Constantin-François de Chassebœuf. Les Leçons d’histoire sont des
conférences données en 1795-1796 à l’École Normale (future ENS).

4
Rome, aux dates que j’ai prises comme exemple et même si l’on choisit les estimations
les plus basses, le rapport entre les deux chiffres – celui des citoyens et celui de la
population totale – est de 1 à 7.
Ce qui différencie les cités entre elles ce n’est donc pas la composition de leur popu-
lation, mais la manière dont il y est ou non possible, si on en est exclu, d’accéder un jour
à la citoyenneté. C’est la question qui s’est posée à toute cité, jamais à propos des
femmes comme je l’ai dit, mais en ce qui concerne les membres des deux groupes les
plus éloignés de la citoyenneté, celui des étrangers et celui des esclaves. Ce qui est
intéressant est que Rome et les cités grecques ont apporté à cette question des réponses
radicalement différentes pour ne pas dire opposées.
La Grèce et Rome face aux étrangers : des choix contradictoires
Les cités grecques dans leur ensemble apparaissent comme traditionnellement méfian-
tes à l’égard des étrangers, fussent-ils eux-mêmes grecs mais originaires d’autres cités.
Dans sa Vie de Lycurgue, Plutarque loue ainsi le personnage, législateur légendaire de
Sparte, « d’avoir banni de la ville les étrangers qui s’y glissaient et s’y rassemblaient sans
y être d’aucune utilité et risquaient d’en bouleverser la constitution »
7
. Le résultat de
cette méfiance est un repli sur soi et une fermeture du corps civique dont l’une des
manifestations est par exemple la loi que fit voter Périclès à Athènes en 451 av. J.-C. et
qui stipulait que pour être citoyen il fallait être né d’un père citoyen et d’une mère fille
de citoyen : cela excluait de la citoyenneté les enfants dont le père ou la mère était
étranger et qui auparavant étaient comptés au nombre des citoyens. Cela ne signifie pas
que les cités grecques n’accordaient jamais la citoyenneté à quiconque : nous avons
conservé une série de « décrets de naturalisation » athéniens qui prouvent le contraire
8
,
mais ils montrent qu’il s’agit d’une mesure tout à fait exceptionnelle : Lysias, que nous
considérons comme l’un des plus grands orateurs attiques, est resté toute sa vie un
métèque à Athènes, comme l’était son père, un fabricant de boucliers originaire de Syra-
cuse ; il en a été de même pour Aristote, originaire de Stagire.
7
Plutarque, Vie de Lycurgue, 27, 7.
8
Voir M. J. Osborne, Naturalization in Athens, vol. 1-4, Bruxelles, 1981-1983).

5
L’histoire romaine regorge à l’inverse d’exemples – constamment rappelés – d’étrangers
accueilis à Rome et directement intégrés dans la cité. Parmi ces personnages, il y a par
exemple Lucumon, le futur roi Tarquin l’Ancien : Lucumon, dit l’historien Tite-Live
9
, fils
d’un Corinthien exilé pour raisons politiques à Tarquinia en Étrurie
10
, et mariée à une
Étrusque, choisit de s’installer à Rome précisément parce que cette cité était accueillante
aux étrangers et il y réussit si bien qu’il en devint le roi. Il y a également Attius Clausus,
connu ensuite par les Romains sous le nom d’Appius Claudius, venu de Sabine pour
s’installer à Rome au tout début du Vè s. av. J.-C. : Tite-Live rapporte que la République
qui venait de naître lui donna à lui et à ses nombreux clients (c’est-à-dire ceux qui
dépendaient de lui) « la citoyenneté et des terres sur la rive droite de l’Anio »
11
; cela
implique un très important apport de population
12
. Appius lui-même fut peu après
admis au sénat et sa gens (sa lignée) donna à Rome nombre de personnages de premier
plan, dont l’empereur Claude. Selon Cicéron, il ne s’agit pas là de cas isolés mais d’un
choix politique assumé : c’est ce qu’il affirme dans le discours qu’il prononce en faveur
de Balbus, un Espagnol de Gadès accusé par ses adversaires d’avoir accédé à la citoyen-
neté à la suite d’un passe-droit. Cicéron conclut sa démonstration par une formule
célèbre qui fait de Romulus, pourrait-on dire, un anti-Lycurgue : « Romulus, le premier
de nos rois, le créateur de notre ville, nous a enseigné par le traité avec les Sabins que
nous devions accroître notre État en y accueillant même des ennemis. Forts de cette
garantie et de ce précédent, nos ancêtres n’ont cessé d’accorder et de distribuer le droit
de cité. Ainsi dans le Latium beaucoup d’habitants de Tusculum et de Lanuvium, et dans
d’autres régions, des peuples entiers, tels que les Sabins, les Volsques, les Herniques ont
reçu de nous le droit de cité »
13
. C’est par cette tradition ancestrale que plus tard
l’empereur Claude, dans le discours qui nous a été en partie conservé par les Tables
Claudiennes de Lyon, justifie sa volonté de faire entrer des Gaulois au sénat. Dans la
version que l’historien Tacite donne de ce discours et dont nous savons qu’elle est fidèle
à l’original, l’historien fait ainsi déclarer au Prince : « Quelle autre cause y a-t-il eu à la
9
Tite-Live, Histoire romaine, 1, 34.
10
C’est la région que nous nommons aujourd’hui la Toscane.
11
Tite-Live, Histoire romaine, 2, 16.
12
Denys d’Halicarnasse, un historien grec contemporain de Tite-Live, donne même le chiffre de 5000
hommes en âge de porter les armes pour les clients d’Appius (Antiquités romaines, 5, 40).
13
Cicéron, Pour Balbus, 31. Le discours date de 56 av. J.-C.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%