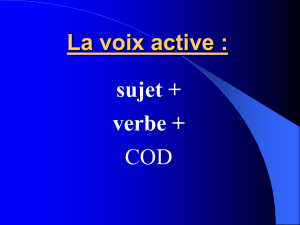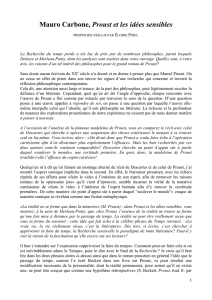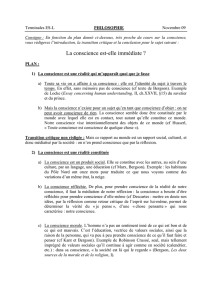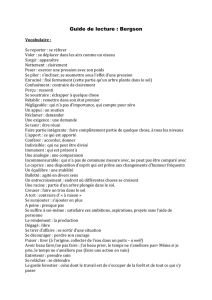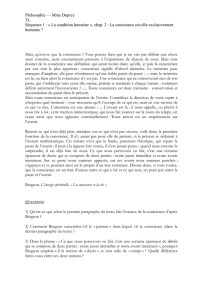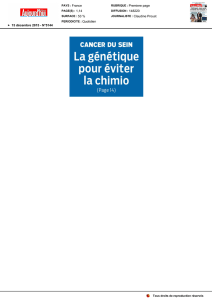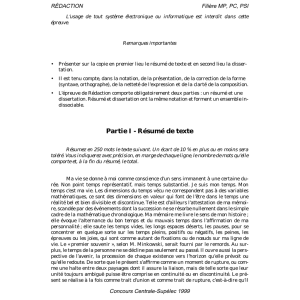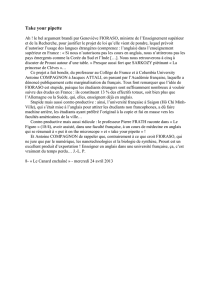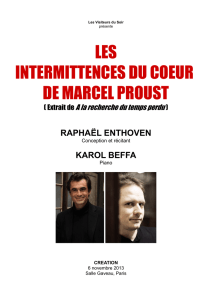Extrait

Proust était un neuroscientifique sans le savoir
Jonah Lehrer
EXTRAIT
Marcel Proust
La méthode de la mémoire
Intuitions
Proust ne serait pas surpris par ses pouvoirs prophétiques. Il considérait que l’art et la
science traitaient tous deux de faits (« L’impression est pour l’écrivain ce que
l’expérimentation est pour le scientifique »), que seul l’artiste pouvait décrire la réalité telle
qu’on la vivait réellement. Proust en était certain, tout lecteur de son roman « reconnaîtrait en
lui-même ce que le livre racontait… Ceci sera la preuve de sa véracité ».
Proust apprit à croire au pouvoir étrange de l’art grâce au philosophe Henri Bergson
1
.
Quand Proust entreprit l’écriture de La Recherche, Bergson était sur la voie de la célébrité. Le
métaphysicien remplissait les salles de concert, les touristes intellectuels écoutaient avec une
profonde attention ses conférences
2
sur l’élan vital, la comédie et « l’évolution créative ».
Dans son essence, la philosophie de Bergson consistait en une résistance acharnée à une
vision mécaniste de l’univers. Les lois de la science étaient bonnes pour la matière inerte,
disait Bergson, pour discerner les relations entre atomes et cellules, mais qu’en était-il nous
concernant ? Nous avions une conscience, une mémoire, un être. Selon Bergson, cette réalité
– la réalité de notre conscience de soi – ne pouvait se prêter à une réduction ou une dissection
expérimentale. Il pensait que seule l’intuition nous permettait de nous comprendre nous-
mêmes, et ce processus demandait beaucoup d’introspection, des journées oisives de
contemplation de nos connexions internes. C’était, en substance, une méditation pour les
bourgeois.
Proust fut l’un des premiers artistes à intégrer la philosophie de Bergson. Son œuvre
littéraire devint une célébration de l’intuition, de toutes les vérités que nous pouvons
découvrir simplement en étant allongé sur le lit à réfléchir tranquillement. Et même si
l’influence de Bergson n’était pas sans inquiéter Proust – « J’ai assez à faire, écrivit-il dans
une lettre, sans essayer de faire de la philosophie de Bergson un roman ! » –, Proust ne
pouvait malgré tout pas résister aux thèmes bergsoniens. En fait, l’assimilation approfondie de
la philosophie de Bergson amena Proust à conclure que le roman du XIXe siècle, qui
privilégiait les choses par rapport aux idées, n’avait absolument rien compris. « Le type de
littérature qui se satisfait de “décrire les choses”, écrivit Proust, de leur consacrer un maigre
résumé en termes de lignes et de surfaces, a beau se prétendre réaliste, est en fait le plus
1
Proust assista aux conférences de Bergson données à la Sorbonne de 1891 à 1893. De plus, il lut Matière et
mémoire, l’ouvrage de Bergson, en 1909, juste au moment où il commençait à rédiger Du côté de chez Swan. En
1892, Bergson épousa la cousine de Proust. Mais une seule conversation est attestée entre Proust et Bergson, au
cours de laquelle ils discutèrent de la nature du sommeil. Il est également fait état de cette conversation dans
Sodome et Gomorrhe. Pour le philosophe, toutefois, Proust n’est demeuré que le cousin qui lui avait acheté une
boîte d’excellentes boules Quies, sans plus.
2
Son apparition à l’université de Columbia provoqua le premier embouteillage jamais connu à New York.

éloigné de la réalité. » Comme le soutenait Bergson, la meilleure manière de comprendre la
réalité est subjective. Et intuitive pour avoir accès à ses vérités.
Mais comment une œuvre de fiction pouvait-elle démontrer le pouvoir de l’intuition ?
Comment un roman pouvait-il prouver que la réalité était, selon la formule de Bergson, « en
dernier lieu spirituelle, et non physique » ? La réponse de Proust prit une forme inattendue,
celle d’un petit gâteau sec au beurre parfumé au zeste de citron et en forme de coquillage.
C’était là un peu de matière qui révélait « la structure de son esprit », un dessert qui pouvait
« se réduire à ses éléments psychologiques ». C’est ainsi que débute la Recherche, avec la
célèbre madeleine, à partir de laquelle se dévoile tout un esprit :
« Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon
palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi. Un plaisir
délicieux m’avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m’avait aussitôt rendu les
vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la
même façon qu’opère l’amour, en me remplissant d’une essence précieuse : ou plutôt
cette essence n’était pas en moi, elle était moi. J’avais cessé de me sentir médiocre,
contingent, mortel. D’où avait pu me venir cette puissante joie ? Je sentais qu’elle était
liée au goût du thé et du gâteau, mais qu’elle le dépassait infiniment, ne devait pas être
de même nature. D’où venait-elle ? Que signifiait-elle ? Où l’appréhender ? Je bois
une seconde gorgée où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième
qui m’apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m’arrête, la vertu du
breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n’est pas en lui,
mais en moi »
3
.
Ce magnifique paragraphe résume toute l’essence de l’art de Proust, la vérité s’élevant
comme de la buée d’une tasse de thé limpide. Alors que la madeleine était le déclencheur de
la révélation de Proust, ce passage ne porte pas sur la madeleine. Le gâteau sec est
simplement pour Proust un prétexte pratique pour explorer son sujet favori : lui-même.
Qu’ont appris à Proust ces miettes prophétiques de sucre, farine et beurre ? Il a en réalité
fait preuve d’une immense intuition au sujet de la structure du cerveau humain. En 1911,
l’année de la madeleine, les physiologistes n’avaient pas la moindre idée du mode de
connexion des sens à l’intérieur du crâne. C’est là que Proust eut l’une de ses intuitions les
plus pénétrantes : notre odorat et notre goût portent ensemble le poids de la mémoire.
« Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la
destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus
persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des
âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans
fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir »
4
.
Les neurosciences ont maintenant pu prouver que Proust avait vu juste. Rachel Herz,
psychologue à l’université Brown, a montré – dans un article scientifique intitulé avec
beaucoup d’esprit « Tester l’hypothèse proustienne » – que notre odorat et notre goût sont
exceptionnellement sentimentaux, car ce sont les seuls sens directement connectés à
l’hippocampe, centre de la mémoire à long terme du cerveau. Leur marque est indélébile.
Tous nos autres sens (vue, toucher et ouïe) sont au départ traités par le thalamus, source du
3
À la recherche du temps perdu, tome 1, Du côté de chez Swan, GF Flammarion, Paris, 1987, édition revue et
mise à jour en 2009, p. 144-145.
4
À la recherche du temps perdu, tome 1, Du côté de chez Swan, GF Flammarion, Paris, 1987, édition revue et
mise à jour en 2009, p. 147.

langage et porte d’entrée de la conscience. Ils sont donc beaucoup moins efficaces pour
évoquer notre passé.
Proust a eu l’intuition de cette anatomie. Il s’est servi, pour faire remonter à la surface de la
mémoire son enfance
5
, du goût de la madeleine et de l’odeur du thé car la vue seule du gâteau
sec en forme de coquille n’a pas suffi. Proust est d’ailleurs même allé jusqu’à accuser son
sens de la vue de brouiller ses souvenirs d’enfance. « Peut-être parce que, en ayant souvent
aperçu depuis, sans en manger, écrit Proust, leur image s’était dissociée de ces jours à
Combray »
6
. Fort heureusement pour la littérature, Proust décida de porter à sa bouche le
gâteau sec.
5
A. J. Liebling, célèbre hédoniste et journaliste au New Yorker, a écrit : « À la lumière de ce que Proust a écrit
avec un stimulus aussi léger (la quantité de cognac contenue dans une madeleine ne suffirait pas pour faire une
friction à l’alcool à un moucheron), qu’il n’ait pas eu un appétit plus solide est une perte pour l’humanité. »
Liebling aurait été content de savoir que Proust avait en fait un excellent appétit. Il ne prenait qu’un repas par
jour (sur ordre du médecin), mais son dîner était digne de Liebling. Un exemple de menu : deux œufs sauce à la
crème, trois croissants, la moitié d’un poulet rôti, des pommes de terre frites, des raisins, de la bière et quelques
gorgées de café.
6
À la recherche du temps perdu, tome 1, Du côté de chez Swan, GF Flammarion, Paris, 1987, édition revue et
mise à jour en 2009, p. 147.
1
/
3
100%