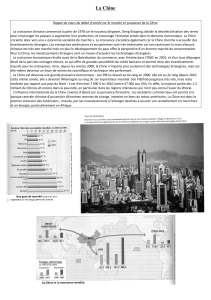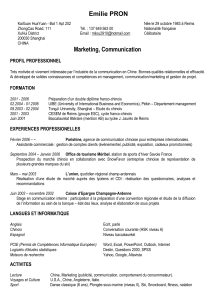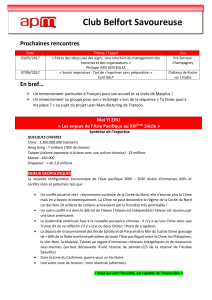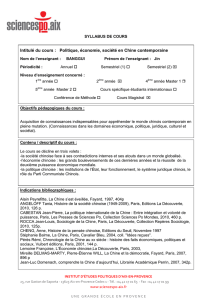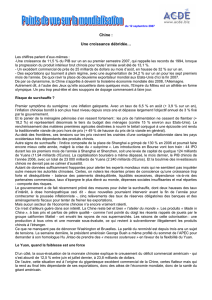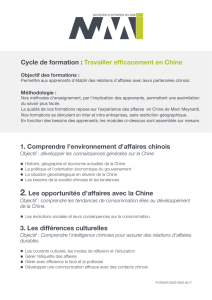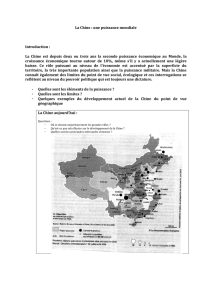MOU Zongsan - Institut Ricci

Recension par Michel MASSON
de l’ouvrage de MOU Zongsan,
Spécificités de la philosophie chinoise
Introduction de Joël Thoraval,
traduit du chinois par Ivan Kamenarovié et Jean-Claude Pastor,
Cerf « Patrimoines », 2003, 244 pp., 44 euros
Voici la première traduction en langue occidentale d'un livre de Mou Zongsan (1909-
1995), un des principaux penseurs confucéens du XX° siècle. Ce livre, paru en 1974, rassemble
dix conférences données l'année précédente à l'Université de Hong Kong : dix conférences pour
rappeler aux Chinois que la Chine a une philosophie.
Ce n'est pas la première fois qu'un penseur chinois au XX° siècle se lance dans une
défense et illustration du passé philosophique de la Chine. La question est donc: Mou Zongsan
dit-il du nouveau ? Ou n'est-il qu'un de ces culturalistes attardés qu'accusait alors Yin Haiguang,
« de dissoudre les catégories kantiennes pour reconstruire les impératifs confucéens » et « de
chercher une porte de sortie pour la culture chinoise dans la philosophie hégélienne » ?
Au moins, il y a déjà une nouveauté : c'est la situation de la culture chinoise en 1973.
Alors que dans les années 20 à 40, avec Liang Shuming, Xiong Shili, Feng Youlan, le débat sur
la tradition chinoise était un débat d'actualité lourd d'enjeux socio-politiques, en 1973 tout donne
à penser que la partie est perdue et que le confucianisme n'appartient plus qu'au musée
universel des antiquités. En effet, en Chine continentale, c'est la Révolution culturelle ; quant
aux Chinois de Hong Kong, où Mou Zongsan s'est réfugié en 1949, ils semblent avoir de leur
plein gré abandonné leur tradition au profit d'une culture « coloniale » dont il a horreur.
Est nouveau aussi l'itinéraire dramatique d'un homme qui aura toujours vécu
douloureusement, comme nous le fait découvrir la remarquable biographie intellectuelle, longue
de 56 pages, que lui consacre Joël Thoraval. Après la `solitude affective' de son enfance, Il
entre à l'université, et là ce sera une plongée `largement solitaire' dans B. Russell, Whitehead et
le Wittgenstein du
Tractatus.
En 1932, cette solitude est illuminée par la rencontre avec le grand
Xiong Shili : c'est la découverte d'un confucianisme qui exige une adhésion quasi-religieuse et
que domine la figure de Wang Yangming (1472-1529). Suivent les errances du temps de guerre,
des essais d'engagement politique, finalement l'exil en 1949 et la chute libre dans la déchéance
physique et morale : « Il n'y a plus de réalité. Il n'y a plus rien. » Dans ce désarroi, Mou Zongsan
se lance à corps perdu dans l'aventure spéculative « Au sein de ma propre existence solitaire et

sèche, je ne saurais approcher cette vie que dans le domaine de l'abstraction.» Hegel, donc,
Kant surtout dont il traduira les trois « Critiques » et aussi les grandes écoles du bouddhisme
chinois : en tout cela, cet homme qui n'a jamais vécu hors de Chine tente « d'instituer entre
Chine et Occident un espace commun d'intercompréhension et d'évaluation » (p. 56). Il en sort
une oeuvre considérable, « abrupte et presque héroïque dans son déploiement solitaire », une
authentique réinvention du confucianisme pour les uns, mais pour certains, tels Fu Weixun, une
rhapsodie de méprises et sur la philosophie kantienne et sur la transmutation philosophique des
notions religieuses du bouddhisme.
Egalement nouveau, enfin, est l'attention soutenue portée au christianisme dans ces dix
conférences. Les prédécesseurs de Mou Zongsan avait bien perçu le rôle « philosophique »
joué par le christianisme en Europe, et une équivalence entre « aller à l'Eglise » en Occident et
« philosopher » en Chine, mais ils n'avaient pas juger utile de s'informer sur la Bible et encore
moins sur la théologie. Mou Zongsan, lui, monte au créneau, expliquant qu'à la différence des «
valeurs universelles » que sont la science et la démocratie, le christianisme constitue l'essence
même de l'Occident ; seule une Chine christianisée serait véritablement « occidentalisée. »
Citant les Evangiles et
La philosophie de la religion
de Hegel, Mou Zongsan insère donc une
intrigue théologique dans le discours confucéen. Ainsi, « le concept de Rédemption correspond
à la notion chinoise d'Eveil ou d'Illumination », mais en régime chrétien il n'est pas possible que
la nature divine « soit constitutive de notre propre subjectivité. » (p.105) Le christianisme ne peut
pas non plus « articuler une moralité éthique, mais seulement des notions morales purement
religieuses. » (p.144) Par ailleurs, « l'explication que Hegel donne de la notion de Trinité peut
être utilisée pour relire le développement de la pensée confucéenne. » Quant à l'idée de
Révélation divine, elle n'est pas « totalement absente » en Chine ; mais « elle n'a pas, comme
ce fut le cas dans le christianisme, évolué vers une doctrine établissant fermement la notion
d'Incarnation et de Fils unique de Dieu. » (p. 230)
Une fois tout cela dit, la question revient de plus belle : Mou Zongsan dit-il quelque
chose ? Et a-t-il quelque chose à dire à d'autres interlocuteurs que ses auditeurs chinois de
1973 ? Je pense que `oui', et c'est que tradition chinoise et tradition occidentale représentent
deux manières de gérer la relation transcendance/immanence. L'Occident pose Dieu comme
extériorité, un Dieu qui dicte des commandements sans dire comment ces derniers
correspondent à la nature foncière de l'homme. La Chine, elle, se concentre sur cette nature,
sur l'homme. Bref, si pour le chrétien il s'agit de faire la volonté de Dieu, avec l'aide de sa grâce,

le confucéen travaille à laisser s'épanouir sa nature foncière, et c'est au cours de cet effort de
sincérité totale qu'il s'ouvre à la transcendance du Mandat Céleste. Ainsi, « les Confucéens ne
prennent pas pour point de départ Dieu pour tenter d'expliquer ensuite d'expliquer ce qu'est la
volonté divine. Ils mettent plutôt l'accent sur la manière dont l'homme peut réaliser en soi la
volonté de Dieu ou de la Voie Céleste. » Bref, « ce confucianisme ne s'est pas coupé du Ciel
(...) Il a mis l'accent sur la façon dont on peut incorporer la Voie du Ciel à travers une prise de
conscience. » (pp. 223-224)
En 1973, Mou Zongsan n'était guère prêt à dialoguer même avec les plus ouverts des
théologiens chinois - ces Chinois « occidentalisés » par excellence, dont il voyait qu'ils
ignoraient tout de la tradition. Mais, de nos jours ses propos, comme ceux des autres penseurs
chinois non-marxistes du XX° siècle, sont susceptibles de toutes sortes de re-lecture, par les
intellectuels en cherche de sens et qui s'interrogent sur nos traditions respectives. Dans ce
nouveau contexte, le texte de Mou Zongsan semble aussi croiser des propos théologiques
comme ceux du cardinal Christoph Schönborn qui, interviewé sur les tensions parmi les
évêques de langue allemande, identifie deux positions, dont il se hâte de souligner qu'elles sont
complémentaires : « partons-nous de la présentation de la révélation chrétienne ou partons-
nous du cœur humain qui aspire à du sens - le sens de la vie. (...) et qui désire la venue de
Dieu ? »
(The Tablet,
17 avril, 2004) C'est là la question même de Mou Zongsan tout au long de
ses dix conférences. C'est aussi le débat lancé en Chine par les « chrétiens culturels » : la
tradition confucéenne, qui « part du cœur humain » sans clairement affirmer la transcendance,
est-elle à même de garantir le sens moral et les droits de la personne dans la société chinoise
d'aujourd'hui ?
Un grand merci aux deux traducteurs, Ivan Kamenarovié et Jean-Claude Pastor, pour
nous permettre d'entendre un grand penseur chinois parler aux siens de ces enjeux majeurs de
notre commune humanité. Certes, à se savoir une voix qui crie dans le désert, Mou Zongsan
peut irriter. Et cette voix est-elle encore celle de Wang Yangming ? Cette question aussi doit
être posée, mais tous ceux qui s'aventurent dans la rencontre des cultures et le dialogue
interreligieux auront beaucoup à apprendre au contact de cette voix impétueuse aux prises avec
l'altérité : la nôtre et la sienne.
1
/
3
100%