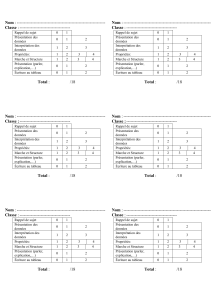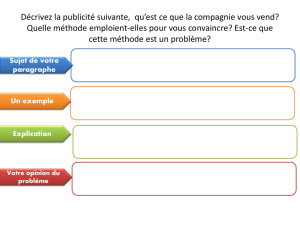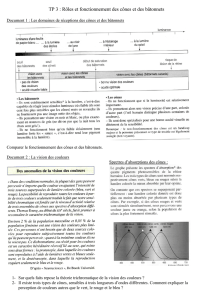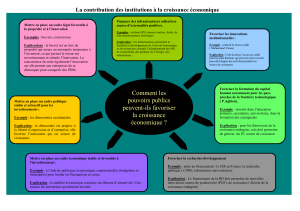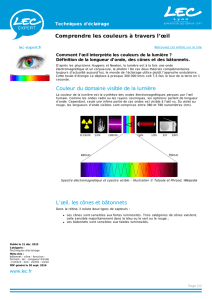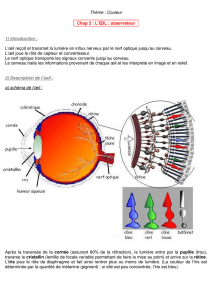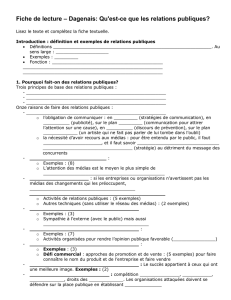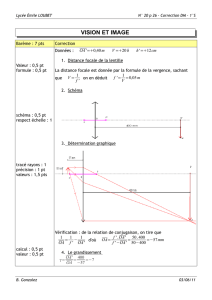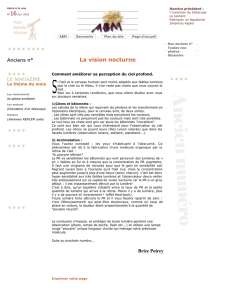pourquoi ne fait on pas de montres en caoutchouc

1
POURQUOI ON NE FAIT PAS DE MONTRES EN CAOUTCHOUC
Genres et limites de l’explication fonctionnelle
Philippe HUNEMAN
1
Que peut-on affirmer de la portée des explications fonctionnelles concernant les parties
d’un tout ? Autrement dit, est-ce qu’on peut de manière générale affirmer que les parties d’un
tout dont on a identifié la fonction ont elles-mêmes des fonctions ? Jusqu’à quel point le fait
que le tout ait les parties qu’il a relève d’une explication fonctionnelle ? Je distinguerai
d’abord plusieurs stratégies d’explication qui ont recours au discours fonctionnel. Ensuite,
j’examinerai selon chacune de ces stratégies le statut du rapport de la partie au tout, et la
portée des énoncés fonctionnels sur les parties. La distinction entre les stratégies explicatives
permettra de dissoudre certains malentendus concernant la portée de l’explication
fonctionnelle des parties d’un tout.
Le discours fonctionnel
En biologie et en technologie le terme de fonction intervient dans plusieurs contextes de
discours. J’en distinguerai trois : l’attribution fonctionnelle, la description fonctionnelle,
l’explication fonctionnelle.
1. Une attribution fonctionnelle est un énoncé de type
(P) « la fonction de X est Z »
Cet énoncé, s’il n’est pas isolé, peut être lui-même intégré dans les deux autres types de
discours fonctionnel.
2. La description fonctionnelle, représente une entité en identifiant ses composantes en
termes fonctionnels. On peut considérer que la description d’une voiture qui repérerait le
radiateur, les freins, le carburateur, le démarreur, etc., est une description fonctionnelle
implicite, car usant d’identifications en termes fonctionnels.
3. L’explication fonctionnelle, répond à des questions en des termes fonctionnels.
Elle se divise en deux stratégies générales.
(a). P répond à la question « pourquoi X est-il là ? »
(b). P répond à une question sur comment est ou opère une entité
identique à ou comprenant X. (b) se subdivise donc en :
(b1). P répond à « pourquoi S, qui comporte X, et est doté de parties yi,
peut-il opérer le processus V? »
(b2). P répond à « Pourquoi X est-il comme ça en lui-même ? »
Donnons un exemple. Selon (a), (p) : « la fonction des yeux est de voir » explique
pourquoi les vertébrés ont des yeux ;
selon (b1), l’énoncé (p) explique pourquoi les yeux sont dans la cavité oculaire, sont
connectés au cerveau par un nerf optique etc., et contribuent ainsi au processus général de
vision
selon (b2), (p) explique pourquoi les yeux des vertébrés sont composés d’une rétine
faite de photorécepteurs, d’un cristallin situé à telle distance de la rétine, etc
2
.
1
Rehseis, CNRS, UMR 7596, Paris. [email protected]
2
Achinstein 1977 développe une typologie des attributions fonctionnelles (use function ; design function ; service function).
Celle proposée ici est indépendante ; elle a le mérite de mieux distinguer les choses en ce qui concerne les classes de
contraste, et de correspondre facilement à des types d’investigation en biologie, même si la typologie d’Achinstein s’intègre
dans une théorie de l’explication plus sophistiquée.

2
Le principe de cette classification (évidemment un peu arbitraire) est : d’un côté une
question sur la raison de l’existence d’une entité, de l’autre une question sur sa configuration.
Mais j’aurais pu aussi bien ranger (a) avec (b1), parce que dans les deux cas P répond à
« pourquoi une entité générale S a-t-elle X ? », alors que dans (b2) la question est « pourquoi
X est-il comme il est ? ».
Bien qu’assez peu examinée dans la littérature, la stratégie (b2) a une place importante
dans la pratique scientifique car elle donne lieu à la démarche selon laquelle la connaissance
de la fonction permet d’élucider la structure auparavant méconnue de l’entité en question.
« La fonction de X est Z » permet, si l’on ne connaît pas X, d’inférer que X doit avoir telles et
telles capacités et dispositions, et finalement, vu le contexte où X doit se trouver, d’inférer
une gamme assez restreinte de structures possibles pour X. Ainsi, la découverte de l’ADN
exemplifie cette stratégie
3
: connaissant la fonction de cette structure, qui était de transmettre
héréditairement l’information, les chercheurs en ont déduit qu’elle devait être susceptible de
se dupliquer, ce qui les a conduit à chercher une configuration chimique spécifique propre à la
duplication. Le candidat était alors nécessairement une macromolécule avec une structure en
double hélice, et des considérations sur le type de système où cette macromolécule était
placée ont permis d’inférer que la molécule était l’acide désoxyribonucléique.
Les stratégies (a) et (b) se distinguent plus généralement par la classe de contraste
propre à chacune des questions. En (a), la question à laquelle répond (P) est : « Pourquoi X
est-il là plutôt que pas là ? » ; en (b), la question est : « pourquoi X est-il fait comme ça plutôt
qu’autrement ? » (et en (b1), on doit entendre « autrement intégré dans son système », tandis
qu’en (b2) il faut entendre « autrement constitué en lui-même »)
4
.
Cette distinction entre les deux stratégies implique une différence dans le cadre de
référence de l’explication, à savoir la classe d’états de fait qui ne sont pas à expliquer, c’est-à-
dire qui sont présupposés comme donnés et fixes. Posons l’ensemble des Xi qui pourraient
être à la place de X dans S, constitué d’un certain nombre de parties Yi dans un
environnement décrit par des variables Ci. La classe de contraste est une sous-classe de
l’ensemble des Xi, le cadre de référence est un sous-ensemble de la réunion des Ci et des Yi.
Dans la stratégie (a), ce cadre de référence est l’ensemble d’entités réelles ou possibles
par rapport auquel le fait de faire Z grâce à X apporte une différence (par exemple, des
individus dans une population). En effet, les systèmes qui ont X contrastent avec l’ensemble
de systèmes qui leur sont semblables sauf qu’ils n’ont pas cet X qui fait Z, et c’est alors
l’occurrence de X qu’il faut expliquer.
Dans la stratégie (b1), le cadre de référence est les autres éléments du système. La
question contraste la situation dans laquelle est réellement X avec des situations
contrefactuelles où X serait dans d’autres relations avec les mêmes ou d'autres éléments du
système : par là ce qui est présupposé fixe et n’est pas à expliquer, c’est bien cette
composition du système. Il faut noter qu’on pourrait poser cette même question relativement à
chacun des éléments supposés fixés (par exemple : pourquoi les nerfs optiques sont-ils comme
ils sont ?). Dans la stratégie (b2), dans la mesure où l’entité peut être considérée comme
appartenant à un système, comme dans le cas des yeux, le cadre de référence est, de même,
une sous-classe du cadre de référence de (b1), soit une partie du système lui-même. (p)
explique la structure interne des yeux dans la mesure où on présuppose un système qui
connecte les yeux, pour dire vite, à des inputs lumineux et à des sorties en termes
d’excitations neuronales.
Cette typologie des stratégies implique une conséquence assez générale sur leur
signification relative. Si on considère leurs classes de contraste et leur cadre de référence, en
gros la stratégie (a) connecte l’attribution fonctionnelle à une histoire (l’émergence de l’état
3
Enç 1979
4
Sur la classe de contraste, cf. Dretske (1971), « Contrastive empiricism », in Sober (1994)

3
pourvu de X par rapport à l’état sans X), la stratégie (b) à une structure. En ce sens, les deux
conceptions philosophiques dominantes de la fonction depuis une trentaine d’années – la
conception dite étiologique qui développe l’article fondateur de Wright (1973) et la
conception dite du rôle causal de Cummins (1975) - déploient chacune les engagements des
stratégies (a) et (b).
Dans la stratégie (a), le sens de P est rendu par la théorie étiologique (Wright 1973,
Millikan 1984) selon laquelle P veut dire « X est là parce qu’il fait Z ». En biologie, la
sélection naturelle justifie ce type d’explication : le fait de faire Z a donné aux porteurs de X
un avantage sélectif qui explique qu’ils aient survécu et se soient répandus etc
5
. Dans la
stratégie (b1), le sens de P est rendu par la théorie du rôle causal (Cummins 1975), car
l’attribution fonctionnelle P signifie l’identification du rôle causal que joue X dans un
système, ce qui entraîne sa place et son statut dans la structure générale dans laquelle il est
intégré. On pourra nommer stratégie étiologique la stratégie (a), stratégie systémique la
stratégie (b1), et stratégie systémique-interne la stratégie (b2).
Parties et traits fonctionnels
Pour les traits fonctionnels complexes, la question se pose de savoir si leur explication
fonctionnelle induit, concernant leurs parties, une attribution fonctionnelle et une
identification structurelle. En pratique cela revient souvent à s’interroger sur l’attribution de
fonctions à des parties d’un mécanisme. Par exemple : dans la stratégie (b2), l’énoncé (p) « la
fonction du cœur est de pomper le sang » explique pourquoi le cœur a deux ventricules,
pourquoi le myocarde etc. Mais (p) n’explique pas la matière des parois du coeur (il y a des
cœurs artificiels). Et qu’est-ce qui fait que la montre ordinaire ne peut pas être réalisée avec
des rouages en caoutchouc ? Est-ce que cela fait partie des nombreuses inférences autorisées
par l’attribution fonctionnelle sur la montre, ou bien cela relève-t-il d’une autre logique
explicative ?
Classiquement, on pose en effet que par principe une même fonction peut être réalisée
par un nombre indéfini de structures. Ainsi, de par sa fonction, une montre indique l’heure.
Une clepsydre, un cadran solaire, une montre à quartz, une montre ordinaire réalisent cette
fonction. Maintenant, si « indiquer l’heure » est multiréalisable, pourquoi ne peut-on pas faire
de montres en caoutchouc ? Qu’est-ce qui limite la multiréalisabilité – et si la fonction est par
définition multiréalisable est-ce que cette limite peut quand même relever de l’explication
fonctionnelle? Or Enç (1979) conteste cette multiréalisabilité-par-essence : l’attribution
fonctionnelle n’est explicative qu’à proposer des conditions d’identités sur les items qui les
réalisent. Dans cet esprit, j’aurai quelques réserves sur la thèse classique de multiréalisabilité
indéfinie, sur la base de ma typologie des stratégies d’explication fonctionnelle.
Le grain de l’attribution fonctionnelle et la consistance interne.
Une explication fonctionnelle d’un trait complexe correspond au schéma suivant :
Entité E (dans Système S)
Fonction X
| Mécanisme M
|
| Parties xi
| Structures Ni
5
Cet usage de la biologie évolutionniste est celui auquel recourent les théoriciens de la conception étiologique de la fonction
(Neander 1991; Godfrey-Smith 1994), et nous y renvoyons pour une considération plus détaillée. On trouvera une critique du
caractère suffisant de la sélection naturelle pour rendre compte de la valeur explicative des attributions fonctionnelles dans
Mc Laughlin (2003) et Lewens (2004) ; cf. aussi Mc Laughlin, ce volume.

4
| Dispositions Zi - (Fonctions Ti ?)
La question que je poursuis ici peut donc donner lieu aux questions suivantes dans le
schéma : Comment individualiser les xi et leurs fonctions? Est-ce que spécifier X spécifie
immédiatement les sous-fonctions Ti et les sous-structures Ni ?
Considérons ces questions dans les trois stratégies d’explication fonctionnelle et sur un
exemple.
Dans l’oeil caméra des vertébrés, la rétine est faite de cônes et de bâtonnets. Les cônes
sont de trois espèces, et leur regroupement fait qu’ils sont sensibles à la variation de couleur,
de sorte que leur ensemble détecte les couleurs ; on pense donc que leur fonction n’est pas de
détecter l’intensité lumineuse, tandis que les bâtonnets détectent les variations d’intensité
lumineuse mais n’ont pas la disposition chromosensible, de sorte que l’œil caméra entier
perçoit le visible (lumière et couleurs). Comment comprendre alors l’énoncé (q) « la fonction
des cônes de l’œil caméra est de distinguer les couleurs » ?
Dans la stratégie (b2), (q) répond à « Pourquoi l’oeil a-t-il des cônes ? ». L’énoncé (r)
sur la fonction du tout : « la fonction des yeux est de voir en couleur», est présupposé par (q).
La fonction des cônes dans l’œil, soit (q), découle de (r) comme présupposition étant donné
les bâtonnets de l’oeil comme cadre de référence : s’il y a des bâtonnets qui ont fonction de
détecter les variations de lumière, alors les cônes de l’oeil détecteront les couleurs. (Le même
argument vaut pour la fonction des bâtonnets : alors les cônes sont pris comme cadre de
référence.)
Maintenant, pour ce qui est de la stratégie (a), le rôle du cadre de référence est essentiel
aussi : (q) répond à « pourquoi l’œil a-t-il des cônes » car les cônes apporteraient un avantage
sélectif à des animaux qui seraient pourvus d’yeux avec des seuls bâtonnets, donc non
sensibles à la couleur. C’est pourquoi, puisque les cônes font la différence, ils auront une
fonction. (Certes, dans une explication évolutionniste authentique, on devrait s’assurer de
variants, d’espèces parentes, qui auraient existé sans les cônes ; ici il s’agit de confronter les
stratégies sur un même exemple, d’où l’aspect schématique.)
Ces considérations permettent de soutenir que la spécification des Ni et des Ti dépend
du grain de l’attribution fonctionnelle. En effet, la fonction des cônes était spécifiable parce
que l’attribution (p) spécifiait voir « en couleurs » ; voir tout court n’aurait pas été suffisant
pour le raisonnement. Développons cette remarque.
Le schéma suivant représente la réalisation d’une fonction par des structures possibles.
Type de dispositif M :
| Œil Caméra
Détecter > Voir (H) |
| Œil à facettes
Si on attribue une fonction à une entité E, cela implique des opérations possibles qui
exigent des dispositions à les réaliser de la part des structures concernées. Toute attribution
fonctionnelle implique ainsi des contraintes dispositionnelles, qui font que la
multiréalisabilité d’une fonction donnée n’est jamais infinie. Sur le schéma, il y a une
inclusion des fonctions. On voit tout de suite que plus le grain de la fonction est fin, plus les
contraintes dispositionnelles sont fortes : Détecter exige une structure corrélée aux
changements environnementaux, mais voir exige une structure corrélée aux variations de la
lumière, ce qui réduit les possibilités. La même chose vaut d’ailleurs pour les artefacts :
indiquer l’heure est faisable par un cadran solaire, des clepsydres, des montres, mais indiquer
l’heure à la seconde près est effectuable uniquement par une montre à aiguilles, ou une
montre à quartz.
Qu’en est-il alors en ce schéma de la fonction des parties ? Si on pose un cadre de
référence, alors la fonction du tout fournit une contrainte dispositionnelle sur les parties, ce

5
qui permet de leur assigner une gamme de structures possibles. Par exemple : si on stipule les
bâtonnets de l’œil, et que la fonction de l’œil est « voir en couleur », puisqu’ils ne peuvent
discriminer les couleurs, alors les autres parties constituantes – les cônes - doivent discriminer
la couleur, donc ils ont une fonction d’enregistrement de couleur, et doivent être faits d’une
matière chromosensible.
Ici, la matière des parties est partiellement prescrite par l’attribution fonctionnelle via
les contraintes dispositionnelles (mais ce sont les lois de la physique qui déterminent si telle
matière aura la disposition requise). Cela a pour conséquence que la multiréalisabilité n’est
pas essentielle à la fonction puisque l’attribution fonctionnelle permet jusqu’à un certain point
d’identifier des structures
6
. Ce qui signifie que les fonctions ne sont pas un raccourci
explicatif pour traiter d’entités qui seraient structurellement différentes mais identiques au
regard d’un de nos intérêts cognitifs. La spécificité épistémologique des explications
fonctionnelles ne dépend pas du caractère ontologiquement foisonnant des propriétés dans
notre monde.
Néanmoins, la dérivation des fonctions des parties à partir de la fonction du tout n’est
pas si directe que l’exemple le suggérait. Cela apparaît si l’on hiérarchise les attributions
fonctionnelles selon leur grain. Sur le schéma, on voit qu’en H il y a bifurcation non
fonctionnelle, car la même fonction est opérée par deux types de dispositif entre lesquels il
n’y a pas de différence fonctionnelle
7
.
Quelles sont les conséquences de cette bifurcation ? En stratégie (b2), l’assertion (p)
« la fonction de l’œil est de voir » répond à la question « pourquoi l’œil est comme ça en lui-
même ? ». A supposer que l’on soit dans le genre « œil à facettes », l’assertion (p) explique
qu’il y a dans cet oeil des parties transmettant une portion d’énergie lumineuse (lentilles), et
des parties disposant d’une sensibilité à un signal lumineux ; si maintenant on est dans le
genre œil caméra, l’assertion (p) implique un mécanisme avec des parties disposées à incliner
les rayons lumineux. (p) en elle-même ne précise pas les genres d’oeil, mais une fois qu’ils
sont posés, (p) entraîne des contraintes quant aux dispositions que doivent avoir les parties.
Les dispositions des parties ne sont donc pas expliquées par la fonction seule, mais par la
fonction ajoutée au choix du type d’œil, c’est-à-dire à une première spécification arbitraire du
genre de mécanisme : ainsi, dès que l’on a spécifié que l’on est dans une structure « caméra »,
(p) implique les dispositions de certaines parties, soit ici pour les unes la disposition à courber
les rayons lumineux corrélée à une disposition photosensible pour les autres (cellules de la
rétine)
8
.
J’appelle maintenant « consistance interne » un type de relation entre parties dont la
nature est fixée par la bifurcation et conditionne certaines contraintes structurales et
dispositionnelles
9
. Si on considère un système qui rentre dans un certain genre de mécanisme
défini par une option de la bifurcation H, alors sa structure sera soumise à certaines
contraintes au sens où, si on a une partie donnée, une partie corrélative ne pourra pas être
n’importe comment sous peine de voir la structure s’écrouler. Ce sont ces raisons de
consistance interne, découlant du genre de mécanisme M considéré sous la bifurcation H, qui
complètent l’attribution fonctionnelle d’une fonction générale à un tout, pour déterminer les
fonctions des parties. En biologie, la consistance interne correspond à l’idée de Bauplan
6
Si dans un monde possible une disposition est réalisable par une seule structure alors la fonction n’est pas multiréalisable ;
la multiréalisabilité est donc une propriété contingente des attributions fonctionnelles dans notre monde où beaucoup de
dispositions sont réalisables par plusieurs matières.
7
J’écarte ici la question de savoir si les mêmes gènes de développement soutiennent dans les deux cas, vertébrés et
arthropodes, l’évolution de l’oeil, comme le suggéreraient certaines découvertes récentes (cf. Gehring 1994), ce qui ne
change pas l’analyse présentée.
8
Ici, l’analyse vaut aussi pour la stratégie (b1), car il y a une équivalence entre l’explication (b2) de X sous un genre de M et
l’explication (b1) de xi (partie de X) dans X (considéré comme système) sous ce genre de M.
9
Sur ce point cf. Buller (2002)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%