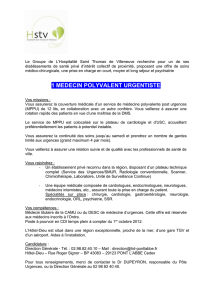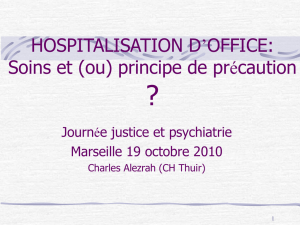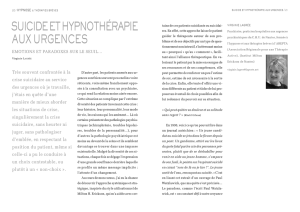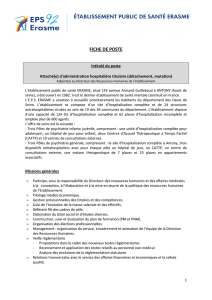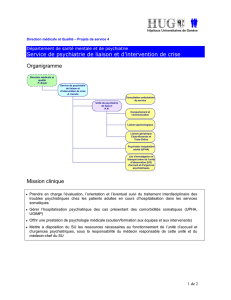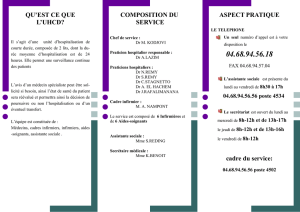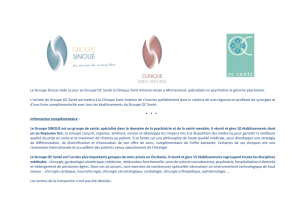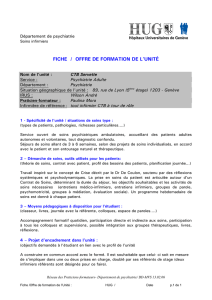Volet Santé Mentale du SROS III

Groupe de travail sur la prise en charge du suicide
Volet Santé Mentale du SROS III
Relevé de conclusions de la réunion du mardi 7 décembre 2004
CH de Pontivy
Etaient présents :
- Mme Aéby Hélène, DRASS de Bretagne
- Dr Bourgeat Philippe, CH Plouguernével, UMP de Pontivy
- Dr Briard David, CHU de Rennes, Service de Pédiatrie
- Dr Brunet Christine, DDASS d’Ille-et-Vilaine
- Dr Chanudet Christine, UMP du CHIC de Quimper
- M Coquelin Charles, Fondation Bon Sauveur Bégard
- Dr Cordier Jean-Claude, CH de Saint Malo
- Mme Daniel Monique, CH Plouguernével, UMP de Pontivy
- Dr Dejean Yasmina, CHU de Brest
- Dr Douchet Jean-Charles, CH St Jean de Dieu, UMP de Saint Brieuc
- Mme Galardon Sylvie, SOS Amitiés, Collectif JNPS 35
- Dr Gautier Jean-Yves, CH Charcot Caudan, UMP de Lorient
- M. Gueguen Alain, CH Plouguernével, UMP de Pontivy
- Dr Houdet Dominique, EPSM Saint Avé, UMP de Vannes
- Dr Houang Philippe, CH Charcot Caudan
- Mme Le Bechec Sylvie, DDASS des Côtes d’Armor
- Dr Le Clech Gildas,Clinique du Val Josselin
- Dr Mevel Alain, DDASS du Finistère
- Dr Marquis Françoise, DRASS de Bretagne
- Dr Petitjean François, DRASS de Bretagne
Etaient excusés :
- M. Doaudal Guy, Vie Espoir 2000
- Dr Tual Florence, DDASS du Morbihan
- Pr Walter Michel, Unité Anjela Duval, CHU de Brest

2
Ouverture de la réunion par les Docteurs Marquis et Petitjean
En ouverture de la réunion, sont rappelés les objectifs de cette rencontre.
L’objectif est l’élaboration du volet Santé Mentale du SROS III. Ce dernier a la particularité d’être
unique. Il se compose de différents volets dont un volet santé mentale qui inclut le suicide. Ce
travail s’inscrit dans la continuité du SROS santé mentale 2001 – 2005. Le Comité Régional de
Santé Mentale a relevé les points particuliers justifiant une réflexion spécifique (gérontopsychiatrie,
la prise en charge des adolescents et des enfants, le suivi des patients chroniques).
L’objectif de cette rencontre est d’aboutir à des propositions relatives à l’organisation des soins
dans le cadre du SROS pour le phénomène suicidaire. Deux questions devront être abordées pour
chaque aspect : d’une part, la validation des constats du premier SROS santé mentale et d’autre
part, l’élaboration de propositions en terme de principes et de recommandations.
Le groupe de travail a pour mission d’élaborer des recommandations d’ordre général qui seront
relayées dans les Conférences Sanitaires de Secteur (CSS) pour l’organisation spécifique de
chacun des sites dans le cadre des projets médicaux de territoire.
En ce qui concerne le calendrier, des modifications sont intervenues. En effet, désormais le SROS
III définitif devra être publié en mars 2006 au lieu de septembre 2005. Le temps supplémentaire
sera mis à profit pour échanger avec les CSS afin de décliner les recommandations au plan local.
Ces recommandations seront soumises au Comité Régional de Santé Mentale du 14 décembre
2004. Une nouvelle réunion du groupe pourra éventuellement être organisée au 1er trimestre 2005.
Déroulement de l’ordre du jour
Le groupe de travail prend pour support un document de synthèse présenté sous power-point.
1. La prise en charge en urgence à l’hôpital
Personnels
Le constat :
L’objectif (présence d’un infirmier spécialisé H24 + astreinte ou garde psychiatre H24 dans les
SAU, recours H24 à un psychiatre et présence d’un infirmier spécialisé dans les UPATOU) est
atteint dans les SAU mais pas dans les UPATOU.
En ce qui concerne les centres hospitaliers disposant d’un SAU, une astreinte de psychiatre ainsi
que la présence d’un infirmier spécialisé est mise en place dans l’ensemble des établissements
concernés. Une garde sur place de psychiatre est assurée à Brest et à Rennes.
Les propositions :
Pour les SAU :
Présence d’un infirmier spécialisé H24. L’astreinte de psychiatre suffit à répondre aux besoins. La
garde sur place dans les CHU se discute en fonction du volume de passage aux urgences.
Pour les UPATOU :
Une présence d’un infirmier le jour et une astreinte de nuit pouvant être mobilisée dans un délai
raisonnable, doublée d’une astreinte de psychiatre, est suffisante.

3
Conditions d’intervention
Le constat :
Au niveau des SAU, les lits d’Hospitalisation de Très Courte Durée (lits HTCD) accueillent les
patients admis après une tentative de suicide. Plusieurs modes d’organisation apparaissent en
Bretagne :
Dans les SAU :
- Quimper : dispose de lits dédiés à la psychiatrie parmi les lits d’HTCD. Cette modalité
d’organisation donne une certaine indépendance aux psychiatres par rapport aux urgentistes
et leur donne la possibilité de gérer la durée de séjour des patients. Les patients sont adressés
directement à l’équipe de psychiatrie en collaboration avec les somaticiens.
- Brest, Rennes, Lorient : l’accueil des suicidants se fait sans lits dédiés aux urgences.
L’hospitalisation est possible en HTCD mais la capacité (Brest, Rennes) semble insuffisante.
- Saint Malo, Vannes, Saint Brieuc : passage dans une HTCD généraliste permettant un bilan
somatique du patient, suivi ou non d’une admission en UMP, qui est une unité de transition
permettant une prise en charge de la crise suicidaire sur une durée moyenne de 5 jours.
Dans les UPATOU :
- Pontivy : un dispositif spécifique a été mis en place avec une prise en charge systématique des
patients par un infirmier psychiatrique avec un bilan général puis hospitalisation dans le service
de psychiatrie.
- Guingamp, Lannion, Paimpol : présence d’une antenne médico-psychologique (présence d’un
infirmier de jour 8h-21h et consultation dans un délai rapproché avec un psychiatre),
hospitalisation de 48h dans les services du CH et travail de psychiatrie de liaison.
Les propositions :
Le passage en HTCD apparaît comme un temps fondamental permettant la confrontation entre la
médecine et la psychiatrie. En effet, les arrivées aux urgences restent le point d’appui du dispositif
et la prise en charge des patients nécessite une collaboration entre les psychiatres, les
somaticiens et les urgentistes. Cet accueil indifférencié des suicidants en HTCD doit être préservé,
que les lits soient dédiés ou non à la psychiatrie au sein de l’Unité d’Hospitalisation de Courte
Durée (UHCD).
La psychiatrie de liaison permet également l’intervention de personnels spécialisés dans les
services de soins somatiques.
Un séjour de 48h est un maximum à l’UHCD, ce n’est pas tant la durée de séjour qui constitue une
garantie que le relais de la prise en charge en aval (Cf infra). Ce passage en UHCD permet
d’établir dans certains cas l’alliance thérapeutique avec le patient mais pas toujours. Il faut
rappeler l’intrication complexe du somatique et du psychique dans toutes les pathologies de
l’urgence.

4
2. La prise en charge en amont et en aval de l’hôpital
En amont
Le constat :
L’ offre pour un conseil ou un adressage rapide est insuffisante. Le généraliste en difficulté (face à
une crise suicidaire) doit pouvoir faire appel au CMP et à une équipe spécialisée. Une
sensibilisation des généralistes voire une formation au problème du suicide pourrait être mise en
place. Des modes d’organisation ont été expérimentés (plate forme téléphonique, accès à un
infirmier CMP).
Il n’existe pas de protocoles SAMU, les appels aux équipes se font à la demande.
Les propositions :
Se pose la question de l’implication des psychiatres libéraux dans le cadre des urgences gérées
par les CMP. Le relais possible auprès de ces professionnels serait de les impliquer dans les
CMP en leur demandant de mettre à disposition de la structure une partie de leur temps en contre
partie d’une rémunération. La difficulté est que les psychiatres libéraux estiment déjà répondre à
leurs propres urgences.
En ce qui concerne la régulation, au SAMU apparaît un problème important. La difficulté dans ce
domaine est le turn over des régulateurs ainsi que l’absence de formation adaptée. La solution
passerait par l’implication d’une personne expérimentée (urgentiste spécialisé) jouant le rôle
d’interface auprès des médecins régulateurs.
En aval
Le constat :
A l’hôpital , une large palette existe selon les lieux :
- Sur 3 sites existe une orientation possible en UMP ; le rôle de ces unités
intermédiaires est à préciser.
- L’unité Anjela Duval à Brest a un fonctionnement très spécifique quant au
recrutement et aux modalités de prise en charge.
- Des conventions avec des cliniques privées psychiatriques,
- Une hospitalisation dans les services des CH pour les UPATOU et la
psychiatrie de liaison,
- Un pavillon d’accueil intersectoriel en hôpital psychiatrique (exemple : PAIS
Lorient),
- Dans des services de soins de suite (SSR).
En ambulatoire : les délais de consultation sont longs tant en CMP qu’en psychiatrie libérale, le
relais avec les médecins généralistes n’est pas toujours formalisé. Quelques expériences ont été
mises en place : un CMP spécifique post urgence à Lorient, des consultations de retour aux
urgences, appels téléphoniques systématiques des patients…
Les propositions :
Sur les UMP :
La modalité d’une prise en charge en 2 temps de la crise suicidaire semble particulièrement
opérante pour les patients avec lesquels une alliance thérapeutique a pu être établie. C’est
pourquoi, l’UMP est un relais pertinent pour ces patients à la sortie de l’UHCD (l’UMP n’est pas
spécialisée pour les personnes suicidaires ou suicidantes).
Certains patients peuvent être orientés ensuite vers une hospitalisation en psychiatrie.

5
Autres formes d’hospitalisation :
Organiser une palette d’offre selon les lieux : conventions avec des cliniques privées, services
SSR, pavillon intersectoriel d’accueil « attractif », services de l’hôpital général avec psychiatrie de
liaison (travail entre les équipes ++).
Formaliser le plus possible le partenariat quelque soit l’offre.
En ambulatoire :
Pour certains patients, le relais peut être pris d’emblée en ambulatoire à condition que le rendez-
vous soit pris depuis l’UHCD et qu’il soit formalisé. En ce sens, l’expérience du CMP post
urgences à Lorient est particulièrement intéressante : moyennant une organisation particulière un
rendez-vous est possible le jour même ou le lendemain et permet une sortie rapide de l’UHCD. A
partir du CMP, s’organise le relais avec les médecins généralistes (réseau de médecins
généralistes « référents »).
Un lien doit exister entre le personnel prenant en charge le suicidant et son médecin traitant.
Les psychiatres libéraux pourraient assurer des consultations post urgences dans leur cabinet
pour le compte du CMP à condition qu’ils soient rémunérées. Un relais par des psychologues
serait possible si les psychothérapies prescrites médicalement étaient remboursées.
Il est proposé de relancer des essais de secrétariat pour coordonner l’offre ambulatoire et
hospitalière.
Une proposition de rappel téléphonique peut être faite aux suicidants : méthode à tester (voir
expérience du Nord Pas de Calais).
En conclusion, tout patient doit quitter le service des urgences avec une orientation effective et
formalisée (rendez-vous déjà pris pour le relais en ambulatoire par exemple).
3. La prise en charge de populations spécifiques
Enfants, adolescents
Le constat :
Des organisations variées : lits dédiés en pédiatrie, pédopsychiatrie de liaison, service de
pédopsychiatrie spécialisé par rapport à l’accueil des crises. L’offre de suivi en ambulatoire est
insuffisante.
Pour les adolescents, des lieux spécifiques ont été mis en place. A Rennes, par exemple, l’unité
pour adolescents de l’hôpital Sud assure l’interface entre médecine et psychiatrie. Elle assure un
rôle de premier filtre au delà duquel certains adolescents seulement seront adressés au service de
psychiatrie.
Les propositions :
Un lien avec le médecin traitant est là encore nécessaire puisque même si celui-ci n’est pas
considéré comme un interlocuteur privilégié par les adolescents eux-mêmes, la majorité d’entre
eux s’orienteront vers lui après leur hospitalisation.
Il est recommandé d’hospitaliser systématiquement toute tentative de suicide d’un adolescent en
pédiatrie. L’hospitalisation en pédiatrie nécessite une collaboration entre les pédopsychiatres et les
équipes pédiatriques. Dans certains cas, une hospitalisation de plus longue durée en psychiatrie
peut être décidée. Par conséquent, il apparaît nécessaire de développer des structures spécifiques
à l’accueil des adolescents dans le milieu psychiatrique (Vannes, Lorient, Rennes, Brest).
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%